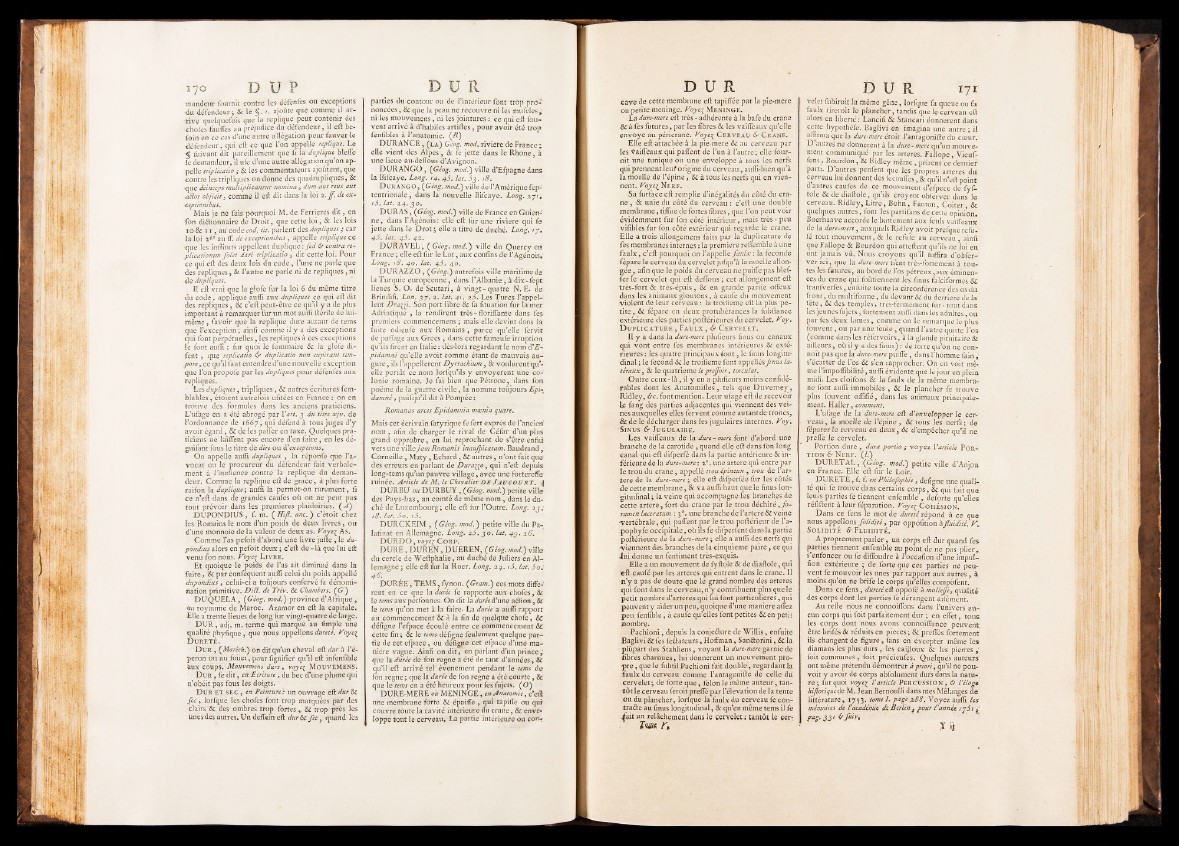
1 7 0 D U P
mandent fournît contre les défenfes ou exceptions
du défendeur; & le §. /. ajoûte que comme il arrive
quelquefois que la répliqué peut contenir des
choies fauffes au préjudice du défendeur, il eft besoin
en ce cas d’une autre allégation pour fauver le
défendeur , qui eft ce que l’on appelle réplique. Le
fuivant dit pareillement que fi la duplique blefle
le demandeur, il u(e d’une autre allégation qu’on appelle
triplicatio ; & les commentateurs ajoutent, que
contre les tripliques on donne des quadrupliques, &
•que deinceps multiplicantur nomina , dum aut reus aut
-aclor objicit} comme il eft dit dans la loi z. ff. deex-
•ceptionïbus.
Mais je ne fais pourquoi M. de Ferneres dit, en
ion dictionnaire de Droit, que cette lo i, & les lois
10 8c i r , au code eod. tit. parlent des dupliques ; car
la loi l de au IF. de exceptionibus, appelle triplique ce
que les inftituts appellent duplique : fed & contra re-
plicationem folet dari triplicatio , dit cette loi. Pour
ce qui eft des deux lois du code, l’une ne parle que
des répliqués, & l’autre ne parle ni de répliqués, ni
de dupliques.
11 eft vrai que la glofe fur la loi 6 du même titre
•du code, applique aufli aux dupliqués ce qui eft dit
des répliqués, & c’eft peut-être ce qu’il y a de plus
important à remarquer fur un mot aufli ftériie de lui-
même, favoir que la répliqué dure autant de tems
que l’exception ; ainfi comme il y a des exceptions
qui font perpétuelles, les répliqués à ces exceptions
le font aufli : fur quoi le fommaire 8c la glofe di-
fent , que replicatio & duplicatio non expirant tempore,
ce qu’il faut entendre d’une nouvelle exception
que l’on propofe par les dupliques pour défenfes aux
répliqués.
' Les dupliques, tripliques, 8c autres écritures fem-
biables, étoient autrefois ufitées en France : on en
trouve des formules dans les anciens praticiens.
L’ufage en a été abrogé par Y art. 3 du titre xjv. de
l’ordonnance de 1667, qui défend à tous juges d’y
avoir égard, 8c de les paffer en taxe. Quelques praticiens
ne laiffent pas encore d’en faire, en les dé-
guifant fous le titre de dire ou d’exceptions.
On appelle aufli dupliques , l a . réponfe que l’a-
voeat ou le procureur du défendeur fait verbalement
à 1 audience contre la répliqué du demandeur.
Comme la répliqué eft de grâce, à plus forte
raifon la duplique ; aum la permet-on rarement, fi
ce n’eft dans de grandes eaufes oh on ne peut pas
tout prévoir dans les premières plaidoiries. (A )
DUPONDIUS, f. m. ( Hiß. anc. ) c’étoit chez
les Romains le nom d’un poids de deux livres, ou
d’une monnoie de la valeur de deux as. Voye{ As.
■ Comme l’as pefoit d’abord une livre jufte , le du-
pôndius alors en pefoit deux ; c’eft de - là que lui eft
venu fon nom. Voyeç L iv r e .
Et quoique le poids de l’as ait diminué dans la
fuite, 8c par conféquent aufli celui du poids appelté
dupondius, celui-ci a toujours confervé fa dénomination
primitive. Dict. de Trév. 8c Chambers. {G )
DUQUEL A , {Géog. mod.') province d’Afrique ,
au royaume de Maroc. Azamor en eft la capitale.
Elle a trente lieues de long fur vingt-quatre de large.
D U R , adj. m. terme qui marque au fimple une
qualité phyfique, que nous appelions dureté. Voyeç
D u r e t é .
D ur , {Maréck.)on dit q u ’un c h ev al eft dur à l’ép
e ro n o u a u fo u e t, p o u r fignifier qu ’il eft infenfible
a u x co u p s. Mouvemens durs , voye^ MOUVEMENS.
D ur , fe dit, en Ecriture, du bec d’une plume qui
n’obéit pas fous les doigts.
D u r e t s e ç , en Peinture : un ouvrage eft dur 8c
fed, lorfquè. les ehofes font trop marquées par des
clairs. & des ombres trop fortes,. 8c trop près les
unesdés autres. Un deffein eft dur 8c fec, quand les
D U R
parties du contour ou de l’intérieur font trop pro*
noncées, 8c que la peau ne recouvre ni les mufcles,’
ni les mouvemens, ni les jointures : ce qui eft fou-
vent arrivé à d’habiles artiftes, pour avoir été trop
fenfibles à l ’anatomie. (R)
DURANCE, ( l a ) Géog. mod. riviêfe de France ;
elle vient des Alpes, & fe jette dans le Rhône, à
une lieue au-deffous d’Avignon.
DURANGO, {Géog. mod.) ville d’Efpagne dans
la Bifcaye. Long. 14. 46. lat. 63. 18.
D urango , {Géog. mod.') ville de l’Amérique fep-’
tentrionale, dans la nouvelle Bifcaye. Long, 2J1I
■ iS. lat. 2.4. 3O-.
DURAS, {Géog. mod.) ville de France en Guien-
ne, dans l’Agénois : elle eft fur une riviere qui fe
jette dans le Drot ; elle a titre de duché. Long. /y.
4S. lat. 46. 42.
DURAVEL, {Géog. mod.) ville du Quercy eiî
France ; elle eft fur le Lot, aux confins de l’Agénois..'
Long. 18. 40. lat. 45. 40.
D U R A ZZO , {Géog.) autrefois ville maritime de
la Turquie européenne, dans l’Albanie, à dix-fept
lieues S. O. deScutari, à vingt-quatre N. E. de
Brindifi. Lon. 37 . 2. lat. 41. 26. Les Turcs l’appellent
Dra^i. Son port libre 8c fa fituation fur la mer
Adriatique , la rendirent très - floriflante dans fes
premiers commencemens ; mais elle devint dans la
fuite odieufe aux Romains, parce qu’elle fervit
de paflage aux Grecs , dans cette fàmeufe irruption
qu’ils firent en Italie : dès-lors regardant le nom à’E-
pidarnné qu’elle avoit comme étant de mauvais augure,
ils l’appellerent Dyrrachium, 8c voulurent qu’elle
portât ce nom forfqu’ils y envoyèrent une colonie
romaine. Je fai bien que Pétrone, dans fon
poëme de la guerre civile, la nomme toujours £pi*
damné , puifqu’il dit à Pompée :
Romanas arces Epidamnia moema quatre.
Mais cet écrivain fatyrique fe fert exprès de I’ancicri
nom, afin, de charger le rival de Céfar d’un plus
grand opprobre, en lui reprochant de s’être enfui
vers une ville jam Romanis inaufpicatam. Baudrand ,
Corneille, Maty, Echard, 8c autres, n’ont fait que
des erreurs en parlant de Dura^o, qui n’eft depuis
long-tems qu’un pauvre village, avec une fortereffe
ruinée. Article de M. le Chevalier d e Ja v c o v r t . j|
DURBU ou DURBUY, {Géog. mod.) petite ville
des Pays-bas, au comté de même nom, dans le duché
de Luxembourg ; elle eft fur l’Outre. Long. 23 »
,8. lat. So. /f* '.
DURCKEIM , {Géog. mod.) petite ville du Palatin
a t en Allemagne. Long. 26. 30. lat. 43. zC.
DU RDO, voyeç Corp.
D U R E, DUREN, DUEREN, ÇGéog. mod.) ville
du cercle de Weftphalie, au duché de Juliers en Allemagne
; elle eft fur la Roer. Long. 24. i3. lat. So,
a— i ■
DURÉE, TEMS, fynon. {Gram.) ce s mots different
en ce que la durée fe rapporte aux ehofes, 8c
le tems aux perfonnes. On dit la durée d’une aétion, 8r
le tems qu’on met à la faire. La durée a aufli rapport
au commencement 8c à la fin de quelque ehofe, &
défigne Fefpace écoulé entre ce commencement 8c
cette fin; 8c le tems défigne feulement quelque partie
de cet efpace, ou defigpe cet efpace d’une manière
vague. Ainfi on dit, en parlant d’iin prince,’
que la durée de fon régné a été de tant d’années, 8c
qu’il eft arrivé tel événement pendant le tems de
fon régné ; que In durée dé fon régné a été-courte, 8c
que le tems en a été heureux pour fes fujets. {O)
DURE-MERE ou MENINGE, en Anatomie, c’eft
une membrane forte 8c épaiffe , qui tâpiffe ou qui
couvre toute la cavité intérieure du crâne, 8c enveloppe
tout le cerveau. La partie intérieure ou con-
D U R
c a v e de c e tte m em bran e eft tap ifîee p a r la pie-m ere
o u p etite m én ing é. V?yei M é n in g é .
La dure-mere eft tirés - adhérente à la bafe du crâne
& à fes futures, par les fibres 8c les vaifleaux qu’elle
envoyé au péricrane. Voye[ C e r v e a u & C r â n e .
Elle eft attachée à la pie-mere 8c au cerveau par
les Vaifleaux qui paflent de l’un à l’autre ; elle fournit
une tunique ou une enveloppe à tous les nerfs
qui prennent leuf origine du cerveau, aufli-bien qu’à
la moelle de l’épine, 8c à tous les nerfs qui en viennent.
Voyei N e r f .
Sa furface eft remplie d’inégalités du côté du crân
e , 8c unie du côté du cerveau : c’eft une double
membrane, tiffue de fortes fibres, que l ’on peut voir
évidemment fur fon côté intérieur, mais très - peu
vifibles fur fon côté extérieur qui regarde le crâne.
Elle a trois allongemens faits par la duplicature de
fes membranes internes : la première reflemble à une
faulx, c’eft pourquoi on l’appelle faulx : la fécondé
fépare le cerveau du cervelet jufqu’à la moelle allongée
, afin que le poids du cerveau ne puiffe pas bief-
fer le cervelet qui eft defious'; cet allongement eft
très-fort 8c très-épais, 8c en grande partie ofleux
dans les animaux gloutons, à caufe du mouvement
violent de leur cerveau : la troifieme eft la plus petite
, 8c fépare en deux protubérances la fubftance
extérieure des- parties poftérieures du cervelet. Voy.
D u p l ic a t u r e , F a u l x , & C e r v e l e t .
Il y a dans la dure-mere plufieurs finus ou canaux
qui vont entre fes membranes intérieures & extérieures
: les quatre principaux font, le finus longitudinal
; le fécond 8c le troifieme font appellés finus latéraux
, & le quatrième le preffoir, torcular.
Outre ceux - là , il y en a plufieurs moins confidé-
rables dont les Anatomiftes, tels que Duverney,
Ridléy, &c. font mention. Leur ufage eft de recevoir
le fang des parties adjacentes qui viennent des veines
auxquelles elles fervent comme autant de troncs,
& de le décharger dans les jugulaires internes. Voy.
■ Sin u s & J u g u l a ir e .
Les vaifleaux de la dure - mere font d’abord une
branche de la carotide , quand elle eft dans fon long
canal qui eft difperfé dans la partie antérieure 8c inférieure
de la dure-mere : z°. une àrtere qui entre par
le trou du crâne, appefté trou épineux , trou de l’ar-
îere de la dure-mere ; elle eft difperfée fur les côtés
de cette membrane, & va aufli haut que le finus longitudinal
; la veine qui accompagne les branches de
cette artere, fort du crâne par le trou déchiré, foramen
laceratum : 30. une branche de l’artere 8c veine
•vertébrale, qui paflent par le trou poftérieur de l’a-
-pophyfe occipitale, oh ils fe difperfent dans la partie
poftérieure de la dure-mere ; elle a aufli des nerfs qui
•viennent des branches de la cinquième paire, ce qui
lu i donne un fentiment très-exquis.
Elle a un mouvement de fy ftole 8c de diâftole, qui
•eft caufé par les arteres qui entrent dans le crâne. Il
n’y a pas de doute que le grand nombre des arteres
qui font dans le cerveau, n’y contribuent plus que le
petit nombre d’arteres qui lui font particulières, qui
peuvent y aider un peu, quoique d’une maniéré affez
peu fenfible, à caufe qu’elles font petites 8c en petit
nombre.
Pachioni, depuis la conjeélure de Willis, enfuite
Baglivi 8c fes feûateurs, Hoffman, Sanâorini, 8c la
plupart des Stahliens, voyant la dure-mere garnie de
•fibres charnues, lui donnèrent un mouvement propre
, que le fubtil Pachioni fait double, regardant la
faulx du cerveau comme I’antagonifte de celle du
cervelet ; de forte que, félon le même auteur, tantôt
le cerveau feroit prefle par l’élévation de la tente
ou du plancher , lorfque la faulx du cerveau fe contraire
au finus longitudinal, 8c qu’en même tems il-fe fait un relâchement dans le cervelet ; tantôt le cerï<<
m r ,
D U R 1 7 1
velet fubiroit la même gêne, lorfque fa queue ou fa
faulx tireroit le plancher, tandis que le cerveau eft
alors en liberté : Lancifi 8c Stancari donnèrent dans
cette hypothèfe. Baglivi en imagina une autre ; il
affirma que la dure-mere étoit l’antagonifte du coeur.
D autres ne donnèrent à la dure-m.ere qu’un mouvement
communiqué par les arteres. Fallope, Vieuf-
fens, Bourdon, 8c Ridley même, prirent ce dernier
parti. D autres penfent que les propres arteres du
cerveau lui donnent des fecoufles, 8c qu’il n’eft point
d’autres eaufes de.ee mouvement d’efpece de fyf-
t°le 8c de diâftole, qu’ils croyent obferver dans le
cerveau. Ridley, Litre, Bohn, Fanton, Coiter , 8c
quelques autres, font les partifans de cette opinion.
Boerhaave accorde le battement aux feuls vaifleaux
de la dure-mere, auxquels Ridley avoit prefque refu-
fé tout mouvement, 8c le refulè au cerveau, ainfi
que Fallope 8c Bourdon qui atteftent qu’ils ne lui en
ont jamais vû. Nous croyons qu’il fuffira d’obfer-
ver ic i, que la dure-mere tient très-fortement à toutes
les futures, au bord de l’os pétreux, aux éminences
du crâne qui foûtiennent les finus falciformes 8c
tranfverfes, enfuite toute la circonférence des os dit
front , du multiforme, du devant 8c du derrière de la
tete, 8c des temples, très-fermement fur - tout dans
les jeunes fujets, fortement aufli dans.les adultes, ou
par fes deux lames, comme on le remarque le plus
fouvent, ou par une feule, quand l’autre quitte l ’os
(comme dans les réfervoirs, à la glande pituitaire 8c
ailleurs, oh il y a de£ finus) : de forte qu’on ne çon-
noît pas que la dure-mere puifle , dans l'homme fain ,
S’écarter de l’os 8c s’en rapprocher. On en voit même
l’impoflibilité, aufli évidente que le jour en plein
midi. Les cloifôns 8c la faülx de la même membrane
font aufli immobiles , 8c le plancher fe trouve
plus fouvent oflifié, dans les animaux principale-'
ment. Haller, comment.
L’ufage de la dure-mere eft d’enveloppet le cerveau,
la moelle de l’épine , 8c tous les nerfs ; de
féparer le cerveau en deux, 6c d’empêcher qu’il ne
prefle le cervelet.
Portion dure , dura portio ; voyez Y article Port
io n & N e r f . {L)
DURETAL, {Géog. mod.) petite ville d’Anjou
en France. Elle eft fur le Loir.
' DURETÉ, f. f. en Philofophie , defigne une qualité
qui fe trouve dans certains corps, 8c qui fait que
leurs parties fe tiennent enfemble , deforte qu’elles
réfiftent à leur féparation. Voye^ C ohésion.
Dans ce fens le mot de dureté répond à ce que
nous appelions folidit-é, par oppofition à fluidité. V,
So lidité & Flu id ité,
A proprement parler, un corps eft dur quand fes
parties tiennent enfemble au point de ne pas plier,,
s’enfoncer ou fe diffoudre à l’occafion d’une impul-
fion extérieure ; de forte que ces parties ne peuvent
fe mouvoir les unes par rapport aux autres, à
moins qu’on ne brife le corps qu’elles compéfent.
Dans ce fens, dureté eft oppofé à mollejje, qualité
des corps dont les parties fe dérangent ahément.
Au refte nous ne connoiflons dans l’univers aucun
corps qui foit parfaitement dur ; en effet, tous
les corps dont nous avons connoiflance peuvent,
être brifés 8c réduits en pièces ; 8c preflës fortement
ils changent de figure, fans en excepter même les
diamans les plus durs , les .caijloux 8c les pierres *
foit communes , foit précieufes. Quelques auteurs
ont même prétendu démontrer à priori, qu’il ne pou-
voit y avoir de corps abfolument durs dans la nature
; fur quoi voye^ l ’article PERCUSSION , & l ’éloge
hijloriquede M. Jean Bernoulli dans mes Mélanges de
littérature ,-17^3. tomel. page 288. 'Voyez aufli les
mémoires de l’académie, de. Berlin 9 pour l ’année r jô i ^
pa§‘ 3 3 1 m SD
. y *