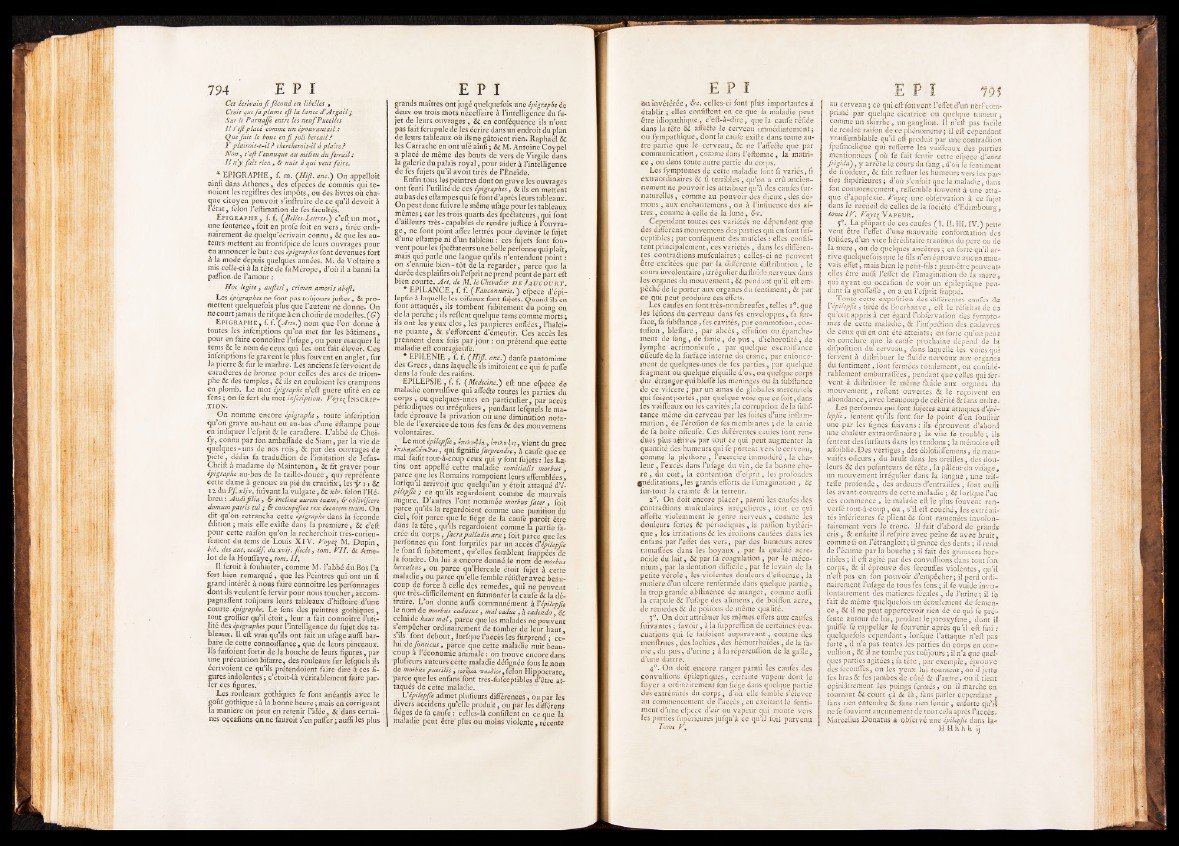
Cet écrivain f i fécond en libelles ,
Croit que fa plume efi la lance £ Argali;
Sur le Parnajfe entre les neuf Pucelles
I l s’efi placé comme un épouvantail .*
Que fait le bouc en f i jo li bercail ?
Y plairoit-t-il ? chercheroit-il à plaire?
Non, c’eß Veunuque au milieu du ferrdil:
I l n'y fait rien , & nuit à qui veut faire.
* EPIGRAPHE, f. m. (Hift. anc.) On appelloit
ainfi dans Athènes, des efpeces de commis qui te-
noient les regiflres des impôts, ou des livres oh chaque
citoyen pou voit s’inflruire de ce qu’il de voit à
1 état, félon l’eflimation de fes facultés. Epigraphe, f .f . (Belles-Lettres.) c’eflun mot,
une fentence, foit en profe foit en vers, tirée ordk
nairement de quelqu’écrivain connu, & que les auteurs
mettent au frontifpice de leurs ouvrages pour
en annoncer le but : ces épigraphes font devenues fort
à la mode depuis quelques années. M. de Voltaire a
mis celle-ci à la tête de faMérope, d’oh il a banni la
paffion de l’amour :
Hoc legite , außen , crimen amoris abefi.
Les épigraphes ne font pas toûjours jufles, & promettent
quelquefois plus que l’auteur ne donne. On
ne court jamais de rifque à en choifir de modeftes. (G) Epigraphe, f .f . (Arts.) nom que l’on donne à
toutes les infcriptions qu’on met fur les bâtimens,
pour en faire connoître l’ufage, ou pour marquer le
tems & le nom de ceux qui les ont fait élever. Ces
infcriptions fe gravent le plus fouvent en anglet, fur
la pierre & fur le marbre. Les anciens fe fèrvoient de
caraéleres de bronze pour celles des arcs de triomphe
& des temples, & ils en couloient les crampons
en plomb. Le mot épigraphe n’efl guere üfité en ce
fens ; on fe fert du mot infcrlption. Voye^ Inscript
io n .
On nomme encore épigraphe , toute infcription
qu’on grave au-haut ou au-bas d’une éflampe pour
en indiquer l ’efprit & le cara&ere. L’abbé de Choi-
fy , connu par fon ambaflade de Siam, par la vie de
quelques - uns de nos rois, & par des ouvrages de
piété, dédia fa tradiiâiort de l’imitation de Jefus-
Chrift à madame de Maintenon, & fit graver pour
épigraphe au-bas de la taille-douce, qui repréfente
cette dame à genoux au pié du crucifix -, les ÿ 11 &
1 2 du Pf. xljv. fuivant la vulgate, & xlv. félon l’Hébreu
: Audi filia , & inclina aurem tuam, & oblivifcere
domum patris tui ; & concupifcet rex decorem tuum. On
dit qu’on retrancha cette épigraphe dans la fécondé
édition ; mais elle exifle dans la première, & e’efl
pour cette raifon qu’on la recherchoit très-curieu-
fement du tems de Louis X IV . Voyei M. Dupin,
bib. des aut. eccléf. du xvij. ficelé , tom. VII. & Ame-
lot de la Houffaye, tom. II.
Il feroit à fouhaiter, comme M. l’abbé du Bos l’a
fort bien remarqué, que les Peintres qui ont un fi
grand intérêt à nous faire connoître les perfonnages
dont ils Veulent fe fervir pour nous toucher , accom-
pagnaffent toûjours leurs tableaux d’hiftoire d’une
courte épigraphe. Le fens des peintres gothiques,
tout groflier qu’il étoit, leur a fait connoître l’utilité
des épigraphes pour l’intelligence du fujet des tableaux.
Il efi: vrai, qu’ils ont fait un ufage aufli barbare
de cette connoiflance., que de leurs pinceaux.
Ils faifoient fortir de la bouche de leurs figures, par
une précaution bifarre, des rouleaux fur lefquels ils
ecrivoient ce qu’ils prétendoient faire dire à ces figures
indolentes ; c’étoit-là véritablement faire parler
ces figures.
Les rouleaux gothiques fe font anéantis avec le
goût gothique : à la bonne heure ; mais eh corrigeant
la maniéré on peut en retenir l’idée, & dans certaines
oçcafions on ne fauroit s’en palier; aufli les plus
grands maîtres ont jugé quelquefois une épigraphe de
deux ou trois mots néceffaire à l’intelligence du fujet
de leurs ouvrages , & en conféquence ils n’ont
pas fait fcrupule de les écrire dans un endroit du plan
de leurs tableaux oh ils ne gâtoient rien. Raphaël &
les Carrache en ont ufé ainfi; & M. Antoine Coypel
a placé de même des bouts de vers de Virgile dans
la galerie du palais royal, pour aider à l’intelligence
de fes fujets qu’il avoit tires de l’Éneïde.
Enfin tous les peintres dont on grave les ouvrages
ont fenti l’utilité de ces épigraphes, &ils en mettent
au bas des eflampes qui fe font d’après leurs tableaux.
On peut donc fuivre le même ufage pour les tableaux
mêmes ; car les trois quarts des fpeftateurs, qui font
d’ailleurs très-capables de rendre juftice à l’ouvrage
, ne font point affez lettrés pour deviner le fujet
d’une eftampe ni d’un tableau : ces fujets font fou-
vent pour les fpeâateurs une belle perfonne qui plaît,
mais qui parle une langue qu’ils n’entendent point :
on s’ennuie bien - tôt de la regarder, parce que la
durée des plaifirs oh l’efprit ne prend point de part efi:
bien courte. Art. de M. leChevalier D e Ja u c o u r t .
* EPILANCË, f. f. ( Fauconnerie. ) efpece d’épi-
lepfie à laquelle les oifeaux font fujets. Quand ils eh
font attaqués, ils tombent fubitement du poing ou
de la perche ; ils relient quelque tems comme morts ;
ils ont les yeux clos, les paupières enflées, l’halei-
ne puante, & s’efforcent d’émeutir. Ces accès les
prennent deux fois par jour : on prétend que cette
maladie efi contagieufe.
. * EPILENIE , f. f. (Hiß. anc.') dänfe pantomime
des Grecs, dans laquelle ils imitoient ce qui fe paffe
dans la foule des raifins.
EPILEPSIE , f. f. (Medecine.) efi une efpece de
maladie convulfive qui affeéle toutes les parties du
corps , ou quelques-unes en particulier, par accès
périodiques ou irréguliers, pendant lefquels le malade
éprouve la privation ou une diminution notable
de l’exercice de tous fes fens & des mouvemens
volontaires.
5 Le mot epilepfie , tTr/Xn-^ia,, f vient du grec
ï7ri\a.fi€ctvtd-ai} qui fignifie furprendre, à càufe que ce
mal faifit tout-à-coup ceux qui y font fujets : les La^
tins ont appellé cette maladie comitiàlis morbus ,
parce, que les Romains rompoient leurs affemblées,
lorfqu’il arrivoit que quelqu’un y étoit attaqué dV-
pilepfie ; ce qu’ils regardoient comme de mauvais
augure. D ’autres l’ont nommée morbus facer , foit
parce qu’ils la regardoient comme une punition du
ciel ,■ foit^parce que le fiége de la càufe paroît être
dans la tête, qu’ils regardoient comme la partie fa-
cree du corps, facrapalladis arx ; foit parce que les
perfonnes qui font furprifes par un accès d'épilepfie
le font fi fubitement, qu’elles femblent frappées de
la foudre. On lui a encore donné ie nom de morbus
herculeus, ou parce qu’Hercule étoit fujet à cette
maladie , ou parce qu’elle femble réfifler avec beaucoup
de force à celle des remedes, qui ne peuvent
que tres-difficilement eh furmonter la caufe & la détruire.
L’on donné aufli communément à Vépïlepfie
le nom de morbüs caducus , mal caduc, à cadendo, &
celui de haut mal, parce que les malades ne peuvent
s’empêcher ordinairement de tomber de leur haut
s’ils font debout, lorfque l’accès les furprend ; ce-
lui defonticus, parce que cette maladie nuit beaucoup
à l’économie animale : on trouve encore dans
plufieurs auteurs cette maladie défignée fous le nom
de morbus puérilis , vo^n/ia. tfeuViov 9 félon Hippocrate,
parce que les enfans font très-fufceptibles d’être attaqués
de cette maladie..
L'epilepfie admet plufieurs différences, ou par les
divers accidens qu’elle produit, ou par les differens
fieges de fa caufe : celles-là confiflent en ce que la
maladie peut être" plus ou moins*violente, récente
feu invétérée, &c. celles-ci font plus importantes à
établir ; elles confiflent en ce que la maladie peut
être idiopathique, c’efl-à-dire, que la caufe refide
dans la tête & affeéte le cerveau immédiatement ;
ou fympathique, dont la caufe exifle dans toute autre
partie que le cerveau, & ne l’affeélê que pal-
communication , comme dans I’eflomac, la matrice
, ou dans toute autre partie du corps.
Les fymptomes de cette maladie font fi variés, fi
extraordinaires & fi terribles , qu’on a crû anciennement
ne pouvoir les attribuer qu’à des caufes fur-
naturelles , comme au pouvoir des dieux, des démons
, aux enchantemens, ou à l’influence des af-
tres, comme à celle de la lune, &c.
Cependant toutes ces variétés ne dépendent que
des différens mouvemens des parties qui en fontfuf-
ceptibles ; par conféquent des mufcles : elles confif-
tent principalement, ces variétés dans les différentes
contractions mufculaires ; celles-ci ne peuvent
être excitées que par la différente diflribiition , le
cours involontaire, irrégulier du fluide nerveux dans
les organes du mouvement, & pendant qu’il efi empêché
de fe porter aux organes du fentiment, & par
ce qui peut produire ces effets.
Les caufes en font très-nombreufes, telles i° . que
les"léfions du cerveau dans fes enveloppes, fa fur-
face, fa fubflance , fes cavités, par commotion, con*
tufion , bleffure, par abcès, effufion ou épanchement
de fang, de fanie, de pus , d’ichorofité , de
lymphe acrimonieufe , par quelque excroiffance
offeufe de la furface interne du crâne, par enfoncement
de quelques-unes de fes parties, par quelque
fragment ou quelque efquille d’o s , ou quelque corps
dur étranger qui blefle les méningés ou la fubflance
de ce vifeere ; par un amas de globules mercuriels
qui foient portés, par quelque voie que ce foit, dans
fes vaiffeaux ou fes cavités ; la corruption de la fubf-
tance même du cerveau par les fuites d’une inflammation
, de l’érofion de fes membranes ; de la carie
de fa boîte offeufe. Ces différentes caufes font rendues
plus aftives par tout ce qui peut augmenter la
quantité des humeurs qui fe portent vers le cerveau,
comme la pléthore , l’exercice immodéré , la chaleur
, l’excès dans l’ufage du vin, de la bonne chère
, du coït, la contention d’efprit, les profondes
0néditations, les grands efforts de l’imagination , &
fur-tout la crainte & la terreur.
2°. On doit encore placer , parmi les caufes des
contractions mufculaires irrégulières, tout ce qui
affeCte violemment le genre nerveux , comme les
douleurs fortes & périodiques, la paffion hystérique
, les irritations & les érofions caui'ées dans les
enfans par l’effet des vers, par des humeurs acres
ramaffées dans les boyaux , par la qualité acre-
acide du la it , & par fa coagulation , par le méconium
, par la dentition difficile, par le levain de la
petite vérole , les violentes douleurs d’eflomac, la
matière d’un ulcéré renfermée dans quelque partie,
la trop grande abflinence de manger, comme aufli
la crapule & l’ufage des alimens, de boiffon acre,
de remedes & de poifons de même qualité.
3°. On doit attribuer les mêmes effets aux caufes
fuivantes ; favoir, à la fuppreflion de certaines évacuations
qui fe faifoient auparavant, comme des
menflrues, des lochies , des hémorrhoïdes, de la fanie
, du pus, d’urine ; à larépereuflion de la galle,
d’une dartre.
4°. On doit encore ranger parmi les caufes des
convulfions épileptiques, certaine vapeur dont le
foyer a ordinairement fon fiége dans quelque partie
des extrémités du corps, d’oh elle femble s’élever
au commencement de l’accès, en excitant le fentiment
d’une efpece d’air ou vapeur qui monte vers
les parties fupérieures jufqu’à ce qu’il foit parvenu
Tome V t
au cerveau ; cé qui efi fôiivent l’effet d*un nferf cômA
primé par quelque cicatrice ou quelque tumeur *
comme un skirrhe, un ganglion. Il n’efl pas facile
de rendre raifon de ce phénomène ; il efi cependant
vraiflemblable qu’il efi produit par une contraction
fpafmodique qui reflerre les vaiffeaux des parties
mentionnées ^ou fe fait fentir cette efpece d'aurct
frigida) , y arrête le cours du fang, d’oh le fentiment
de froideur, Sc fait refluer les humeurs vers les parties
fupérieures; d’oh s’enfuit que la maladie, dans
fon commencement, reflemble fouvent à une attaque
d’apoplexie* Voye^ une obfervation à ce fujet
dans le recueil de celles, de la fociété d’Edimbourg i
tome IV. Voyeç Vapeur,
5°. JLa plûpart de ces caufes ( I . II. III. IV.) peu-»
vent etre l’effet d’une mauvaife conformation des
folides, d’un vice héréditaire tranfmis du pere ou dé
la mere, ou de quelques ancêtres ; en forte qu’il arrive
quelquefois que le fils n’en éprouve aucun mauvais
effet, mais bien Je petit-fils : peut-être peuvent-4
elles être aufli l ’effet de l ’imagination de la mere ÿ
qui ayant eu occafion de voir un épileptique pendant
la groffeffe, en a eu l’efprit frappé.
Toute cette expofition des différentes caufes de
Vepilepfie, tirée de Boerhaave , efi le réfultat de ce
qu’ont appris à cet égard l’obfervation des fymptomes
de cette maladie, & l’infpe&ion des cadavres
de ceux qui en ont été atteints ; en forte qu’on peut
en conclure que la caufe prochaine dépend de la
difpofition du cerveau, dans laquelle les voies qui
fervent à diftribuer le fluide nerveux aux organes
du fentiment, font fermées totalement, ou confidé-
rablement embarraflees, pendant que celles qui fervent
à diflribuer le même fluide aux organes du
mouvement, refient ouvertes & le reçoivent en
abondance, avec beaucoup de célérité & fans ordre.
Les perfonnes qHi font lujetes aux attaques d'épi-
lepfie, fentent qu’ils font fur le point d’en fouffrir
une par les lignes fuivans : ils éprouvent d’abord
une chaleur extraordinaire ; la vûe fe trouble ; ils
fentent des furfauts dans les tendons ; la mémoire efi
affoiblie.Des vertiges, des ébloiiiffemens, demau-
vaifes odeurs , du bruit dans les oreilles, des douleurs
& des pefanteurs de tête, la pâleur du vifage,
un mouvement irrégulier dans la langue, une trif-
teffe profonde, des ardeurs d’entrailles , font aufli
les avant-coureurs de cette maladie ; & lorfque l’ac
cès commence , le malade efi le plus fouvent ren-
verfé tout-à-coup, o u , s’il efi couché, les extrémités
inférieures fe plient & font ramenées involontairement
vers le tronc. Il fait d’abord de grands
cris , & erifuite il refpire avec peine & avec bruit,
comme fi on l’étrangloit ; il grince des dents ; il rend
de l’écume par la bouche ; il fait des grimaces horribles
; il efi agité par des convulfions dans tout fon
corps, & il éprouve des fecouffes violentes, qu’il
n’efl pas en fon pouvoir d’empêcher ; il perd ordinairement
l’ufage de tous fes fens ; il fe vuide involontairement
des matières fécales , de l’urine ; il fe
fait de même quelquefois un écoulement de femen-
c e , & il ne peut appercevoir rien de ce qui fe préfente
autour de lui, pendant leparoxyfme, dont il
puiffe fe rappeller le fouvenir après qu’il efi fini :
quelquefois cependant, lorfque l’attaque n’efl pas
forte, il n’à pas toutes les parties du corps en con-
vulfion, & il ne tombe pas toûjours ; il n’a que quelques
parties agitées ; fa tête, par exemple, éprouve
des fecouffes, ou les yeux lui tournent, ou il jette
fes bras & fes jambes de côté & d’autre, ou il tient
opiniâtrement les poings fermés, ou il marche en
tournant & court çà & là , fans parler cependant,
fans rien entendre & fans rien fentir , emorte qu’il
ne fe fouvient aucunement de tout cela après l’accès.
Marcellus Donatus a obfervé une epilepfie dans la-
HHhhh ij