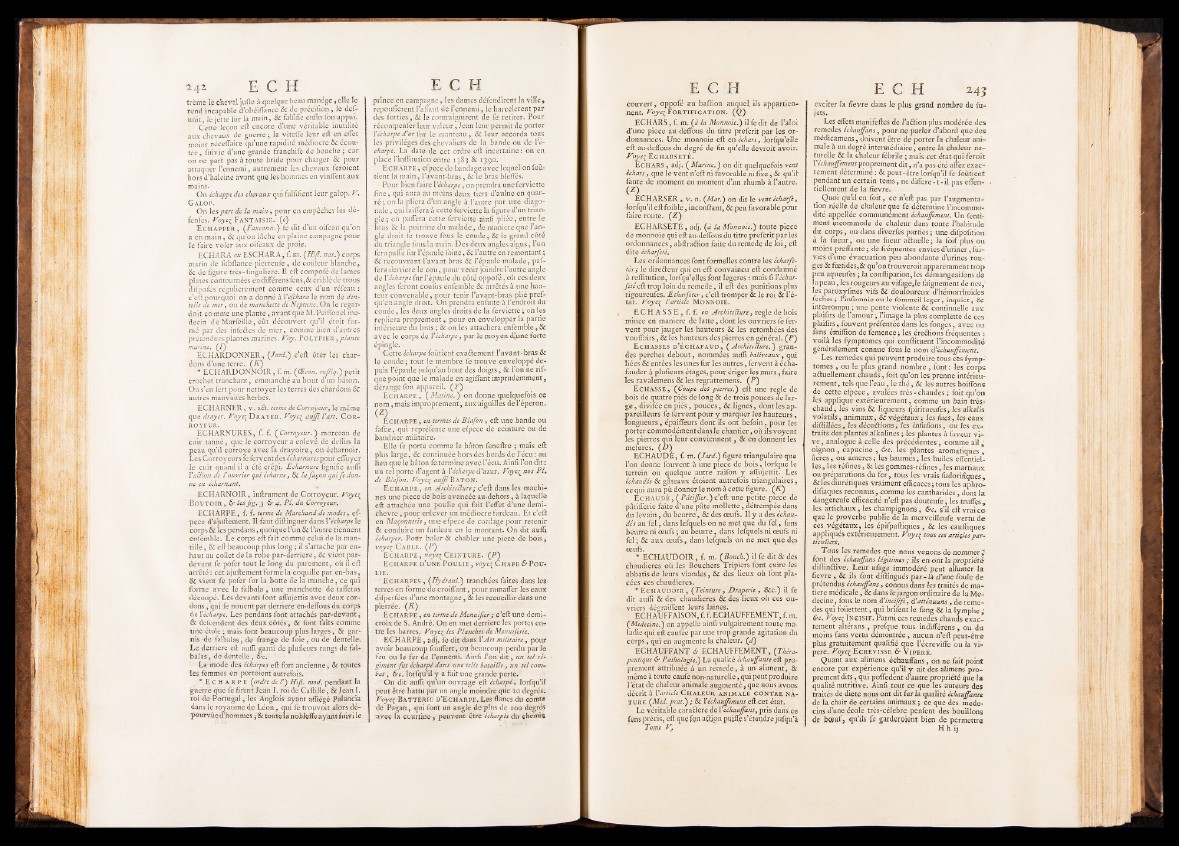
îrème te cheval ]ufte à quelque beau manège, elle te
rend incapable d’obciflimcc & de prccifion, le def-
unit, le jette fur la main, ôc falfifie enfin ion appui.
Cette leçon efl encore cl’une véritable inutilité
aux chevaux de guerre ; la vîtefle leur efl en effet
moins néeeffaire qu’une rapidité médiocre ôc écoutée
, fuivie d’une grande franchife de bouche ; car
on ne part pas à toute bride pour charger ôc pour
attaquer l’ennemi, autrement les chevaux feroient
hors d’haleine avant que les hommes en vinffent aux
mains.
On échappe des chevaux qui falfifient leur galop. V ,
Galop .
On les part de la main, pour en empêcher les de-
fenfes. Voye^ Fan t aisie. {e)
E chapper , (Fauconn.) le dit d’un oifeau qu’on
a en main, ôc qu’on lâche en plaine campagne pour
le faire voler aux oifeaux de proie.
ECHARA ou ESCHARA, f. m. {Hifl. nat.) corps
marin de fubflance pierreufe , de couleur blanche,
& de figure très-linguliere. Il efl compofé de lames
plates contournées en différensfens,& criblé de trous
difpofés régulièrement comme ceux d’un réfeau :
c’efl pourquoi on a donné à Vefchara le nom de dentelle
de mer, ou de manchette de Neptune. On le regar-
doit co mme une plante, avant que M. Peiffonel médecin
de Marfeille, eût découvert qu’il étoit formé
par des infe&es de nier, comme bien d’autres
prétendues plantes marines. Voy. Po l y p ie r , plante
marine. (7)
ECHARDONNER, (TW.) c’efl ôter les chardons
d’une terre., {K)
* ECHARDONNOIR, f. m. ([OEcon. rufiq.) petit
crochet tranchant, emmanché au bout d’un bâton.
On s’en l'ert pour nettoyer les terres des chardons ôc
autres mauvailes herbes.
ECHARNER, v. aâ. terme de Corroyeur, le même
que drayer. Voyeç DRAYER. Voye^ auffi l'art. CORROYEUR.
ECHARNURES, f. f. ( Corroyeur. ) morceau de
cuir tanne,, que le corroyeur a enlevé de deffus la
.peau qu’il corroyé avec la drayoire , ou écharnoir.
Les Corroyeursfe fervent des écharnures pour efïuyer
le cuir quand il a été crépi. Echarnurefignifie auffi
Vaction de l'ouvrier qui écharne, ÔC la façon qui fe donne
en acharnant.
ECHARNOIR, infiniment de Corroyeur. Voye^
Bo u to ir , & les fig. 3 6* 4. PI. du Corroyeur.
ECHARPE, f. f. terme de Marchand de modes, efpece
d’ajuflement. Il faut diflinguer dans Yécharpe le
corps ôc les pendans, quoique l’un ôc l’autre tiennent
enfemble. Le corps efl fait comme celui de la mantille
, & efl beaucoup plus long ; il s’attache par en-
haut au collet de la robe par-derriere, & vient par-
devant fe pofer tout le long du parement, oit il efl
arrêté : cet ajuflement forme la coquille par en-bas,
& vient fe pofer fur la botte de la manche, ce qui
forme â,vec le falbala , une manchette de taffetas
découpé. Les devants font affujettis avec deux cordons
j qui fe nouent par derrière en-defîous du corps
de l'écharpe. Les pendans font attachés par-devant,
•& dfifcendent des deux Côtés, & font faits comme
ime étole ; mais font beaucoup plus larges, & garnis
-de falbalas, de frange de foie, ou de dentelle.
Le derrière efl auffi garni de plufieurs rangs de falv
bâlMS', d e dentelle, &c. S
La mode dès écharpes efl fort ancienne, & toutes
lèS; femmes en portoient-autrefois.
* E c h a r p e {ordre de Z5) H ijt. mod. pendant la
guerre que fe firent Jean I. roi de Caflilie, & Jean I.
roi de Portugal, les Anglois ayant affiégé Palancia
dans le royaume de Léon,, qui fe trouvoit alors dépourvue
d’hommes ;& toutela noblèfïe ayant fuivi le
E C H
prince en campagne, les dames défendirent la ville,
repoufferent l’affaut de l’ennemi, le harcelèrent par
des forties, & le contraignirent de fe retirer. Pour
récompenfer leur valeur, Jean leur permit de porter
Y écharpe d’or fur le manteau, & leur accorda tous
les privilèges des chevaliers de la bande ou de Yé-
charpe. La date de cet ordre efl incertaine: on en
place l’inflitution entre 13 83 & 1390. '
E c h a r p e , efpece de bandage avec lequel on foûtient
la main, l’avant-bras, ÔC le bras bleffés.
Pour bien faire Y écharpe, on prendra une ferviette
fine, qui aura au moins deux tiers d’aulne en quar-
ré ; on la pliera d’im angle à l’autre par une diagonale
, qui laiffera à cette ferviette la figure d’un triangle
; on paffera cette ferviette ainfi pliée, entre le
bras ôc la poitrine du malade, de maniéré que l’angle
droit fe trouve fous le coude, ôc le grand côté
du triangle fous la main. Des deux angles aigus, l’un
ferapaflé fur l’épaule faine, ôc l’autre en remontant ;
ôc recouvrant l’avant-bras ôc l’épaule malade, paffera
derrière le cou, pour venir joindre l’autre angle
de Y écharpe fur l’épaule du côté oppofé, où ces deux
angles feront coufus enfemble ôc arrêtés à une hauteur
convenable, pour tenir l’avant-bras plié pref-
qu’en angle droit. On prendra enfuite à l’endroit du
coude, les deux angles droits de la ferviette ; on les
repliera proprement, pour en envelopper la partie
inférieure du bras ; & on les attachera enfemble, &
avec le corps de Y écharpe, par le moyen diune forte
épingle.
Cette écharpe foûtient exa&ement l’avant-bras &
le coude ; tout le membre fe trouve enveloppé depuis
l’épaule jufqu’au bout des doigts, & l’on ne rif-
que point que le malade en agiffant imprudemment,
dérange fon appareil. ( Y )
E c h a r p e , ( Marine.) o n d o n n e quelq u efo is ce
n o m , m ais im p ro p re m e n t, a u x aiguilles de l’é p e ro n .
(Z)E
c h a r p e , en termes de Blafon, efl u n e b an d e o u
fa fc e , q u i rep réfen te u n e efpece de cein tu re o u de
b a u d rier m ilitaire.
Elle fe porte comme le bâton feneflre ; mais efl
plus large, ôc continuée hors des bords de Fécu : au
lieu que le bâton fe termine avec l’écu. Ainfi l’on dit :
un tel porte d’agent à Y écharpe d’azur. Voye^ nos PL
de Blafon. Voyeç aujjî BATON.
E c h a r p e , en Architecture ; c’efl dans les machines
une piece dé bois avancée au-dehors, à laquelle
efl attachée une poulie qui fait l’effet d’une demi-
chevre, pour enlever un médiocre fardeau. Et c’efl
en Maçonnerie, une efpece de cordage pour retenir
& conduire un fardeau en le montant. On dit auffi
ècharper. Portr haler & chabler une piece de bois ,
voye^ C a b l e . (E )
E c h a r p e , voye% C e in t u r e . ( P )
E c h a r p e d ’u n e P o u l ie , v o y e i C h a p e & P o u l
i e .
E c h a r p e s , (’Hydraul.) tranchées faites dans les
terres en forme de croiffant, pour ramaffer les eaux
difperfées d’une montagne, & les recueillir dans une
pierrée. (K )
E c h a r p e , en terme de Menuifier ; c ’efl une demi-
croix de S. André. On en met derrière les portes entre
les barres. Voyelles Planches de Menuiferie.
ÉCHARPÉ, adj. fe dit dans Y Art militaire, pour
avoir beaucoup fouffert, ou beaucoup perdu par le
feu ou le fer de l’ennemi. Ainfi l’on dit, un tel régiment
fut écharpé dans 'Une telle bataille , un tel combat
, &c. lorfqu’il y a fait une grande perte.
On dit auffi qu’un ouvrage efl écharpé., lorfqu’il
peut être battu par un angle moindre que 20 degrés;
Voyei-B a t t e r ie d ’É c h a r p é . Les flancs du comte
de Pagan, qui font un angle de plus de 100 degrés
avec la courtine, peuvent être écharpés du chemiü
c o u v e rt, o p p o fé a u b aflio n auquel, ils a p p a rtie n n
e n t. Voye^ F o r t i f i c a t i o n . (Q )
ECHARS, f. m. (à la Monnoie.) il fe dit de l’aloi
d’une piece au-defïbus du titre prefcrit par les ordonnances.
Une monnoie efl en èchars, lorfqu’elle
efl au-deffous du degré de fin qu’elle devroit avoir.
rVoyer E g h ARSETÉ.
E c h a r s , adj. ( Marine. ) on dit quelquefois vent
echars, que le vent n’efl ni favorable ni fixe, & qu’il1
faute de moment en moment d’un rhumb à l’autre.
(Z) - -
ECHARSER, v. n. {MarJ on dit le vent écharfe,
lorfqu’il efl foible, inconfiant, Ôc peu favorable pour
faire route. (Z )
ECHARSETÉ , adj. {à la Monnoie.) toute piece
de monnoie qui efl au-deffous du titre prefcrit par les
ordonnances, abflraétion faite du remede de lo i, efl
dite écharfeté.
Les ordonnances font formelles contre les écharfe-
tés ,* le directeur qui en efl convaincu efl condamné
à reflitution, lorfqu’elles font legeres : mais fi Yéchar-
feté efl trop loin du remede, il eft des punitions plus
rigoureufes. Echarfeter, c’efl tromper & le roi & l’état.
Voye1 l'article M o n n o ie .
E C H A S S E , f. f. en Architecture , réglé de bois
mince en maniéré de latte, dont les ouvriers fe fervent
pour jauger les hauteurs ôc les retombées des
voufloirs, ôc les hauteurs des pierres en général. (P )
ECHASSES d ’ÉCHAFAUD, {Architecture.) gra n d
es p erch es d e b o u t, nom m ées auffi baliveaux, qui
liées ôc en tées les un es fur les a u tre s , fe rv e n t à éc h a fa
u d e r à p lufieurs étag es, p o u r é rig e r les m u rs, faire
le s rav alem en s ôc les re g ra ttem e n s. {P)
E c h a s s e , {Coupe des pierres.) eft u n e rég lé de
b o is de q u a tre p ies d e lo n g & de tro is p o u ces de la rg
e , d iv ifée en p ié s , p o u c e s , ôc lig n e s, d o n t les ap-
p areilleu rs fe fe rv e n t p o u r y m arq u er les h a u te u rs ,
lo n g u e u rs, ép aifleu rs d o n t ils o n t b e fo in , p o u r les
p o rte r com m o d ém en t dan s le c h a n tie r, o ù ils v o y e n t
les p ierres q u i le u r c o n v ie n n e n t, & e n d o n n e n t les
m efu res. { D )
ÉCHAUDÉ, f. m. {Jard.) figure triangulaire que
l’on donne fouvent à une piece de bois, lorfque le
terrein ou quelque autre raifon y aflujettit. Les
échaudés & gateaux étoient autrefois triangulaires,
ce qui aura pû donner le nom à cette figure. {K)
E c h a u d é , {Pâtijfier.)c’eft une petite piece de
pâtifierie faite d’une pâte mollette, détrempée dans
du levain, du beurre, ôc des oeufs. Il y a des échaudés
au fe l, dans lefquels on ne met que du fe l, fans
beurre ni oeufs ; au beurre, dans lefquels ni oeufs ni
fel ; ôc aux oeufs, dans lefquels on ne met que des
oeufs.
* ECHAUDOIR, f. m. {Bouch.) il fe dit & des
chaudières où les Bouchers Tripiers font cuire les
abbatis de leurs viandes, ôc des lieux où font placées
ces chaudières.
* E c h a u d o ir , {Teinture , Draperie , & c.) il fe
dit auffi & des chaudières Ôc des lieux où ces ouvriers
dégraiflent leurs laines.
ECHAUFFAISON, f. f. ECHAUFFEMENT, f. m.
{Medecine.) on appelle ainfi vulgairement toute maladie
qui eft caufée par une trop grande agitation du
corps, qui en augmente la chaleur, {d)
ECHAUFFANT & ECHAUFFEMENT, {Thérapeutique
& Pathologie.) La qualité échauffante eft. proprement
attribuée à un remede, à un aliment, &
même à toute caufe non-naturelle, qui peut produire
l ’état de chaleur animale augmenté, que nous avons
décrit à Y article C h a l e u r a n im a l e c o n t r e n a t
u r e {Med. prat.) ; ôc Yéchauffement efl cet état.
Le véritable caraélere de Y échauffant, pris dans ce
fens précis, efl que fon a&ipn pqiffo s’étendre jufqu’à
Tome Vf
exciter la fievre dans le plus grand nombre de fu-
jets.
Les effets manifefles de l’aétion plus modérée des
remedes èchauffans, pour ne parler d’abord que des
médicamens, doivent être de porter la chaleur animale
à un degré intermédiaire, entre la chaleur naturelle
ôc la chaleur fébrile ; mais cet état qui feroit
Y échauffement proprement dit, n’a pas été allez exactement
déterminé : & peut-être lorfqu’il fe foûtient
pendant un certain tems, ne différé - 1 - il pas effen-
tiellement de la fievre.
Quoi qu’il en foit, ce n’efl pas par l’augmentation
réelle de chaleur que fe détermine l’incommodité
appellée communément échauffement. Un fenti-
ment incommode de chaleur dans toute l’habitude
du corps, ou dans diverfes parties ; une difpofition
à la fueur, ou une fueur aéluelle ; la foif plus ou
moins preffante ; de fréquentes envies d’uriner, fui-
vies d’une évacuation peu abondante d’urines rouges
& foetides,& qu’on trouveroit apparemment trop
peu aqueufes ; la conflipation, les démangeaifons de
la peau, les rougeurs au vifage,ie faignement de nez,'
les paroxyfmes vifs ôc douloureux d’hémorrhoïdes
feches ; l’infomnie ou le fommeil Ieger, inquiet, ôc
interrompu ; une pente violente ôc continuelle aux
plaifirs de l’amour ; l’image la plus complette de ces
plaifirs, fouvent préfentée dans les fonges, avec ou
fans émifïïon de femence ; les éreélions fréquentes :
voilà les fymptomes qui conflituent l’incommodité
généralement connue fous le nom Réchauffement.
Les remedes qui peuvent produire tous ces fymptomes
, ou le plus grand nombre, font : les corps
actuellement chauds, foit qu’on les prenne intérieurement,
tels que l’eau, le thé, & les autres boiffons
de cette efpece, avalées très - chaudes ; foit qu’on
les applique extérieurement, comme un bain très-
chaud, les vins & liqueuts fpiritueufes, les alkalis
volatils, animaux, ôc végétaux ; les fucs, les,eaux
diflillées, les décoâions, les infuftons, ou les extraits
des plantes alkalines ; les plantes à faveur v ive
, analogue à celle des précédentes, comme ail
oignon, capucine , & c . les plantes aromatiques ,
âcres, ou ameres ; les baumes, les huiles efîentiel-
les, les réfines, & les gommes-réfines, les martiaux
ou préparations du fer, tous les vrais fudorifiques ,
& les diurétiques vraiment efficaces ; tous les aphro-
difiaques reconnus, comme les cantharides, dont la
dangereufe efficacité n’eft pas douteufe, les truffes,’
les artichaux, les champignons, &c. s’il efl vrai ce
que le proverbe publie de la merveilleufe vertu de
ces végétaux , les épifpafliques , ôc les caufliques
appliqués extérieurement. Voye^ tous ces articles particuliers.
Tous les remedes que nous venons de nommer^
font des èchauffans légitimes ; ils en ont la propriété
diflinâive. Leur ufage immodéré peut allumer la
fievre , ôc ils font diflingués par - là d’une foule de
prétendus èchauffans, connus dans les traités de matière
médicale, ôc dans le jargon ordinaire de la Médecine,
fous le nom RinciJîfs, d’attènuans , de reme-
des qui fouettent, qui brifent le fang ôc la lymphe
&c. V iy e { In c is if . Parmi ces remedes chauds exactement
altérans , prefque tous indifférens, ou du
moins fans vertu démontrée, aucun n’efl peut-être
plus gratuitement qualifié que l’écreviffe ou la vipère.
V o y e i E c r e v is s e & V i p e r e .
Quant aux alimens èchauffans, on ne fait point
encore par expérience qu’il y ait des alimens proprement
dits, qui poffedent d’autre propriété que la
qualité nutritive. Ainfi tout ce que les auteurs des
traités de diete nous ont dit fur la qualité échauffante
de la chair de certains animaux ; ce que des médecins
d’une école très-célebre penfent des bouillons
de boeuf, qu’ils fe garderoient bien de permettre
H h i j