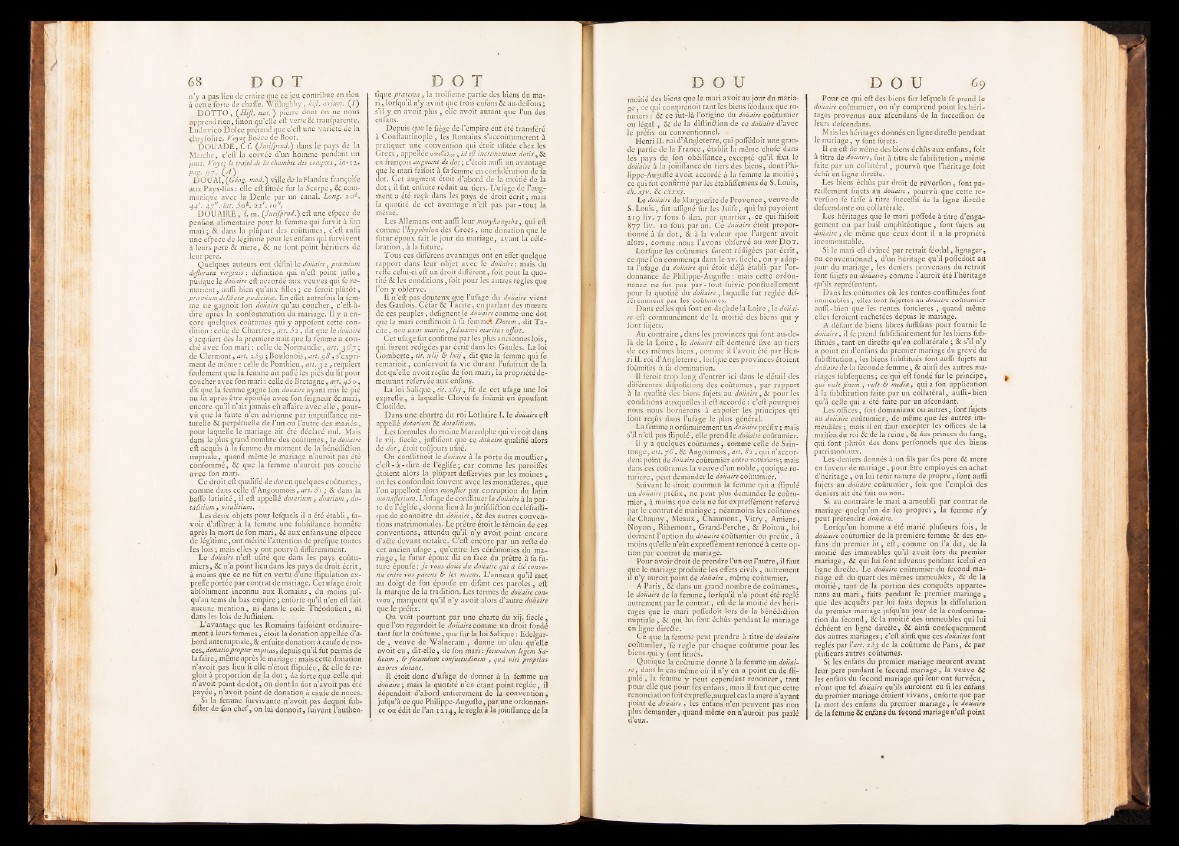
n ’y a p as lieu de c ro ire q u e ce jeu contribue, en rien
à c e tte forte de chaffe. "V illu g h b y , hiß. avium. ( / )
D O T T O , {Hiß. nat.) pierre dont ori ne nous
apprend rien, linon qu’elle eft verte & tranfparente.-
Ludovico Dolce prétend que c’eft une variété de la
çhryfolite. Koye^ Boëce de Boot.
DOUADE, f. f. {Jurifprud.') dans le pays de la
Marche, c’eft la corvée d’un homme pendant un
jour. Voyt^ le traité de la chambre des comptes, in-îz.
Paë - 97' (-^)
DOUAI, {Géog. mod.') ville de la Flandre françoife
aux Pays-Bas : elle eft lituée fur la Scarpe, & communique
avec la Deule par un canal. Long. z o d.
44'. 4y". lat. 5od. 22.'. 10".
DOUAIRE , f. m. {Jurifprud.') eft une efpece de
penfion alimentaire pour la femme qui furvit à fon
mari ; & dans la plupart des coutumes, c’eft aulîi
une efpece de légitime pour, les enfans qui furvivent
à leurs pere & mere, & ne font point héritiers de
leur pere.
Quelques auteurs ont défini le douaire, protmium
déflorâttz virginis : définition qui n’eft point jufte,
puifque le douaire eft accordé aux veuves qui fe remarient
, aulîi bien qu’aux filles ; ce feroit plutôt,
pmmium delibatoe pudicitia. En effet autrefois la femme
ne gagnoit fon doïiaire qu’au coucher, c ’eft-à-
dire après la confommation du mariage. Il y a encore
quelques coûtumes qui y appofent cette condition
: celle de Chartres, art. 5z , dit que le douaire
s’acquiert dès la première nuit que la femme a couché
avec fon mari : celle de Normane lie , art. 3 6 7 ;
de Clermont, art. a ip ; Boulonois, art. c) 8 , s’expriment
de même : celle de Ponthieu, art. 32., requiert
feulement que la femme ait pafle les piés du lit pour
coucher avec fon mari : celle de Bretagne, art. 4J0,
dit que la femme gagne fon douaire ayant mis le pié
au lit après être époufée avec fon feigneur &mari,
encore qu’il n’ait jamais eu affaire avec elle, pourvu
que la faute n’en advienne par impuiffance naturelle
& perpétuelle de l’un ou l’autre des mariés,
pour laquelle lé mariage ait été déclaré nul. Mais
dans le plus grand nombre des coûtumes, le douaire
eft acquis à la femme du moment de la bénédi&ion
nuptiale, quand même le mariage n’auroit pas été
confommé, & que la femme n’auroit pas couché
avec ion mari.
Ce droit eft qualifié de dot en quelques coûtumes,
comme dans celle d’Angoumois, art. 81 ; & dans la
baffe latinité, il eft appellé dotarium , doarium , do-
talitium, vitalitium. ■
Les deux objets pour lefquels il a été établi, fa-
voir d’affûrer à la femme une fubfiftance honnête
après la mort de fon mari, & aux enfans une efpece
de légitime, ont mérité l’attention de prefque toutes
les lois ; mais elles y ont pourvû différemment.
Le douaire n’eft ufité que dans les pays çoûtu-
miers, & n’a point lieu dans les pays de droit écrit,
à moins que ce ne fût en vertu d’une ftipulation ex-
preffe portée par contrat de mariage. Cet ufage étoit
abfolument inconnu aux Romains, du moins juf-
qu’au tems du bas empire ; enforte qu’il n’en eft fait
aucune mention, ni dans le code Théodofien, ni
dans les lois de Juftinien.
L’avantage que les Romains faifoient ordinairement
à leurs femmes, étoit la donation appellée d’abord
anténuptiale, & enfuite donation à caufe de no-
cesydonatiopropter nuptias, depuis qu’il fut permis de
la faire, même après le mariage : mais cette donation
n’avoit pas lieu li elle n’étoit ftipulée, & elle fe re-
gloit à propçrtion de la dot ; de forte que celle qui
n’avoit point de dot, ou dont la dot n’avoit pas été
payée, n’avoit point de donation à caufe de noces.
Si la femme furvivante n’avoit pas dequoi fub-
fifter de fon chef, on lui donnoit, fuivant l’authentique
praterea , la troifieme partie des biens du mari
, lorfqu’il n’y avoit que trois enfans & au-deffous ;
s’il y en avoit plus , elle avoit autant que l’un des
enfans.
Depuis que le fiége de l’empire eut été transféré
à Conftantinople , les Romains s’accoûtumerent à
pratiquer une convention qui étoit ufitée chez les
Grecs, appellée varoCô^ov, id eft incrementum dotis, &
en françois augment de dot; c’étoit auffi un avantage
que le mari faifoit à fa femme en confidération de fa
dot. Cet augment étoit d’abord de la moitié de la
dot; il fut enfuite réduit au tiers. L’ufage de l’augment
a été reçû dans les pays de droit écrit ; mais
la quotité de cet avantage n’èft pas par-tout la
même.
Les Allemans ont aufli leur moryhangtba, qui eft
comme Yhypobolon des Grecs, une donation que le
futur époux fait le jour du mariage, avant la célébration
, à la future.
Tous ces différens avantages ont en effet quelque
rapport dans leur objet avec le douaire', mais du
refte celui-ci eft un droit différent, foit pour la quotité
& les conditions, foit pour les autres réglés que
l’on y obferve.
Il n’eft pas douteux que l’ufage du doïiaire vient
des Gaulois. Céfar & T acite, en parlant des moeurs
de ces peuples, defignent le douaire comme une dot
que le mari conftituoit à fa femme^ Dotem, dit T acite,
non uxor marito ,feduxori maritus offert.
Cet ufage fut confirmé par les plus anciennes lois,
qui furent rédigées par écrit dans les Gaules. La loi
Gomberte, tit. xlij & Ix ij, dit que la femme qui fe
remarioit, confervoit fa vie durant l’ufufruit de la
dot qu’elle avoit reçûe de fon mari, la propriété demeurant
refervée aux enfans.
La loi Salique, tit. x lv j, fit de cet ufage une loi
expreffe, à laquelle Clovis fe foûmit en époufant
Clotilde.
Dans une chartre du roi Lothaire I. le douaire eft
appellé dotarium & dotalitium.
Les formules du moine Marculphe qui vivoit dans
le vij. fiecle , juftifient que ce douaire qualifié alors
de dot, étoit toûjours ufité.
On conftituoit le doïiaire à la porte du mouftier,
c’eft-à -d ire de l’églife; car comme les paroiffes
étoient alors la plûpart deffervies par les moines ,
on les confondoit fouvent avec les monafteres, que
l’on appelloit alors mouftier par corruption du latin
monafterium. L’ufage de conftituer le doïiaire à la porte
de l’églife, donna lieu à la jurifdiftion eccléfiafti-
que de connoître du doïiaire, & des autres conventions
matrimoniales. Le prêtre étoit le témoin de ces
conventions, attendu qu’il n’y avoit point encore
d’aâe devant notaire. C ’eft encore par un refte de
cet ancien ufage , qu’entre les cérémonies du mariage
, le futur époux dit en face du prêtre à fa future
époufe : je vous doiie du doïiaire qui a été convenu
entre vos parens & les miens. L’anneau qu’il met
au doigt de fon époufe en difant ces paroles, eft
la marque de la tradition. Les termes de doïiaire convenu
, marquent qu’il n’y avoit alors d’autre douaire
que le préfix.
On voit pourtant par une charte du xij. fiecle,'
que l’on regardoit le douaire comme un droit fondé
tant fur la coûtume, que fur la loi Salique : Edelgar-
de , veuve de Walneram , donne un aleu qu’elle
avoit eu , dit-elle, de fon mari : fecundum legem Sa-
licam , & fecundum confuetudinem > quâ viri proprias
uxçres dotant.
. Il étoit donc d’ufage de donner à la femme un
doïiaire ; mais la quotité n’en étant point réglée, il
dépendoit d’abord, entièrement de la convention,
jufqu’à ce que Philippe-Augufte, par une ordonnance
ou édit de l’an 1 z 14, le régla à la joüifiance de la
moitié des biens que le mari avoit au jour du mariage
, ce qui comprenoit tant les biens féodaux que roturiers
; & ce fut-là l’origine du douaire coûtumier
ou légal , & de la diftin&ion de ce douaire d’avec
le préfix ou conventionnel. •
Henri II. roi d’Angleterre, qui poffédoit une grande
partie de la France, établit la même chofe dans
les pays ’de fon obéiffance, excepté qu’il fixa le
doïiaire à la joüiffance du tiers des biens, dont Philippe
Augufte avoit accordé à la femme la moitié ;
ce qui fut confirmé par les établiffemens de S. Louis,
ch, xjv. & cxxxj.
Le doïiaire de Marguerite de Provence, veuve de
S. Louis, fut afligné fur les Juifs, qui lui payoient
z i 9 liv. 7 fous 6 den. par quartier, ce qui faifoit
877 liv. 10 fous par an. Ce doïiaire étoit proportionné
à fa dot, & à la valeur que l’argent avoit
alors, comme nous l’avons obfervé au mot D o t .
Lorfque les coûtumes furent rédigées par écrit,
ce que l’on commença dans le xv. fiecle, on y adopta
Biffage du doïiaire qui étoit déjà établi par l’ordonnance
de Philippe-Augufte : mais cette ordonnance
ne fut pas par - tout fuivie pon&uellement
pour la quotité du doïiaire , laquelle fut réglée différemment
par les coûtumes.
Dans celles qui font en-deçà de la Loire, le doïiaire
eft communément de la moitié des biens qui y
font fujets.
Au contraire, dans les provinces qui font au-delà
de la Loire, le douaire eft demeuré fixe au tiers
de ces mêmes biens, comme il l’avoit été par Henri
II. roi d’Angleterre, lorfque ces provinces étoient
foûmifes à fa domination.
Il feroit trop long d’entrer ici dans le détail des
différentes difpofitions des coûtumes, par rapport
à la qualité des biens fujets au douaire, & pour les
conditions auxquelles il eft accordé : c’eft pourquoi
nous nous bornerons à expofer les principes qui
font reçûs dans l’ufage le plus général.
La femme a ordinairement un doïiaire préfix ; mais
s’il n’eft pas ftipulé, elle prend le doïiaire coûtumier.
Il y a quelques coûtumes, comme celle de Sain-
tonge, art. j 6 , & Angoumois, are. 82 » qui n’accordent
point de doïiaire coûtumier entre roturiers; mais
dans ces coûtumes la veuve d’un noble, quoique roturière
, peut demander le doïiaire coûtumier.
Suivant le droit commun la femme qui a ftipulé
un doïiaire préfix, ne peut plus demander le coûtumier
, à moins que cela ne fut expreffément refervé
par le contrat de mariage ; néanmoins les coûtumes
de Chauny, Meaux, Chaumont, V it r y , Amiens,
Noyon, Ribemont, Grand-Perche, & Poitou, lui
donnent l’option du doïiaire coûtumier ou préfix, à
moins qu’elle n’eût expreffément renoncé à cette option
par contrat de mariage.
Pour avoir droit de prendre l’un ou l’autre, il faut
que le mariage produife les effets civils , autrement
il n’y auroit point de doïiaire, même coûtumier.
A Paris, &c dans un grand nombre de coûtumes,
le doïiaire de la femme, lorfqu’il n’a point été réglé
autrement, par le contrat, eft de la moitié des héritages
que le mari poffédoit lors de la bénédittion
nuptiale , & qui lui font échûs pendant le mariage
en ligne direfté.
Ce que la femme peut prendre à titre de doïiaire
coûtumier, fe réglé par chaque coûtume pour les
biens qui y font fitués.
Quoique la Coûtume donne à la femme un doïiaire,
dans le,cas même où il n’y en a point eu de ftipulé
, la femme y peut cependant renoncer, tant
pour elle que pour fe s enfans; mais il faut que cette
renonciation foit expreffe,auquel cas la mere n’ayant
point de doïiaire , les enfans. n’en peuvent pas non
plus demander, quand même on n’auroit pas parlé
d’eux.
Pour ce qui eft des biens fur lefquels fè prend le
douaire coûtumier, on n’y comprend point les héritages
provenus aux afeendans de la fuccelîion de
leurs defeendans.
Mais les héritages donnés en ligne dire&e pendant
le mariage, y font fujets.
Il en eft de même des biens échûs aux enfans, foit
à titre de doïiaire, foit à titre de fubftitution, même
faite par un collatéral, pourvû que l’héritage foit
échû en ligne direûe.
Les biens échûs par droit de reverfion, font pareillement
fujets au doïiaire, pourvû que cette reverfion
fe faffe à titre fucceffxf de la ligne direfte
defeendante ou collatérale.
Les héritages que le mari poffede à titre d’enga*-
gement ou par bail emphitéotique, font fujets au
doïiaire, de même que ceux dont il a la propriété
incommutable.
Si le mari eft évincé par retrait féodal, lignager,
ou conventionnel, d’un héritage qu’il poffédoit au •
jour du mariage, les deniers provenans du retrait
font fujets au doïiaire, comme l’auroit été l’héritage
qu’ils repréfentent.
Dans les coûtumes où les rentes conftituées font
immeubles, elles font fujettes au doüaire coûtumier
aufli-bien que les rentes foncières , quand même
elles feroient rachetées depuis le mariage.
A défaut de biens libres fuffifans pour fournir le
doïiaire, il fe prend fubfidiairement fur les biens fub-
ftitués, tant en dire&e qu’en collatérale ; & s’il n’y
a point eu d’enfans du premier mariage du grevé de
fubftitution, les biens fubftitués font aufli fujets au
doüaire de la fécondé femme, & ainfi des autres mariages
fubfequens ; ce qui eft fondé fur le principe, g.
qui vult finem , vult & media, qui a fon application
à la fubftitution faite par un collatéral, aufli-bien
qu’à celle qui a été faite par un afeendant.
Les offices, foit domaniaux ou autres, font fujets
au doüaire coûtumier, de même que les autres immeubles
; mais il en faut excepter les offices de la
maifon du roi & de la reine, & des princes du fang,
qui font plutôt des dons perfonnels que des biens
patrimoniaux.
Les deniers donnés à un fils par fes pere & mere
en faveur de mariage, pour être employés en achat
d’héritage , ou lui tenir nature de propre, font aufli
fujets au doüaire coûtumier, foit que l’emploi des
deniers ait été fait ou non.
Si au contraire le mari a ameubli par contrat de
mariage quelqu’un de fes propres, la femme n’y
peut prétendre doüaire.
Lorfqu’un homme a été marié plufieurs fois, le
doüaire coûtumier de la première femme & des enfans
du premier l i t , eft, comme on l’a dit, de la
moitié des immeubles qu’il avoit lors du premier
mariage, & qui lui.font advenus pendant icelui en
ligne direfte. Le doüaire coûtumier du fécond mariage
eft du quart des mêmes immeubles, & de la
moitié, tant de la portion des conquêts apparte-
nans au mari, faits pendant le premier mariage,
que des acquêts par lui faits depuis la diffolution
du premier mariage jufqu’au jour de la confommation
du fécond, & la moitié des immeubles qui lui
échéent en ligne direfte, & ainfi conféquemment
des autres mariages ; c’eft ainfi que ces doüaires font
réglés par Y art. 2J3 de la coûtume de Paris, & par
plufieurs autres coûtumes.
Si les enfans du premier mariage meurent avant
leur pere pendant le fécond mariage, la veuve &
les enfans du fécond mariage qui leur ont furvécu,
n’ont que tel doüaire qu’ils auroient eu fi les enfans
du premier mariage étoient vivans, enforte que par
la mort des enfans du premier mariage, le doüaire
de la femme & enfans du fécond mariage n’eft point