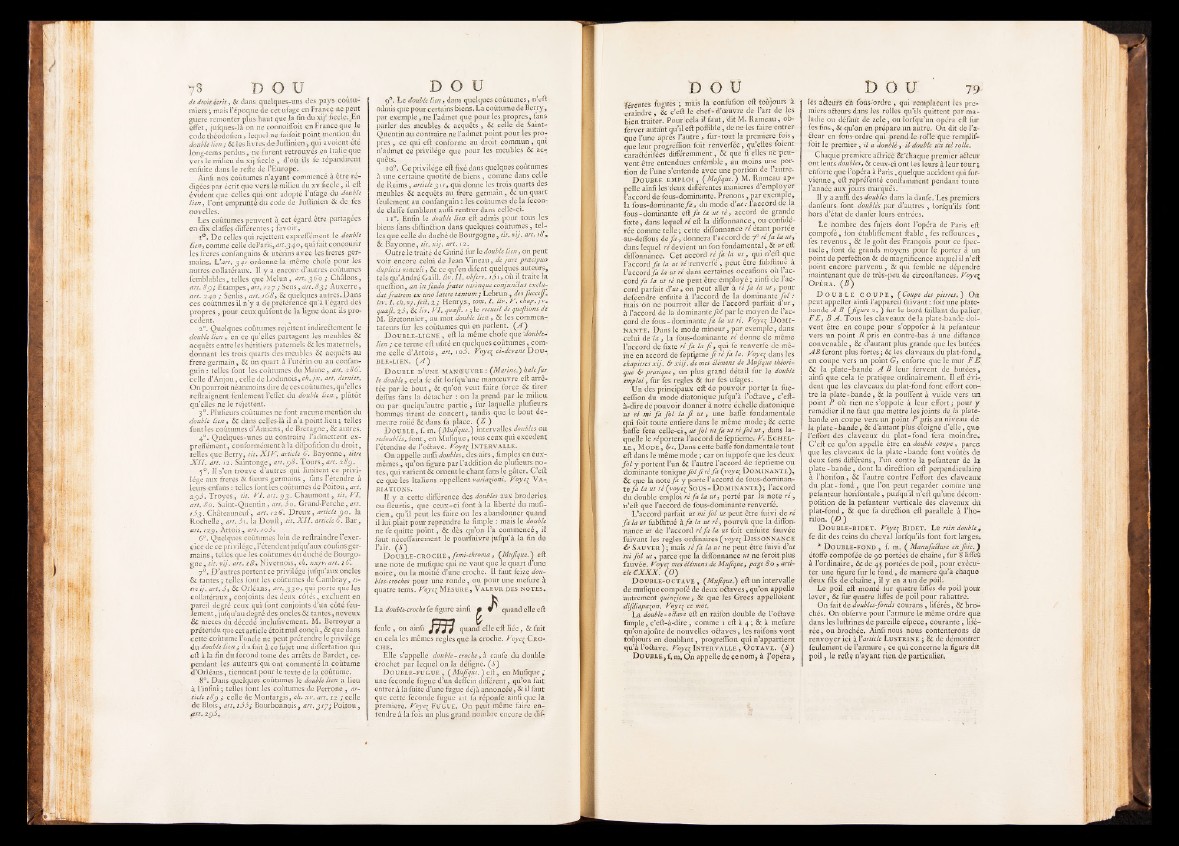
de droit -écrit, & dans quelques-uns des pays côutu*-
miers ; mais l’époque de cet ufage en France ne peut
guere remonter plus haut que la fin du xije fiecle.JEn
effet, jufqucs-là on ne connoifl'oit en France que le
code théodofien, lequel ne faifoit point mention du
double lien; 6c les livres.de Juftinien, c[ui avpient été
long-tems perdus, -ne furent retrouyes en Italie que
vers le milieu du xij fiecle , d’où, ils fe répandirent
enfuite dans le refte de l’Europe.
Ainfi nos coûtumes n’ayant commencé à être rédigées
par écrit que vers le milieu du xv fiecle, il eft
évident que celles qui ont adopté l’ufage du double
lien , l’ont emprunte du code de Juftinien & de fies
novelles. ¥•>.- . . f.
Les coûtumes peuvent à cet égard être partagées
en dix claffes différentes ; favoir,
i° . De celles qui rejettent exprefîement le double
lien, comme celle deParis, arr.3 40, qui fait concourir
les freres confanguins & utérins avec les freres germains.
Van. 341 ordonne la même chofe pour les
autres collatéraux. Il y a encore d’autres coûtumes
femblables, telles que Melun, art. 360 ; Châlons,
art. 8g; Etampes, art. ixy ; Sens, art. 83; Auxerre,
art. 240 ; Senlis, art.168, & quelques autres. Dans
ces coûtumes il n’y a de préférence qu’à l’égard des
propres , pour ceux qui font de la ligne dont ils procèdent.
„
20. Quelques coûtumes rejettent indirectement le
double lien, en ce qu’elles partagent les meubles &
acquêts entre les héritiers paternels 6c les maternels,
donnant les trois quarts des meubles & acquêts au
frere germain, 6c un quart à l’utérin ou au confan-
guin : telles font les coûtumes du Maine, art. 286.
celle d’Anjou, celle de Lodunois, ch. jx . art. dernier.
On pourroit néanmoins dire de ces coûtumes, qu’elles
reftraignent feulement l’effet du double lien, plûtôt
qu’elles ne le rejettent.
3 °. Plufieurs coûtumes ne font aucune mention du
double lien , 6c dans celles-là il n’a point lieu ; telles
font les coûtumes d’Amiens, de Bretagne, 6c autres.
40. Quelques-unes au contraire l’admettent ex-
preffément, conformément à la difpofition du droit,
telles que Berry, tit. X IF . article 6. Bayonne, titre
X I I . art. 12. Saintonge, art.$8. Tours, art. 28$.
50. II s’en trouve d’autres qui limitent ce privilège
aux freres & Ibeurs germains , fans l’étendre à
leurs enfans : telles font les coûtumes de Poitou, art.
ngS. Troyes, tit. VI. art.9 3. Chaumont, tit. VI.
art. 80. Saint-Quentin, art.So. Grand-Perche, art.
1S3. Châteauneuf, art. 12 G. Dreux, article go . la
Rochelle, art. S i. la Douft, tit. X I I . article G. Bar ,
art. 129. Artois, art. ioS.
6°. Quelques coûtumes loin de reftraindre l’exercice
de ce privilège,l’étendent jufqu’aux coufins germains
, telles que les coûtumes du duché de Bourgogne,
tit. vij. art. 18, Nivernois, ch. xxjv.art. iG.
y°. D ’autres portent ce privilège jufqu’aux oncles
de tantes ; telles font les coûtumes de Cambray, titre
ij. art. S, 6c Orléans, art. 330, qui porte que les
collatéraux, conjoints des deux côtés, excluent en
pareil degré ceux qui' font conjoints d’un côté feulement
, jufqu’au degré des oncles 6c tantes, neveux
6c nieces du décédé inclufivement. M. Berroyer a
prétendu que cet article étoit mal conçû, 6c que dans
cette coûtume l’oncle ne peut prétendre le privilège
du double lien ; il a fait à ce fujet une differtation qui
eft à la fin du fécond tome des arrêts de Bardet, cependant
les auteurs qui ont commenté la coûtume
d’Orléans, tiennent pour le texte de la coûtume.
8°. Dans quelques coûtumes le double lien a lieu
à l’infini ; telles l’ont les coutumes de Perrone , article
18g ; celle de Montargis, ch. xv. art. 12 ; celle
de Blois, art, iSS; Bourbonnois, art, 3 ly; Poitou,
jirt. zgS^r
90. Le double lien, dans quelques coûtumes, n’eft
admis que pour certains biens. La coûtume de Berry,
par exemple, ne l’admet que pour les propres, fans
parler des meubles & acquêts , 6c celle de Saint-
Quentin au contraire ne l’admet point pour les propres
, ce qui eft conforme au droit commun, qui
n’admet ce privilège que pour les meubles 6c ac-:
quêts.
io°. Ce privilège eft fixé dans quelques coûtumes
à une certaine quotité de biens, comme dans celle
de Reims, article 311, qui donne les trois quarts des
meubles 6c acquêts au frere germain, 6c un quart
feulement au confanguin : les coûtumes de la fécondé
claffe femblent aufli rentrer dans celle-ci.
i i ° . Enfin le double lien eft admis pour tous les
biens fans diftin&ion dans quelques coûtumes, telles
que celle du duché de Bourgogne, tit. vij. art. 18±
& Bayonne, tit. x ij. art. 12.
Outre le traité de Guiné fur le double lien, on peut
voir encore celui de Jean Vineau, de jure proecipuo
duplicis vinculi, 6c ce qu’en difent quelques auteurs,
tels qu’André Gaill. liv. II. obferv. 1S1, où il traite la
queftion, an infeudo frater utrinque conjunclus exclu-
dat fratrem ex uno latere tantum ; Lebrun , des fuccejf.
liv. I. ch. vj.fecl. 2 ; Henrys, tom. 1. liv. V. chap.jv.
quaft. 2S, 6c liv. VI. qucejt. 1 ; le recueil de quefiions de
M. Bretonnier, au mot double lien, & les commentateurs
fur les coûtumes qui en parlent. (A )
D o u b l e - l ig n e , eft la même chofe que 'double-
lien; ce terme eft ufité en quelques coûtumes, comme
celle d’A rtois, art. 10S. Voye^ ci-devant D o u b
l e - l ie n . ( A )
D o u b l e d ’u n e m a n oe u v r e : (Marine.') haie fur
le double, cela fe dit lorfqu’une manoeuvre eft arretée
par le bout, & qu’on veut faire force 6c tirer
deffus fans la détacher : on la prend par le milieu
ou par quelqu’autre partie, fur laquelle plufieurs
hommes tirent de concert, tandis que le bout demeure
roiié 6c dans fa place. (Z )
D o u b l e , f. m . (Mufique. ) in terv alles doubles o u
redoublés, f o n t, en M u fiq ue , to u s ceu x q u i ex céd en t
l’éten d u e d e l’o â à v e . Voye£ In t e r v a l l e .
On appelle aufli doubles, des airs, fimples en eux-
mêmes , qu’on figure par l’addition de plufieurs notes
, qui varient 6c ornent le chant fans le gâter. C ’eft
ce que les Italiens appellent varia^joni. Voye1 V ar
ia t io n s .
Il y a cette différence des doubles aux broderies
ou fleurtis, que ceux-ci font à la liberté du mufi-
cien, qu’il peut les faire ou les abandonner quand
il lui plaît pour reprendre le fimple : mais le double
ne fe quitté point, 6c dès qu’on l’a commencé, il
faut néceffairement le pourfuivre jufqu’à la fin de
l’air. (S )
D o u b l e - c r o c h e , femi-chroma, (Mufique.) eft
une note de mufique qui ne vaut que le quart d’une
noire, ou la moitié d’une croche. Il faut feize doubles
croches pour une ronde, ou pour une mefure à
quatre tems. Voyeç M e s u r e , V a l e u r d e s n o t e s .
La double-croche fe figure ainfi • quand elle eft
feule , ou ainfi m quand elle eft liée, & fuit
en cela les mêmes réglés que la croche. Voye£ C r o c
h e .
Elle s’appelle double - croche, à caufe du double
crochet par lequel on la défigne. (S)
D o u b l e - f u g u e , ( Mufique. ) eft, en Mufique ,’
une fécondé fugue d’un deffein différent, qu’on fait
entrer à la fuite d’une fugue déjà annoncée , & il faut
que cette fécondé fugue ait fa réponfe ainfi que la
première. Voye^ F u g u e . On peut même faire entendre
à la fois un plus grand nombre encore de difïére
ntêS fttgites ; m ais lâ confufion eft "toujours à
•craindre , 6c c’eft le c h e f- d’oe u v re de l’art de les
•bien tra ite r. P o u r céla il1 f a u t,'d it M . R a m e a u , ob-
fe rv e r au ta n t q u ’il eft poflible ,d e n e les faire e n trer
q u e l’u n e ap rès l’a u tr e , fu r-to u t la p rem ière fo is ,
q u e leu r p ro g ré flio n foit re n v e rfé e , qu ’elles foien t
caraélérifées d ifférem m en t, 6c que fi elles n e ’p eu v
e n t ê tre en ten d u es enfém ble , a u m oins u n e p o rtio
n de l’u n e s’en ten d e av ec une p o rtio n de l’a u tre .
D o u b l e e m p l o i , ( Mufique. ) M. Rameau appelle
ainfi lès'deux différentes maniérés d’employer
l ’accord de fous-dominante. Prenons, par exemple,
la fous-dominante fa , du mode d’ut : l’accord de la
fous-dominante eft fa la ut ré, accord de grande
fixte, dans lequel ré eft la diffonnance ou confide-
•rée comme telle-; cette diffonnance re étant portée^
au-deffous de fa -, donnera l’accord de 7e re fa la ut,
dans lequel ré devient un fon fondamental, & ut eft
diffonnance. Cet accord ré fa la u t, qui n’éft que
l ’accord fa la ut ré 'renverfé, peut être fubftitue à
Raccord fa laut ré dans certaines occafions où l’accord
fa la ut ré nè peut être'employé; ainfi de l’accord
parfait Gut on peut aller à re fa la ut, pour
descendre enfuite à l’accord de la dominante fo l :
friais On ne pourroit aller de l’accord parfait Gut,
à l’accord de la dominante fo l par le moyen de l’accord.
de fous - dominante fa la ut ré. Voyeç DOMINANTE.
Dans le mode mineur, par exemple, dans
celui de 'la , la fous-dominante ré donne de même
l ’accord de fixte ré fa la f i , qui fe renverfe de même
en accord de feptipme Ji ré fa la. V?yeç dans les
chapitres x ij. & xiij. de mes élémens de Mufique théorique
& pratique, un plus grand détail fur le double
emploi, fur fes réglés & lur fes ufages.
Un des principaux eft de pouvoir porter la fuc-
ceffion du mode diatonique jufqu’à l’o ftave, c’eft-
à-dire de pouvoir donner à notre échelle diatonique
ut ré mi fa fo l la f i u t, une baffe , fondamentale
qui foit toute entière dans le même mode ; 6c cette
baffe fera celle-ci, ut fo l ut fa ut ré fo l u t, dans laquelle
le réportera l’accord de feptieme» V. E c h e l l
e , M o d e , &c. Dans cette baffe fondamentale tout
éft dans le même mode ; car on fuppofe que les deux
fo l y portent l’un 6c l’autre l’accord de leptieme ou
dominante tonique fol f i ré fa (voye( D o m in a n t e ) ,
Sc que la note fa y porte l’accord de fous-dominan-
Xcfa la ut ré (yoye{ Sous - D o m in a n t e ) ; Raccord
du double emploi ré fa la ut, porté par la note ré ,
ti’eft que l’accord de fous-dominante renverfé.
L’accord parfait ut mi fol ut peut être fuivi de ré
fa la Ut fubftitué k fa la ut ré, pourvû que la diffon-
ïiance ut de l’accord ré fa la ut foit enfuite fauvée
fuivant les réglés ordinaires ( voyeç D is s o n n a n c e
& Sa u v e r ) ; mais ré fa la ut ne peut être fuivi Gut
mi fo l ut, parce que la diffonnance ut ne feroit plus
fauvée. Voye^ mes élémens de Mufique, page 80 , article
CXXX. (O)
D o u b l e - o c t a v e , (Mufique.) eft un intervalle
de mufique compofé de deux oôaves, qu’on appelle
autrement quinzième, & que les Grecs appelloient
difdiaparpn. Voyeç ce mot.
La double-oîlave eft en raifon double de l’oâave
ïimple, c’eft-à-dire , comme 1 eft à 4 ; & à mefure
qu’on ajoûte de nouvelles oftaves, les raifons vont
toûjours en doublant, progreflion qui n’appartient
qu’à l’oftave. Voyeç In t e r v a l l e , O c t a v e . (S )
D ouble, f, m. On appelle de ce nom, à l’opéra,
lès aéleûrs e'A fous-ordre , qui remplacent les premiers
a&eurs dans les rolles qu’ils quittent par ma -
ladie ou défaut de ze le, ou lorfqu’un opéra eft fur
les fins-, & qu’on en-prépare un autre. On dit dè l’acteur
en fous-ordre qui prend le-rôïïè que remplif-
foit le premier , f / a doublé-, il double un tel rolle.
Chaque premièrea&rîce Stchaque premier aâeuï
ont leur,s doubles, & ceux-ci ont les leurs à leur tour ;
enfdrtè que l ’opéra à Paris, quelque accident qui fuf-
vienne, eft^repréfenté conftamment pendant toute
f année aux jours marques.
Il y a aufli des doubles dans la danfe. Les premiers
danfeurs font doublés par d’autres , lorfqu’ils font
hors d’état de danfer leurs entrées.
Lè nombre des fujets dont l ’opérà de Paris eft
compofé, fon établiffement ftable, fes reffources ,
fes revenus, & le goût des François pour ce fpec-
taclè, font de grands moyens pour lè porter à un
point de perfe&ion & de magnificence auquel il n’eft
point encore parvenu, & qui femble ne dépendrè
maintènant què dè très-peïi de circonftances. Voyeç
Opéra* ( 2?)
D o u b l e c o u p e , ( Coupe des pierres. ) On
peut appeller ainfi l’appareil fuivant foit une plate-
bande A B ( figure 2. ) fur le bord faillant du palier,
F E , B A. Tous les claveaux de la plate-bande doivent
être en coupe pour s’oppofer à la pefanteur
vers un point R pris en contre-bas à une diftance
convenable, 6c d’autant plus .grande que les butées
A B feront plus fortes ; & les claveaux du plat-fond,
en coupe vers un point G, enforte que le mur F E,
6c la plate-bande A B leur fervent de butées,
ainfi que cela fe pratique ordinairement. Il eft évi-.
dent que les claveaux du plat-fond font effort contre
la plate-bande, & la pouffent à vuide vers un
point P où rien ne s’oppofe à leur effort ; pour y
remédier il ne faut que mettre les joints de la plate-
bande en coupe vers un point P pris au niveau de
la plate-bande, & d’autant plus éloigné d’elle, que
l’effort des claveaux du plat-fond fera moindre*
C ’eft ce qu'on appelle être en double coupe, parce
que les claveaux de la plate - bande font voûtés de
deux fens différens, l’un contre la pefanteur de la
plate - bande, dont la direction eft perpendiculairè
à l’horifon, 6c l’autre contre l’effort des claveaux
du plat - fond , que l’on peut regarder comme une
pefanteur horifontale, puifqu’il n’eft qu’une décôm-
pofition de la pefanteur verticale des claveaux dû
plat-fond, & que fa direction eft parallèle à l’horifon.
(D )
D oUble-b id e t . Voye^ Bid et. Le rein double
fe dit des reins du cheval lorfqu’ils font fort largesv
* D ouble-fond , f. m. ( Manufacture en foie, y
étoffe compofée de 90 portées de chaîne, fur 8 liffeà
à l’ordinaire, & de 45 portées de poil, pour exécuter
une figure fur le fond, de maniéré qu’à chaque
deux fils de chaîne, il y en a un de poil-.
Le poil eft monté fur quatre liffes de poil pouir
lever, 6c fur quatre liffes de poii pour rabattre.
On fait de doubles-fonds couràns, liférés, 6c brochés.
On obferve pour l’armure le même ordre què
dans les luftrines de pareille efpece, courante, lifé-
rée, ou brochée. Ainfi nous nous contenterons de
renvoyer ici à. ¥ article Lustrine ; 6c de démontrer
feulement de l’armure, ce qui concerne la figure dit
poil, le reftç n’ayant rien de particulier»