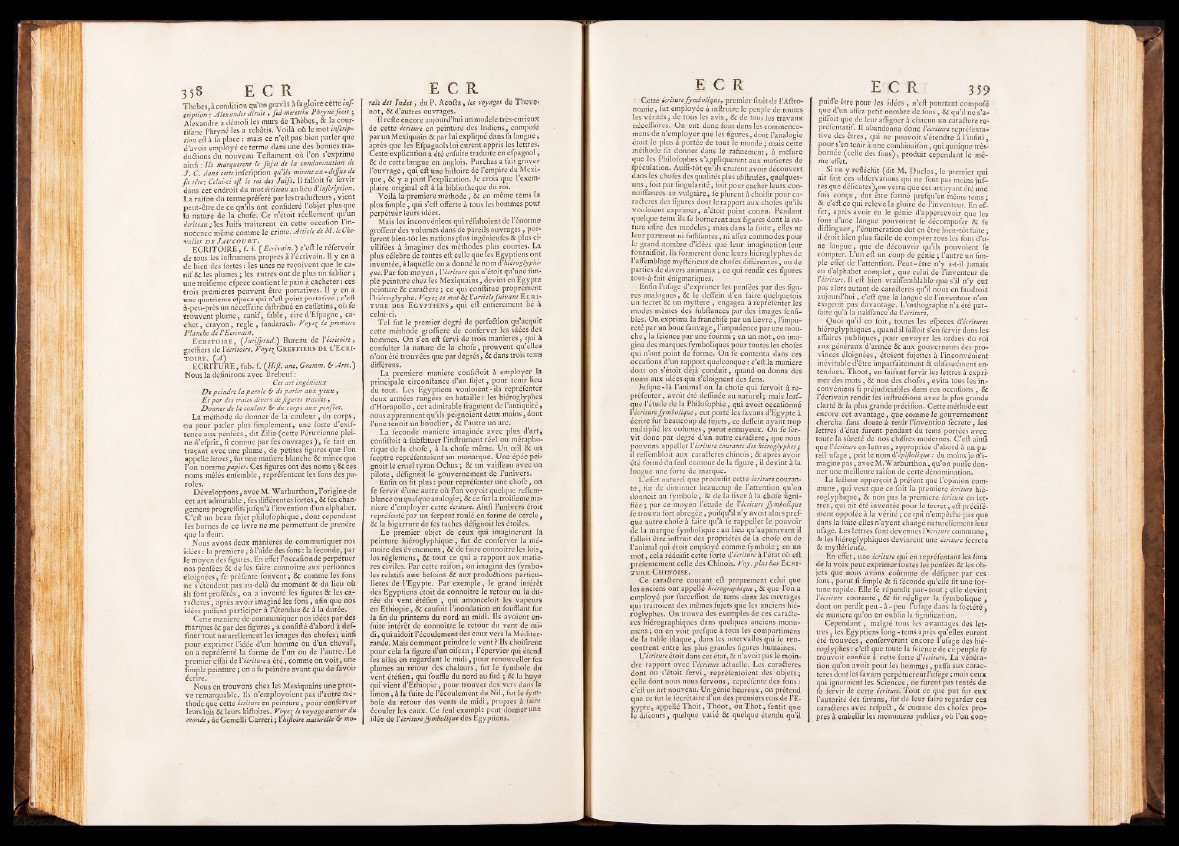
Thebes, à condition qu’ on gravât à fa gloîrô cëtte Inscription
: Altxandcr dirait, fedmeretrix Phrynefecit ;
Alexandre a démoli les murs de Thèbes, & la cour-
tifane Phryné les a rebâtis. Voilà oh le mot infeription
eft à la place : mais ce n’eft pas bien parler que
d’avoir employé ce terme dans une des bonnes trad
ition s du nouveau Teftament oîi l’on s’exprime
ainli : Ils marquèrent le fujet de la condamnation de
J. C. dans cette infeription qu'ils mirent au - deffus de
fa tête: Celui-ci eft le roi des Juifs. Il failoit fe fervir
dans cet endroit du mot écriteau au lieu d’infeription.
La raifon du terme préféré par les traducteurs, vient
peut-être de ce qu’ils ont confideré l’objet plus que
la nature de la ebofe. Ce n’étoit réellement qu un
écriteau; les Juifs traitèrent en cette occafion l’innocence
même comme le crime. Article de M. le Chevalier
DE J AU COU RT.
ECRITOIRE, f. f. (Ecrivain.) c’eft le refervoir
de tous les inftrumens propres à l’écrivain. Il y en a
de bien des fortes : les unes ne reçoivent que le canif
& les plumes ; les autres ont de plus un fablier ;
une troifieme efpece contient le pain à cacheter : ces
trois premières peuvent être portatives. Il y en a
une quatrième efpece qui n’eft point portative ; c’eft
à-peu-près un néceffaire diftribué en caffetins, oii fe
trouvent plume, canif, fable, cire d’Efpagne, cachet
, cra yon, réglé , fandarach. Voye{ la première
Planche de C Ecrivain.
E c r it o i r e , (Jurifprud.) Bureau de Yécritoire,
greffiers de Yécritoire. Voye^ G r e f f ie r s d e l’E c r i-
t o i r e . ( A )
ECRITURE, fub. f. (Hift. anc. Gramm. & Arts. )
Nous la définirons avec Brebeuf:
Cet art ingénieux
De peindre la parole & de parler aux yeux >
E t par des traits divers de figures tracées ,
Donner de la couleur & du corps aux penfées.
La méthode de donner de la couleur, du corps,
nu pour parler plus Amplement, une forte d’exif-
tence aux penfées, dit Zilia (cette Péruvienne pleine
d’efprit, fi connue par fes ouvrages), fe fait en
traçant avec une plume, de petites figures que l’on
appelle lettres, fur une matière blanche & mince que
l ’on nomme papier. Ces figures ont des noms ; 8c ces
noms mêlés enfemble, repréfentent les fons des paroles.
Développons, avec M. 'Varburthon, l’origine de
cet art admirable, fes différentes fortes, & fes chan-
gemens progreffifs jufqu’à l’invention d’un alphabet.
C ’eft un beau fujet philofophique, dont cependant
les bornes de ce livre ne me permettent de prendre
que la-fleur. ^
Nous avons deux maniérés de communiquer nos
idées : la première, à l’aide des fons : la fécondé, par
le moyen des figures. En effet l’occafionde perpétuer
nos penfées 8c de les faire connoître aux perfonnes
éloignées, fe préfente fottvent ; Ôc comme les fons
ne s’étendent pas au-delà du moment & du lieu où
ils font proférés, on a inventé les figures & les Ca-
rafteres, après avoir imaginé les fons, afin que nos
idées puffent participer à l’étendue & à la durée.
Cette maniéré de communiquer nos idées par des
marques & par des figures, a confifté d’abord à def-
finer tout naturellement les images des chofes ; ainfi
pour exprimer l’idée d’un homme ou d’un cheval,
on a repréfenté la forme de l’un ou de l’autre.: Le
premier effai de Y écriture a été 9 comme on vo it , une
fimple peinture ; on a fu peindre avant que de favoir
écrire.
Nous en trouvons chez les Mexiquains une preuve
remarquable. Ils n’employoient pas d’autre méthode
que cette écriture en peinture, pour conferver
leurs lois & leurs hiftoires. Voye^ le voyage autour du
monde > de Gemelli Car reri j Yhifioire naturelle & movolt
dis Indes, 'du Y. Acofta, les voyages de Theve*
not, 8c d’autres ouvrages.
Il refte encore aujourd’hui urimodèle très-curieux
de cette écriture en peinture des Indiens, compofé
par un Mexiquain 8c par lui expliqué dans fa langue ,
après que les Efpagnols lui eurent appris les lettres.
Cette explication a été enfuite traduite en efpagnol,
6c de cette langue en ânglois. Purchasafait graver
l ’ouvrage, qui eft une hiftoire de l’empire du Mexique
, 6c y a joint l’explication. Je crois que l’exemplaire
original eft à la bibliothèque du roi.
Voilà la première méthode, 8c en même tems la
plus fimple, qui s’eft offerte à tous les hommes pouf
perpétuer leurs idées.
Mais les inconvéniens qui réfultoient de l’énorme
groffeur des volumes dans de pareils ouvrages, portèrent
bien-tôt les nations plus ingénieufes 6c plus ci-
vilifées à imaginer des méthodes plus courtes. La
plus célébré de toutes eft celle que les Egyptiens ont
inventée, à laquelle on a donné le nom à?hiéroglyphique.
Par fon m oyen, Y écriture qui n’étoit qu’une fimple
peinture chez les Mexiquains, devint en Egypte
peinture 6c caraâere ; ce qui conftitue proprement
l’hiéroglyphe. Voye{ ce mot 8c Y article fuivant E criture
des Egypt iens , qui eft entièrement lié à
celui-ci.
Tel fut le premier degré de perfeâion qu’acquit
cette méthode groffiere de conferver les idées des
hommes. On s’en eft fervi de trois maniérés, qui à
confulter la nature de la chofe, prouvent qu’elles
n’ont été trouvées que par degrés, 8c dans trois tems
différens.
La première maniéré confiftoit à employer la
principale circonftance d’un fujet, pour tenir lieu
du tout. Les Egyptiens vouloient - ils repréfenter
deux armées rangées en bataille : les hiéroglyphes
d’Horapollo, cet admirable fragment de l’antiquité ÿ
nous apprennent qu’ils peignoient deux mains, dont
l’une tenoit un bouclier, 6c l’autre un arc.
La fécondé maniéré imaginée avec plus d’art,
confiftoit à fubftituer l’inftrument réel ou métaphorique
de la chofe , à la chofe même. Un oeil ôc un
feeptre repréfentoient un monarque. Une épée pei-
gnoit le cruel tyran Ochus ; 6c un vaiffeau avec un
pilote, défignoit le gouvernement de l’univers.
Enfin on fit plus : pour repréfenter une chofe, on
fe fervit d’une autre où l’on voyoit quelque reffem-
blance ou quelque analogie ; 6c ce fut la troifieme maniéré
d’employer cette écriture. Ainfi l’univers étoit
repréfenté par un ferpent roulé en forme de cercle,
6c la bigarrure de fes taches défignoit les étoiles.
Le premier objet de ceux qui imaginèrent la
peinture hiéroglyphique, fut de conferver la mémoire
des évenemens, ôc de faire connoître les lois %
les réglemens, 6c tout ce qui a rapport aux matières
civiles. Par cette raifon, on imagina des fymbo*
les relatifs aux befoins 6c aux produttions particulières
de l ’Egypte. Par exemple, le grand intérêt
des Egyptiens étoit de connoître le retour ou la durée
du vent étéfien , qui amonceloit les vapeurs
en Ethiopie, 6c caufoit l’inondation en foufflant fur
la fin du printems du nord au midi. Ils a voient en-
fuite intérêt de connoître le retour du vent de mi*
di, qui aidoitl’écoulement des eaux vers la Méditerranée.
Mais comment peindre le vent ? Ils choifirent
pour cela la figure d’un oifeau ; l’épervier qui étend
fes aîles en regardant le midi, pour renouveller fes
plumés au retour dès chaleurs, fut le fymbole du
vent étéfien, qui fouffle du nord au fud ; 6c la huye
qui vient d’Etniopie, pour trouver des vers dans le
limon, à la fuite de l’écoulement du Nil, fut le fymbole
du retour des vents de midi, propres à faire
écouler les eaux. Ce feul exemple peut donner une
idée de Y écriture Symbolique des Egyptiens.
■ Cette écriture fymbcrliquey premier fruit de EAftro-
nomie, fut employée à inftruire le peuple de toutes
les vérités, de tous les avis , 6c de tous les travaux
néceffaires. On eut donc foin dans les commence-
mens de n’employer que les figures, dont l’analogie
étoit le plus à portée de tout le monde ; mais cette
méthode fit donner dans le rafinement, à mefure
que les Philofophes s ’appliquèrent aux matières de
fpeculation. Auffi-tôt qu’ils crurent avoir découvert
dans les chofes des qualités plus abftrufes, quelques-
uns , foit par fingularité, foit pour cacher leurs con-
noiffances au vulgaire, fe plurent à choifir pour ca-
raûeres des figures dont le rapport aux chofes qu’ils
vouloient exprimer, n’étoit point connu. Pendant
quelque tems ils fe bornèrent aux figures dont la nature
offre des modèles ; mais dans la fuite, elles ne
leur parurent ni fuffifantes, ni affez commodes pour
le grand nombre d’idées que leur imagination leur
fourniffoit. Ils formèrent donc leurs hiéroglyphes de
l’affemblage myftérieux de chofes différentes, ou de
parties de divers animaux ; ce qui rendit ces figures
tout-à-fait énigmatiques.
Enfin l’ufage d’exprimer les penfées par des figures
analogues, 6c le deffein d’en faire quelquefois
un fecret 6c un myftere , engagea à repréfenter les
modes mêmes des fubftances par des images fenfi-
bles. On exprima la franchife par un lievre, l’impureté
par un bouc fauvage, l’impudence par une mouche
, la fcience par une fourmi ; en un m ot, on imagina
des marques fymboliques pour toutes les chofes
qui n’ont point de forme. On fe contenta dans ces
occafions d’un rapport quelconque : c’eft la maniéré
dont on s’étoit déjà conduit, quand on donna des
noms aux idées qui s’éloignent des fens.
Jufque-là l ’animal ou la chofe qui fervoit à repréfenter
, avoit été deffinée au naturel ; mais lorf-
que l’étude de la Philofophie, qui avoit occafionné
Xécriture fymbolique , eut porté les favans d’Egypte à
écrire fur beaucoup de fujets, ce deffein ayant trop
multiplié les volumes, parut ennuyeux. On fe fervit
donc par degré d’un autre cara&ere, que nous
pouvons appeller Y écriture courante des hiéroglyphes ;
il reffembloit aux carafteres chinois ; Sc après avoir
été formé du feul contour de la figure, il devint à la
loqgue une forte de marque.
L’effet naturel que produifit cette écriture courante
, fut de diminuer beaucoup de l’attention qu’on
donnoit au fymbole, & de la fixer à la chofe figni-
fiée ; par ce moyen l’étude de Y écriture fymbolique
fe trouva fort abrégée, puifqu*il n’y avoit alors pref-
que autre chofe à faire qu’à fe rappeller le pouvoir
de la marque fymbolique : au lieu qu’auparavant il
failoit être inftruit des propriétés de la chofe ou de
l ’animal qui étoit employé comme fymbole ; en un
mot, cela réduifit cette lorte d'écriture à l’état où eft
préfentement celle des Chinois. Voy. plus bas Ecr iture
C hinoise.
Ce cara&ere courant eft proprement celui que
les anciens ont appellé hiérographique, 8c que l’on a
employé par fucceffion de tems dans les ouvrages
qui traitoient des mêmes fujets que les anciens hié—
roglyphes. On trouve des exemples de ces caractères
hiérographiques dans quelques anciens monu-
mens ; on en voit prefque à tous les compartimens
de la table iliaque, dans les intervalles qui fe rencontrent
entre les plus grandes figures humaines.
L'écriture étoit dans cet état, & n’avoit pas le moindre
rapport avec Y écriture actuelle. Les caraCteres
dont on s’étoit fe rvi, repréfentoient des objets ;
celle dont nous nous fervons, repréfente des fons :
c ’eft un art nouveau. Un génie heureux, on prétend
que ce-fut le fecrétaire d’un des premiers rois de l’Egypte,
appellé Thoit, Thoot, ou T h o t, fentit que
le difeours, quelque varié 6c quelque étendu qu’il
puiffé être pour les idées , n’eft pourtant compofé
que d’un affez petit nombre de fons, 6c qu’il ne s’a-
giffoit que de leur affigner à-chacun un cara&ere re-
prelentatif. Il abandonna donc Y écriture repréfenta-
tive des etres, qui ne pouvoir s’étendre à l ’infini,
pour s’en tenir à.une combinaifon, qui quoique très-
bornee (celle des fons)-, produit cependant le mê-
ihe effet.
. ^ on y réfléchit (dit M. Duclos, le premier qui
ait fait ces obfervations qui ne font pas moins juf-
tes que délicates),on verra, que cet art ayant été une
fois conçu, dut être formé prefqu’en même tems ;
& c’eft ce qui releve la gloire de l’inventeur. En effet
, après avoir eu le génie d’appercevoir que les
fons d’une langue pouvoient fe décompofer 6c fe
diftinguer-, l’énumération dut en être bien-tôt faite ;
il étoit bien plus facile de compter tous les fons d’une
langue, que de découvrir qu’ils pouvoient fe
compter. L’un eft un coup de génie ; l’autre un fimple
effet de l’attention. Peut-être n’y a-t-il jamais
eu d’alphabet complet, que celui de l’inventeur de
Y écriture. Il eft bien vràiflemblable que s’il n’y eut
pas alors autant de carafteres qu’il nous en faudroit
aujourd’hui, c’eft que la langue de l’inventeur n’en
exigeoit pas davantage. L’orthographe n’a été par-,
faite qu’à la naiffance de Y écriture.
Quoi qu’il en foit, toutes les efpeces d'écritures
hiéroglyphiques, quand il failoit s’en fervir dans les
affaires publiques, pour, envoyer les ordres du roi
aux généraux d’armée 8c aux gouverneurs des provinces
éloignées , étoient fujettés à l’inconvénient
inévitable d’être imparfaitement 8c obfeurément entendues.
Thoot, en faifant fervir les lettres à exprimer
des mots, 6c non des chofes, évita tous les inconvéniens
fi préjudiciables dans ces occafions , &
l ’écrivain rendit fes inftruéfions avec la plus grande
clarté 8c la plus grande précifion. Cette méthode eut
encore c et avantage, que comme le gouvernement
chercha fans doute à tenir l’invention fecrete, les
lettres d’état furent pendant du tems portées avec
toute la sûreté de nos chiffres modernes. C ’eft ainfi
que Y écriture en lettres, appropriée d’abord à un pareil
ufage, prit le nom d’épijlolique : du moins je it’i—
magine pas, avec M."Warburthon, qu’on puiffe donner
une meilleure raifon de cette dénomination»
Le le&eur apperçoit à préfent que l’opinion commune
, qui veut que ce foit la première écriture hiéroglyphique
, 8c non pas la première écriture en lettres
, qui ait été inventée pour le fecret, eftlpjrécifé-
ment oppofée à la vérité ; ce qui n’empêche ’$as que
dans la fuite elles n’ayent changé naturellement leur
ufage. Lès lettres fpnt devenues Yécriture commune,
8c lès hiéroglyphiques devinrent une écriture fecrete
8c myftérieufe.
En effet, une écriture qui en repréfentant les fons
de la voix peut exprimer toutes les penfées & les où-
jets que nous' avons coutume de défigner par ces
fons, parut fi fimple 8c fi féconde qu’elle fit une fortune
rapide. Elle fe répandit par- tout ; elle devint
Y écriture courante , & fit négliger la. fymbolique f
dont on perdit peu - à - peu 1-ulage dans la fociété ,
de maniéré qu’on en oublia la lignification.
Cependant, malgré tous les avantages des lettres
, les Egyptiens long - tems après qu’elles eurent
été trouvées , confervèrent encore Eufage des hié-
roglyphes .* ç’eft que toute la fcience de ce peuple fe
trôuvoit confiée à cette forte d'écriture. La vénération
qu’on avoit pour les hommes, paffa aux caractères
dont les favans perpétuèrent l’ufage ; mais Ceux
qui ignoroient les Sciences, ne furent pas tentés de
le fervir de cette écriture. Tout ce que put fur eux
l’autorité des favans, fiit de leur faire regarder ces
caraôeres avec refpeft , 8c comme des chofes propres
à embellir les monumens publics, où l’on con