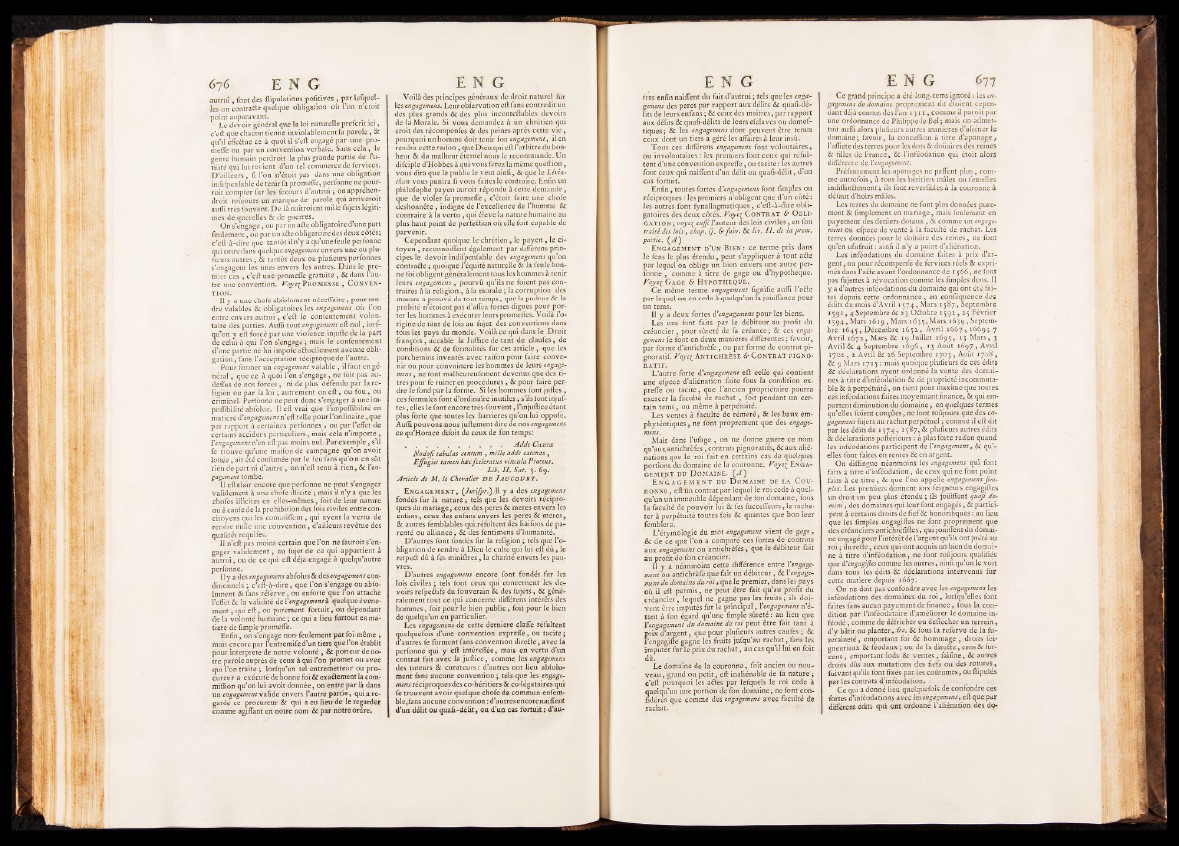
autrui, font des ftipulations pofitives, par lefquel-
les on contratte quelque obligation oii l’on n’étoit
point auparavant. .
Le devoir général que la loi naturelle preferit ici,
c’eft que chacun tienne inviolablement fa parole, &
qu’il effectue ce à quoi il s’eft engagé par une pro-
mefle ou par un convention verbale. Sans cela, le
genre humain perdroit la plus grande partie de l’utilité
qui lui revient d’un tel commerce de fervices.
D ’ailleurs, fi l’on n’étoit pas dans une obligation
indifpenfable de tenir fa promeffe, perfonne ne pour-
roit compter fur les fecours d’autrui ; onappréhen-
droit toujours un manque de parole qui arriveront
auffi très fouvent. D e là naîtroient mille fujets légitimes
de querelles & de guerres.
' On s’engage, ou par un a£le obligatoire d’une part
feulement, ou par un aéte obligatoire des deux cotes;
c’eft à-dire que tantôt il n’y a qu’une feule perfonne
qui entre dans quelque engagement envers une ou plufieurs
autres, & tantôt deux ou plufieurs perfonnes
s’engagent les unes envers les autres. Dans le premier
cas , c’eft une promeffe gratuite, 6c dans l’autre
une convention. Voye^ Promesse , Convention.
Il y a une chofe abfolument néceffaire, pour rendre
valables 6c obligatoires les tngagemens oh l’on
entre envers autrui, c’eft le contentement volontaire
des parties. Auffi tout engagement eft nul, lorsqu'on
y eft forcé par une violence injufte de la part
de celui à qui l’on s’engage ; mais le confentement
d’une partie ne lui impofe aéiucllement aucune obligation
j fans l’acceptation réciproquede l’autre.
Pour former un engagement valable , il faut en général
, que ce à quoi l’on s’engage, ne foit pas au-
deffus de nos forces, ni de plus défendu par la religion
ou par la loi ; autrement on eft , ou fou, ou
criminel. Perfonne ne peut donc s’engager à une im-
poffibiliré abfolue. Il eft vrai que l’impoffibilité en
matière Rengagement n’eft telle pour l’ordinaire ,que
par rapport à certaines perfonnes , ou par l’effet de
certains accidens particuliers, mais cela n’importe,
Y engagement R en eft pas moins nul. Par exemple, s’il
fe trouve qu’une maifon de campagne qu’on avoit
loiiée, ait été confumée par le feu fans qu’on en sût
rien de part ni d’autre, on n’eft tenu à rien, & Y engagement
tombe.
Il eft clair encore que perfonne ne peut s’engager
Validement à une chofe illicite ; mais il n’y a que les
"chofes illicites en elles-mêmes , foit de leur nature
ou à caufe de la prohibition des lois civiles entre concitoyens
qui les connoiffent, qui ayent la vertu de
rendre nulle une convention, d’ailleurs revêtue des
qualités requifes.
Il n’eft pas moins certain que l’on ne fauroit s’engager
validement, au fujet de ce qui appartient à
autrui, ou de ce qui eft déjà engage à quelqu’autre
perfonne.
Il y a des engagemens abfolus & des engagemens conditionnels
; c’eft-à-dire, que l’on s’engage ou abfolument
& fans réferve, ou enforte que l’on attache
l’effet & la validité de l’engagement^ quelque événement
, qui eft, ou purement fortuit, ou dépendant
de la volonté humaine; ce qui a lieu furtout en matière
de fimple promeffe.
Enfin, on s’engage non-feulement par foi-même *
mais encore par l’entremife d’un tiers que l’on établit
pour interprète de notre volonté , 6c porteur de notre
parole auprès de ceux à qui l’on promet ou avec
qui l’on traite ; lorfqu’un tel entremetteur ou procureur
a exécuté de bonne foi & exactement la com-
miffion qu’on lui avoit donnée, on entre par là danà
un engagement valide envers l’autre partie, qui a regardé
ce procureur & qui a eu lieu1 de le regarder
comme agiffant en notre nom 6c par notre ordre.
Voilà des principes généraux de droit naturel fur
les engagemens. Leur obfervation eft fans contredit un
des plus grands 6c des plus inconteftables devoirs
de la Morale. Si vous demandez à un chrétien qui
croit des récompenfes & des peines après cette v ie ,
pourquoi un homme doit tenir fon engagement, il en
rendra cette raifon, que Dieu qui eft l’arbitre du bonheur
& du malheur éternel nous le recommande. Un
difciple d’Hobbes à qui vous ferez la même queftion,
vous dira que le public lé veut ainli, & que le Leviathan
vous punira fi vous faites le contraire. Enfin un
philofophe payen auroit répondu à cette demande ,
que de violer fa promeffe , c’étoit faire une chofe
deshonnête , indigne de l’excellence de l’homme &
contraire à la vertu, qui éleve la nature humaine au
plus haut point de perfe&ion oh elle foit capable de
parvenir.
Cependant quoique le chrétien, le payen , le citoyen
, reconnoiffent également par différens principes
le devoir indifpenfable des engagemens qu’on
contrarie ; quoique l’équité naturelle & la feule bonne
foi obligent généralement tous les hommes à tenir
leurs engagemens , pourvu qu’ils ne foient pas contraires
à la religion , à la morale ; la corruption des
moeurs a prouvé de tout temps, que la pudeur 6c la
probité n’étoient pas d’affez fortes digues pour porter
les hommes à exécuter leurs promeffes. Voilà l’origine
de tant de lois au fujet des conventions dans
tous les pays du monde. Voilà ce qui dans le Droit
françois, accable la Juftice de tant de claufes, de
conditions & de formalités fur cet article , que les
parchemins inventés avec raifon pour faire convenir
ou pour convaincre les hommes de leurs engagemens
, ne font malheureufement devenus que des titres
pour fe ruiner en procédures , & pour faire perdre
le fond par la forme. Si les hommes font jùftes ,
ces formules font d’ordinaire inutiles ; s’ils font injuf-
tes, elles le font encore très-fouvent, l’injuftice étant
plus forte que toutes les barrières qu’on lui oppofe.
Auffi pouvons-nous juftement dire de nos engagemens
ce qu’Horace difoit de ceux de fon temps:
....................................................Ad.de Cicuttz
Nodojî tabulas centum , mille adde catenas ,
Effugiet tamen hoec feeleratus vincula Proteus.
Lib. II. Sat. 3. 69.
Article de M. le Chevalier D E J A U COU R T .
Engagement, (Jurifpr.).Il y a des engagemens
fondés fur la nature ; tels que les devoirs réciproques
du mariage, ceux des peres 6c meres envers les
enfans, ceux des enfans envers les peres 6c meres,
& autres femblables qui réfultent des liaifons de parenté
ou alliance, 6c des fentimens d’humanité.
D’autres font fondés fur la religion ; tels que l’obligation
de rendre à Dieu le culte qui lui eft dû, le
relpeft dû à fes miniftres, la charité envers les pauvres.
D ’autres engagemens encore font fondés fur les
lois civiles ; tels font ceux qui concernent les devoirs
refpeftifs du fouverain 6c des fujets, 6c généralement
tout ce qui concerne différens intérêts des
hommes, foit pour le bien public, foit pour le bien
de quelqu’un en particulier.
Les engagemens de cette derniere claffe réfultent
quelquefois d’une convention expreffe, ou tacite ;
d’autres fe forment fans convention direûe, avec la
perfonne qui y eft intéreffée, mais en vertu d’un
contrat fait avec la juftice, comme les engagemens
des tuteurs & curateurs : d’autres ont lieu abfolument
fans aucune convention ; tels que les engagemens
réciproques des co-héritiers & co-légataires qui
fe trouvent avoir quelque chofe de commun enfem-
ble,fans aucune convention : d’autres encore naiffent
d’un délit ou quafi-délit, ou d’un cas fortuit : d’aufres
enfin naiffent du fait d’autrui ; tels que les engagemens
des peres par rapport aux délits 6c quafi-dé-
lits de leurs enfans ; 6c ceux des maîtres, par rapport
aux délits 6c quafi-délits de leurs efclaves ou domef-
tiques ; & les engagemens dont peuvent être tenus
ceux dont un tiers a géré les affaires à leur insû.
Tous ces différens engagemens font volontaires,
ou involontaires : les premiers font ceux qui réfultent
d’une convention expreffe, ou tacite : les autres
font ceux qui naiffent d’un délit ou quafi-délit, d’un
cas fortuit.
Enfin, toutes fortes R tngagemens font fimples ou
réciproques : les premiers n’obligent que d’un côté :
les autres font fynallagmatiques, c’eft-à-dire obligatoires
des deux côtés. Voye£ Contrat & Obligation
; voye{ aujji l’auteur des lois civiles, en fon
traité des lois , chap. ij. & fuiv. 6c tiv. II. de la prem.
partie. {A } Engagement d’un Bien : ce terme pris dans
le fens le plus étendu, peut s’appliquer à tout afte
par lequel on oblige un bien envers une autre perfonne
, comme à titre de gage ou d’hypotheque.
Voye^ Gage O Hypotheque.
Ce même terme engagement lignifie auffi l ’afte
par lequel on en cede à quelqu’un la joiiiffance pour
un tems.
Il y a deux fortes R engagemens pour les biens.
Les uns font faits par le débiteur au profit du
créancier, pour sûreté de fa créance ; & ces engagemens
fe font en deux maniérés différentes ; favoir,
par forme d’antichrèfe, ou par forme de contrat pignoratif.
Foyei ANTICHRÈSE & CONTRAT PIGNORATIF.
L ’autre forte Rengagement eft celle qui contient
une efpece d’aliénation faite fous la condition expreffe
ou tacite, que l ’ancien propriétaire pourra
exercer la faculté de rachat , foit pendant un certain
tems, ou même à perpétuité.
Les ventes à faculté de réméré, & les baux emphytéotiques
, ne font proprement que des engagemens.
Mais dans l’ufage , on ne donne guere ce nom
qu4auxantichrèfes, contrats pignoratifs, 6c aux aliénations
que le roi fait en certains cas de quelques
portions du domaine de la couronne. Voye^ Engagement
du Domaine. (A ) E n g a g em e n t du D omaine de la Couronne
, eft Un contrat par lequel le roi cede à quelqu’un
un immeuble dépendant de fon domaine, fous
la faculté de pouvoir lui & fes fucceffeurs, le racheter
à perpétuité toutes fois 6c quantes que bon leur
femblera.
L’étymologie du mot engagement vient de gage,
& de ce que l’on a comparé ces fortes de contrats
aux engagemens ou antichrèfes, que le debiteur fait
au profit de fon créancier.
Il y a néanmoins cette différence entre Yengagement
ou antichrèfe que fait un débiteur, 6c Y engagement
du domaine du roi y que le premier, dans les pays
où il eft permis, ne peut être fait qu’au profit du
créancier, lequel ne gagne pas les fruits ; ils doivent
être imputés fur le principal , Y engagement n’étant
à fon égard qu’une fimple sûreté : au lieu que
Y engagement du domaine du roi peut être fait tant à
prix d’argent, que pour plufieurs autres caufes ; &
l’engagifte gagne les fruits jufqu’au rachat, fans les
imputer fur le prix du rachat ; au cas qu’il lui en foit
dû. • ' -. •
Le domaine de la couronne, foit ancien ou nouveau,
grand ou petit, eft inaliénable de fa nature;
c’eft pourquoi les a£les par lefquels le roi cede à
quelqu’un une portion de fon domaine, ne font con-
fidéres que comme des engagemens avec faculté de
rachat.
Ce grand principe a été long-tems ignoré : les engagemens
du domaine proprement dit étoient cependant
déjà connus dès l’an 131 1 , comme il paroît par
une ordonnance de Philippe-Ie-Bel ; mais on admet-
toit auffi alors plufieurs autres maniérés d’aliéner le
domaine; favoir, la conceffion à titre d’apanage,
l’affiete des terres pour les dots & douaires des reines
& filles de France, 6c l’inféodation qui étoit alors
différente de Y engagement.
Préfentement les apanages ne paffent plus, comme
autrefois, à tous les héritiers mâles ou femelles
indiftinttement ; ils font reverfibles à la couronne à
défaut d’hoirs mâles.
Les terres du domaine ne font plus données purement
& Amplement en mariage, mais feulement en
payement des deniers dotaux, & comme un engagement
ou efpece de vente à la faculté de rachat. Les
terres données pour le douaire des reines, ne font
qu’en ufufruit : ainfi il n’y a point d’aliénation.
Les inféodations du domaine faites à prix d’argent
, ou pour récompenfe de fervices réels & exprimés
dans l’ade avant l’ordonnance de 1566, ne font
pas fujettes à révocation comme les fimples dons. Il
y a d’autres inféodations du domaine qui ont été faites
depuis cette ordonnance, en conféquence des
édits du mois d’Avril 1574, Mars 1587, Septembre
15 9 1 ,4 Septembre 6c 23 Oftobre 15 91 ,2 5 Février
1594, Mars 16 19 ,Mars 1635,Mars i639,Septemr
bre 1645, Décembre 1652, Avril 1667, 1669; 7
Avril 1672, Mars 6c 19 Juillet 1695, 13 Mars, 3
Avril 6c 4 Septembre 1696 , 13 Août 1697, Avril
1702, 2 Avril & 26 Septembre 1703 , Août 1708 ,
6c 9 Mars 1715: mais quoique plufieurs de ces édits
6c déclarations ayent ordonné la vente des domaines
à titre d’inféodation 6c de propriété incommuta-
ble & à perpétuité, on tient pour maxime que toutes
ces inféodations faites moyennant finance, & qui emportent
diminution du domaine, en quelques termes
qu’elles foient conçûes, ne font toûjours que des engagemens
fujets au rachat perpétuel ; comme il eft dit
par les édits de 1574, 1587, & plufieurs autres édits
& déclarations poftérieurs : à plus forte raifon quand
les inféodations participent de Y engagement, 6c qu’-
elles font faites en rentes 6c en argent.
On diffingue néanmoins les engagemens qui font
faits à titre d’inféodation, de ceux qui ne font point
faits à ce titre, & que l’on appelle engagemens fimples.
Les premiers donnent aux feigneurs engagiftes
un droit un peu plus étendu ; ils joiiiffent quafi do-
mini y des domaines qui leur font engagés, & participent
à certains droits de fief 6c honorifiques : au lieu
que les fimples engagiftes ne font proprement que
des créanciers antichréfiftes, qui joiiiffent du domaine
engagé pour l’intérêt de l’argent qu’ils ont prété au
roi ; durefte, ceux qui ont acquis un bien du domaine
à titre d’inféodation, ne font toûjours qualifiés
que Rengagifies comme les autres, ainfi qu’on le voit
dans tous les édits 6c déclarations intervenus fur
cette matière depuis 1667.
On ne doit pas confondre avec les engagemens les
inféodations des domaines du roi, lorfqu’elles font
faites fans aucun payement de finance, fous la condition
par l’inféodataire d’améliorer le domaine inféodé,
comme de défricher ou deffécher un terrein,
d’y bâtir ou planter, & fous la referve de la fu-
'zeraineté , emportant foi 6c hommage , droits fei-
gneuriaux & féodaux ; ou de la direâe, cens & fur-
cens, emportant lods 6c ventes., faifiné, 6c autres
droits dûs aux mutations des fiefs ou des rotures,
fuivant qu’ils font fixés par les coûtumes, ou ftipulés
par les contrats d’inféodation.
Ce qui a donné lieu quelquefois de confondre ces
fortes d’inféodations avec lès engagemens, eft que par
-différens édits qui ont ordonné l’aliénation des do