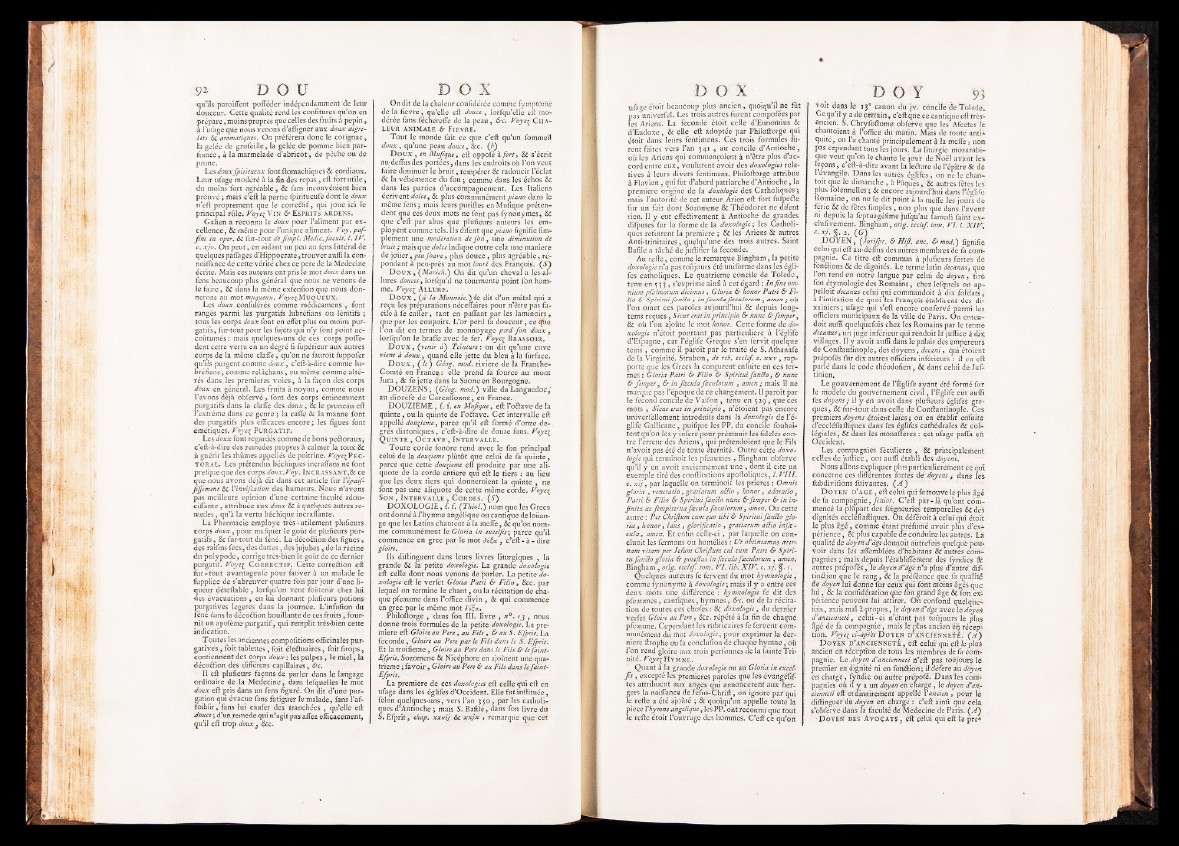
m d o u
qu’ils paroiffent pofféder indépendamment de lent
douceur. Cette qualité rend les confitures qu’on en
'prépare, moins propres que celles des fruits à pépin ,
à l’ufage que nous venons d’afligner aux doux aigrelets
Sc aromatiques. On préférera donc le cotignaC,
la gelée de grofeille, la gelée de pomme bien par*-
fumée, à la marmelade d’abricot, de pêche ou de
prune.
Les doux fpiritueux font ftomachiques & cordiaux.
Leur ufage modéré à la fin des repas, eft fort utile,
du moins fort agréable, & fans inconvénient bien
prouvé ; mais c’eft la partie fpiritueufe dont le doux
n’eft proprement que le correctif, qui joue ici le
principal rôle. VoyefVin & E s p r it s a r d è n s »
Galien a reconnu le doux pour l’aliment par excellence,
& même pour l’unique aliment. Voy.paf-
Jîm in oper. & fur-tout de Jimpl. Medic.facult. L IV ■
c. xjv. On peut, en aidant un peu au fens littéral de
quelques paflages d’Hippocrate, trouver aufli la con-
noiffance de cette vérité chez ce pere de la Medecine
écrite. Mais ces auteurs ont pris le mot doux dans un
fens beaucoup plus général que nous ne venons de
le faire, & dans la même extenfion que nous donnerons
au mot muqueux. J'ôyeç-MUQUEUX.
Les doux confédérés comme médicamens , font
rangés parmi les piirgatifs lubréfians ou lénitifs ;
tous les corps doux font en effet plus ou moins purgatifs,
fur-tout pour les fujets qui n’y font point accoutumés
: mais quelques-uns de ces corps poffe-
dent cette vertu en un degré fi fupérieur aux autres
corps de la même claffe, qu’on ne fauroit fuppofer
qu’ils purgent comme doux, c’eft-à-dire comme lu-
bréfîans, comme relâchans, ou même comme altérés
dans.les premières voies, à la façon des corps
doux en général. Les fruits à noyau, comme nous
l’avons déjà obfervé , font des corps éminemment
purgatifs dans la claffe des doux, & le pruneau eft
l ’extrême dans ce genre ; la caffe & la manne font
des purgatifs plus efficaces encore; les figues font
émétiques. Voye{ P u r g a t if .
Les doux font regardés comme de bons peétoraux,
c’eft-à-dire des remedes propres à calmer la toux &
à guérir les rhumes appellés de poitrine. Voye^ P e c t
o r a l . Les prétendus béchiques incraffans ne font
prefque que des corps doux.Voy. ÏNCRASSANT,& ce
que nous avons déjà dit dans cet article fur Yépaif-
fijfement & Yinvifcation des humeurs. Nous n’avons
pas meilleure opinion d’une certaine faculté adou-
ciffante, attribuée aux doux & à quelques autres re-
medes, qu’à la vertu béchique incraffante.
La Pharmacie employé très-utilement plufieurs
corps doux, pour mafquer le goût de plufieurs purgatifs
, & fur-tout du féné. La déco&ion des figues,
des raifins fecs, des dattes, des jujubes, de la racine
du pol-ypode, corrige très-bien le goût de ce dernier
purgatif. Voye^ C o r r e c t i f . Cette correction eft
fur-tout avantageufe pour fauver à un malade le
fupplice de s’abreuver quatre fois par jour d’une liqueur
déteftable , lorfqu’on veut foûtenir chez lui
des évacuations , en lui donnant plufieurs potions
purgatives legeres dans la journée. L’infufion du
ïéne dans la décoôion bouillante de ces fruits, fournit
un apofème purgatif, qui remplit très-bien cette
indication.
Toutes les anciennes comportions officinales purgatives
, foit tablettes, foit éleôuaires, foit firops,
contiennent des corps doux : les pulpes, le miel I la
déco&ion des différens capillaires, &c.
Il eft plufieurs façons de parler dans le langage
ordinaire de la Medecine, dans lefquelles le mot
doux eft pris dans un fens figuré. On dit d’une purgation
qui évacue fans fatiguer Je malade, fans l’af-
foiblir, fans lui caufer des tranchées , qu’elle eft
douce ; d’un remede qui n’agit pas affez efficacement,
qu’il eft trop doux^ &c.
D G X
O n d it de la ch aleu r confédérée com m e fym ptôrtiè
de la fie v re , qu ’elle eft douce , io rfq u ’elle eft m od
érée fans fécliereffe de la p e a u , &c. Voyeç C h a l
e u r a n im a l e & F ie v r e .
Tout le monde fait ce que c’eft qu’un fommeil
doux, qu’une peau douce, &c. (b)
D o u x , en Mujique, eft oppofé à fort, & s’écrit
au-deffus des portées, dans les endroits oii l’on veut
faire diminuer le bruit, tempérer & radoucir l’éclat
& la véhémence du fon ; comme dans les échos Sc
dans les parties d’accompagnement. Les Italiens
écrivent dolce, & plus communément piano dans le
même fens ; mais leurs purifies en Mufique prétendent
que ces deux mots ne font pas fynonymes, Si
que C’eft par abus que plufieurs aiiteurs lès em-
ployent comme tels. Ils difent que piano fignifie Amplement
une modération de fo n , une diminution de
bruit} mais que dolce indique outre cela une maniéré
de joiier, piu foave , plus douce, plus agréable, répondant
à peu-près au mot louré des François, (Y)
D o u x , (Maréch.) O n d it qu’u n c h ev al a les allu
res douces, Io rfq u ’il ne to u rm e n te p o in t fô n hom m
e. Voye^ A l l u r e .
D o u x , (à la Monnoie.) fe dit d’un métal qui a
reçu les préparations néceffaires pour n’être pas facile
à fe caffer, tant en paffant par les laminoirs ,
qiée par les coupoirs. L’or perd fa douceur, ce que
l ’on dit en termes de monnoyage perd fon doux ,
lorfqu’on le braffe avec le fer. Voye^ Br a s s o ir .
D o u x , (venir a) Teinture : on dit qu’une cuve
vient à doux, quand elle jette du bleu à la furface.
D o u x , ( /e ) Géog. mod. riviere de la Franche-
Comté en Franc%: elle prend fa fource au mont
Jura, & fe jette dans la Saône en Bourgogne.
DOUZENS, {Géog. mod.') ville du Languedoc,"
au diocèfe de Carcaffonne, en France.
DOUZIEME, f. f. en Mufique, eft l’oétaV e de la
quinte, ou la quinte de l’oûave. Cet intervalle eft
appellé douzième, parce qu’il eft formé d’onze d e -,
grés diatoniques, c’eft-à-dire de douze fons. Voyeç
Q u in t e , O c t a v e , In t e r v a l l e .
Toute corde fonore rend avec le fon principal
celui de la douzième plûtôt que celui de fa quinte,
parce que cette douzième eft produite par une ali-
quote de la corde entière qui eft le tiers : au lieu
que les deux tiers qui donneroient la quinte , ne
font pas une aliquote de cette même corde. Voye%
S o n , I n t e r v a l l e , C o r d e s . (X )
DOXOLOGIE, f. f. (Théol.) nom que les Grecs
ont donné à l’hymne angélique ou cantique de louange
que les Latins chantent à la meffe, & qu’on nomme
communément le Gloria in excelfis ; parce qu’il
commence en grec par le mot , c’eft - à - dire
gloil-Ci I
Ils diftinguent dans leurs livres liturgiques , la
grande & la petite doxologie. La grande doxologie
eft celle dont nous venons de parler. La petite doxologie
eft le verfet Gloria Patri & Filio , Sic. par
lequel on termine le chant, ou la récitation de chaque
pfeaume dans l’office divin , & qui commence
en grec par le même mot JVfa.
Philoftorgè , dans fon III. livre , n°. /j , nous
donne trois formules de la petite doxologie. La première
eft Gloire au Pere , au Fils , & au S. Efprit. La
fécondé, Gloire au Pere par le Fils dans le S. Efprit.
Et la troifieme, Gloire au Pere dans le Fils & le faine-
Efprit. Sozomene & Nicéphore en ajoutent une quatrième
; fàvoir, Gloire au Pere & au Fils dans le faint-
Efprit. •
La première de ces doxologies eft celle qui eft en
ufage dans les églifes d’Occident. Elle fut inftituée,
félon quelques-uns, vers l’an 350, par les catholiques
d’Antioche ; mais S. Bafile, dans fon livre dû
S, Efprit, chap. xxvij & x x jx , remarque que cet
D O X
tiiWe étoit beaucoup plus ancien, quoiqu’il ne fut
pas°uniyerfel. Les trois autres furent compofées par
les Ariens. La fécondé étoit celle d’Eiihomius &
d’Eudoxe, & elle eft adoptée par Philoftorgè qui
étoit dans leurs fentimèrts. Ces trois formulés frirent
faites vers l’àn 341 , àü concile d’Antioche,
où les Ariens qui comrnénçoient à h’êtrë pliis d’accord
entre-eux, voulurent avoir des doxologies relatives
à leurs divers fetttittiens. Philoftorgè attribue
à Flavien, qui fut d’abord patriarche d’Antioche, la
première origine de la doxologie des Gathôliqiiës ;
mais l’autorité de cet auteur Arien eft fort fulpë&e
fur un fait dont Sozomerte & Théodotët ne difent
rien. Il y eut effectivement à Antioche de grandes
difputes fur la forme de là doxologie ; les Catholiques
retinrent la première ; Si les Ariens & autres
Anti-trinitaires, quelqu’une des trois autres. Saint
Bafile a tâché de juftiner la fécondé.
Au refte, comme le remarque Bingham, la petite
doxologie n’a pas toûjours été uniforme dans les églifes
catholiques. Le quatrième concile de Tolede,
tenu en 533, s’exprime ainfi à cet égard : In fine otii-
nium pfalmorum dicimus , Gloria & honàr Patri & Filio
& Spiritui fanclo , in fieçula fceculorum , amen • oti
l’on omet ces paroles aujourd’hui & depuis long-
tems reçues, Sicut eràt in prihcipio & nuric & feriiper,
& où l’on ajoûtè lé mot honor. Cétte forme de doxologie
n’étoit pourtant pâs particulière à l’églife
d’Efpagne, car l ’églife Greque s’en fervit quelque
tems , comme il parôît par le traité de S. Athanafé
de la Virginité. Strabon, de reb. ècclef. c. xxv , rapporte
que les Grées la conçurent enfuite en ces termes
: Gloria Patri & Filio & Spiritui fanclo, & hune
& femper, & in foecula fzculdrüih ; amen • mais il he
marque pas l’époque dé ce changement. Il paroit par
le fécond concile de Vaifon , tenu en 529, que cès
mots , Sicut état in prihcipio, rt’étôient pas encofé
univërfellement introduits dans la doxologie dé l’églife
Gallicane, puifque les PP. du concile fouhai-
tent qu’on les y infère pour prémunir lés fidelés Contre
l’erreur des Ariens, qui prétendoiënt que le Fils
n ’avoit pas été dé toute éternité. Outre cette doxologie
qui terminoit lès pfeaumés , Bingham obfétve
qu’il y en âvoit anciennement urtè , dont il cite un
exemple tiré des conftitutions âpoftoliqties, l. VÎII.
c. x i j , par laquelle On terminoit les prières : OmniS
gloria , veneratio, gratiarum actio , JiohOr, adoratio ,
Patri & Filio & Spiritui fânclo hühc & femper & ih ih-
finita ac fempiterha foecula fcecülorum , amen. Ou Cette
autre : Per Chrifium cum quo tibi & Spiritui fàriîlo gloria
, honor, laus , glûrificâtio , gratiarutti deliô ihfoe-
cula, amen. Et enfin celle-ci , par laquelle on con-
cluoit les fermons OU homélies : Ut obtiheamus oeter-
nam vitam per Jefum Chrifium cui cum Pâtre & Spiri-
tu fanclo gloria & potefias.ih foecula foeculorum , afnen,
Bingham , orig. éedif. tohi. VI. lib. X IV. c. xj. § . /.
Quelques âuféurs fe fervent du mot hymnolàgie,
comme lynonyme à doxologie ; mais il y a entré ces'
deux mots lifte différence : hyrhnologie fe' dit des
pfeaumes, cantiques, hymnes, S’c. ou de la récita-*
tion de toutes cës chofes : St doxologie, du dernier
verfet Gloire aii Pere, &C. répété à là fin de châqtre'
pfeaume. Cependant les rUbricaireS fe fervent communément
du mot doxologie, pour exprimer la dernier
e ftrophe ou la conclu'fiôn de chaque hymne, Oit
l’on rend gloire aux-trois perfonnes de la laintë Trinité.
J'qyeç Hymn e.,
Quant à la grande doxologie Oti âU Gloria ih eXc'èl-
f i s , excepté lés premières paroles que les éVârtgé'fif-
tes attribuent aux anges qui annoncèrent aux bergers
la naiffance de Jefuâ-Chrift, on ignore par qui
le refte a été àjoûté ; & quoiqu’on appellé toute" là
piece Y hymne angelique, les PP. ont reconnu que tout
le refte étoit" l’ouvrage des hommes. C’eft ce qu’on
D O Y 95
vôit dans îè 13e canon du jv. concile dé Tolede-
Ce qu’il y a dé certain, c’eft que ce cantique eft très-
äncien. S. Chryfoftöme obfétve que les Afcetes lë
chantoient à l’officé dii mâtin. Mais de toute ânti*
quite, on l’a chanté principalement à la meffë > noh
pas cependant tous les jôiits. La liturgie mozatâbi-
que veut qu’on le chante le jour de Noël avant les
leçons ,_e eft-à-dire avant là leêlüre de l’épître & de 1 évangiles Dans les aütrés églifès , on ne le chàri1-
toit que le dimanche , à Pâques, & autres fêtes les
plus folennelles ; & encore aujourd’hui dans Péglife
Romaine, Oh he le dit point à la meffe les jours de
ferie & de fêtes Amples, non plus que dans Pavent
ni depuis la feptuàgéfime jufqu’au famedi fàint ex-
clufivemeht. Bingham, orig. ectlef. tom. VI. I. X IV
c. xj. § . z . {G)
•DOYEN, {Jurifpr. & Hfi. ahc. & rhod.) lignifie
celui qui eft au-deffus des autres membres dé fa compagnie.
Ce titre eft commun à plufieurs fortes dê
fondions & de dignités. Le terme latin decànusi que
l’on rend en notre langue pàt celui de doyen, tiré
fort étymologie des Romains, che t lefquels ort ap-
pelloit decàhus celui qui commandoit à dix földats V
à l’imitation de quoi les François établirent des di-
xainiers ; ufage qui s’eft encore confèrvé parmi les
officiers municipaux de la ville de Paris. On enten-
doit aufli quelquefois chez les Romains par le terme
decahus, un jugé inférieur quirèndoit là juftice à dix
villages. Il y avoit aufli dàrts le palais des empéreurà
de ConflantirtOple, des doyens, decani, qui éfoient
prépôfés ftir dix autres officiers inférieurs : il en eft
parlé dans le code théodofien, & dans celui de JuR
tihien.
Le gouvernement de FÉglife ayant été fo'tihé fut
le modele du gouvernement civil, FÉglife eut auflî
fês doyens ; il ÿ çti avoit dans plufieurs égliféà gre-
ques, St fur-tout dans celle dé Cortftantinöple. Ces
premiers doyens étoient laïcs ; ùli en établit ertfaite
d’eccléfiâftiques dans les églifes cathédrales St collégiales,
& dans les monaftères : cet ufage paffa en
Occident.
Les compagnies féculièrës , & prirtcipàlement
celles de juftice, ont aitfli établi des doyens.
Noiis allons expliquer plus particulièrement ce qui
concerne ces différentes fortes dé doyens , dans lei
ftibdivifiôns ftiivarttes.
D o y e n d ’a g è , eft celui qUrfé trouVe lé plus âgé
de fà compagnie, fenior. C ’eft par- là qu’ont commencé
la plûpatt des feigneiiries temporelles ôi des
dignités ecclefiàftiqae's. On déférôit à celui qirî étôit
le plus âgé, Cômme étant préfümé avoir plus d’expérience
, & pfiiS capable de conduire les antres. Là
qualité de doyert d'âgé donnoit airtrèfois quelquC'pOn-
voir dans les a'ffemblées cPhabifans & âutfes compagnies
; mais cfèpUis l’établiffement dés fyndics &
autres" p ré p ô fé s té doyen d’iïgè n’a: plus d’aütré" dif-
tinûion que le rang , & la préféance que fa qualité
de doyen lui döh'rte fùr ceUx'qni font moins âgés que
Itli, Si la côiilîdération qtté fon grand âge & fon eX-
périènce peuvcnt lui attirer. On confond quelquefois,
mais mal-àrpTopôs, 1 édoyehd'ûge avée le doyen
d'ancienneté, celui-Ci n’étant pas toûjours le plus
âgé de.fà compkgnie , mais fé plnS ancien é^récepi
tïôrt. Pfyèt ci-àprés DotÈN D^XN’èfENNÉ'i’E. {A )
D'oÿên d’ancienneté , eft cefiiî qui eft le plus
ancien en réception de* tous lés Membres de fa éOm^
pagnie. L e-doyen d'ancienneté û’éft pas, toujours lé
premier en dignité ùi en foiléliort ; il défère au doyen
eiï charge, fyndic OU autre prépofé. Dans les compagnies
OÙ il y a un doyen etl 'Cnârge, le dopen d’ancienneté
eft ordinairement appellé' Y ancien f pour ïè
diftinguêr'dü doyen ert'.charge : c’eft ainfi que celà
s’bbfëryé dàns là faculté de Médecine de Paris. (^ )
| D oÿ 'èN* dés' A v o c a t s , eft'celu i q u i eft le pre*