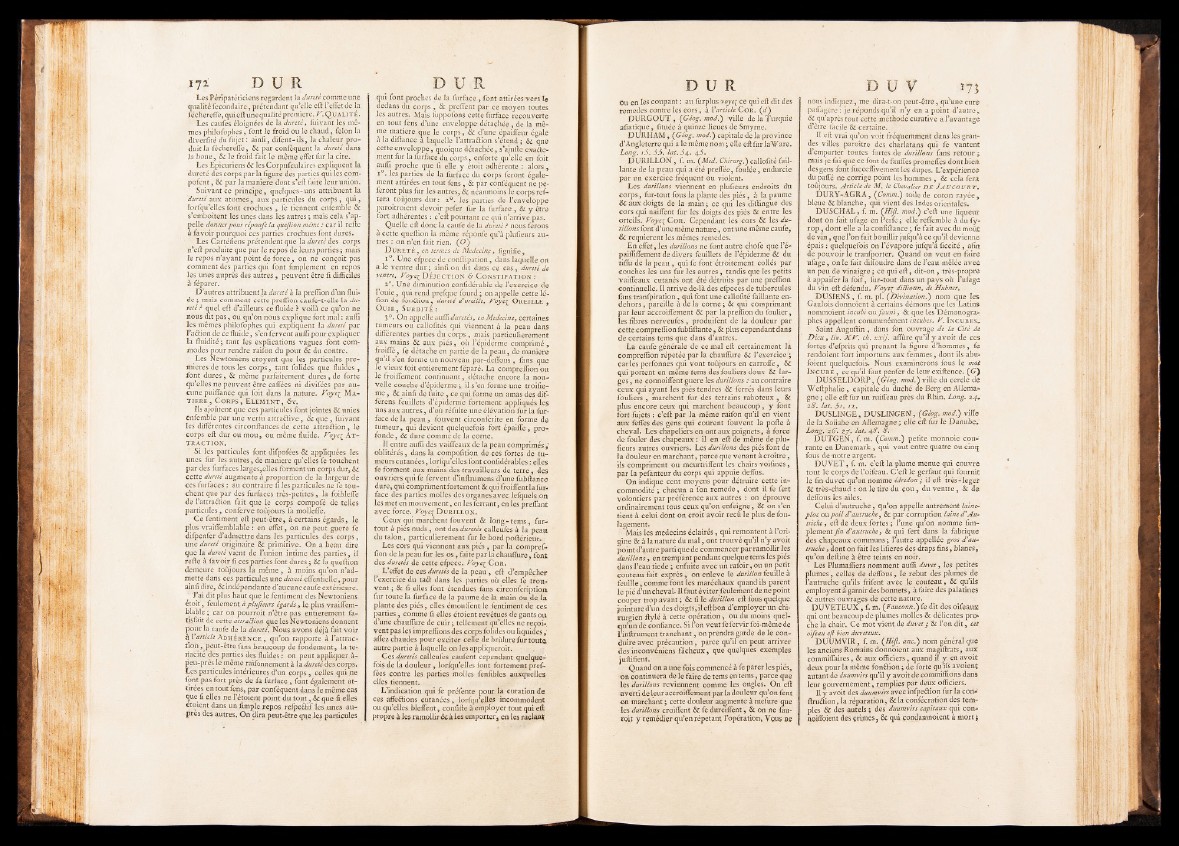
Les Péripatéticiens regardent la durai comme une
qualité fecondaire, prétendant qu’elle eft l’effet de la
féchereffe, qui eft une qualité première. V , Qualité.
Les caufes éloignées de la dureté, fuivant les mêmes
philofophes, font le froid ou le chaud, félon la
diverfiré du fùjet : ainfi, difent-ils, la chaleur produit
la féchereffe, & par conféquent la dureté dans
la boue, & le froid fait le même effet fur la cire.
Les Epicuriens & les Corpufculaires expliquent la
dureté des corps par la figure des parties qui les com-
pofent, & par la maniéré dont s’eft faite leur union.
Suivant ce principe, quelques-uns attribuent la
dureté aux atomes, aux particules du corps, qui,
lorfqu’elles font crochues , fe tiennent enfemble &
s’emboîtent les unes dans les autres ; mais cela s’appelle
donner pour réponfe la quejlion même : car il refte
à favoir pourquoi ces parties crochues font dures.
Les Cartéfiens prétendent que la dureté des corps
n’efi produite que par le repos de leurs parties ; mais
le repos n’ayant point de force , on ne conçoit pas
comment des parties qui font fimplement en repos
les unes auprès des autres, peuvent être fi difficiles
à féparer.
D ’autres attribuent ,1a dureté à la prefîion d’un fluide
; mais comment cette prefîion caufe-t-elle la dureté?
quel eff d’ailleurs ce fluide ? voilà ce qu’on ne
nous dit pas, ou qu’on nous explique fort mal : aufïi
les mêmes philofophes qui expliquent la dureté par
l’aétion de ce fluide, s’en fervent auffi pour expliquer
la fluidité ; tant les explications vagues font commodes
pour rendre raifon du pour & du contre.
Les Newtoniens croyent que les particules premières
de tous les corps, tant folides que fluides ,
font dures, & même parfaitement dures, de forte
qu’elles ne peuvent être caffées ni divifées par aucune
puiffance qui foit dans la nature. Voyeç M a t
i è r e , C o r p s , E l é m e n t , &c.
Ils ajoutent que ces particules font jointes & unies
énfemble par une vertu attra&ive, & que , fuivant
les différentes circonffances de. cette attraûion, le
corps eft dur ou mou, ou même fluide. Voye£ A t t
r a c t io n .
Si les particules font difpofées & appliquées les
unes fur les autres, de maniéré qu’elles fe touchent
par des furfaCes larges,elles forment un corps dur, &
cette dureté augmente à proportion de la largeur de
ces furfaces : au contraire fi les particules ne fe touchent
que par des furfaces très-petites , la foibleffe
de l’attraûion fait que le corps compofé de telles
particules, conferve toujours fa molleffe.
Ce fentimeiit eft peut-être, à certains égards, le
plus vraiffemblable : en effet, on ne peut guere fe
difpenfer d’admettre dans les particules des corps,
une dureté originaire & primitive. On a beau dire
que la dureté vient de l’union intime des parties, il
refte à favoir fi ces parties font dures ; & la queftion
demeure toujours la même, à moins qu’on n’admette
dans ces particules une dureté effentielle, pour
ainfi dire, & indépendante d’aucune caufe extérieure.
J’ai dit plus haut que le fentiment des Newtoniens
étoit, feulement à plufieurs égards , le plus vraiffem-
blable ; car On pourroit n’être pas entièrement fa-
tisfait de cette attraction que les Newtoniens donnent
pour la caufe de la dureté. Nous avons déjà fait voir
à Varticle A d h é r e n c e , qu’on rapporte à l’attraction
, peut-être fans beaucoup de fondement, la ténacité
des parties des fluides : on peut appliquer à-
peu-près le même raifonnement à la dureté des corps.
Les particules intérieures d’un corps, celles qui ne
fpnt pas fort près de fa furface, font également attirées
entoutfens, par conféquent dans le même cas
cpe fi elles ne l’étoient point du tout, & que fi elles
etoient dans un fimgle repos refpeâif les unes auprès
des autres. On dira peut-être que les particules
qui font proches çle ta furface , font attirées vers le
dedans du corps , & preffent par ce moyen toutes
les autres. Mais fuppofons cette furface recouverte
en tout fens d’une enveloppe détachée , de la même
matière que le corps, & d’une épaiffeur égale
à la diftance à laquelle l’attraâion s’étend ; & que
cette enveloppe, quoique détachée, s’ajufte exactement
fur la fiirfa.ee du corps, enforte qu’elle en foit
aufli proche que fi elle y étoit adhérente : alors ,
i °. les parties de la furface du corps feront également
attirées en tout fens , & par conféquent ne pe-
feront plus fur les autres, & néanmoins le corps restera
toujours dur : i Q. les parties de l’enveloppe
paroîtroient devoir pefer fur la furface , & y être
fort adhérentes : c’eft pourtant ce qui n’arrive pas.
Quelle eft donc 1a caufe de la dureté ? nous ferons
à cette queftion la même réponfe qu’à plufieurs autres
: on n’en fait rien. (O)
D u r e t é , en termes de Medecine, fignifie,
i . Une efpece de conftipation, dans laquelle on
a le ventre dur ; ainfi on dit dans ce cas , dureté de
ventre. Voye[ D é j e c t io n & C o n s t i p a t io n :
2°. Une diminution confidérable de l’exercice de
l’ouie, qui rend prefque fourd ; on appelle cette lé-
fion de fonftion, dureté d'oreille. Voye^ O r e il l e ,
O u ï e , Su r d i t é :
3°. On appelle aufli duretés, en Medecine, certaines
tumeurs ou callofités qui viennent à la peau dans
différentes parties du corps , mais particulièrement
aux mains & aux piés, où l’épiderme comprimé ,
froifîe, fe détache en partie de la peau, de maniéré
qu’il s’en forme un nouveau par-deffous , fans que
le vieux foit entièrement féparé. La compreflion ou
le froiffement continuant, détache encore la nouvelle
couche d’épiderme ; il s ’en forme une troifie-
me, & ainfi de fuite , ce qui forme un amas des dif-
férens feuillets d’épiderme fortement appliqués les
uns aux autres, d’où réfulte une élévation fur la fur-
face de la peau * fouvent circonfcrite en forme de
tumeur, qui devient quelquefois fort épaiffe, profonde
, & dure comme de la corne.
II e n tre aufli dés v aiffeau x d e la p e a u com p rim és
o b lité ré s, dan s la com p o fitio n d e ces fortes de tu m
eu rs c u ta n é e s, lorfqu’elles fon t confidérables : elles
fe fo rm en t au x m ains des tra v a ille u rs de te r r e , d es
o u v rie rs qui fe fe rv e n t d’inftrum ens d ’u n e fubftarice
d u re , q u i com p rim en t fo rtem e n t & q u i fro iffen t la fur-
fa c e des p arties m olles des o rg an es av e c lefquels o n
les m et en m o u v e m e n t, en les fe rra n t, en les p ré ffan t
a v e c fo rce. Voye^ D u r il l o n .
Ceux qui marchent fouvent & long - tems, fur-
tout à pies nuds , ont des duretés calleufes à la peau
du talon, particulièrement fur le bord poftérieur.
Les cors qui viennent aux piés , par la compref-
fion de la peau fur les o s , faite par la chauffure, font
des duretés de cette efpece. Voye^ C o r .
L’effet de ces duretés de la peau , eft d’empêcher
l’exercice du taél dans les parties où elles fe trouvent
; & fi elles font étendues fans circonfcription.
fur toute la furface de la paume de la main ou de la
plante des piés, elles émouffent le fentiment de ces
parties, comme fi elles étoient revêtues de gants ou
d’une chauffure de cuir ; tellement qu’elles ne reçoi-,
vent pas les impreffions des corps folides ou liquides ,
affez chaudes pour exciter celle de brûlure fur toute
autre partie à laquelle on les appliqueroit.
Ces duretés calleufes caufent cependant quelquefois
de la douleur, lorfqu’elles font fortement pref*
fées contre les parties molles fenfibles auxquelles,
elles tiennent.
L’indication qui fe préfente pour la curation de
ces affeélions cutanées, lorfqu’elles incommodent
ou qu’elles bleffent, confifte à employer tout qui eft
propre à les ramollir & à les emporter, en les raglan*
o u en les c o u p an t : a u furp lu s voyeç ce qui eft d it dés
rem ed es c o n tre les c o r s , à l’article C o r . ( d )
DURGOUT , (Géog. mod.) ville de la Turquie
afiatique, fitué.e à quinze lieues de Smyrne.
DURHAM, {Géog. mod.') capitale de la province
d’Angleterre qui a le même nom ; elle eft fur hfWare.
Long. i5. 6£. lat. £4. /j.£,
DURILLON, f. m. {Med. Chirurg.) callofité fail-
lante de la peau qui a été preffée, foulée, endurcie
par un exercice fréquent ou violent.
Les durillons viennent en plufieurs endroits du
corps, fur-tout fous la plante des piés, à la paume
& aux doigts de la main.; ce qui les diftingue des
cors qui naiffent fur les doigts des piés & entre les
orteils. Voye£ C o r . Cependant les cors & les durillons
font d’une même nature, ont une même caufe,
& requièrent les mêmes remedes.
En effet, les durillons ne font autre chôfe que l’é-
paiflîffement de divers feuillets de l’épiderme & du
tiffu de la peau , qui fe font étroitement collés par
couches les uns fur les autres, tandis que les petits
vaiffeaux cutanés ont été détruits par une preflîon
continuelle. Il arrive de-là des efpeces de tubercules
fans tranfpiration, qui font une callofité faillante en-
dehors , pareille à de la corne ; & qui comprimant
par leur accroiffement & par la prefîion du foulier,
les fibres nerveufes, produifent de la douleur par
cette compreflion fubfiftante, & plus cependant dans
de certains tems que dans d’autres.
La caufe générale de ce mal eft certainement la
compreflion répétée par la chauffure & l’exercice ;
caries perfonnes qui vont toujours en carroffe, &
qui portent en même tems des fouliers doux & larges
, ne connoiffent guere les durillons : au contraire
ceux qui ayant les piés tendres & ferrés dans leurs
fouliers , marchent fur des terrains raboteux , &
plus .encore ceux qui marchent beaucoup, y font
fort fujets : c’eft par la même raifon qu’il en vient
aux feffes des gens qui courent fouvent la pofte à
cheval. Les chapeliers en ont aux poignets, à force
de fouler des chapeaux : il en eft de même de plufieurs
autres ouvriers. Les durillons des piés font de
la douleur en marchant, parce que venant à croître,
ils compriment ou meurtriffent les chairs voifines,
par la pefanteur du corps qui appuie deffus.
On indique cent moyens pour détruire cette incommodité;
chacun a Ton remede, dont il fe fert
volontiers par préférence aux autres : on éprouve
ordinairement tous ceux qu’on enfeigne, & on s’en
tient à celui dont on croit avoir recû le plus de fou-
lagement.
Mais les médecins éclairés, qui remontent à l’origine
& à 1a nature du mal, ont trouvé qu’il n’y avoit
point d’autre parti que de commencer par ramollir les
durillons , en trempant pendant quelque tems les piés
dans l’eau tiedè ; enfuite avec un raloir, ou un petit
couteau fait exprès, on enleve le durillon feuille à
feuille, comme font les maréchaux quand ils parent
le pié d’un cheval. Il faut éviterfeulement de ne point
couper trop avant ; & fi le durillon eft fous quelque
jjointure d’un des doigts, il eftbon d’employer un chirurgien
ftylé à cette opération -, ou du moins quelqu’un
de confiance. Si Ton veut fe fervir foi-même de
l ’inftrument tranchant, on prendra garde de le conduire
avec précaution, parce qu’il en peut arriver
des inconvéniens fâcheux, que quelques exemples
juftifient.
Quand on a une fois commencé à fe parer les piés,
on continuera de le faire de tems en tems, parce que
les durillons reviennent comme les ongles. On eft
averti de leur accroiffement par la douleur qu’on fent
en marchant ; cette douleur augmente à mefure que
les durillons croiffent & fe durciffent, & on ne fau-
roit y remédier qu’en répétant; l ’opération, Vous ne
nous indiquez, me dira-t-on peut-être, qu’une curé
paffagere : je réponds qu’il n’y en a point d’autre,
& qu’après tout cette méthode curative a l’avantage
d’être facile & certaine.
Il eft vrai qu’on voit fréquemment dans lès grandes
villes paroître des charlatans qui fe vantent
d’emporter toutes fortes de durillons fans retour ;
mais je fai que ce font de fauffes promeffes dont bien
des gens font fucceflivement les dupes. L’expérience
du paffé ne corrige point les hommes, & cela fera
toujours. Article de M. le Chevalier DE J AU COURT.
DURY-iAGRA, ( Comm.) toile de coton rayée,
bleue & blanche, qui vient des Indes orientales.
DUSÇHAL i f. m. (Hijl. mod.) c’eft une liqueur
dont on fait ufage en Perfe ; elle reffemble à du fy-
ro p , dont elle a la confiftance ; fe fait avec du moût
de vin, que l’on fait bouillir jufqu’à ce qu’il devienne
épais : quelquefois on l’évapore jufqu’à ficcité, afin
de pouvoir le tranfporter. Quand on veut en faire
ufage, ônle fait diffoudre.dans de l’eau mêlée avec
un peu de vinaigre ; ce qui eft, dit-on, très-propre
à appaifer la foi?, fur-tout dans un pays où l’ufage
du vin eft défendu. Voye£ dictionn. de Hubner-,
DUSIENS , f. m. pl. (Divination,,) nom que les
Gaulois donnoient à certains démons que les Latins
nommoient incubi ou fauni, & que les Démonographes
appellent communément incubes. V. In c u b e s -é
Saint Auguftin , dans fon ouvrage de la Cité de
Dieu, liv. X V. ch. xxij. affûre qu’il y avoit de ces
fortes d’efprits qui prenant la figure d’hommes, fe
rendoient fort importuns aux femmes, dont ils abu*
foient quelquefois. Nous examinerons fous le moi
In c u b e , ce qu’il faut penfer de leur exiftence. ( G)
DUSSELDORP, (Géog. mod.) ville du cercle de
"Weftphalie , capitale du duché de Berg en Allemagne
; elle eft fur un ruiffeau près du Rhin. Long. 24,
28. lat. 61. 12.
DUSLINGE, DUSLINGEN, (Géog. mod.) ville
de la Soiiabe en Allemagne ; elle eft fur le Danube*
Long. 2 G. 2J. lat. 48. 8.
DUTGEN, f. m. (Comm.) petite monnoie courante
en Danemark, qui vaut entre quatre ou cinq
fous de-notre argent.
D U V E T , f. m. c’eft la plume menue qui couvre
tout le corps de l’oifeau. C ’eft le gerfaut qui fournit
le fin duvet qu’on nomme édredon ; il eft très-léger
& très-chaud : on le tire du cou, du ventre, & de
deffous les ailés.
Celui d’autruche, qu’on appelle autrement laine*
ploc ou poil d'autruche, ÔC par corruption laine d'Autriche,
eft de deux fortes ; l’une qu’on nomme Amplement
fin d'autruche, & qui fert dans la fabrique
des chapeaux communs ; l’autre appellée gros d'autruche
, dont on fait les lifieres des draps fins, blancs,
qu’on deftine à être teints en noir.
Les Plumafliers nomment aufli duvet, les petites
plumes, celles de deffous, le rebut des plumes de
l’autruche qu’ils frifent avec le couteau, & qu’ils
employent à garnir des bonnets, à faire des palatines
& autres ouvrages de cette nature.
DUVE TEUX, f. m. (Fauconn.) fe dit des oifeâux
qui ont beaucoup de plumes molles & délicates pro*
che la chair.. Ce mot vient de duvet ,* & l’on dit, cet
oifeau efi bien duveteux.
DUUMVIR, f. m. (Hijl. ànc.) nom général que
les anciens Romains donnoient aux magiftrats, aux
commiffaires, & aux officiers, quand il y. en avoit
deux pour la même fonâion ; de forte qu’ils avoient
autant de duumvirs qu’il y avoit de commiflions dans
leur gouvernement, remplies par deux officiers.
Il y avoit des duumvirs avec infpeâion fur la con-
ftru&ion, la réparation, & la confécration des temples
& des autels ; des duumvirs capitaux qui con-
noiffoient des grimes, Ôc qui çondawnoient à mortj;