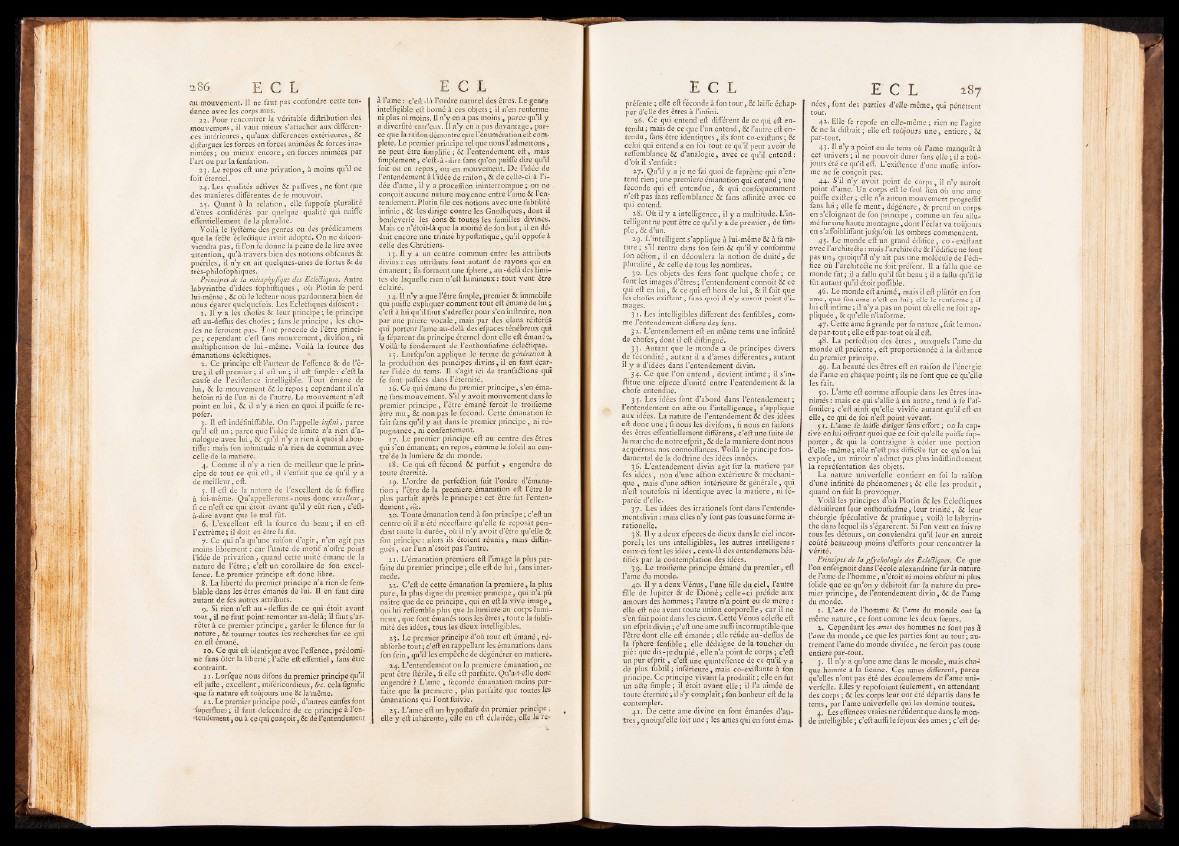
au mouvement. Il ne faut pas confondre cette tendance
avec les corps mus.
22. Pour rencontrer la véritable diftribution des
mouvemens, il vaut mieux s’attacher aux différences
intérieures, qu?aux différences extérieures, &
diftinguer les forces en forces animées & forces inanimées
; ou mieux encore, en forces animées par
-l’art ou par la fenfation.
23. Le repos eft une privation, à moins qu’il ne
foit éternel.
24. Les qualités aftives & pafîives, ne font que
des maniérés différentes de fe mouvoir.
25. Quant à la relation, elle fuppofe, pluralité
d’êtres confidérés par quelque qualité qui naiffe
effentiellement de la pluralité.
Voilà le fyftème des genres ou des prédicamens
•que la fe£te éclectique avoit adopté. On ne difcon-
viendra pas, fi l’on fe donne la peine de le lire avec
attention, qu’à-travers bien des notions obfcures &
puériles, il n’y en ait quelques-unes de fortes & de
très-philofophiques.
Principes de la métaphyjîque des Eclectiques. Autre
labyrinthe d’idées fophiftiques , où Plotin fe perd
lui-même, & où le leCteur nous pardonnera bien de
nous égarer quelquefois. Les Eclectiques difoient :
1. Il y a les chofes & leur principe ; le principe
eft au-deffus des chofes ; fans le principe, les chofes
ne feroient pas. Tout procédé de l’être principe
; cependant c’eft fans mouvement, divifion, ni
multiplication de lui-même. Voilà la fource des
émanations éclectiques,
2. Ce principe eft l’auteur de l’effence & de l’être
; il eft premier ; il eft un ; il eft fimple : c’eft la
caufe de l’exiftence intelligible. Tout émane de
lui, & le mouvement & le repos ; cependant il n’a
befoin ni de l’un ni de l’autre. Le mouvement n’eft
point en lu i, & il n’y a rien en quoi il puiffe fe re-
pofer.
3. Il eft indéfïniffable. On l’appelle infini, parce
qu’il eft un ; parce que l’idée de limite n’a rien d’analogue
avec lui, & qu’il n’y a rien à quoi il abou-
tiffe : mais fon infinitude n’a rien de commun avec
celle de la matière.
4. Comme il n’y a rien de meilleur que le principe
de tout ce qui eft, il s’enfuit que ce qu’il y a
de meilleur, eft.
5. Il eft de la nature de l’excellent de fe fuffire
à foi-même. Qu’appellerons-nous donc excellent,
fi ce n’eft ce qui étoit avant qu’il y eût rien, c’eft-
à-dire avant que le mal fût.
, 6. L’excellent eft la fource du beau ; il en eft
l’extrême ; il doit en être la fin.
7. Ce qui n’a qu’une raifon d’agir, n’en agit pas
moins librement : car l’unité de motif n’offre point
l’idée de privation, quand cette unité émane de la
nature de l’être ; c’en un corollaire de fon excellence.
Le premier principe eft donc libre.
8. La liberté du premier principe n’a rien de fem-
blable dans les êtres émanes de lui. Il en faut dire
autant de fes autres attributs.
9. Si rien n’eft au - deffus de ce qui étoit avant
tout, il ne faut point remonter au-delà; il faut s’arrêter
à ce premier principe, garder le filence fur fa
nature, & tourner toutes fes recherches fur ce qui
en eft émané.
10. Ce qui eft identique avec l’effence, prédomine
fans ôter la liberté ; l’aCte eft effentiel, fans être
contraint.
11. Lorfque nous difons du premier principe qu’il
eft jufte, excellent, miféricordieux, &c. cela fignifîe
que fa nature eft toûjours une &; la'même.
12. Le premier principe pofé, d’autres caufes font
Superflues; il faut defcendre de ce principe à l’en-
-tendement 9 ou à ce qui conçoit, & de l’entendement
à l’ame : c’eft-là l’ordre naturel des êtres. Le genre
intelligible eft borné à ces objets ; il n’en renferme
ni plus ni moins. Il n’y en a pas moins, parce qu’il y
a diverfité entr’eux. Il n’y en a pas davantage, parce
que la raifon démontre que l’énumération eft complété.
Le premier principe tel que nous l’admettons,
ne peut être Amplifié ; & l’entendement eft, mais
Amplement, c’eft-à-dire fans qu’on puiffe dire qu’il
foit ou en repos, ou en mouvement. De l’idée de
l’entendement à l ’idée de raifon, & de celle-ci à l’idée
d’ame, il y a procefîion ininterrompue ; on ne
conçoit aucune nature moyenne entre l’ame & l’entendement.
Plotin file ces notions avec une fubtilité
infinie, & les dirige contre les Gnoftiques, dont il
bouleverfe les éons & toutes les familles divines^
Mais ce n’étoit-là que la moitié de fon but ; il en déduit
encore une trinité hypoftatique, qu’il oppofe à
celle des Chrétiens.
13. Il y a un centre commun entre les attributs
divins : ces attributs font autant de rayons qui en
émanent ; ils forment une fphere, au-delà des limites
de laquelle rien n’eft lumineux : tout veut être
éclairé.
14. Il n’y a que l’être fimple, premier & immobile
qui puiffe expliquer comment tout eft émané de lui ;
c’eft à lui qu’il faut s’adreffer pour s’en inftruire, non
par une prierè vocale, mais par des élans réitérés
qui portenr l’ame au-delà des efpaces ténébreux qui
la féparent du principe éternel dont elle eft émance-.
Voilà'le fondement de l’enthoufiafme écleCtique.
15. Lorfqu’on applique le terme de génération à
la production des principes divins,.il en faut écarter
l’idée du tems. Il s’agit ici de tranfaCtions qui
fe font paffées dans l’éternité.
16. Ce qui émane du premier principe , s’en émane
fans mouvement. S’il y avoit mouvement dans le
premier principe, l’être émané feroit le troifieme
être mu, & non pas le fécond. Cette émanation fe
fait fans qu’il y ait dans le premier principe, ni répugnance
, ni confentement.
17. Le premier principe eft au centre des êtres
qui s’en émanent; en repos, comme le foleil au centre'
de la lumière & du monde.
18. Ce qui eft fécond & parfait , engendre de
toute éternité.
19. L’ordre de perfection fuit l’ordre d’émanation
; l’être de la première émanation eft l’être le
plus parfait après le principe : cet être fut l’entendement
, vue.
20. Toute émanation tend à fon principe ; c’eft un
centre où il a été néceffaire qu’elle fe reposât pendant
toute la durée, où il n’y avoit d’être qu’elle &
fon principe : alors ils étoient réunis, mais diftin-
gués, car l’un n’étoit pas l’autre.
21. L’émanation première eft l’image la plus parfaite
du premier principe ; elle eft de lu i, fans intermède.
22. C ’eft de cette émanation la première, la plus
pure, la plus digne du premier principe, qui n’a pû
naître que de ce principe, qui en eft la vive image ,
qui lui reffemble plus que la lumière au corps lumineux
, que font émanés tous les êtres, toute la fubli-
mité des idées, tous les dieux intelligibles. •
23. Le premier principe d’où tout eft émané, ré-
abforbe tout ; c’eft en rappellant les émanations dans
fon fein, qu’il les empêche de dégénérer en matierè.
24. L’entendement ou la première émanation, ne
peut être ftérile, A elle eft parfaite. Qu’a-t-elle donc
engendré ? L’ame , fécondé émanation moins parfaite
que la première , plus parfaite que toutes les
émanations qui l’ont fuivie. /
25. L ’ame eft un hypoftafe du premier principe ;
elle y Éj| inhérente, elle en eft éclairée, elle Ia'fépréfente
; elle eft féconde à fon tour, & laiffe échapper
d’elle des êtres à l’infini.
26. Ce qui entend eft différent de ce qui eft entendu
; mais de ce que l’un entend, & l’autre eft en-’
tendu, fans être identiques, ils font co-exiftans ; &
celui qui entend a en foi tout ce qu’il peut avoir de
reffemblance & d’analogie, avec ce qu’il entend :
d’où il s’enfuit :
27. Qu’il y a je ne fai quoi de fuprème qui n’entend
rien ; une première émanation qui entend ; une
fécondé qui eft entendue, & qui conféquemment
n’eft pas fans reffemblance & fans affinité avec ce
qui entend.
28. Où il y a intelligence, il y a multitude. L’intelligent
ne peut être ce qu’il y a de premier, de fimple
, & d’un.
29. L’intelligent s’applique à lui-même & à fa nature
; s’il rentre dans fon fein & qu’il y confomme
fon aérien, il en découlera la notion de duité, de
pluralité, & celle de tous les nombres.
30. Les objets des fens font quelque chofe ; ce
font les images d’êtres ; l’entendement connoît & ce
qui eft en lui, & ce qui eft hors de lui, & il fait que
les chofes exiftent, fans quoi il n’y auroit point d’images.
31. Les intelligibles different des fenfibles, comme
l’entendement différé des fens.
3 2. L’entendement eft en même tems une infinité
de chofes,- dont il eft diftingué.
3 3. Autant que le monde a de principes divers
de fécondité, autant il a d’ames différentes, autant
il y a d’idées dans l’entendement divin.
34. Ce que l’on entend , devient intime ; il s’in-
ftitue une efpece d’unité entre l’entendement & la
chofe entendue.
35. Les idées font d’abord dans l’entendement;
l’entendement en a été ou l’intelligence, s’applique
aux idées. La nature de l’entendement & des idées
eft donc une ; fi nous les divifons, fi nous en faifons
des êtres effentiellement différens, c’eft une fuite de
la marche de notre efprit, & de la maniéré dont nous
acquérons nos connoiffances. Voilà le principe fondamental
de la doftrine des idées innées.
36. L’entendement divin agit fur la matière par
fes idées , non d’une aCtion extérieure & méchani-
que , mais d’une aCtion intérieure & générale, qui
n’eft toutefois ni identique avec la matière, ni fé-
parée d’elle.
37. Les idées des irrationels font dans l’entendement
divin : mais elles n’y font pas fous une forme ir-
rationelle.
38. Il y a deux efpeces de dieux dans le ciel incorporel
; les uns. intelligibles, les autres intelligens :
ceux-ci font les idées, ceux-là des entendemens béatifiés
par la contemplation des idées.
39. Le troifieme principe émané du premier, eft
l ’ame du monde.
40. Il y a deux Vénus, l’une fille du ciel, l’autre
fille de Jupiter & de Dioné; celle-ci préfide aux
•amours des hommes ; l’autre n’a point eu de mere :
elle eft née avant toute union corporelle , car il ne
s’en fait point dans les cieux. Cette Vénus célefte eft
un efprit divin ; c’eft une ame aufli incorruptible que
l’être dont elle eft émanée ; elle réfide au-deflùs de
la fphere fenfible ; elle dédaigne de la toucher du
pié : que dis-je du pié, elle n’a point de corps ; c’eft
un pur efprit, c’eft une quinteffence de ce qu’il y a
de plus lubtil ; inférieure, mais co-exiftante à fon
principe. Ce principe vivant la produifit ; elle en fut
un atte fimple ; il étoit avant elle; il l’a aimée de
toute éternité ; il s’y complaît ; fon bonheur eft de la
contempler.
41. De cette ame divine en font émanées d’autres
, quoiqu’elle foit une ; les âmes qui en font émanées,
font des parties d’elle-même, qui pénètrent
tout.
42. Elle fe repofe en elle-même ; rien ne l’agite
& ne la diftrait ; elle eft toûjours une, entière, ôc
par-tout.
43. Il n’y a point eu de tems où l’ame manquât à
cet univers ; il ne pouvoit durer fans elle ; il a toûjours
ete ce qu’il eft. L’exiftence d’une maffe informe
ne fe conçoit pas.
44. S’il n’y1 avoit point de corps, il n’y auroit
point d’ame. Un corps eft le feul lieu où une ame
puiffe exifter ; elle n’a aucun mouvement progreffif
fans lui ; elle fe meut, dégénéré, & prend un corps
en s’éloignant de fon principe , comme un feu allumé
fur une haute montagne, dont l’éclat va toûjours
en s’affoibliffant jufqu’où les ombres commencent.
45. Le monde eft un grand édifice, co - exiftant
avec l’architeCle : mais l’archite&e & l ’édifice ne font
pas un ÿ quoiqu’il n’y ait pas une molécule de l’édifice
où l’archite&e ne foit préfent. Il a fallu que ce
monde fût ; il a fallu qu’il fût beau ; il a fallu qu’il le
fût autant qu’il étoit poffible.
46. Le monde eft animé, mais il eft plutôt en font
ame, que fon ame n’eft en lui ; elle le renferme ; il
lui eft intime ; il n’y a pas un point où elle ne foit appliquée
, & qu’elle n’informe.
47. Cette ame fi grande par fa nature, fuit le monde
par-tout ; elle eft par-tout où il eft.
48. La perfection des êtres , auxquels l’ame du
monde eft préfente, eft proportionnée à la diftance
du premier principe.
49. La beauté des êtres eft en raifon de l’énergie
de l’ame en chaque point ; ils ne font que ce qu’elle
les fait.
50. L’ame eft comme affoupie dans les êtres inanimés
: mais ce qui s’allie à un autre, tend à fe l’af-
fimiler ; c’eft ainfi qu’elle vivifie autant qu’il eft en
elle, ce qui de foi n’eft point vivant.
51. L ’ame fe laiffe diriger fans effort ; on la captive
en lui offrant quoi que ce foit qu’elle puiffe fup-
porter, & qui la contraigne à céder une portion
d’elle - même ; elle n’eft pas difficile fur ce qu’on- lui
expofe, un miroir n’admet pas plus indiftinciement
la repréfentation des objets.
La nature univerfelle contient en foi la raifon
d’une infinité de phénomènes ; & elle les produit,
quand on fait la provoquer.
Voilà les principes d’où Plotin & les Eclectiques
déduifirent leur enthoufiafme, leur trinité, & leur
théurgie fpéculative & pratique ; voilà le labyrinthe
dans lequel ils s’égarèrent. Si Ton veut en fuivre
tous les détours, on conviendra qu’il leur en auroit
coûté beaucoup moins d’efforts pour rencontrer la
vérité.
Principes de la pjyckologie des Eclectiques. Ce que
l’on enfeignoit dans l’école alexandrine fur la nature
de l’ame de l’homme, n’étoit ni moins obfcur ni plus
folide que ce qu’on y débitoit fur la nature du premier
principe, de l’entendement divin, &c de l’ame
du monde.
1. L’ame de l’homme & Marne du monde ont la
même nature, ce font comme les deux foeurs.
2. Cependant les âmes des hommes ne font pas à
Marne du monde, ce que les parties font au tout ; autrement
l’ame du monde divifée, ne feroit pas toute
entière par-tout.
3. Il n’y a qu’une ame dans le monde, mais chaque
homme a la fienne. Ces âmes different, parce
qu’elles n’ont pas été des écoulemens de l’ame univerfelle.
Elles y repofoient feulement, en attendant
des corps ; & les corps leur ont été départis dans le
tems, par l’ame univerfelle qui les domine toutes.
4. Les effences vraies ne refident que dans le monde
intelligible ; c’eft aufli le féjour des âmes ; ç ’eft de