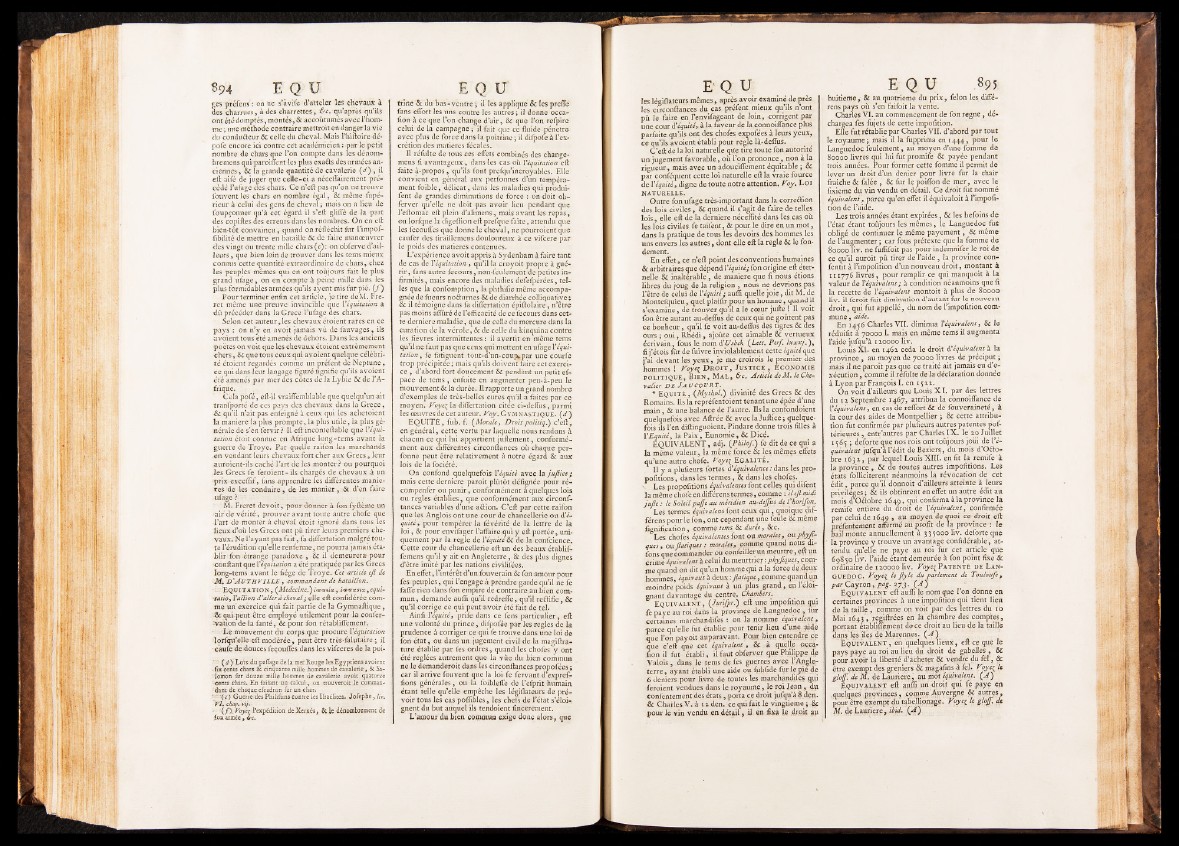
ges préfefis': on ne s’âvife d’atteler les chevaux à
des charrues, à des charrettes, qu’après qu’ils
ont été domptés, montés, & accoutumés avec l’horû?-
me ; une méthode contraire mettroit en danger la vie
du conducteur & celle du cheval. MaisThiftoire dé-
pofe encore ici contre cet académicien : par le petit
nombre de chars que l’on compte dans les dénom-
■ bremens qui paroiflent les plus exafts des armées anciennes,
6c la grande quantité de cavalerie (d ) , il
eft aifé de juger que celle-ci a néceffairement précédé
l’ufage des chars. Ce n’eft pas qu’on ne trouve
fouvent les chars en nombre égal, 6c même fupe-
rieur à celui des gens de cheval; mais on a lieu de
foupçonner qu’à cet égard il s’eft glifle de la part
des copiftes-des erreurs dans les nombres. On en eft
bien-tôt convaincu, quand on réfléchit fur l’impof-
fibilité de mettre en bataille & de faire manoeuvrer
des vingt ou trente mille chars (e): on obferve d’ailleurs
, que bien loin de trouver dans les tems mieux
connus cette quantité extraordinaire de chars, chez
les peuples mêmes qui en ont toujours fait le plus
grand ufage, on en compte à peine mille dans les
plus formidables armées qu’ils ayent mis fur pié. (ƒ )
Pour terminer enfin cet article, je tire deM. Fre-
ret même une preuve invincible que Yéquitation a
•dû précéder dans la Grece l’ufage des chars.
Selon cet-auteur, les chevaux étoient rates en ce
pays : on n’y en avoit jamais vu de fauvages, ils
uvoient tous été amenés de dehors. Dans les anciens
poètes on voit que les chevaux étoient extrêmement
chers, 6c que tous ceux qui avoient quelque célébrité
étoient regardés comme un préfent de Neptune,
ce qui dans-leur langage figuré fignifie qu’ils avoient
éfé amenés par mer des côtes de la Lybie 6c de l’Afrique.
Cela pofé, eft-il vraisemblable que quelqu’un ait
tranfporté de ces pays des chevaux dans la Grece,
&c qu’il n’ait pas enfeigné à ceux qui les achetaient
la maniéré la plus prompte, la plus utile, la plus générale
de s’èn fervir ? Il eft inconteftable que Y équitation
étoit connue en Afrique long-tems avant la
guerre de Troye. Par quelle raifon les marchands
en vendant leurs chevaux fort cher aux Grecs, leur
.auroient-ils caché l ’art de les monter ? ou pourquoi
les Grecs fe feroient - ils chargés de chevaux.à un
prix-exceflif, fans apprendre les différentes-manières
de les conduire, de les manier, & d’en faire
ufage ? -
M. Freret devoit, pour donner à fon fyftème un
air'de vérité, prouver avant toute autre chofe que
d’art de monter à cheval étoit ignoré dans tous les
lieux d’où les Grecs ont pû tirer leurs premiers chevaux.
Ne l’ayant pas fait, fa differtation malgré toute
l’érudition qu’elle renferme, ne pourra jamais établir
fon ^étrange paradoxe , 6c il demeurera: pour
-confiant que Y équitation a été pratiquée par les Grecs
ïon'g-tems avant lefiége de Troye. Cet article ejl de
M. D'AUTHVILLE , commandant de bataillon.
-i-- E Q U IT A T IO N , (MedecineC)î'a'aùa., i'vs^a.sta., equi-
•tatio, Y action d'aller achevai; elle eft confidérée comme
un'exercice qui fait partie de la Gymnaftique,
& qubpeut être employé utilement pour la confer-
^Vâtion de la fanté, 6c pour ,fon rétabliffement.
- Le mouvement du corps que procure Y équitation
lorfqu’elLe eft modérée, peut être très-falutaire ; il
• càufe de-douces fecouffes dans les vifceres de la poi-
•:s (<£) Lors du paiïage de là mer Rouge les Egyptiens avoient
-fix cents chars & cinquante mille hommes d.e cavalerie , & Salomon
fur douze mille hommes de cavalerie avoit quatorze
■ Cents chars. En faifant un calcul, on trouveroit le commandant
de chaque efcadron fur un char.
Guerre, des Philiftins contre leslfraélites. Jofephe, liv.
VI. chàp. vij.
- ( ƒ)_ Voyez l’expédition de Xerxès, &lc dénombrement de
ion armée, vc.
trine'& du bas-ventre ; il les applique & les preffe
fans effort les uns contre les autres ; il donne occa-
fion à ce que l’on change d’air, 6c que l’on refpire
celui de la campagne ; il fait que ce fluide pénétré
avec plus de force dans la poitrine ; il difpofe à l’excrétion
des matières fécales.
Il réfuke de tous ces effets combinés des change-
mens fi avantageux, dans les cas où Y équitation eft
faite à-propos, qu’ils font prefqu’incroyables. Elle
convient en général aux perfonnes d’un tempérament
foible, délicat, dans les maladies qui produi-
fent de grandes diminutions de force : on doit ob-
■ fèrver qu’elle ne doit pas avoir lieu pendant que
l’eftomac eft plein d’alimens, mais avant les repas,
ou lorfque la digeftion eft prefque faite, attendu que
les fecouffes que donne le cheval, ne pourroient que
caufer des tiraillemens douloureux à ce vifcere par
le poids des matières contenues.
L’expérience avoit appris à Sydenham à faire tant
de cas de Yéquitation , qu’il la croyoit propre à guérir,
fans autre fecours, non-feulement de petites infirmités,
mais encore des maladies defefpérées, telles
que la confomption, la phthifie même accompagnée
de fueurs noûurnes 6c de diarrhée colliquative ;
& il témoigne dans fa differtation épiftolaire, n’être
pas moins affûré de l’efficacité de ce fecours dans cette
derniere maladie, que de celle du mercure dans la
curation de la vérole, & de celle du kinquina contre
les fievres intermittentes : il avertit en même tems
qu’il ne faut pas que ceux qui metrent en ufage Y équitation,
fe fatiguent tout-d’un-coupipar une courfe
trop précipitée ; mais qu’ils doivent'faire cet exercice
, d’abord fort doucement 6c pendant un petit ef-
pace de tems, enfuite en augmenter peu-à-peu le
mouvement & la durée. Il rapporte un grand nombre
d’exemples de très-belles cures qu’il a faites par ce
moyen. Voye[ la differtation citée ci-deffus, parmi
les oeuvres de cet auteur. Voy. Gymnastique. (d )
ÉQUITÉ, fub. f. (Morale, Droitpolitiqi) c’eft,
en général, cette vertu par laquelle nous rendons à
chacun ce qui lui appartient juftement, conformément
aux différentes circonftances où chaque per-
fonne peut être relativement à notre égard & aux
lois de la fociété*
On confond quelquefois Y équité avec la juftict ;
mais cette derniere paroît plutôt défignée pour ré-
compenfer ou punir, conformément à quelques lois
ou réglés établies, que conformément aux circonftances
variables d’une aâion. C ’eft par cette raifon
que les Anglois ont une cour de chancellerie ou dV-
quitè, pour tempérer la févérité de la lettre de la
lo i, & pour envifager l’affaire qui ÿ eft portée, uniquement
par la réglé de Yéquité 6c de la confcience.
Cette cour de chancellerie eft un des beaux établit,
femens qu’il y ait en Angleterre, & des plus dignes
d’être imité par les nations civilifées.
En effet, l’intérêt d’un fouverain 6c fon amour pour
fes peuples, qui l’engage à prendre garde qu’il ne fe
faffe rien dans fon empire de contraire au bien commun
, demande aufli qu’il redreffe, qu’il re&ifie, 6c
qu’il corrige ce qui peut avoir été fait de tel.
Ainfi Y équité, prife dans ce fens particulier, eft
une volonté du prince, difpofée par les réglés de la
prudence à corriger ce qui fe trouve dans une loi de
fon état, ou dans un jugement civil de la magiftra-
ture établie par fes ordres , quand les chofes y ont
été réglées autrement que la vue du bien commun
ne le demanderoit dans les circonftances propofées ;
car il arrive fouvent que la loi fe fervant d’expref-
fions générales, ou la foibleffe de l’efprit humain
étant telle qu’elle empêche les légiflateurs de prévoir
tous les cas poffibles, les chefs de l’état s’éloignent
du but auquel ils tendoient fincerement.
L’amour du bien commun exige donc alors, que
les légiflateurs mêmes, après avoir examiné de près
les circonftances du cas préfent mieux qu’ils n’ont
pu le faire en l’envifageant de loin, corrigent par
une cour d'équité, à la faveur de la connoiffance plus
parfaite qu’ils ont des chofes expofées à leurs yeux,
ce qu’ils avoient établi pour réglé là-deffus.
G’eft de la loi naturelle qite tire toute fon.autorité
un jugement favorable, où i’etn prononce, non à la
rigueur, mais avec un adouciffement équitable ; 6c
par conséquent cette loi naturelle eft la vraie fource
de Y équité r digne de toute notre attention. Voy. L o i
NATURELLE.
Outre fon ufage très-important dans la correction
des lois civiles, 6c quand il s’agit de faire de telles
lois, elle eft de la derniere néceflïté dans les.cas où
les lois civiles fe taifent, & pour le dire en un mot,
dans la pratique de tous les devoirs des hommes, les
uns envers les autres, dont elle eft la réglé 6c le fondement.
-
En effet, çe n’eft point des conventions humaines
& arbitraires que dépend Yéquité; fon origine eft éternelle
6c inaltérable, de maniéré que fi nous étions
libres du joug de la religion , nous ne devrions pas
l’être de celui de Y équité; aufli quelle joie, dit M. de
Montefquieu, quel plaifir pour un homme, quand il
s’examine, de trouver qu’il a le coeur jufte 1 II voit
fon être autant au-deflùs de ceux qui ne goûtent pas
ce bonheur, qu’il fe voit au-deflùs des tigres 6c des
ours ; oui, Rhédi, ajoute cet aimable 6c vertueux
écrivain, fous le nom dUsbek (.Lett. Perf. ïxxxj.'),
fi j’étois fûr de fuivre inviolablemént cette équité que
j’ai devant les yeu x , je me croirois le premier des
hommes ! Voyei D r o i t , Ju st ic e , E conomie
po l it iq u e , Bien , Mal, &c. Article deM. le Chevalier
DE J AV COV RT.
* Eq uité , (Mythol.') divinité des Grecs & des
Romains. Ils la repréfentoient tenant une épée d’une
main, & une balance de Fautre. Ils la çonfondoient
quelquefois avec Aftrée & avec la Juftice ; quelquefois
ils l’en diftinguoient. Pindare donne trois filles à
Y Equité, la Paix, Eunomie, & Dicé.
EQUIVALENT, adj. (Philo/j fe dit de ce qui a
la même valeur, la même force 6c les mêmçs effets
qu’une autre chofe. Voye^ Eg a l it é .
Il y a plufieurs fortes à!équivalence : dans les pro-
pofitions, dans les termes, & dans les chofes.
v Les proppfitipns équivalentes font celles qui difent
la même chofe en différens termes, comme : il efi midi
jufte : le Soleil pafte au méridien au-dejfus dç l'hori/on.
Les termes équivalent font ceux qui, quoique
férens pour le fon, ont cependant une feule 6c même
lignification, comme tems 6ç durée , &c. ,
Les chofes équivalentes fpnt ou morale^ * ou phyft-
ques, ou ftatiques : morales, comme quand noùsi (filons
que commander ou confeillerun meurtre, eft un
crime équivalent à celui du meurtrier : phyftqius, çqpi-
me quand on dit qu’un homme qui a la force de fieux
hommes, équivaut à deux : ftatiquç , comme quand un
moindre poids équivaut à un plus grand, en 1 éloignant
davantage du centre, Çhambers.
Eq u iv alen t , (Jurifpr.) eft une impofition qui
fe paye au roi dans la province de Languedoc, fur
certaines marchandifes : pn la noipmp équivalent ,
parce qu’elle fut établie pqur tenir fieu d’une aide
que l’on payait auparavant. Pp«r bien entendre £?
que c’eft que cet équivalent , & à quelle pçcâ-
fion il fut établi, il faut pbfgrver que Philippe dp
Valois, dans le tems de fes guerres ave.c l’Angleterre
, ayant établi une aide ou fnbfide fur le p^e de
6 deniers pour livre de toutes les marchandifes qui
feroient vendues dans le royaume » le rpi Jean > du
confentement des états, porta ce droit jufqu’à 8 den.
& Charles V , à n den. ce qui fait le vingtième ; &
pour le vin vendu en détail, il en fixa le .dr.oit |p
huitième, & au quatrième du prix, félon les différens
pays pù s’en faifoit la vente.
Charles V I. au commencement de fon régné, déchargea
fes fujets de cette impofition.
Elle fut rétablie par Charles VII. d’abord par tout
le royaume ; mais il la fupprima en 1444, pour le
Languedoc feulement, au moyen d’une fomme de
80000 livres qui lui fut promile 6c payée pendant
trois années. Pour former cette fomme il permit de
lever un droit d’un denier pour livre fur la chair
fraiche & falée , 6c fur le poiffon de mer, avec le
fixieme du vin vendu en détail. Ce droit fut nommé
équivalent, parce qu’en effet il équivaloit à l’impofi-
tion de l’aide.
Les trois années étant expirées, & les befoins de
l’état étant toûjours les mêmes, le Languedoc fut
obligé de continuer le même payement, 6c même
de l’augmenter ; car fous prétexte que la fomme de
80000 liv. ne fuffifoit pas pour indemnifer le roi de
ce qu’il auroit pû tirer de l’a ide, la province con-
fentit à l’impofition d’un nouveau droit, montant à
111776 livres, pour remplir ce qui manquoit à la
valeur de Y équivalent; à condition néanmoins que fi
la recette de Y équivalent montoit à plus de 80000
liv. il feroit fait diminution d’autant fur le nouveau
droit, qui fut appellé, du nom de l’impofition commune
, aide.
En 1456 Charles VII. diminua Y équivalent, 6c le
réduifit à 700001. mais en même tems il augmenta
l’aide jufqu’à 110000 liv.
Louis XL en 1461 céda le droit d'équivalent à la
province, au moyen de 70000 livres de préciput ;
mais il ne paroît pas que ce traité ait jamais eii d’exécution
, comme il refulte de la déclaration donnée
à Lyon par François I. en 1512.
On voit d’ailleurs que Louis X I . par des lettres
du 12 Septembre 1467, attribua la connoiffance de
Y équivalent, en cas de reflort & de fouveraineté, à
la cour des aides de Montpellier ; 6c cette attribution
fut confirmée par plufieurs autres patentes pof-
térieures, entr’autres par Charles IX . le 20 Juillet
1565 ; deforte que nos rois ont toujours joui de 17-
quivaient jufqu’à l’édit de Beziers., du mois d’Otto-
bre 1632, par lequel Louis XIII. en fit la remife à
la province , 6c de toutes autres importions. Les
états folliciterçut néanmoins la révocation de cet
édit, parce qu’il donnoit d’ailleurs atteinte à leurs
privilèges ; 6c ils obtinrènt en effet un autre édit au
mois çfoûobre 1640, qui confirma à la prpvince là
remife entière du droit de Y équivalent, confirmée
par celui de 1649 , au moyçn de quoi ce droit eft
préfentement affermé au profit de la province : le
bail monte annuellement à 3 3 5000 liv. deforte que
■ la province y trouve un avantage confidérable , attendu
quelle ne paye au roi fur cet article que
69^50 liv. l’aide étant demeurée à fon point fixe &
ordinaire de 1,20000 liv. Voye{ Patente de Lan-
GyEEjpC. Voye^ le ftylç du parlement de Touloufe,
par C ayron, Eag- 2.73 • )
EQiuivAyENT eft aufli le nom que l ’on donne en
certaines provinces à une impofition qui tient lieu
; de la taille , pomme on voit par des lettres du 16
Mai 1643", regiftrées en la chambre des comptes,
portant établifffment de ce droit au lieu de la taille
daji^lès île? de Marennçs. ( A )
’ É q u iv a l e n t , en q u elq u es lie u x , eft ce que le
p ay s p a y e au rp i a u fieu dp d ro it d e gabelles , &
p o u r a v o ir la lib e rté d’aplietpr 6c ven d re d u fé l, &
ê tre ex em p t clés g feniers $c ipagalîns à fe 1. Voy é{ le
glo/ . de M . fie L a u rie re , a u m ot équivalent. (A " )
E q u iv a l e n t eft aufll un di-oit q u i fe p a y e e n
.quelques p rp v in c e ? , ,cpjpni|e .A u v erg n e 6c a u rie s ,
ppur être ex en ip t d u tabelU pn4g e . lc ^
M . de L a u rie re , ibid. ( A )