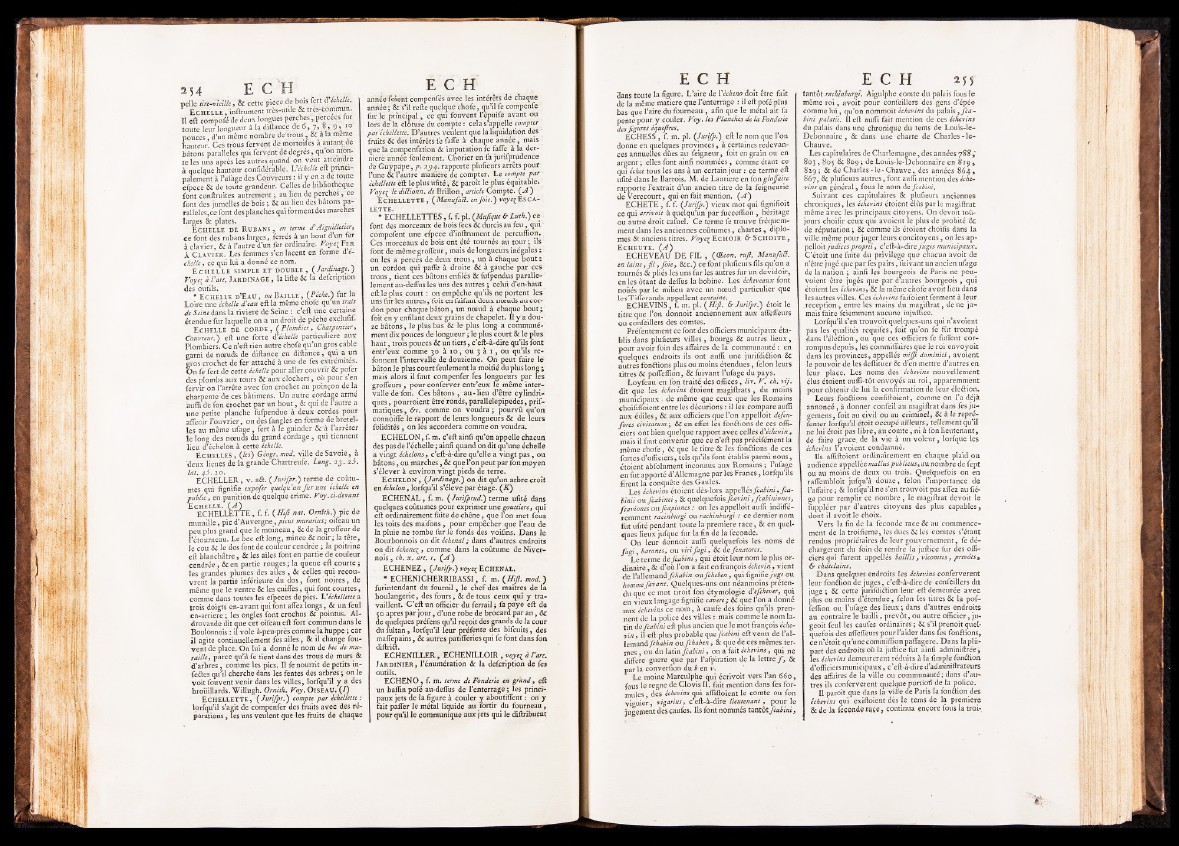
pelle SÊÊÊÊÊ & cetteip ie& ile bois iert « B
E chelle ,'inllnimënt très-ütile &.trèsfSorf«nt!.
Il H compoleàe deux longues perches ,,?e|çéds fur
toute leur longueur à la diftance de m b — M
pouces d’un mèmè nombre de troüs, & a là meme
hauteur. Ces trous fervent de mdrtoifes à autant.de
bâtons parallèles qui fervent de degrés, qu Oïl Wôn-
te les uns après les autres quand' On veut atteindre
à quelque hauteur confidérable. L’échelle efl.principalement
à l’ufage des Couvreurs : il y en a. de toute
éfpecë & de toute grandeur. Celles de bibliothèque
font confiantes autrement ; au lieu de perches, ce
font dès jumelles de bôis ; & au lieu des bâtons parallèles,
ce font des planches qui forment des marches
larges & plates. . .
E c h e l l e d e R u b a n s , en terme d’Aiguilletier,
c e fo n t des n ib an s la rg e s, fefrés à u n b o u t d u n fer
à c la v ie r, & à l’a u tre d’un fer o rd in aire. V F e r
À C l a v ie r . L es fem m es s’en la c e n t en form e d’e-
ckdle, ce q u i lu i a d o n n é ce nom .
E c h e l l e s im p l e e t d o u b l e , (Jardinage.)
Voyei à L'art. Ja r d in a g e , la lifte & la deferiptibn
des outils. , , . . .
* E c h e l l e d ’E a u , ou B a il l e > ( Peche.) fur la
Loire une échelle d’eau efl la même chofe qu’un trait
de Seine dans la riviere de Seine : c’eft une certaine
étendue fur laquelle on a un droit de peche exclulif.
E c h e l l e DE c o r d e , ( Plombier, Charpentier,
Couvreur.') eft une forte $ échelle particulière aux
Plombiers. Ce n’eft rien autre chofe qu’un gros cable
garni de noeuds de diftance ,en diftance, qui a un
gros crochet de fer attaché à une de fes extrémités.
On fe fert de cette échelle pour aller couvrir & pofer
des plombs aux tours & aux clochers, où pour s en
fervir on l’arrête avec fon crochet au poinçon de la
charpente de ces bâtimens. Un autre cordage arme
auffi de fon crochet par un bout, & qui de l’autre a
line petite planche fufpendue à deux cordes pour
affeoir l’ouvrier, ou des fangles en forme de bretelles
au même ufage, fert à le guinder &c à I arrêter
le long des noeuds du grand cordage, qui tiennent
lieu d’échelon à cette echelle.
E c h e l l e s , (les) Géogr. mod. ville de Savoie, à
’deux lieues de la grande Chartreufe. Long. 23. 26.
lat. 4S. 20. " ,, 1 -
ECHELLER, v. aft. ( Jurifpr.) terme de coutumes
qui lignifie expofer quelqu’un fur une echelle en
public, en punition dê quelque crime. Voy. ci-devant
E c h e l l e . (A ) .
ECHELLETTE, f. f. (Hijl nat. Orntth.) pic de
muraille, pic d’Auvergne, jmeus murarius; oifeau un
peu plus grand que le moineau, & de la groffeur de
l ’étourneau. Le bec eft long, mince & noir; la tête,
le cou & le dos font de couleur cendrée ; la poitrine
eft blanchâtre, & les ailes font en partie de couleur
cendrée, & en partie rouges; la queue eft courte ;
les grandes plumes des ailes , & celles qui recouvrent
la partie inférieure du dos, font noires, de
même que le ventre & les cuiffes, qui font courtes,
comme dans toutes les efpeces de pics. L’échellette a
trois doigts en-avant qui font affez longs, & un feul
en-arriere ; les ongles font.crochus & pointus. Al-
drovande dit que cet oifeau eft fort commun dans le
Boulonnois : il vole à-peu-près comme la huppe ; car
il agite continuellement fes ailes, & il change fou-
vent de place. On lui a donné le nom de bec de muraille,
parce qu’il fe tient dans des trous de murs &
d’ arbres, comme les pics. Il fe nourrit de petits in-
feftes qu’il cherche dans les fentes des arbres ; on le
voit fouvent venir dans les villes, lorfqu’il y a des
brouillards. Willugh. Ornith. Voy. Oiseau. (/)
Ech e l le t t e , (Jurifpr.) compte par échellette:
lorfqu’il s’agit de compenfer des fruits avec des réparations
, les uns veulent que les fruits de chaque
année foieiit compenfés avec les intérêts dé chaqite
année ; & s’il relie quelque chofe, qu’il fe compenfe
fur le principal, ce qui fouvent l’épuife avant ou
lofs ,de la clôture du compte : cela s’appelle compter
paréchéllétte. D ’autres veulent que la liquidation des '
fruits & dés intérêts fe fâffe à chaque année, mais '
que la compenfation & imputation fe faffe à la dernière
année feulement. Chorier en fa jùrifprudence
de Gùypàpe , p. 294. rapporte plufieurs arrêts pour
l’une & l’autre manière de compter. Le compte par
échellette eft le plus ufîté, & paroît le plus équitable.
Voy e f i t dicHonn. de Brillon, article Compte. (A )
E c h e l l e t t e , (Mànufacl. en foie.) yoyefÎLsck-
LËTTE.
* ECHELLETTES, f. f. pl. (Muftque & Luth.) ce
font des morceaux de bois fecs & durcis.au feu, qui
compofent une efpece d’inftrument de pereuffion.
Ce$ morceaux de bois ont été tournés au tour ; ils
font de même groffeur, mais de longueurs inégales :
on les a percés de deux trous, un à chaque bout :
un cordon qui paffe à droite & à gauche par ces
trous, tient ces bâtons enfilés & fufpendus parallèlement
au-delfus les uns des autres ; celui d’en-haut
eft le plus court : on empêche qu’ils ne portent les
uns fur les-autres, foit en faifant deux noeuds au cordon
pour chaque bâton, un noeud à chaque bout;
foit en y enfilant deux grains de chapelet. Il y a douze
bâtons, le plus bas & le plus long a communément
dix pouces de longueur ; le plus court & le plus
haut, trois pouces & un tiers, c’eft-à-dire qu’ils font
entr’eux comme 30 à 10, ou 3 à 1 , ou qu’ils re-
fonnent l’intervalle de douzième. On peut faire lé
bâton le plus court feulement la moitié du plus long ;
mais alors il faut compenfer les longueurs par les
groffeurs , pour conferver entr’eux le même intervalle
de fon. Ces bâtons , au-lieu d’être cylindriques
, pourroient être ronds, parallelepipedes, prif-
matiques, &c. comme on voudra ; pourvû qu’on
connoiffe le rapport de leurs longueurs & de leurs
folidités, on les accordera comme on voudra.
ECHELON, f. m. c’eft ainfi qu’on appelle chacun
des pas de l’échelle ; ainfi quand on dit qu’une échelle
a vingt échelons, c’eft-à-dire qu’elle a vingt pas, ou
bâtons, ou marches, & que l’on peut par fon moyen
s’élever à environ vingt pieds de terre.
E c h e l o n , (Jardinage.) on dit qu’un arbre croît
en échelon y lorfqu’il s’élève par étage. (K )
ECHENAL, f. m. (Jurijprud.) terme ufité dans
quelques coûtumes pour exprimer une gouttière, qui
eft ordinairement faite de chêne, que l’on met fous
les toîts des maifons , pour empêcher que l’eau de
la pluie ne tombe fur le fonds des voifins. Dans le
Bourbonnois on dit échenal; dans d’autres endroits
on dit échene[ , comme dans la coûtume de Niver-
nois, ch. x . art. /. (A )
ECHENEZ, (Jurifp.) voye{ ECHENAL,
* ECHENICHERRIBASSI, f. m. (Hijl. mod.)
furintendant du fournil, le chef des maîtres de la
boulangerie, des fours, & de tous ceux qui y travaillent.
C ’eft un officier du ferrail ; fa paye eft de
50 apres par jour, d’une robe de brocard par an, &
de quelques préfens qu’il reçoit des grands de la cour
du lultan, lorfqu’il leur préfente des bifeuits, des
maffepains, & autres patifferies qui fe font dans fon
diftrifl.
ECHENILLER, ECHENILLOIR , yoyel à l ’art.
J a r d in i e r , l’én um ératio n & la deferip tio n d e fes
outils.
ECHENO, f. m. terme de Fonderie en grand, eft
un baffin pofé au-deffus de l’enterrage ; les principaux
jets de la figure à couler y aboutiffent : on y
fait palier le métal liquide au lortir du fourneau ,
pour qu’il le communique aux jets qui le dillribuent
dans toute la figure. L’aire de l’écheno doit être fait
de la même matière que l’enterrage : il eft pofé plus
bas que l’aire du fourneau , afin que le métal ait fa
pente pour y couler. Voy. les Planches de la Fonderie
des figures équefires.
ECHESS , f. m. pl. (Jurifp.) eft le nom que l’on
donne en quelques provinces, à certaines redevances
annuelles dues au feigneur, foit en grain ou en
argent ; elles font ainfi nommées, comme étant ce
qui échet tous les âns à un certain jour : ce terme eft
ufité dans le Barrois. M. de Lauriere en fon gloffaire
rapporte l’extrait d’un ancien titre de la feigneurie
de Verecourt, qui en fait mention. (A )
ECHETË , f. f. (Jurifp.) vieux mot qui fignifioit
ce qui arrivoit à quelqu’un par fucceffion , héritage
ou autre droit cafuel. Ce terme fe trouve fréquemment
dans les anciennes coûtumes, chartes , diplômes
& anciens titres. Voye^ E ch oir & Sc h o it e ,
E cheute. (A )
ECHEVEAU DE FIL , (OEcon. ruft. Manufacl.
en laine, f i l , foie, & c.) ce font plufieurs fils qu’on a
tournés & pliés les uns lur les autres fur un dévidoir,
en les ôtant de deffus la bobine. Les écheveaux font
noiiés par le milieu avec un noeud particulier que
lesTifferands appellent centaine.
ECHEVINS, f. m. pl. ( Hijl. & Jurifpr.) étoit le
titre que l’on donnoit anciennement aux affeffeurs
ou confeillers des comtes.
Préfentement ce font des officiers municipaux établis
dans plufieurs villes, bôurgs & autres lieux,
pour avoir foin des affaires de la communauté : en
quelques endroits ils ont auffi une jurifdi&ion &
autres fondions plus ou moins étendues, félon leurs
titres & poffeffion, & fuivant l’ufage du pays.
Loyfeau en fon traité des offices, Uv. V. ch. vij.
élit que les éckevins étoient magiftrats , du moins
municipaux, de même que ceux que.les Romains
choififfoient entre les décurions : il les compare auffi
aux édiles, & aux officiers que l’on appelloit defen-
fores civitatum ; & en effet les fondions de ces officiers
ont bien quelque rapport avec celles d’échevin,
mais il faut convenir que ce n’eft pas précifément la
même chofe, & que le titre & les fondions de ces
fortes d’officiers, tels qu’ils font établis parmi nous,
étoient abfolument inconnus aux Romains ; l’ufage
en fut apporté d’Allemagne par les Francs, lorfqu’ils
■ firent la conquête des Gaules. ^
Les échevins étoient dès-lors appelles fcabini,fca-
binii ou feabinei, & quelquefois Jcavini , feabiniones,
feaviones ou feapiones : on les appelloit auffi indifféremment
racinburgi ou rachinburgi : ce dernier nom
fut ufité pendant toute la première race, & en quelques
lieux jufque fur la fin de la fécondé.
On leur donnoit auffi quelquefois les noms de
fagiy barones, ou yirifagi, & de fenatores;
Le terme defeabini, qui étoit leur nom le plus ordinaire
, & d’où l’on a fait en françois échevin, vient
de l’allemand fehabin ou feheben, qui fignifie juge ou
homme favant. Quelques-uns ont néanmoins prétendu
que ce mot tiroit fon étymologie d’efehever, qui
en vieux langage fignifie cavere ,• & que l’on a donné
aux échevins ce nom, à caufe des foins qu’ils prennent
de la police des villes : mais comme le nom latin
de feabini eft plus ancien que le mot françois échevin
t il eft plus probable que feabini eft venu de l’allemand
fehabin ou fehaben, & que de ces mêmes termes
, ou du latin Jcabini, on a fait échevins, qui ne
différé guere que par l’afpiration de la lettre ƒ , &
par la converfion du b en v.
Le moine Marculphe qui écrivoit vers l’an 660,
fous lé regne de Clovis II. fait mention dans fes formules
des échevins qui affiftoient le comte ou fon
viguier, vigarius, c’eft-à-dire lieutenant , pour le
jugement des caufes. Ils font nommés tantôt feabini,
tantôt rachinburgi. Aigulphe comte du palais fous le
même ro i, avoit pour confeillers des gens d’épée
comme lui, qu’on nommoit éckevins du palais, feabini
palatii. Il eft auffi fait mention de ces échevins
du palais dans une chronique du teins de Louis-le-
Debonnaire , & dans une charte de Charles - le-
Chauve.
Les capitulaires de Charlemagne, des années 7S8,’
803,805 & 809 ; de Louis-le-Debonnaire en 8 19,
819; & de Charles - le - Chauve, des années 864,
867, & plufieurs autres, font auffi mention des échevins
en général, fous le nom de feabini.
Suivant ces capitulaires & plufieurs anciennes
chroniques, les échevins étoient élus par le magiftrat
même avec les principaux citoyens. On devoit toujours
choifir ceux qui avoient le plus de probité &c
de réputation ; & comme ils étoient choifis dans la
ville même pour juger leurs concitoyens, on les appelloit
judices proprii, c’eft-à-dire juges municipaux.
C ’étoit une fuite du privilège que chacun avoit de
n’être jugé que par fes pairs, fuivant un ancien ufage
de la nation ; ainfi les bourgeois de Paris ne pou-
voient être jugés que par d’autres bourgeois , qui
étoient les échevins, & la même chofe avoit lieu dans
les autres villes. Çes échevins faifoient ferment à leur
.réception, entre les mains du magiftrat, de ne jamais
faire feiemment aucune injuftice.
Lorfqu’il s’en trouvoit quelques-uns qui n’avoient
pas les qualités requifes, foit qu’on fe fut trompé
dans l’éleélion, ou que ces officiers fe fuffent corrompus
depuis, les commiffaires que le roi envoyoit
dans les provinces, appelles mifjî dominici, avoient
le pouvoir de les deftituer & d’en mettre d’autres en
leur place. Les noms des échevins nouvellement
élus étoient auffi-tôt envoyés au roi, apparemment
pour obtenir de lui la confirmation de leur éleôiori.
Leurs fondions confiftoient, comme on l’a déjà
annoncé, à donner confeil au magiftrat dans fes ju-
gemens, foit au civil ou au criminel, & à le repre-
fenter lorfqu’il étoit occupé ailleurs, tellement qu’il
ne lui étoit pas libre, au comte, ni à fon lieutenant,
de faire grâce, de la vie à un voleur, lorfque les
échevins l’a voient condamné.
Ils affiftoient ordinairement en chaque plaid ou
audience appelle e publicus, au nombre de fept
ou au moins de deux ou trois. Quelquefois on en
raffembloit jufqu’à douze, félon l’importance de
l’affaire ; & lorfqu’il ne s’en trouvoit pas affez au liège
pour remplir ce nombre, le magiftrat devoit le
fuppléer par d’autres citoyens des plus capables,
dont il avoit le choix.
Vers la fin de la fécondé race & au commencement
de la troifieme, les ducs & le s comtes s’étant
rendus propriétaires de leur gouvernement, fe déchargèrent
du foin de rendre la juftice fur des officiers
qui furent appellés baillis , vicomtes, prévôts,
& châtelains.
Dans quelques endroits les échevins conferverent
leur fonélion de juges, c’eft-à-dire de confeillers du
juge ; & cette jurifdiélion leur eft demeurée avec
plus ou moins d’étendue, félon les titres & la poffeffion
ou l’ufage des lieux ; dans d’autres endroits
au contraire le bailli, prévôt, ou autre officier, ju-
geoit feul les caufes ordinaires ; & s’il prenoit quelquefois
des affeffeurs pour l’aider dans fes fonctions,
cen’étoit qu’une commiffion paffagere. Dans la plupart
des endroits où la juftice fut ainfi adminiftrée ;
les échevins demeurèrent réduits à la fimple fonélion
d’officiers municipaux, c ’eft-à-dire d’adminiftrateurs
des affaires de la ville ou communauté; dans d’au-
, très ils conferverent quelque portioii de la police.
Il paroît que dans la ville de Paris la fonfrion des
échevins qui exiftoient dès le tems de la première
& de la fécondé race, continua encore fous la troi