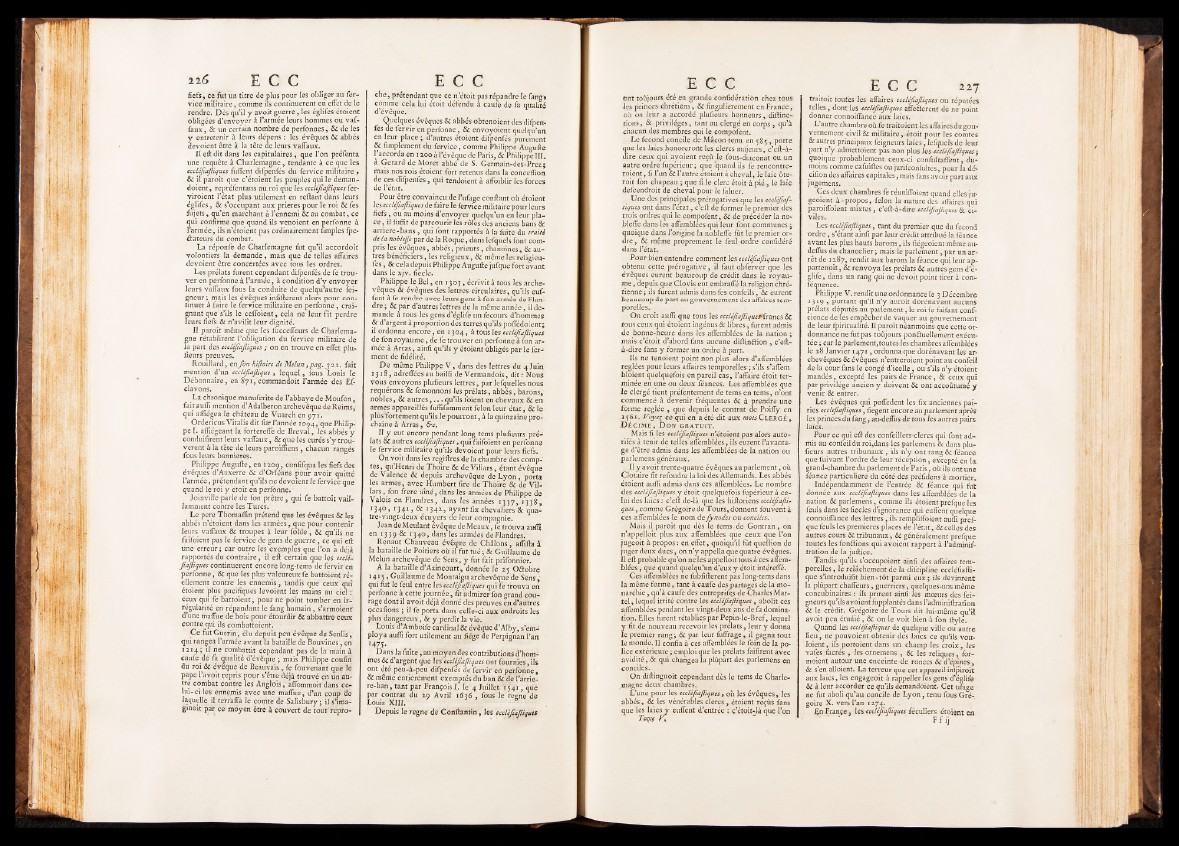
fiefs, ce fut un titre de plus pour les obliger au fer-
vice militaire, comme ils continuèrent en effet de le
rendre. Dès qu’il y avoir guerre, les églifes étoient
obligées d’envoyer à l’armée leurs hommes ou vafi-
faux, & un certain nombre de perfonnes, & de les
y entretenir à leurs dépens : les évêques & abbés
dévoient être à la tête de leurs vaffaux.
II eft dit dans les capitulaires, que l’on prcfenta
une requête à Charlemagne, tendante à ce que les
ecdéjîajliques fuffent difpenfés du fervice militaire ,
& il paroît que c’étoient les peuples qui le deman-
doient, repréfentans au roi que les ecdéjîajliques fer-
viroient l’état plus utilement en reftant dans leurs
églifes, & s’occupant aux prières pour le roi & fes
fujets, qu’en marchant à l’ennemi & au combat, ce
qui confirme que quand ils venoient en perfonne à
l’armée, ils n’etoient pas ordinairement Amples fpe-
âateurs du combat.
La réponfe de Charlemagne fut qu’il accordoif
volontiers la demande, mais que de telles affaires
dévoient être concertées avec tous les ordres.
Les prélats furent cependant difpenfés de fè trouver
en perfonne à l’armée, à condition d’y envoyer
leurs vaffaux fous la conduite de quelqu’autre lei-
gneur ; mais les évêques inlifterent alors pour continuer
à faire le fervice militaire en perfonne, craignant
que s’ils le ceffoient, cela ne leur fît perdre
leurs fiefs & n’avilît leur dignité.
Il paroît même que les fucceffeurs de Charlemagne
rétablirent l’obligation du fervice militaire de
la part des ecdéjîajliques ; on en trouve en effet plu-
fieurs preuves.
Rouillard, en fon hifloirt de Melun, pag. 322. fait
mention d’un cccléjîajlique, lequel, fous Louis le
Débonnaire, en 871,'commandoit l’armée des Ef-
clavons.
La chronique manuferite de l’abbaye de Moufon,
fait aufli mention d’Adalberon archevêque de Reims,
qui aflïégea le château de Vuarch en 971.
Ordericus Vitalis dit fur l’année 1094, que Philippe
I. aflîégeant la fortereffè de Breval, les abbés y
conduifirent leurs vaffaux, & que les curés s’y trouvèrent
à la tête de leurs paroiluens , chacun rangés
fous leurs bannières.
Philippe Àugufte, en 1209, confifqua les fiefs des
évêques d’Auxerre & d’Orléans pour avoir quitté
l’armée, prétendant qu’ils ne dévoient le fervice que
quand le roi y étoit en perfonne.
Joinville parle de fon prêtre, qui fe battoit vaillamment
contre les Turcs.
Le pere Thomaflin prétend que les évêques & les
abbés n’étoient dans les armées, que pour contenir
leurs vaffaux & troupes à leur folde, & qu’ils ne
faifoient pas le fervice de gens de guerre, ce qui eft
une erreur ; car outre les exemples que l’on a déjà
rapportés du contraire, il eft certain que les ecclé-
JîaJliqucs continuèrent encore long-tems de fervir en
perfonne, & que les plus valeureux fe batfoient réellement
contre les ennemis , tandis que ceux qui
étoient plus pacifiques levoient les mains au ciel :
ceux qui fe battoient, pour ne point tomber en irrégularité
en répandant le fang humain, s’armoient
d’une maflue de bois pour étourdir & abbattre ceux
contre qui ils combattoient. . •
Ce fut Guérin, élu depuis peu évêque de Senlis,
qui rangea l’armée avant la bataille de Bouvines, en
1214; il ne combattit cependant pas de la main à
caufe dé la qualité d’évêque ; mais Philippe coufin
du roi & eveqüe de Beauvais r fe fouvenant que lé
pape l’a voit repris’pour s’être déjà trouvé én un autre
combat contré les Anglois, âfforiimoit dans celui
ci les ennemis avec une maffue, d’un coup de
laquelle il terrafla le comte de Salisbury ; il s’ima-
gmoit par ce moyen être à couvert de toüt'répfoche,
prétendant que ce n’étoit pas répandre le fang*
compte cela lui étoit défendu à caufe de fa qualité
d’évêque.
Quelques évêques & abbés obtenoient des difpen-
fes de fervir en perfonne, & envoyoient quelqu’un
en leur place ; d’autres étoient difpenfés purement
& Amplement du fervice, comme Philippe Augufté 1 accorda en 1200 à l’évêque de Paris, & Philippe III.
a Gérard de Moret abbé de S. Germain-des-Prez ;
mais nos rois étoient fort retenus dans la conceflïon
de ces difpenfes, qui tendoient à affaiblir les forces
de l’état.
Pour être convaincu de l’ufage confiant où étoient
les ecdéjîajliques de faire le fervice militaire pour leurs
fiefs, ou au moins d’envoyer quelqu’un en leur place
, il fuffit de parcourir les rôles des anciens bans &
arriéré-bans , qui font rapportés à la fuite du traité
delà noblejje par de la Roque, dans lefquels font compris
les évêques, abbés, prieurs, chanoines, & autres
bénéficiers, les religieux, & même les religieu-
fe s , & cela depuis Philippe Augufte jufque fort avant
dans le x jv. fiecle.-
Philippe le B el, en 1303 , écrivit à tous les archevêques
& évêques des lettres circulaires, qu’ils eufi*
fent à fe rendre avec leurs gens à fon armée de Flandre
; & par d’autres lettres de la même année, il demande
à tous les gens d’églife un fecours d’hommes
& d’argent à proportion des terres qu’ils poffédôient;
il ordonna encore, en 1304, à tous les ecdéjîajliques
de fon royaume, de fe trouver en perfonne à Ion armée
à Arras, ainfi qu’ils y étoient obligés par le fer-,
ment de fidélité.
De même Philippe V , dans des lettres du 4 Juin
1318, adreffées au bailli de Vermandois, dit : Nous
vous envoyons plufieurs lettres, par lesquelles nous
requérons Sc femonnons les prélats, abbés, barons,
nobles, & autres, . . . qu’ils Soient en chevaux & en
armes appareillés fuffifamment félon leur état, & le
pliïs fortement qu’ils le pourront, à la quinzaine prochaine
à Arras, &c.
II y eut encore pendant long tems plufieurs prélats
& autres ecdéjîajliques, qui faifoient en perfonne
le fervice militaire qu’ils dévoient pour leurs fiefs.
On voit dans les regiftres de la chambre des comptes
, qu’Henri de Thoire & de Viliars, étant évêque
de Valence & depuis archevêque de L y on , porta
les armes , avec Humbert fire de Thôire & de Vil-
lars, fon frere aîné, dans les armées de Philippe de
Valois en Flandres, dans les années 1337, 1338,
1340, 134 1, & 1342, ayant fix chevaliers & quatre
vingt-deux écuyers de leur compagnie.
JeandeMeulant évêque de Meaux, fe trouva aufli
en 1339 & 1340, dans les armées de Flandres.
Renaut Chauveau évêque de Châlons, afîifta à
la bataille de Poitiers où il fut tué; & Guillaume de
Melun archevêque de Sens, y fut fait prifonnier.
A la bataille d’Azincourt, donnée le 25 Octobre
*4*5 > Guillaume de Montaigu archevêque de Sens,'
qui fut lé feul entrelès ecdéjîajliques qui fe trouva en
perfonne à cette journée, fit admirer fon grand courage
dont il avoit déjà donné des preuves en d’autres
occafions ; il fe porta dans celle-ci aux endroits les
plus dangereux, & y perdit la vie.
Louis d’Amboife cardinal & évêque d’AIby, s’employa
aufli fort utilement au fîége de Perpignan l’an
*475-
Dans la fuite, au moyen des contributions d’hom-
meS ^c/<^ar8ent fl*-16 l&'dcléjiàjliques ont fournies, ils
ont ete peu-à-peu difpènfes de fervir en perforine,
& même entièrement exemptés du ban & de Parrie-
re-ban, tant par François I. le 4 Juillet 1^4 § “ que
par contrat du 29 Avril 1636 , fous le règne de
Louis XIII.
Depuis le régné de Côrtftaütin, les ecdéjiàjliques
put toûjours été en grande confidératiôn chez tous
les princes chrétiens, & fingUlierement en France,
où on leur a accordé plufieurs honneurs, diftinç-
tions, & priyilqges, tant au clergé en corps , qu’à
chacun des membres qui le eompofent.
Le fécond concile de Mâcon tenu en 58 5 , porte
que les laïcs honoreront les clercs majeurs, c’eft-à-
dire ceux.qui ayqient reçu le. fous-diaconat ou un
autre ordre fupérieur; que quand ils fe rencontre-
roient, fi l’un & l’autre étoient à cheval, le laïc ôte-
roit fon chapeau ; que fi le clerc étoit à pié, le laïc
defeendroit de cheval pour le faluer.
Une des principales prérogatives, que les eccjéjîaf-,
tiques ont dans l’état, c’eft de former le premier des
trois ordres qui le eompofent, & de précéder la no»
bleffe dans les affemblees qui leur font communes^
quoique dans l ’origine la nobleffe fût le premier ordre,
& même proprement le feul ordre confidéré
dans l’état.
Pour bien entendre comment leseccléjîajliques ont
obtenu cette, prérogative, il faut obferver que les
évêques eurent beaucoup de crédit dans le royaume
, depuis que Clovis eut embraffé la religion chrétienne
; ils furent admis dans fes confeils, & eurent
beaucoup de part au gouvernement des affaires temporelles.
On croit aufli que tous les ecdèJîaJliquePfrancs &
tous ceux qui étoient ingénus & libres, furent admis
de bonne-heure dans les affemblées de la nation ;
mais c’étoit d’abord fans aucune diftinûion , c’eft-
à-dire fans y former un ordre à part.
Ils ne tenoient point non plus alors d’ affemblées
réglées pour leurs affaires temporelles ; s’ils s’affem
bloient quelquefois en pareil cas, l’affaire étoit terminée
en une ou deux féances. Les affemblées que
le clergé tient préfentement de tems en tems, n’ont
commencé à devenir fréquentes & à prendre une
forme réglée , que depuis le contrat de Poifîy en
1561. Voyei ce qui en a été dit aux mots CLERGÉ,
D é c im e , D o n g r a t u i t .
Mais fi les ecdéjîajliques n’étoient pas alors au'to-
rifés à tenir de telles affemblées, ils eurent l’avantage
d’être admis dans les affemblées de la nation ou
parlemens généraux.
Il y avoit trente-quatre évêques au parlement, où
Clotaire fit refoudre la loi des Allemands. Les abbés
étoient aufli admis dans ces affemblées. Le nombre
des ecdéjîajliques y étoit quelquefois fupérieur à celui
des laïcs : c’eft de-là que les hiftoriens eccléjîajli-
ques, comme Grégoire de Tours, donnent fouvent à
ces affemblées le nom de fynodes ou conciles.
Mais il paroît que dès le tems de Gontran, on
n’appellôit plus aux affemblées que ceux que l’on
iugeoit à-propos: en effet, quoiqu’il fût queftion de
juger deux ducs, on n’y appella que quatre évêques.
Il eft probable qu’on ne les appelloit tous à ces affemblées
, que quand quelqu’un d’eux y étoit intéreffé.
Ces affemblées ne fubfifterent pas long-tems dans
la même forme, tant à caufe des partages de la monarchie
, qu’à caufe des entreprifisjs de Charles Mart
e l,’lequel irrité contre les ecdéjîajliques , abolit ces
affemblées pendant les vingt-deux ans de fa domination.
Elles furent rétablies par Pepin-le-Bref, lequel
y fit de nouveau recevoir les prélats, leur y donna
le premier rang ; & par leur fuffrage, il gagna tout
le monde. Il confia à ces affemblées le foin de la police
extérieure ; emploi que les prélats faifirent avec
avidité, & qui changea la plûpart des parlemens en
conciles.
On •diftinguoit cependant dès le tems de Charlemagne
deux chambres.
L’une pour les ecdéjîajliques , où les évêques, les
abbés, & les vénérables clercs, étoient reçus fans
que les laïcs y euffent d’entrée : c’ètoit-là que l’on
Totp.e Vx
traitoit toutes les affaires ecdéjîajliques ou réputées
telles, dont les ecdéjîajliques affeélerent de ne point
donner connoiflance aux laïcs.
L’autre chambre où fe traitoient les affaires du gou»
vernement civil & militaire*.étoit pour les comtes
& autres principaux feigneurs laïcs, lefqliels de leur
part n’y admettoient pas non plus les ecdéfiajtlques 5
quoique probablement ceux-ci çonfultaffent, du-»
moins comme cafuiftes ou jurifconfultes, pour la dé»
cifioh des affaires capitales, mais fans avoir part aux
jugemensl.
Ces deux chambres fe réuniffoient quand elles ju»
geôient à -propos, félon la nature des affaires qui
paroiffoient mixtes, c’eft-à-dire eccUJiajliques & ci-»
viles-.
Les ecdéjîajliques, tant du premier que du fécond
ordre, s’étant ainfi par leur crédit attribué la féance
avant les plus hauts barons, ils fiégeoient même au-
deffus du chancelier ; mais le parlement, par un arrêt
de 1287, rendit aux barons la féance qui leur ap-
partenoit, & renvoya les prélats & autres gens d’églife,
dans un rang qui ne de voit point tirer à con*-
léquence.
Philippe V-. rendit une ordonnance le 3 Décembre
1 3* 9 , portant qu’il n’y auroit dorénavant aucuns
prélats députés au parlement, le roi fe faifant confidence
de les empêcher de vaquer au gouvernement
de leur fpiritualité. Il paroît néanmoins que cette ordonnance
ne fut pas toûjours ponctuellement exécutée
; car le parlement,toutes les chambres aflemblées
le 28 Janvier 147 1, ordonna que dorénavant les archevêques
& évêques n’entreroient point au confeil
de la cour fans le congé d’icelle, ou s’ils n’y étoient
mandés, excepté les pairs de France, & ceux qui
par privilège ancien y doivent & ont accoûtumé y
venir & entrer.
Les évêques qui poffedent les fix anciennes pairies
eccUJiajliques, fiegent encore au parlement après
les princes du fang, au-deffus de tous les autres pairs
laïcs..^
Pour ce qui eft des confeillers-clercs qui font ad*-
mis au conleil du roi,dans les parlemens & dans plufieurs
autres tribunaux , ils n’y ont rang & féance
que fuivant l’ordre de leur réception, excepté en là
grand-chambre du parlement de Paris, où ils ont une
féance particulière du côté des préfidens à mortier.
Indépendamment de l’entrée & féance qui fut
-donnée aux ecdéjîajliques dans les affemblées de la
nation & parlemens, comme ils étoient prefque les
-feuls dans les fiecles d’ignorance qui euffent quelque
connoiflance des lettres, ils rempliffoient aufli prefque
feuls les premières places de l’état, & celles des
autres cours & tribunaux , & généralement prefque
toutes les fondions qui a voient rapport à l’adminif-
tration de la juftice.
Tandis qu’ils s’occupoient ainfi des affaires temporelles
, le relâchement de la difeipline eccléfiafti-
que s’introduifit bien-tôt parmi eux; ils devinrent
la plûpart chaffeurs, guerriers-, quelques-uns même
concubinaires : ils prirent ainfi les moeurs des feigneurs
qu’ils avoient fiipplantés dans Fadminiftration
& le crédit. Grégoire de Tours dit lui-même qu’il
avoit peu étudié, & on le voit bien à fon ftyle.
Quand les ecdéjîajliques Ae quelque ville ou autre
lieu, ne pouvoient obtenir des laïcs ce qu’ils voir»
loient, ils p.ortoient dans un champ les croix, les
vafes facrés, les ornemens , & les reliques , formaient
autour une enceinte de ronces & d’épines ,
& s’en alloient. La terreur que cet appareil infpiroit
aux laïcs, les èngageoit à rappeller les gens d’églife
& à leur accorder ce qu’ils demandoient. Cet ufàge
ne fut aboli qu’au concile de Lyon, tenu fous Grégoire
X. vers l’an 1274. .
•En France, les ■ eçcléjîàjliques féculiers étoient en
' ' F f ij '