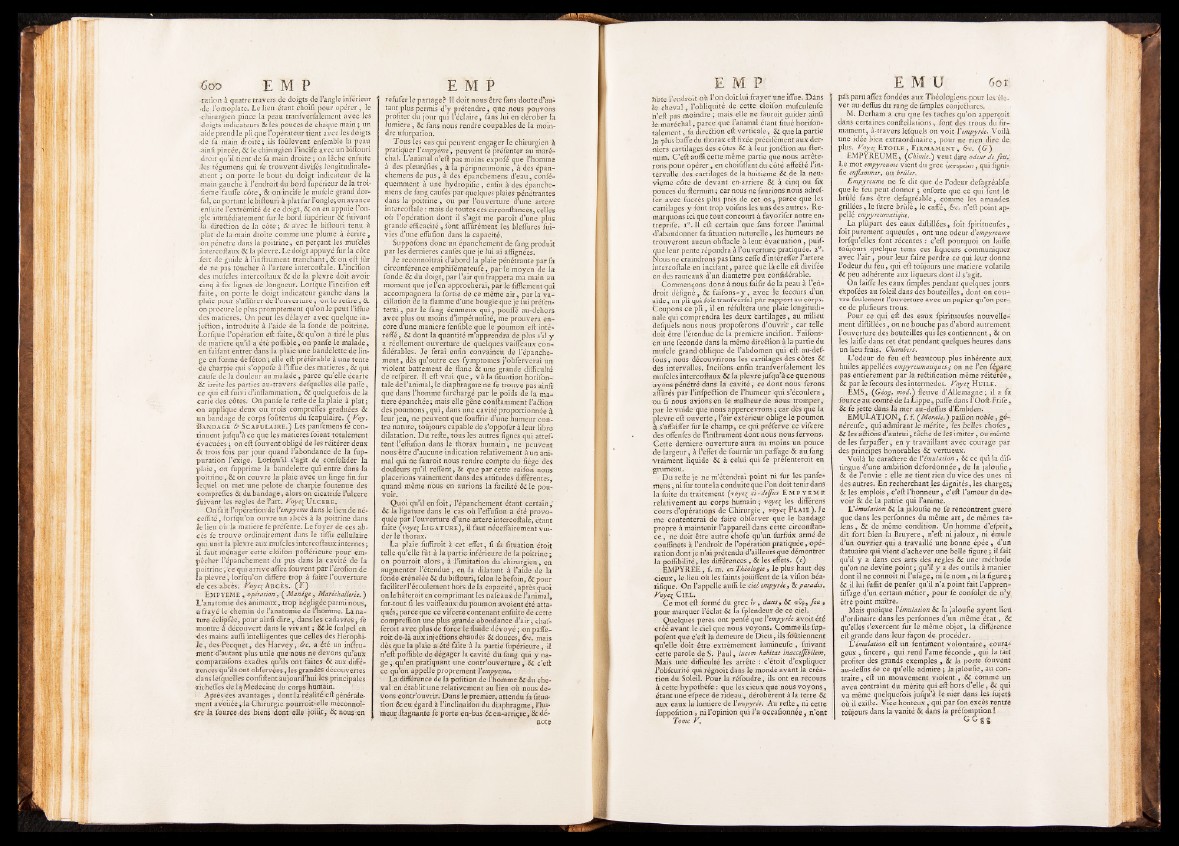
II
ra tio n à q u a tre tra v e rs de doigts d e l’angle inférieur
•de l’om oplate. L e lieu é tan t choifi p o u r o p é re r, le
•chirurgien p ince la p eau tran fv erfalem en t av ec les
•doigts in d icateurs & les pouces d e chaque m ain ; un
■ aide pre nd le pli q u e l’o p é ra te u r tie n t av ec les doigts
•de fa m ain d ro ite ; ils foû lev en t enfem ble la p eau
.ainfi p incée; & le chiru rg ien l’incife av ec un bifto u ri
d ro it qu ’il tie n t d e fa m ain d ro ite ; o n lâche enfuite
Jç s tégum ens q u i fe tro u v e n t divifés lo ngitudinalem
e n t ; o n p o rte le b o u t d u d o ig t in d ic ate ur de la
m a in g au ch e à l’en d ro it du b o rd fupérieur de la troi-
-fiem e fauffe co te ,& o n incife le m ufcle grand dor-
-fal, en p o rta n t le bifto u ri à p lat fur l’ongle; on av an ce
en fuite l’extrém ité de ce d o ig t, & on en appuie l’on-
jgle im m éd iatem en t fur le b o rd fup érieu r & fuiv-ant 4a dire d io n d e la cô te ; & av ec le biftouri te n u à
:p lat de la rn a in dro ite com m e une plum e à é c r ire ,
:on p én étré dans la p o itrin e , en p e rçan t les m ufcles
in terco ftau x & la p le v re . L e doigt ap p u y é fur la c ô te
.fert de g uide à l’in ftrum en t tra n c h a n t, & o n eft fur
d e ne p as to u c h e r à l’a rte re interco ftale. L ’incifion
des m ufcles in terco ftau x & de la p le v re d o it a v o ir
cin q à fix lignes de lo n g ue ur. L o rfq u e l’in cifio n eft
f a ite , o n p o rte le doigt in d ic a te u r g au ch e dans la
.plaie p o u r s’afîïirer de l ’o u v e rtu re ; o n le r e tir e , &
on p ro cu re le plus p rom p tem en t qu ’o n le p e u t l’iffue
des m atières. O n p e u t les d é lay er a v e c q u elq u e injection
, in tro d u ite à l’aide de la fonde de p o itrin e.
L o rfq u e l’o p éra tio n eft fa ite , & q u ’o n a tiré le plus
d e m atière q u ’il a é té p o ffib le , o n p an fe le m a la d e ,
e n faifant e n tre r dans la p la ie u n e b an d elette de lin ge
en form e de féton ; elle eft p ré férab le à u n e te n te
-de ch arp ie qui s’o ppofe à l’iffue des m a tiè re s, & qui
c a u fe de la do u leu r aii m a la d e , p arce q u ’elle écarte
& irrite les p a rtie s a u -trav ers defquelles elle p affe,
c e qui eft fiiivi d ’in flam m atio n , & quelquefois de la
c a rie d es cô tes. O n pan fe le refte de la p la ie à p la t;
o n ap p liqu e deux o u tro is com prefles g raduées &
u n b an d ag e de co rps foû ten u s du fcap u laire. \Voy.
B a n d a g e & S c a p u l a ir e .) L es panfem ens fe c o n tin
u e n t jufqu’à ce q u e les m atières foien t to talem en t
év acu ées ; o n eft fo u v e n t obligé de les ré ité re r deux
& tro is fois p a r jo u r q u an d l’ab o n d an ce de la fup -
p u ra tio n l’exige. L o rlq u ’iL .s’ag it de confùlider la
p la ie , on fup p rim e la b a n d e le tte q u i e n tre dans la
p o itrin e , & o n c o u v re la p laie av e c u n lin ge fin fur
leq u el o n m et u n e p elo te de ch arp ie fo u te n u e des
'com prefles & du b a n d a g e , alo rs o n cicatrife l’ulcere
fu iv a n t les réglés de l’a rt. Voye^ U l c é r é .
O n fait l’d p éra tio n de Yempyeme dan s le lieu de né-
ceffité , -lorfqu’ôn o u v re u n abcès à la p o itrin e dans
le lieu oh f a m atière fe p ré fen te. L e fo y e r de ces abcès
fe tro u v e o rd in airem e nt dans le tiffu cellulaire
;qui u n it la p lev re aux m ufcles in terco ftau x in tern es ;
il fau t m énager c e tte clo'ifon p o ftérieu re p o u r em p
ê c h e r l’ép an ch em en t du p u s dans la ca v ité de la
p o itrin e , ce q u i a rriv e affez fo u v e n t p a r l’érofion de
la p le v re lorfqu’o n diffère tro p à fa ire l’o u v e rtu re
d e ces-abcès. Voyt{ A b c è s .- ( E )
Em P YEM E ^opération,Manège , MaréchalUrie. )
L ’anatom ie des a n im a u x , tro p négligée parm i n o u s,
a fra y é le chem in de l’an atom ie de l’hom m e. L a n atu
re éclip fée, p o u r ain ft dire:,; dan s les c a d a v re s, fe
-m ontre à d éc o u v e rt dans le v iv a n t ; & le fcalpel en
-des m ains aufli intelligentes que celles des H érophir
l e , des^Pecquet, des H a rv e y ,:# « :, a é té un in ftru -
m e n t d’au tan t plus u tile qtié n o u s n e devons qu ’aux
C om paraifons exa& es qu ’ils o n t faites & aux différe
n c e s q u ’ils o n t o bfervees les grandes déco u v ertes
■ dans léfquelles co n fiften tau jo u rd ’h u i les principales
tfiçheffes d e là;M edecihç du co rps hum ain.
i A pfèsrcès av an tag és d o n t la ré a lité eft g énéralem
e n t avo u ée ,d a C h irurg ie p o ù rro it-elle m cconnoî-
tr e la io u rc e des b ien s d o n t elle jo u it, de nous en
! refuferle partage? Il doit nous être fans doute d’autant
plus permis d’y prétendre, que nous pouvons
profiter du jour qui l’éclaire, fans lui en dérober la
lumière, & fans nous rendre coupables de la moindre
ufurpatioa.
Tous les cas qui peuvent engager le chirurgien à
pratiquer Yempyeme, peuvent fe préfenter au maréchal.
L’animal n’eft pas moins expofé que l’homme
à des pleuréfiés , à la péripneumonie, à des épan-
chemens de pus, à des épanchemens d’eau, confé-
quemment à une hydropifie, enfin à des épanchemens
de fang caufés par quelques plaies pénétrantes
dans la poitrine, ou par l’ouverture d’une artere
intercoftale : mais de toutes ces circonftances, celles
où l’opération dont il s’agit me paroît d’une plus
grande efficacité, font.affûrément les bleffures fui-
vies d’une effiifion dans la capacité.
Suppofons donc un épanchement de fang produit
par les demieres caufes que je lui ai affignées.
Je reconnoîtrai d’abord la plaie pénétrante par fa
circonférence emphifémateufe, par le moyen de la
fonde & du doigt, par l’air qui frappera ma main au
moment que je l’en approcherai, par le fifflement qui
accompagnera la fortie de ce même air, par la vacillation
de la flamme d’une bougie que je lui préfen-
terai, par le fang écumetix qui, pouffé au-dehors
avec plus ou moins d’impéluolité, me prouvera encore
d’une maniéré, fenfible que le poumon eft inté-
refle, & dont la quantité m’apprendra de plus s’il y
a réellement ouverture de quelques vaiffeaux con-
fidérables. Je ferai enfin convaincu de l’épanchement
, dès qu’outre ces fymptomes j’ôbferverai un
violent battement de flanc & une grande difficulté
de refpirer. IL eft vrai que, vu la fituarion horifon-
tale de l’animal, le diaphragme ne fe trouve pas ainfi
que dans l’homme fiirchargé par le poids de la matière
épanchée ; mais elle gêne conftamment l’aélion
des poumons, qui, dans une cavité proportionnée à
leur jeu, ne peuvent que fouffrir d’une humeur contre
nature, toûjours capable de s’oppofer à leur libre
dilatation. Du refte, tous les autres lignes qui attef-
tent l’effiifion dans le thorax humain, ne peuvent
nousêtre d’aucune indication relativement à un animal
qui ne fauroit nous rendre compte du liège des
douleurs qu’il reffent, & que par. cette raifon nous
placerions vainement dans des attitudes différentes;
quand même nous en aurions la facilité & le pouvoir.
Quoi qu’il enfoit, l’épanchement étant certain,’
& la ligature dans le cas où l’effulion a été provoquée
par l’ouverture d’une- àrtere intercoftale, étant
faite (voyeç L igature) , il faut néceffairement vui-
der le thorax.
La plaie fuffiroit à cet effet, fi fa fîtliation étoit
telle qu’elle fut à la partie inférieure de la poitrine ;
on pourroit alors , ù d’imitation du'chirurgien, en
augmenter l’étendue, en la dilatant à l’aide de la
fonde Crénelée & du biftouri, félon le befoin, & pour
faciliter l’écoulement hors de la capacité, après quoi
onlehâteroiten comprimant les nafeauxde l’animal,
fur-tout fi-Ies vaiffeaux du poumon avaient été attaqués,
parce que ce vifeere contenant enfuite de cette
compreflion une plus grande abondance d’air, chai-
feroit avec plus de forçe-le fluide dévoyé ; on paffe-
roit de-là aux inje&ions ohaudes & douces, &c. mais
dès que la plaie a été faite à la partie fupérieure, il
n’eft poffible de dégager la cavité du fang qui y nage
;;qu’en pratiquant une Contr’ouverture, & c’eft
ce qu’on appelle proprement Yempyejne.
La différence de la pofition de l’homme & du chev
a l in établit une relativement au lieu où nous devons
contr’ouvrir. Dans le premier, attendu fa fi t nation
& eu égard à l’inclinaifondu diaphragme, l’humeur
ftagnante fe porte en-bas U en-arriere, & dénote
v, îhiïa ^ l l i j - | , f i
hôte l’endroit où l’on doit lui frayer une iffue. Dâns
le cheval, l’obliquité de cette cloifon mufculeufe
n’eft pas moindre ; mais, elle ne fàuroit guider ainfi
le; maréchal, parce que l’animal étant fitué horifon-
talement, la direction eft verticale , & que la partie
la plus baffe du thorax eft fixée précifément aux derniers
cartilages des côtes & à leur jonCtion au fter-
mim. C ’eft aufli cette même partie que nous arrêterons
pour opérer, en choififfant du côté affeCté l’intervalle
des cartilages de la huitième & de la neu-
„ vieme côte de devant en-arriere & à cinq ou fix
pouces du fternum ; car nous ne faurions nous adref-
ler avec fuccès plus près de cet. os , parce que lès
cartilages y font trop voifins les uns des autres. Remarquons
ici que tout concourt à favorifer notre en-
treprife. i°. Il eft certain que fans forcer l’animal
d’abandonner fa fltuation naturelle , les humeurs ne
trouveront aucun obftaçle à leur évaluation, puif-
que leur pente répondra à l’ouverture pratiquée, i 0-.
Nous ne craindrons pas faiis celte d’intéreffer l’artere
intercoftale en incifant, parce qué là elle eft diviféè
en des rameaux d’un diamètre peu conlidérable.
Commençons done à nous failir de la peau à l’endroit
défigné, & faifons-y , avec le fecoürs d’un
aide, un pli qui foit tranfverfal pàr rapport au corps.
Coupons ce p li, il en réfültêra Une plaie longitudinale
qui comprendra les deux cartilages, au milieu
délquels nous nous propoferons d’ôuvrif, car telle
doit être l’étendue de la première incifiort. Faifons-
en une feéondè dans la même direction à la partie du
mufcle grand oblique de l’abdomen qui eft au-def-
fous, nous découvrirons les cartilages des côtes &
des intervalles-: Incifons enfin tranfverfalement les
mufcles intercoftaux la plevre jufqu’à ce que nous
ayons pénétré dans' la cavité, ce dont nous ferons
affûrés par l’infpeftion de l’humeur qui s’écoulera,
ou fi nous avions eu le malheur de nous tromper,
par le vuide que nOùs apperceVrons ; car dès que la
plevre eft ouverte, l’air extérieur oblige le poumon
à s’affaiffer fur le champ, ce qui préferve ee vifeere
des offènfes de l’inftrument dont nous nous fervons.
Cette derniere ouverture aura au moins un pouce
de largeur, à l’effet de fournir un paffage & au fang
vraiment liquide & à celui qui fe prefenteroit en
grumeau.
Du refte je ne m’étendrai point ni fur les panfe-
mens, ni fur toute la conduite que l’on doit tenir dans
la fuite du traitement (ydye[ ci - diffus E M P y e M e
relativement au corps huïnain ; vqye£ les différens
cours d’opératiops de Chirurgie, vàye{ Plaie). Je
me contenterai de faire obferver que le bandage
propre à maintenir l’appareil dans cette circonftan-
c e , ne doit être autre chofe qu’un furfaix arme de
couffinets à l’endroit de l’opération pratiquée, operation
dont je n’ai prétendu d’ailleurs que démontrer
la poffibilité, les différences, & les effets. («) EMPYRÉE, f. m. en Théologie, le plus haut des
cieux, le dieu où les faints joüiffent de la vifion béa-
tifique. On l’appelle aufli le ciel empyrée, & paradis.
Voyeç Ciel.
Ce mot eft formé du grec *V, dans, & , feu ;
pour marquer l’éclat & la fplendeur de ce ciel. ^
Quelques peres ont penfé que Y empyrée avoit été
créé avant le ciel que nous voyons. Comme-iis fup-
pofent que c’eft la demeure de D ieu, ils fdûtiennent
qu’elle doit être • extrêmement lumineufe , fuivant
cette parole de S. Paul, lucem habitat inacceffbiletrt.
Mais une difficulté les arrête : c’étoit d’expliquer
l’obfcurité qui régnoit dans le monde avant la création
du. Soleil. Pour la réfoudre, ils ont eu recours
à cette hypothèfe : que les ci.eux que nous voyons ,
étant une efpece de rideau, .dérobèrent à la terre &
aux eaux la lumière de Y empyrée. Au refte , ni cette
fuppofition » ni l’opinion qui l’a occaûonnée^ n’ont
Tome V,
pâ5 paru affe2 fondées aux Théologiens pour les élever
au-deffus du rang de Amples conjedurcs.
M. Derham a cru que les taches qu’on apperçoit
dans certaines conftellatiôns, font des trous du firmament,
à-travers lefquels on voit Y empyrée. Voilà
une idée bien extraordinaire, pour ne rien dire de
plus. Voye{ Etoile , Firmament , & c. (G )
EMPYREUME, {Chimie.') veut dire odeur de feu^
Le mot empyreume vient du grec lp.7r0f.tvuv, qui figni-
fie enflammer, ou brûler\
Empyreume ne fé dit que de l’odeur defâgréable
que le feu peut donner ; enforte que ce qui fent le
brûle fans être defagréable, comme les amandes,
grillées, le fucre brûlé, le e a f f é ,^ n’eft point ap-
pellé empyreumatique.
La plupart des eaux diftillées, foit fpiritueufes,
foit purement aqueufes, ont une odeur d’empyreume
lorfqu’elles font récentes : c’eft pourquoi on laiffe.
toûjours quelque tems ces liqueurs communiquer
avec l’air , pour leur faire perdre ce qui leur donne
l ’odeur du feu, qui eft toujours une matière volatile
& peu adhérente aux liqueurs dont il s ’agitk
On laiffe les eaux Amples pendant quelques jours
expofées au foleil dans des bouteilles, dont on couvre
feulement l’ouverture avec un papier qu’on perce
de plufieurs trous-.
Pour ce qui eft des eaux fpiritueufes nouvellement
diftillées, on ne bouche pas d’abord autrement
l’ouverture des bouteilles qui les contiennent, & on
les laiffe dans eet état pendant quelques heures dans
un lieu frais. Chambers-,
L’odeur de feu eft beaucoup plus inhérente aux
huiles appellées empyreumatiques > on ne l’en fépare
pas entièrement par la re&ification même réitérée ,
& par le feçours des intermèdes, f^oye^ Huile.
EMS, ( Géag. mod.) fleuve d’Allemagne ; il a fa
fource au comté de la Lippe, paffe dans l’Ooft-Frife,
& fe jette dans la mer au-deffus d’Émbden.
EMULATION, f. f. (Morale.) paljîon noble, gé-
néreufe, qui admirant le mérite, les belles chofes ,
& les aélions d’autrui, tâche de les imiter, ou même
de les furpaffer, en y travaillant avec courage par
des principes honorables Sc vertueux.
Voilà le cara&ere de Y émulation, ôc ce qui la dif-
tingue d’une ambition defordonnée, de la jaloufie ,
& de l’envie : elle ne tient rien du vice des unes ni
des autres. En recherchant Jes dignités, les charges,'
& les emplois, c’eft l’honneur, c’eft l’amour du devoir
& de la patrie qui l’anime.
L'émulation & la jaloufie ne fe rencontrent guere
que dans les perfonnes du même art, de mêmes ta-f
lens, & de même condition. Un homme d’efprit,
dit fort bien la Bruyere, n’eft ni jaloux, ni émule
d’un ouvrier qui a travaillé une bonne épée , d’un
ftatuaire qui vient d’achever une belle figure ; il fait
qu’il y a dans ces arts des réglés & une’méthode
qu’on ne devine point ; qu’il y a des outils à manier
dont il ne eonnoît ni l’ufage ; ni le nom, ni la figure ;
& il lui fuffit de penfer qu’il n’a point fait l’appren-
tiffage d’un certain métier, pour fe confoler de n’y
être point maître.
Mais quoique Y émulation & la jaloufie ayent lieiï
d’ordinaire dans les perfonnes d’un même éta t , &
qu’elles s’exercent fur lè même objet, la différence
eft grande dans leur façon de procéder.
U émulation eft un fentiment volontaire, coura-'
geux , fincere, qui rend l’ame féconde , qui la fait
profiter des grands exemples , & la porte fouvent
au-deffus de ce qu’elle admire ; la jaloufie, au contraire
, eft un mouvement violent, & cpmme un
aveu contraint du mérite qui eft hors d’elie, & qui
va même quelquefois jufqu’à le nier dans les fujetâ
où il exifte. Vice honteux, qui par fon excès rentïe
toûjours dans la vanité & dans la préfomptiou 1
G G g g