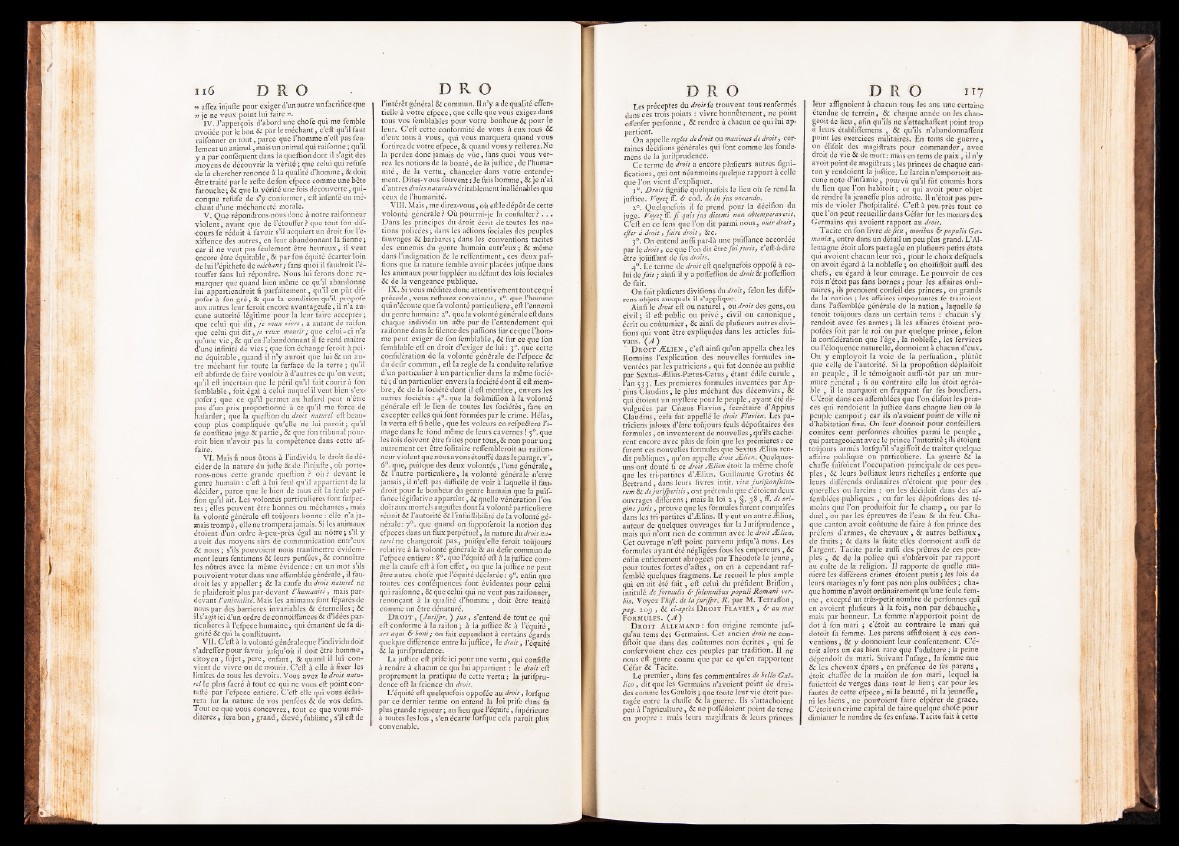
„ affez injufte pour exiger d’un autre unfacrificeque
» je ne veux point lui faire ».
IV. J’apperçois d’abord une chofe cpii me femble
avouée par le bon & pàr le méchant , c eft qu il faut
raifonner en tout, parce que l’homme n’eft pas feulement
un animal, mais un animal qui raifonne ; qu’il
y a par conféquent dans la queftiondont il s’agit des
moyens de découvrir la vérité ; que celui qui refuie
•de la chercher renonce à la qualité d’homme, & doit
■ être traité parle relie defon efpece comme une bête
farouche ; & que la vérité une fois découverte, quiconque
refufe de s’y conformer, elt infenfe ou méchant
d’une méchanceté morale.
V. Que répondrons-nous donc à notre raifonneur
violent, avant que de l’étouffer ? que tout fon dif-
cours fe réduit à favoir s’il acquiert un droit fur l’e-
xiftence des autres, en leur abandonnant la fienne;
car il ne veut pas feulement être heureux, il veut
encore être équitable, & par fon équité écarter loin
de lui l’épithete de méchant; fans quoi il faudroit l’étouffer
fans lui répondre. Nous lui ferons donc remarquer
que quand bien même ce qu’il abandonne
lui appartiendroit li parfaitement, qu’il en pût dif-
pofer à fon gré, & que la condition qu’il propofe
aux autres leur feroit encore avantageufe, il n’a aucune
autorité légitime pour la leur faire accepter ;
que celui qui dit, Je veux vivre, a autant de raifon
que celui qui dit,y« veux mourir; que celui-ci n’a
qu’une v ie , & qu’en l’abandonnant il fe rend maître
d’une infinité de vies ; que fon échange feroit à peine
équitable, quand il n’y auroit que lui & un autre
méchant fur toute la furface de la terre ; qu’il
eft abfiirde de fairè vouloir à d’autres ce qu’on veut;
qu’il eft incertain que le péril qu’il fait courir à fon
femblable, foit égal à celui auquel il veut bien s’ex-
pofer ; que ce qu’il permet au hafard peut n’être
pas d’un prix proportionné à ce qu’il me force de
hafardèr; que la queftion du droit naturel eft beaucoup
plus compliquée qu’elle ne lui paroît; qu’il
fe conftitue juge & partie, & que fon tribunal pour-
roit bien n’avoir pas la compétence dans cette affaire.
VI. Mais fi nous ôtons à l’individu le droit de décider
de la nature du jufte & de l’injufte, où porterons
nous cette grande queftion ? où ? devant le
genre humain : c’eft à lui feul qu’il appartient de la
décider, parce que le bien de tous eft la feule paf-
fion qu’il ait. Les volontés particulières font ful'pec-
tes ; elles peuvent être bonnes ou méchantes, mais
la volonté générale eft toujours bonne : elle n’a jamais
trompe, elle ne trompera jamais. Si les animaux
étoient d’un ordre à-peu-près égal au nôtre ; s’il y
avoit des moyens sûrs de communication entr’eux
& nous ; s’ils pouvoient nous tranfmettre évidemment
leurs fentimens & leurs penfées, & connoître
les nôtres avec la même évidence : en un mot s’ils
pouvoient voter dans une affemblée générale, il faudroit
les y appeller ; & la caufe du droit naturel ne
fe plaideroit plus par-devant l'humanité, mais par-
devant Vanimalité. Mais les animaux font féparés de
nous par des barrières invariables & éternelles ; &
il s’agit ici d’un ordre de connoiffances & d’idées particulières
à l’efpece humaine, qui émanent de fa dignité
& qui la conftituent.
VII. C ’eft à la volonté généraleque l’individu doit
s’ adreffer pour favoir jufqu’où il doit être homme,
citoyen , fujet, pere, enfant, & quand il lui convient
de vivre ou de mourir. C’eft à elle à fixer les
limites de tous les devoirs. Vous avez le droit naturel
le plus facré à tout ce qui ne vous eft point con-
tefté par I’efpece enfiere. C ’eft elle qui vous éclairera
fur la nature de vos penfées & de vos defirs.
Tout ce que vous concevrez, tout ce que vous méditerez
, fera bon, grand, élevé, fublime, s’il eft de
l’intérêt général & commun. Il n’y a de qualité effen-
tielle à votre efpece, que celle que vous exigez dans
tous vos femblables pour votre bonheur Sc pour le
leur. C ’eft cette conformité de vous à eux tous &
d’eux tous à vous, qui vous marquera quand vous
fortirez de votre efpece, & quand vous y relierez. Ne
la perdez donc jamais de vûe, fans quoi vous verrez
les notions de la bonté, de la juftice, de l’humanité
, de la vertu, chanceler dans votre entendement.
Dites-vous fouvent : Je fuis homme, & je n’ai
d’autres droits naturels véritablement inaliénables que
ceux de l’humanité.
VIII. Mais, me direz-vous j où eft le dépôt de cette
volonté générale? Où pourrai-je la confulter? . . .
Dans les principes du droit écrit de toutes les nations
policées ; dans les aélions fociales des peuples
fauvages & barbares ; dans les conventions tacites
des ennemis du genre humain entr’eux ; & même
dans l’indignation & le reffentiment, ces deux paf-
fions que la nature femble avoir placées jufque dans
les animaux pour fuppléer au défaut des lois fociales
& de la vengeance publique.
IX. Si vous méditez donc attentivement tout ce qui
précédé, vous relierez convaincu, i°. que l’homme
qui n’écoute que fa volonté particulière, eft l’ennemi
du genre humain : z°. que la volonté générale eft dans
chaque individu un aéle pur de l’entendement qui
raifonne dans le filence des paillons fur ce que l’homme
peut exiger de fon femblable, & fur ce que fon
femblable elt en droit d’exiger de lui : 30. que cette
confidération de la volonté générale de l’efpece &
du defir commun, eft la réglé de la conduite relative
d’un particulier à un particulier dans la même focié-
té ; d’un particulier envers la fociété dont il eft membre
, & de la fociété dont il eft membre, envers les
autres fociétés : 40. que la foûmifîion à la volonté
générale eft le lien de toutes les fociétés, fans en
excepter celles qui font formées par le crime. Hélas,
la vertu eft fi belle, que les voleurs en refpeélenx l’image
dans le fond même de leurs cavernes ! 50. que
les lois doivent être faites pour tous, & non pour un ;
autrement cet être folitaire reffembleroit au raifonneur
violent que nous avons étouffé dans le paragr. v".
6°. que, puifque des deux volontés, l’une générale,
& l’autre particulière, la volonté générale n’erre
jamais, il n’eft pas difficile de voir à laquelle il faudroit
pour le bonheur du genre humain que la puif-
fance légiflative appartînt, & quelle vénération l’on
doit aux mortels auguftes dont la volonté particulière
réunit & l’autorité & l’infaillibilité de la volonté générale:
70. que quand on fuppoferoit la notion des
efpeces dans un flux perpétuel, la nature du droit naturel
ne changeroit pas, puifqu’elle feroit toujours
relative à la volonté générale & au defir commun de
l’efpece entière : 8°. que l’équité eft à la juftice comme
la caufe eft à fon effet, ou que la juftice ne peut
être autre chofe que l’équité déclarée : 90. enfin que
toutes ces conféquences font évidentes pour celui
qui raifonne, & que celui qui ne veut pas raifonner,
renonçant à la qualité d’homme , doit être traité
comme un être dénaturé.
D r o i t , ( Jurifpr. ) ju s , s’entend de tout ce qui
eft conforme à la raifon ; à la juftice & à l’équité ,
ars tequi & boni; on fait cependant à certains égards
quelque différence entre la juftice, le droit, l’équité
& la jurifprudence.
La juftice eft prife ici pour une vertu, qui confifte
à rendre à chacun ce qui lui appartient : le droit eft
proprement la pratique de cette vertu : la jurifpru-
dence eft la fcience du droit.
L’équité eft quelquefois oppofée au droit, lorfqué
par ce dernier terme on entend la loi prife dans fa
plus grande rigueur; au lieu que l’équité, fupérieure
à toutes les lois, s’en écarte forfque cela paroît plus
convenable.
Les préceptes du droit fe trouvent tous renfermés
dans ces trois points : vivre honnêtement, ne point
©ffenfer perfohrte, & rendre à chacun ce qui lui appartient.
On appelle réglés de droit ou maximes de droit, certaines
décifions générales qui font comme les fonde-
mens de la jurifprudence.
Ce terme de droit a encore plufieurs autres lignifications,
qui ont néanmoins quelque rapport à celle
que l ’on vient d’expliquer.
i° . Droit lignifie quelquefois le lieu où fe rend la
juftice. Vqye%_ ff. & cod. de in jus vocàndo.
2°. Quelquefois il fe prend pour la décifion du
juge. Voye{ ff. f i quis jus diceriti non obtemperàverit.
C ’eft en ce fens que l’on dit parmi nous 5 oiiir droit,
efier à droit, faire droit, &c.
30. On entend auffi par-là une puiffance accordée
par {a droit, ce que l’on dit êtrafiiijurist c’eft-à-dire
être joüiffant de fes droits.
4°. Le terme de droit eft quelquefois oppofé à celui
de fait ; ainfi il y a poffeflion de droit & poffeflion
de fait. ' * •
On fait plufieurs divifiôns du droit, félon les diffe-
rens objets auxquels il s’applique.
Ainfi le droit eft ou naturel, ou droit des gens, ou
civil ; il eft public ou privé , civil ou canonique,
écrit ou coûtumier, & ainfi de plufieurs autres divi-
fions qui vont être expliquées dans les articles fui-
vàns. (^1)
D r o i t Æ l ie n , c’eft ainfi qu’on appella chez les
Romains l’explication des nouvelles formules inventées
par les patriciens, qui fut donnée au public
par Sextus-Ælius-Pætus-Catus, étant édile curule ,
l’an 533. Les premières formules inventées par Appuis
Claudius, le plus méchant des décemvirs, &
qui étoient un myftere pour le peuple, ayant été divulguées
par Cnæus Flavius, fecrétaire d’Appius
Claudius, cela fut appelle le droit Flavién. Lés patriciens
jaloux d’êtfe toûjours feuls dépofitaires des
formules, en inventèrent de nouvelles, qu’ils cachèrent
encore avec plus de foin que les premières : ce
furent ces nouvelles formules que Sextus Ælius rendit
publiques, qu’on appelle droit Ælien. Quelques-
uns ont douté fi ce droit Ælien étoit la même chofe
que les tri-partites d’Ælius. Guillaume Grotius &
Bertrand, dans leurs livres intit. vitoe jurifconfulto-
rum & de jurifpetitis, ont prétendu que c’étoientdeux
ouvrages différens ; mais la loi 2 , § .3 8 , ff. de origine
juris, pfôiiVe que les formules furent comprifes
dans les tri-partites d’Ælius. Il y eut un autre Ælius,
auteur de quelques ouvrages fur la Jurifprudence,
mais qui n’ont rien de commun avec le droit Ælien.
Cet ouvrage n’eft point parvenu jufqu’à nous. Les
formules ayant été négligées fous les empereurs, &
enfin entièrement abrogées par Théodofe le jeune,
pour toutes fortes d’aéles, on eft a cependant raf-
fernblé quelques fragmens. Le recueil le plus ample
qui etl ait été fait , eft celui du préfident Briffon,
intitulé de formulis & folcmnibus populi Roitiani ver-
bis. Voyez Ÿhifl. de la jurifpr. R. par M. Terraffon,
pag. 2.0c) 3 & ci-après DROIT FLAVIEN , & au mot
F o r m u l e s . ( A )
D r o i t A l l e m a n d : fon origine remonte juf-
qü’au tems des Germains. Cet ancien droit ne con-
fiftoit que dans des coûtumeS non écrites , qui fe
confervoient chez ces peuples par tradition. Il ne
nous eft guere cdnnu que par ce qft’én rapportent
Céfar & Tacite.
Le premier, dans fes commentaires de bello Gai-
lico, dit que les Germains n’a voient point de druides
comme les Gaulois ; que toute leur vie étoit partagée
entre la chaffe & l’a guerre. Ils s’àttachoient
peu à l’agriculture, & ne poffédoient point de terre
en propre : mais leurs magiftrâts & leurs princes
leur afiîgnoient à chacun tous les ans ünc cértaine
étendue de terrein, & chaque année on les changent
de lieu, afin qu’ils fte s’attachaffeftt point trop
a leurs établiffeiftens , & qu’ils n’abandonnaffent
point les exercices militaires. En tems de guerre,
on élifoit des magiftrats pour commander * avec
droit de Vie & dé mort: mais en tems de paix , il n’y
avoit point de magiftrats ; les princes de chaque canton
y rendoieftt la juftiee. Le larcin n’emportoit aucune
noté d’iftfamie ? pourvû qü’il fût commis hors
du lien que i’on habitoit ; ce qui' avoit pour objet
de rendre là jeuneffe plus adroite. Il n’étoit pas permis
de violer l’hofpitalité. C ’eft à peu-près tout ce
qiie l ’on peut recueillir dans Céfar fur les moeurs dés
Germains qui avoient rapport au droitt
Tacite en fon livre defitu j fnorïbus & populis Ger*
maniât, entre dans un détail un peu plus grand. L’Allemagne
étoit alors partagée en plufieurs petits états
qui avoient chacun leur ro i, pour le choix defquels
on avoit égard à la riobleffe ; on choififfoit auffi des
chefs j eu égard à leur courage. Le pouvoir de ces
rois n’étoit pas fans bornes ; pour les affaires ordinaires
j ils prenoient confeil dès princes, ou grands
de la nation ; les affaires importantes fe traitoient
dans l’affemblée générale de la nation, laquelle fe
tenoit toûjours dans un certain tems : chacun s’y i
rendoit avec fes armes ; là les affaires étoient pro-
pofées foit par le roi ou par quelque prince, félon
la confidération que l’âge, la nobleffe, les férvices
ou l’éloquence naturelle, donnoient à chacun d’eux.
On y eftiployoit la voie de la perfuafion, plûtôt
que celle de l’àütorité. Si là propofition déplaifoit
au peuplé, il le témoignoit auffi-tôt par un murmure
rénéral ; fi au contraire elle lui étoit agréable
, il le marquoif en frappant fur fès boucliers,
C ’ctoit dans ces aflemblées que l’on élifoit les princes
qui rendoient la juftice dans chaque lieu où le
peuple campoif ; car ils n’avoient point de ville ni
d’habitation fixe* On leur dortftoit pour confeillers
comités cent perfonnes ehoifies parmi le peuple ,
qui partageoient avec le prince l’autorité ; ils étoient
toûjours armés lorfqu’il s’agiffoit de traiter quelque
affaire publique ou particulière. La guerre & la
chaffe faifoient l’occupation principale de ces peuples
, Ôc leurs beftiaux leurs richeffes ; enforte que
leurs différends ordinaires n’étoient que pour des
querelles ou larcins : on les décidoit dans des af-
femblées publiques , ou fur les dépolirions des témoins
que l’on produifoit fur le champ , ou par le
duel, ou par les épreuves de Feau & du feu. Chaque
canton avoit coûtume de faire à fon prince des
préfens d’armes, de chevaux , & autres beftiaux,
de fruits ; & dans la fuite elles donnoient auffi de
l’argent. Tacite parle auffi des prêtres de ces peuples
, & de la police qui s’ôbfervoit par rapport
au culte de la religion. Il rapporte de quelle maniéré
les différens crimes étoient punis ; les lois de
leurs mariages n’y font pas non plus oubliées ; chaque
homme n’avoit ordinairement qu’une feule femme
, excepté un très-petit nombre de perfonnes qui
en avoient plufieurs à là fois, non par débauche,
mais par honneur. La femme n’apportoit point de
dot à fon mari ; c’étoit au contraire le mari qui
dotoit fa femme. Les parens aflîftoient à ces conventions
, & y donnoient leur côriferitement. C ’étoit
alors un cas bien rare que l’adultere ; la peine
dépendoit du mari. Suivant l’ufage, la femme nue
& les cheveux épars , en préfence de fes parens ,
étoit chaffée de la maifoft de fon mari, lequel 1«
foiiettoit de verges dans tout le' lieu ; car pour les
fautes de cette efpece, ni la beauté, ni la jeuneffe,
ni les biens, ne pouvoient faire efpérer de grâce.
C ’étoit un crime capital de faire quelque chofe pour
diminuer le nombre de fes enfans. Tacite fait à cette