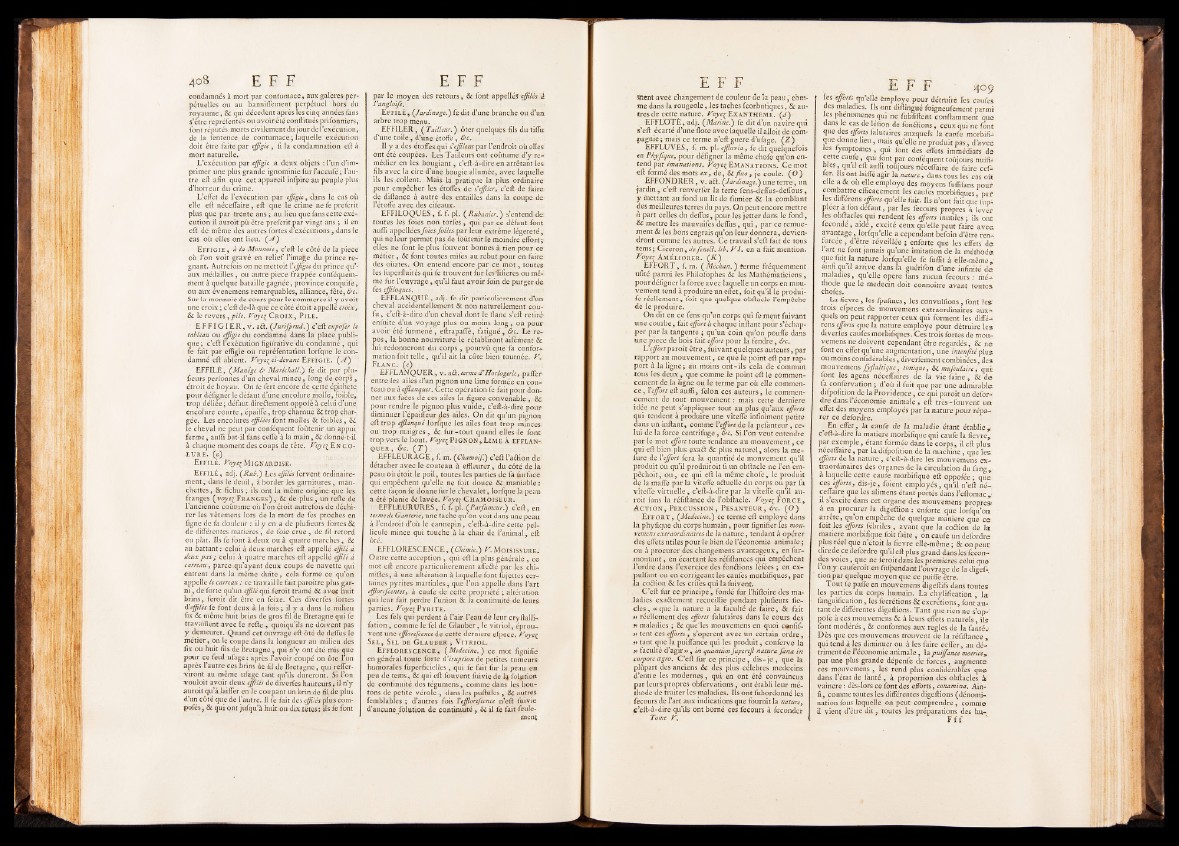
condamnés à mort par contumace, -aux galères per-
pétueiles oïl au banniffement perpétuel hprs : du
royaume, & qui décedênt après les cinq années fanS
s’être repréfentés ou avoir été conftitués prisonniers,
Font réputés morts civilement du jour de î’exécution,,
de la fentence. de contumace.; laquelle exécution;
doit être faite par effigie , li la condamnation eft à
mort naturelle.
L’exécution par effigie a deux objets : l’un d’imprimer
une plus grande ignominie furi’accufé; l’autre
eft afin que cet appareil infpire au peuple plus
d’horreur du crime.
L’effet de l’exécution par effigie, dans le cas oh
elle eft néceffaire , eft que le crime ne fe prefcrit
plus que par trente ans ; au lieu que fans cette exécution
il auroit pu être prefcrit par vingt ans ; il en
eft de même des autres fortes d’exécutions, dans le
cas où elles ont lieu.
Effigie , à la Monnoie, c’eft le côté de la piece
où l’on voit gravé en relief l’image du prince régnant.
Autrefois on ne mettoit Y effigie du prince qu’aux
médaillés , ou autre piece frappée conféquem-
ment à quelque bataille gagnée, province conquife,
ou aux evenemens remarquables, alliance, fête, &c.
Sur la monnoie de cours pour le commerce il y avoit
une croix ; c’eft de-là que ce côté étoit appelle croix,
6c le revers, pile. Voye^ Croix, Pile.
E F F IG I E R ,v . aét. ('Jurifprud.) c’eft expofer le
tableau ou effigie du condamné dans là place publique
; c’eft l’exécution figurative du condamné , qui
le fait par effigie ou repréfentatiori lorfqUe' lé condamné
eft abfent. Foye^ ci-devant EffÏGIE. (.^)
EFFILÉ, (Manège & Maréchall.') fe dit par plu—
fieurs perfonnes d’un cheval mince, long de corps,
étroit de boyau. On fe fert encore de çpttè épithete
pour défigner le défaiit d’une,encolure molle, foible,.
trop délice ; défaut direftement oppofé à celui d’une
encolure courte, épaiffe, trop charnue. 6c trop chargée.
Les encolures effilées font molles & foib'lê's, 6c
le cheval ne peut par conféquent foûtenir un appui/
ferme, auffi bat-il fans ceffe à la main, 6c donne-t-il
à chaque moment des coups de tête. Foye^ Encolu
r e . (e)
Effilé. Foye{ Mignardise.
Effilé, adj. ([Rub.) Les effilés fervent ordinairement,
dans le deuil, à border les garnitures /manchettes
, & fichus ; ils ont la même origine que les
franges (voye{ Franges); 6c de plus , un refte de
l’ancienne coutume où l’on étoit autrefois de déchirer
les vêtemens lors de la mort de fes proches en
ligne de fa douleur : il y en a de plufieurs. fortes 6c
de différentes matières, de foie crue , de fil retord
ou plat. Ils fe font à deux ou à quatre marches , 6c
au battant: celui à deux marches eft appelle effilé à
deux pas ; celui à quatre marches eft appelle effilé à
carreau, parce .qu’ayant deux coups de navette qui
entrent dans la même duite, cela forme c e . qu’on
appelle le carreau : ce travail le fait.paroître plus garni
, de forte qu’un, effilé qui feroit tramé 6c avec huit
brins, feroit dit être en feize. Ges diverfes fortes
d’effilés fe font deux à la fois ; il y a dans le milieu
fix 6c même huit brins de gros fil de Bretagne qui fe
travaillent avec le refte, quoiqu’ils ne doivent pas
y demeurer. Quand cet ouvrage eft ôté de deffus le !
mener, on le coupe dans la longueur au milieu des j
fix ou huit fils de Bretagne, qui n’y ont été mis que
pcxir ce feul ufage : après l ’avoir coupé on ôte l’un
après l’autre ces brins de fil de Bretagne, qui refter-
viront au même ufage tant qu’ils dureront. Si l’on
vouloit avoir deux effilés de diverfes hauteurs, il n’y
auroit qu’àlaiffer en le coupant un brin de fil de plus
d’un côté que de l’autre. Il fe fait des effilés plus com-
pofés, & qui ont jufqu’à huit ou dix têtes : ils fe font
par le moyen des retours, & font appelle*effilés à
T.angloijè. Effilé, (Jardinage f) fe dit d’une branche ou d’un
arbre trop menu.
EFFILER, ( Tailleur. ) ôter quelqufes fils du tiflii
d’une toile , d’une étoffe , &c.
Il y a des étoffes qui s’effilent par l’endroit où elles
ont été coupées. Les Tailleurs ont coûtume d’y remédier
en les; bougiant, c’eft-à^dire en arrêtant les
fils avec la cire d’une bougie allumée, avec laquelle
ils les collent. Mais là pratique la plus ordinaire
pour empêcher les étoffes de s’effiler, c’eft de faire
de diftance à autre des entailles dans la coupe de
l’étoffe, avee.des cifeaux.
EFFILOQUES, f. f. pl. ( Rubanier.) s’entend de
toutes les foies non torfes, qui par ce défaut font
auffi appellées foies folles par leur extrême légèreté,
qui ne leur permet pas de foûtenir lp moindre effort;
elles ne font le plus fouvent bonnes à rien pour ce
métier, 6c font toutes mifes au rebut ipour en faire
des ouates. On entend encore par ce mot, toutes
les fuperfluités qui fe trouvent fur les'lifieres ou même
fur l’ouvrage, qu’il faut avoir foin de purger de
fes effiloques.
EFFLANQUÉ, adj.: fe dit particulièrement d’un
cheval accidentellement & non naturellement cou-
fu , c’eft-à-dire d’un cheval dont le flanc s’eft retiré
enluite d’un voyage plus ou moins long, ou pour
avoir été furmené, eftrapaffé, fatigué., &c. Le repos,
la bonne nourriture-le rétabliront aifément &
lui redonneront du corps , pourvu que fa conformation
foit telle, qu’il ait la côte bien tournée. F. Flanc, (e) .
. EFFLANQUER., v. a£t. terme d*Horlogerie, palier
entre les ailés d’un pignon une lime formée en couteau
ou à efflanquer. Cette opération fe fait pour don-'
ner aux faces de ces ailes la figure convenable , 6c
pour rendre le pignon plus vuide, c’eft-à-dire pour
diminuerTépaiffeur des ailes. On dit qu’un pignon
eft trop efflanqué lorfque les ailes font trop minces
ou trop maigres, 6c fur-tout quand elles le font
trop versFè bout. Foye^ Pign on , Lime à efflan-.
quer , &c. ( T )
EFFLEURAGE, f. m. (Chamoif,!) c’eft l’aâion de
détacher avec le couteau à effleurer, du côté de la
peau où étoit le poil, toutes les parties de fa fiirface
qui empêchent qu’elle ne foit douce & maniable:
cette façon fe donne fur a été planie & lavée. le chevalet, lorfque la peau Foye{ Chamoiseur.
EFFLEURURES, f. f. pl. ( Parfumeur.) c’eft, en
termede Ganterie, une tache qu’on voit dans une peau
à l’endroit d’où le cannepin, c’eft-à-dire cette pellicule
mince qui touche à la chair de l’animal, eft
ôté.
EFFLORESCENCE, ( Chimie.) F. Moisissure.-
Outre cette acception , qui eft la plus générale , ce
mot eft encore particulièrement affeété par les chi-
miftes, à une altération à laquelle font fujettes certaines
pyrites martiales , que l’on appelle dans l’art
efflorefcentes, à caufe de cette propriété ; altération
qui leur fait perdre l’union & la continuité de leurs
parties. Foye^ Pyrite.
Les fels qui perdent à l’air l’eau de leur cryftalli-
fation, comme le fel de Glauber, le vitriol, éprouvent
une effiorefcence de cette derniere efpece. Foye^ Sel, Sel de Glauber , Vitriol.
Efflorescence, ( Medtcine. ) ce mot fignifie
en général toute forte A'éruption de petites tumeurs
humorales fuperficielles , qui fe fait fur la peau en
peu de tems, 6c qui eft fouvent fui vie de 1^ folption
de continuité des tégumens, comme dans les boutons
de petite vérole , dans les pullules ,,6c autres
femblables ; d’autres fois Y effiorefcence n’eft fttivie
d’aucune folution de continuité, 6c il fe fait feulement
tftent aveè changement de couleur de la peaitcomme
dans la rougeole, les taches fcorbutiques, & autres
de cette nature. Foye^ Exanthème. (d \
. EFFLOTÉ, adj. (Marine.) fe dit d’un navire qui
s’eft écarté d’urte flote avec laquelle il alloit de compagnie;
mais ce terme n’eft guere d’ufage. (Z )
EFFLUVES, f. m. pl. effiuvia, fe dit quelquefois
tn Phÿfiqwy pour défigner la même chofe qu’on entend
par émanations. Fqye[ Emanations. Ce mot
eft formé des mots e x , de, 6cfluo, je coule. (O )
EFFONDRER, v. aél. (Jardinage.) une terre ; un
jardin, c’eft rénVerfer la terre fens-deffus-deffous,
y mettant au fond un lit de -fumier 6c la comblant
des meilleures terres du pays. On peut encore mettre
« part celles du deffus, pounles jetter dans le fond,
6c mettre les mauvaifes deffus, qui, par ce remue»-
ment & les bons engrais qu’on leur donnera, deviendront
comme les autres. Ce travail s’eft fait de tous
tems ; Cicéron, de fenecl. lib. F l . en a fait mention.
Foye^ Améliorer. ( K )
EFFORT, f. m. ( Méchan. ) ferme fréquemment
ufité parmi les Philofophes 6c les Mathématiciens,
pour défigner la force avec laquelle un corps en mouvement
tend à produire un effet, foit qu’il le produi-
fe réellement, foit que quelque obftacle l’empêche
de le produire.
On dit en ce fens qu’un corps qui fe meut fuivant
une courbe, fait effort à chaque inftant pour s’échapper
par la tangente ; qu’un coin qu’on pouffe dans
une piece de bois fait effort pour la fendre, &c.
Ueffort paroît être, fuivant quelques auteurs, par
rapport au mouvement, ce que le point eft par rapport
à.la ligne; au moins ont-ils cela de commun
tous les deux, que comme le point eft le commencement
de là ligne ou le terme par où elle commenc
e , Yeffort eft auffi, félon ces auteurs, le commencement
de tout mouvement : mais cette derniere
idée ne peut s’appliquer tout au plus qu’aux efforts
qui tendent à produire üiie vîteffe infiniment petite
dans un inftant, comme Y effort Ae la pefanteur, celui
de la force centrifuge, &t. Si l’on veut entendre
par le mot effort toute tendance au mouvement, ce
qui eft bien plus exaft 6c plus naturel, alors la me-
lure de Yeffort fera la quantité de mouvement qu’il
produit ou qu’il produiroit fi un obftacle ne l’en em-
pêchoit, ou , ce qui eft la même chofe, le produit
de la malle par la vîteffe aétuelle du corps ou par fa
vîteffe virtuelle, c’eft-à-dire par la vîteffe qu’il auroit
fans 4a réfiftance de l’obftacle. Foye^ Êorce,
Action, Percussion, Pesanteur, & c. (O)
Effort , (Medecine.) ce terme eft employé dans
la phyfique du corps humain, pour fignifier les mou-
vemens extraordinaires de la nature, tendant à opérer
des effets utiles pour le bien de l’économie animale ;
ou à procurer des changemens avantageux, en fur-
montant , en écartant les réfiftances qui empêchent
l ’ordre dans l’exercice des fonctions léfées ; en ex-
.pulfant ou en corrigeant les caufes morbifiques, par
la coélion 6c les crilès qui la fuivent.
C ’eft fur ce principe, fondé fur l’hiftoire des maladies
exactement recueillie pendant plufieurs ficelés
, « que la nature a la faculté de faire, & fait
» réellement des efforts falutaires dans le cours des
» maladies ; 6c que'les mouvemens en quoi c®nfif-
» tent ces efforts, s’opèrent avec un certain ordre, ,
tant que la puiffance qui les produit, conferve la
» faculté d’agir » , in quantum JupereJl natura fana in
corpore oegro. C ’eft fur ce principe, dis-je , que la
plûpart des anciens 6c des plus célébrés médecins
d’entre les modernes, qui en ont été convaincus
par leurs propres obfervations, ont établi leur méthode
de traiter les maladies. Ils ont fubordonné les
fecours de l’art aux indications que fournit la nature,
c ’eft-à-dire qu’ils ont borné ees fecours à féconder
Tome F,
îieS JP’fellé èmploye pour détruire lés eaufes
des maladies. Ils ont diftingué foigneufement parmi
les phénomènes qui ne fubfiftent conftamment que
dans le cas de lefion de fondions, ceux qui ne font
que des efforts falutaires auxquels la caufe morbifi-*
que donne lieu, mais qu’elle ne produit pas; d’avec
les lymptomes , qui font des effets immédiats de
cette caufe, qui font par conféquent toujours nuifii
oies, qiul eft auffi toujours néceffaire de faire cef- 1er. Ils ont laiffé agir la nature, dans tous les cas où
elle a & où elle employé des moyens fuffifans pouÉ
combattre efficacement les caufes morbifiques, patf
les différens efforts qu’elle fait. Ils n’ont fait que lup-
pleer à fon défaut, par les fecours propres à lever
les obftacles qui rendent fes efforts inutiles ; ils ont
fécondé, aide, excite ceux qu’elle peut faire avec
avantage ,Jorfqu’èlle a cependant befoin d’être renforcée
, d’être réveillée ; enforte que les effets de
l’art ne font jamais qu’une imitation de la méthode
que fuù la nature lorfqu’elle fe fuffit à elle-même*
ainfi qu’il arrive dans la guérifon d’une infinité de
maladies, qu’elle opéré fans aucun fecours : mé~
thode que le médecin doit connoître avant toute»
chofes.
La fievre, les Ipafmes, les convulfions, font le»
trois efpeces de mouvemens extraordinaires aux-*
quels on peut rapporter ceux qui forment les différens
efforts que la nature employé pour détruire les
diverfes caufes morbifiques. Ces trois fortes de mouvemens
ne doivent cependant être regardés, 6c ne
font en effet qu’une augmentation, une intenfitè plus
ou moins confiderables, diverfement combinées, des
mouvemens fyfialtique, tonique, 6c mujcülaire, qui-
font les agens néceffaires de la vie faine, 6c de
fa confervation ; d’où il fuit que par une admirable
dilpofition de la Providence, ce qui paroît un defor-:
dre dans l’économie animale, eft très-fouvent un
effet des moyens employés par la nature pour réparer
ce defordre.
^ En effet, la caufe de la maladie étant établie ÿ
c’eft-à-dire la matière morbifique qui caufe la fievre,1
par exemple, étant formée dans le corps, il eft plus
néceffaire, par la difpofition de la machine, que les
efforts de la nature , c’eft-à-dire les mouvemens extraordinaires
des organes de la circulation du fang,
à laquelle cette caule morbifique eft oppofée ; que
ces efforts, dis-je, foient employés, qu’il n’eft néceffaire
que les alimens étant portés dans l’eftomacy
il s’excite dans cet organe des mouvemens propres*
à en procurer la digeftion : enforte que lorfqu’on
arrête, qu’on empêche de quelque maniéré que ce
foit les efforts fébriles , avant que la coâion de la
matière morbifique foit faite , on caufe un defordre
plus réel que n’étoit la fievre elle-même ; & on peut
direde ce defordre qu’il eft plus grand dans les fecon-»
des voies, que ne feroit dans les premières celui que
I on y cauferoit en fnfpendant l’ouvrage de la digef-
' tion par quelque moyen que ce puiffe être.
Tout fe palTe en mouvemens digeftifs dans toutes
les parties du corps humain. La chylification , la
fanguification, les fecrétions & excrétions, font autant
de différentes digeftions. Tant que rien ne s’op-
pofe à ces mouvemens 6c à leurs effets naturels, ils
font modérés, & conformes aux réglés de la fanté.1
Dès que ces mouvemens trouvent de la réfiftance
qui tend à les diminuer ou à les faire ceffer, au détriment
de l’économie animale, la puiffance motrice^
paAme plus grande dépènfe de forces, augmente
ces mouvemens , les rend plus confidérabfes que
dans ftétat de fanté , à proportion des obftacles à
vaincre : dès-lors ce font des efforts, conamina. Ainfi,
comme toutes les différentes digeftions (dénomination
fous laquelle on peut comprendre, comme
il vient d’être dit, toutes les préparations des hu-
F f f