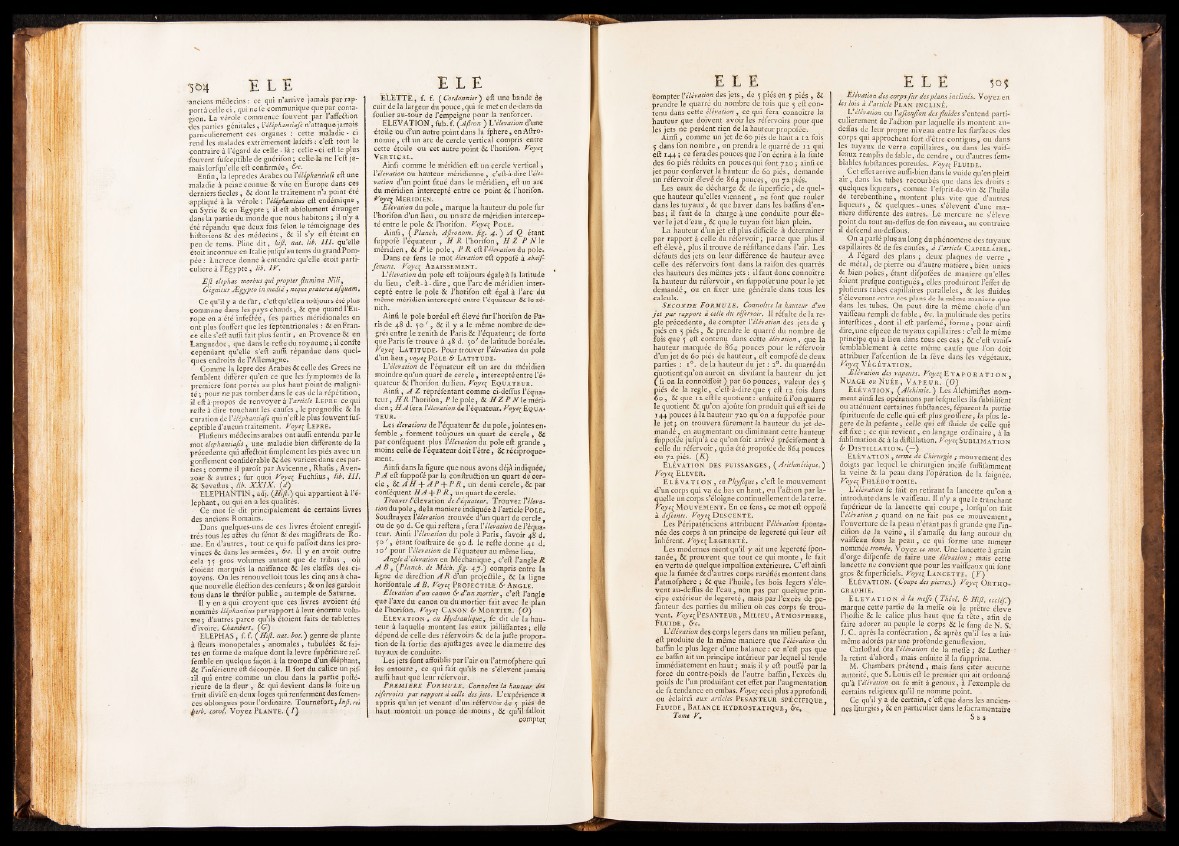
m E L E •anciens médecins : ce qui n’arrive jainais par rapport
à celle c i , qui ne fe communique que par contagion.
La vérole commence fouvent par Paffettion
■ des parties génitales, V-éléphantiafe n’attaque jamais
particulièrement ces organes : cette maladie - ci
rend les malades extrêmement lafcifsi c’eft tout le
contraire à l’égard de celle - là : celle - ci eft le plus
fouvent fufeeptible de guérifon ; celle-la ne l’eft jamais
lorfqu’elle eft confirmée, ■ 6*c.
Enfin, la lepre des Arabes ou Yèlèphantiaft eft une
maladie à peine connue & vue en Europe dans ces
derniers fiecles , & dont le traitement n’a point été
■ appliqué à la vérole : Vèlèphantias eft endémique ,
en Syrie & en Egypte ; il eft abfolument étranger
dans la partie du monde que nous habitons ; il n’y a
été répandu que deux fois félon le témoignage des
hiftoriens & des médecins, 6c il s’y eft éteint en
peu de tems. Pline dit, kifi. nat. lib. III. qu’elle
étoit inconnue en Italie jufqù’autems dugrandPom-
pée : Lucrèce donne à entendre qu’elle étoit particulière
à l’Égypte, Hb. I P .
Eft elephas morbus qui propïer flumina Nili,
Gignitur Ægypto in mediâ , neque praterea ufquam.
Ce qu’il y a de fûr, c'eft qu’elle a toujours été plus
commune dans les pays chauds, & que quand l’Europe
en a été infe&ée, fes parties méridionales en
ont plus fouffert que les l'eptentrionales t & en France
elle s’eft aufli fait plus fentir, en Provence 6c en
Languedoc, que dans le refte du royaume ; il confie
cependant qu’elle s’eft aufli répandue dans quelques
endroits de l’Allemagne.
Comme la lepre des Arabes & celle des Grecs rie
fembïent différer qu’en ce que les fymptomes de la
première font portés au plus haut point de malignité
; pour ne pas tomber dans le cas de la répétition,
il eft à-propos de renvoyer à Y article Lepre ce qui
refte à dire touchant les caüfes, le prognöftic & la
curation de Yéléphantiafe qui n’eft le plus fouvent fufceptible
d’aucun traitement» Voyc{ Lepre.
Plufieurs médecins arabes ont aufli entendu par le
mot eltphanxiafis , une maladie bien differente de la
précédente qui affeûoit Amplement les piés avec un
gonflement confidérable 6c des varices dans ces parties
; comme il paroît par Avicenne, Rhafxs, Aven-
zoar & autres ; fur quoi Voye^ Fuchfiüs, lib. III.
6c Seveftus , Hb. X X IX . (dé)
ELEPHANT1N , adj, (Hiß-) qui appartient à l’é-
lephant, ou qui en a les qualités.
■ Ce mot fe dit principalement de certains livres
des anciens Romains.
Dans quelques-uns de ces livres étoient enregif-
trés tous les atles du fénat & des magiftrats de Rome.
En d’autres, tout ce qui fe pafloit dans les provinces
6c dans les armées, &c. Il y en avoit outre
cela 3 5 gros volumes autant que de tribus , oii
étoient marqués la naiffance & les claffes des citoyens.
On les renouvelloit tous les cinq ans à chaque
nouvelle éleâion des cenfeurs ; & on les gardoit
tous dans le thréfor public, au temple de Saturne.
Il y en a qui croyent que ces livres avoient été
nommés élèphantins par rapport à leur énorme volume;
d’autres parce qu’ils etoient. faits de tablettes
- d’ivoire. Chambers, (G)
ELEPHAS, f. f. ( Hiß. nat. bot. ) genre de plante
à fleurs monopetales, anomales , tabulées Refaites
en forme de mafque dont la levre fupérieure ref-
femble en quelque façon, à la trompe d’un éléphant,
& l’inférieure eft découpée. Il fort du calice un pif-
til qui entre comme un clou dans la partie pofté-
rieure de la fleur , 6c qui devient dans la fuite un
fruit divifé en, deux loges qui renferment des femen-
ces oblongues pour l’ordinaire. Tournefort, Inß, rei
fyrb. corol. Voyez Plante.; ( / )
E L E
TËEËTTE, f. f. ( Cordonnier') eft une bandé dé
cuir de la largeur du pouce, qui lé met en de-dans du
foulier au-tour de l’empeigne pour la renforcer.
ELEVATION, fub.f. ( Aflron ) L'élévationd’üne
étoile ou d’un autre point dans la fphere, en Aftro-
nomie, eft un arc de cercle vertical compris entre
cette étoile ou cet autre point & l’horifon. Voye[ Vertical.
Ainfi comme le méridien eft un cercle Vertical •,
Vèlevation ou hauteur méridienne , c’eft-à-dire Y élévation
d’un point litué dans le méridien, eft un arc
du méridien intercepté entre ce point 6c l’horifon.
Voye{ Méridien.
Elévation du pôle, marque la hauteur du pôle fur
l’horifon d’un lieu, ou un arc de méridien intercepté
entre le pôle & l’horifon. Voyeç Pôle.
Ainfi, ( Plancha AJlronom. fig. 4 . ) A Q étant
fuppofé l’équateur , H R l’horifon t H Z P N le
méridien, & P le pôle, P R eft Y élévation du pôle»
Dans ce fens le môt élévation eft oppofé à abaif-
fement. Voye^ ABAISSEMENT.
L’élévation du pôle eft toûjours égale à là latitude
du lieu, c’e ft-à-dire, que l’arc de méridien intercepté
entre le pôle & l’horifon eft égal à l’arc du
même méridien intercepté entre l’équateur 6c le zénith.
Ainfi le pôle boréal eft élevé fur l’horifon de Paris
de 48 d. 501 , & il y a le même nombre de degrés
entre le zénith de Paris & l’équateur ; de forte
que Paris fe trouve à 48 d. 50' de latitude boréale*
Voye£ Latitude. Pour trouver Vèlevation du pôle
d’un lieu, voyc^ Pôle & Latitude.
L5élévation de l’équateur eft un are du méridien
moindre qu’un quart de cercle, intercepté entre l’équateur
& l’horifon du lieu, Vaye^ Equateur.
Ainfi , A Z repréfentant comme ei-deffus l’équa-*
teur, H R l’horifon, P le pôle, & H Z P N leméridien
; H A fera Vèlevation die l’équateur» Voye^ Equateur.
Les élévations de l’équatéur & du pôle, jointes en-
femble , forment toujours un quart de cercle, 6c
par conféquent plus Vèlevation du pôle eft grande ,
moins celle de l’équateur doit l’être, & réciproquement.
Ainfi dans la figure que nous âvons déjà indiquée,'
P A eftfuppofé par la conftruâion un quart de cercle
, 6>cAH-\-AP-\-PR, un demi cercle, Sc par
conféquent HA -\-P R , un quart de cercle»
Trouver /’élévation de Véquateur. Trouvez Vélévation
pôle, delà maniéré indiquée à l’article Pôle.
Souftrayez Vèlevation trouvée d’un quart de cercle ,
ou de 90 d. Ce qui reftera, fera Vèlevation de l’équateur.
Ainfi Vèlevation du pôle à Paris, favoir 48 d.
50 ' , étant fouftraite de 90 d. le refte donne 41 d.
10 ' pour Vèlevation de l’équateur au même lieu.
Angle d'élévation en Méchanique, c’eft l’angle R
A B , (Planch. de Mèch. fig. 4 7 .) compris entre la
ligne de direâion A R d’un projeâile, & la ligne
horlfontale A B. Foyc^ Projectile & Angle.
Elévation d'un canon & d'un mortier, c’eft l’angle
que Taxe du canon ou du mortier fait avec le plan
d e l’horifon. Voye[ Canon & Mortier. (O) Elévation > en Hydraulique, fe dit de la hauteur
à laquelle montent les eaux jailfiffantes ; elle
dépend de celle des réfervoirs & de la jufte proportion
de la fortie des ajuftages avec le diamètre des
tuyaux de conduite.
Les jets font affoiblis par l’air ou l’atmofphere qui
les entoure , ce qui fait qu’ils ne s’élèvent jamais
aufli haut que leur réfervoir.
PREMIERE F o r m u l e . Connoître la hauteur des
réfervoirs par rapport à celle des jets. L’expérience a
appris qu’un jet venant ?d’un réfervoir de 5 piés de
haut montait un pouce de moins, 6c qu’il falloir
compter,
E L Ë
Compter Vélévation des jets, de 5 piés en 5 piés , &
prendre le quarré du nombre de fois que 5 eft contenu
dans cette élévation , ce qui fera connoître la
hauteur que doivent avoir les réfervoirs pour que
les jets rie perdent rien de la hauteur proposée.
Ainfi, comme un jet de 60 piés de haut a ï z fois
5 dans fon nombre, on prendra le quarré de 12 qui
eft 144 ; ce fera des pouces que l’on écrira à la fuite
des 60 piés réduits en pouces qui font 720 ; ainfi ce
jet pour conferver la hauteur de 60 piés, demande
un réfervoir élevé de 864 pouces, ou 72 piés.
Les eaux de décharge Si de fuperfîcie, de quelque
hauteur qu’ elles viennent, ne font que rouler
dans les tuyaux, & que baver dans les baflins d’en-
bas; il faut de la charge à une conduite pouréle*-
ver le jet d’eau, 6c que le tuyau foit bien plein.
La hauteur d’un jet eft plus difficile à déterminer-
par rapport à celle du réfervoir ; parce que plus il
eft élevé, plus il trouve de réfiftance dans l ’air. Les
défauts des jets ou leur différence de hauteur avec
celle des réfervoirs font dans la raifon des quarrés
des hauteurs des mérites jets : il faut donc connoître
la hauteur du réfervoir, en fuppofer une pour le jet
demandé, ou en fixer urie générale dans tous les
calculs.
S e c o n d e F o r m u l e . Connoître la hauteur <Ùun
je t par rapport à celle du réfervoir. Il réfulte de la réglé
précédente, de compter Vélévation des jets de 5
piés en 5 piés, & prendre le quarré du nombre de
fois que 5 eft contenu dans cette élévation, que la
hauteur marquée de 864 pouces pour le réfervoir
d’ un jet de 60 piés de hauteur, eft compofé de deux
parties : i° . de la hauteur du jet : 20. du quarré du
quotient qu’ori auroit en divifant la hauteur du jet
( f i on la connoiffoit ) par 60 pouces^ valeur des <
piés de la réglé, c’eft-à-dire que 5 eft 12 fois dans
60 , 6c que 12 eft le quotient : enfiiite fi l’on.quarre
le quotient 6c qü’on ajoute fon produit qui eft ici de
144'pouces à la hauteur 720 qu’on a fuppofée pour
le jet ; on trouvera fûrement la hauteur du jet demandé
, en augmentant ou diminuant cette hauteur
fuppofée jufqu’à ce qu’on foit arrivé précifement à
celle du réfervoir, qui a été propofée de 864 pouces
ou 72 piés. (Ül) Elévation des puissances , ( Arithmétique. )
Foyei ElevER.
El é v a t io n , enPhyfique, c’eft le mouvement
d’un corps qui va de bas en haut, ou l’a&ion par laquelle
ùn corps s’éloigne continuellement de la terre.
Voyt{ Mouvement. En ce fens, ce mot eft oppofé
àdefeente. Voye^ D escente.
Les Péripatéticiens attribuerit Vélévation fponta-
née des corps à un principe de legereté qui leur eft
inhérent. Foye1 Legereté.
Les modernes nient qu’il y ait une legereté fpon-
tanée, & prouvent que tout ce qui monte, le fait
én vertu de quelque impulfion extérieure. C ’eft ainfi
que la fumée à d’autres corps raréfiés montent dans
Fatmofphere ; & q u e l’huile, les bois légers s’élèvent
au-defliis de l’eau, non pas par quelque principe
extérieur de legereté, mais par l’excès de pe-
fanteur des parties du milieu où ces corps fe trouvent.
Foye{ Pesanteur , Milieu F , Atmosphère, luïde, & c.
L'élévation des corps légers dans un milieu pefant,
eft produite de la même maniéré que Vèlevation du
baffin le plus leger d’une balance : ce n’eft pas que
ce baffin ait un principe intérieur par lequel il tende
immédiatement en haut ; mais il y eft pouffé par la
force du contre-poids de l’autre baffin, l’excès du
poids de l’un produifarit cet effet par l’augmentation
de fa tendance en embas. Vàye^ ceci plus approfondi
ou éclairci aux articles Pesanteur spécifique,
Fluide, Balance hydrostatique, & c%
Tomt V*
E L Ë
Elévation des corps fur des plans inclines» Voyez-ert
tes lois à l'article Plan INCLINÉ.
L’élévation ou V afeenfion des fluides s’entend particulièrement
de l’aâion par laquelle ils montent au-
deffus de leur propre niveau entre les furfaces des
corps qui approcherit fort d’être contigus, ou dans
les tuyaux de verre capillaires, ou dans les vaif-
feaux remplis de fable, de cendre, ou d’autres fem-,
blables fubftances poreufes. Voye1 Fluide.
^ Cet effet arrive auffi-bien dans le vuide qu’en plein’
air, dans les tubes recourbés que dans les droits :
quelques liqueurs, comme l’efprit-de-vin & l’huile
de terebenthine, montent plus vite que d’autres
liqueuf-s . & quelques-unes s’élèvent d’une maniéré
differente des autres. Le mercure ne s’élève
point du tout au-deffus de fon niveau, au contraire
il defeend au-deffous.
On a parlé plus au long du phénomène des tuyaux
capillaires 6c de les caufes, a L'article Capillaire.'
A l’égard des plans ; deux plaques de verre ,
de métal, de pierre ou d’autre matière, bien unies
6t bien polies, étant dilpofées de maniéré qu’elles
foient prefque contiguës, elles produiront l’effet de
plufieurs tubes capillaires parallèles, & les fluides
s’élèveront entre, ces. plans de la même maniéré que
dans les tubes. On peut dire la même chofe d’un
yaiffeau rempli de fable, &c. la multitude des petits
interftices , dont il eft parfemé, forme, pour ainfi
dire, une efpece de tuyaux capillaires : c’eft le même
principe qui a lieu dans tous ces cas ; & c’eft vraif-
iemblablement à cette même caufe que l’on doit
attribuer l’afcenfion de la fève dans les végétaux*
Foye^ Végétation.
Elévation des vapeurs. Voye£ E VA PORATION * Nuage o/^Nu é e , Va p e u r . (O)
Elévation, (Alchimie.') LesAichimiftes nomment
ainfi les opérations par lefquelles ils fubtilifent
ou atténuent certaines fubftances, féparent la partie
fpiritueufe de celle qui eft plus groffiere, la plus le-
gere de la pefante, celle qui eft fluide de celle qui
eft fixe ; ce qui revient, en langage ordinaire, à la
fublimation 6c à la diftillation. ^oye^SuBLiM ation
& D istillation. (—)
Elévation , terme de Chirurgie ; mouvement des
doigts par lequel le chirurgien incife fuffifamment
la veine & la peau dans l’opération de la faignée*
Voyei Phlébotomie» .
L'élévation îe fait en retirant la lancette qu’on a
introduite dans le vaiffeau. Il n’y a que le tranchant
fupérieur de la lancette qui coupe, lorfqu’on fait
Vélévation ; quand on ne fait pas ce mouvement
l’ouverture de la peau n’étant pas fi grande que l’in-
çifion de la veine, il.s’amafle du fang autour du
vaiffeau fous la peau, ce qui forme une tumeur
nommee trombe. Voyez ce mot. Une lancette à grain
d’orge difpenfe dé faire une élévation; mais cette
lancette ne convient que pour les vaiffeaux qui font
grps & fuperfîciels. Voye^ Lancette. (T )
GRÉALPÉHVIAE.TION. (Coupe des pierres.) Voye^ ORTHOEl
é v a t io n à la mejfe (ThèoU & Hifi, ecclèfX
marque cette partie de la meffe où le pretre éleve
Thoftie & le calice plus haut que fa tête, afin de
faire adorer au peuple le corps & lé fang de N. S»
J. C. après la confécration, & après qu’il les a lui-
même adorés par une profonde génuflexion-.
Carloftad ôta Vélévation de la meffe ; & Luther
la retint d’abord, mais enfuite il la fupprima.
M. Chambers prétend, mais fans citer aucune
autorité, que S. Louis eft le premier qui ait ordonné
qu’à Vélévation on fe mît à genoux, à l’exemple de
certains religieux qu’il ne nomme point. .
Ce qu’il y a de certain, c ’eft que dans les anciennes
liturgies, 6c en particulier dans le.facramentaüre
S s s