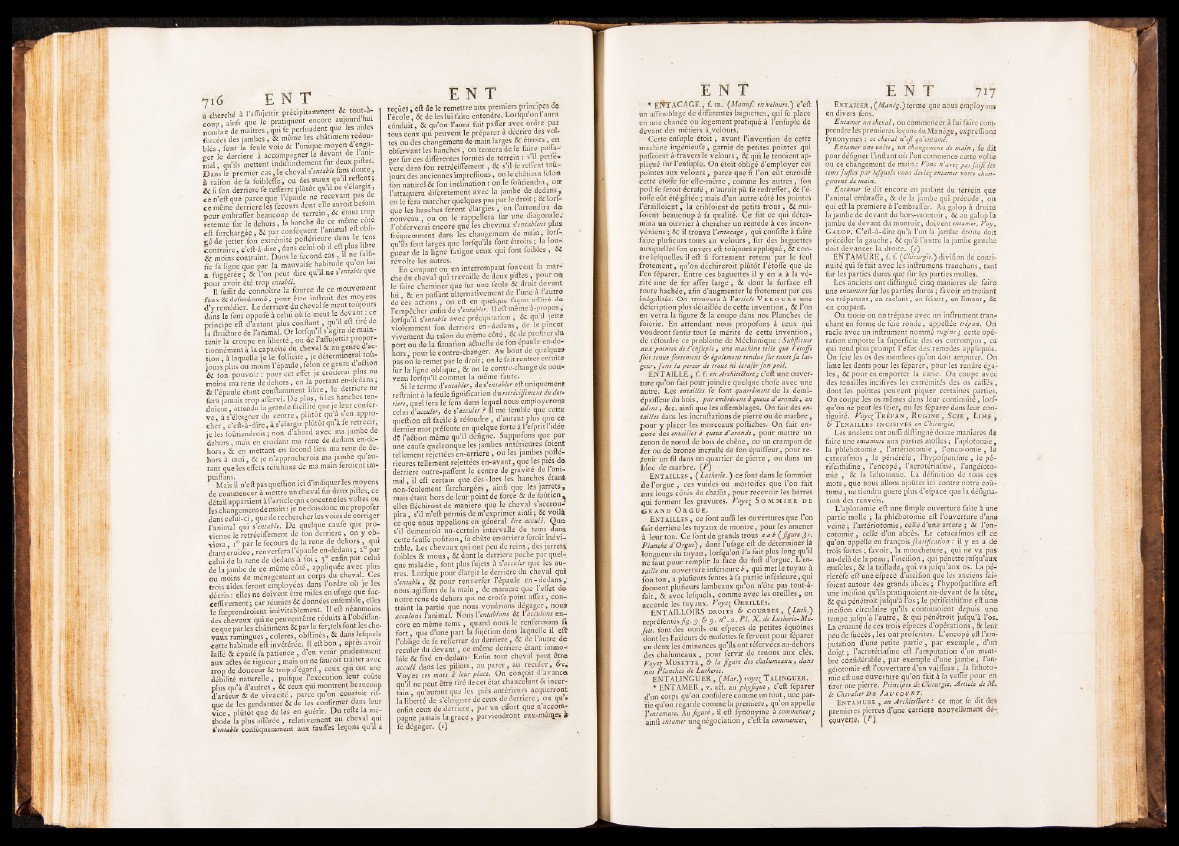
a cherché à l’affujettir précipitamment & tout-à-
conn. ainfi que le pratiquent encore aujourdhui
nombre de, maîtres, qui fe perluadent que les aides
forcées des jambes 1 & même les chatimensjedou-
blés, font la feule voie & l’unique moyen d engager
le derrière à accompagner lé devant de 1 amnial,
qu’ils mettent ihdiftinôement, fur deux putes.
Dans le premier cas, le cheval s’ cntable fans doute,
à raifod de fa foibleffe, ou des maux qu il relient ;
& fi fon derrière fe refferre plutôt qu’il ne s élargit,
ce n’eft que parce que l’épaule ne recevant pas de
ce même derrière les fecours dont elle aurait befom
■ pour émbraffer beaucoup de terrain, & étant tiop
retenue fiir le dehors , > hanche if «* “““ B| elt furchargée, 8c par çonféquent 1 animal eft obligé
de jette? fon extrémité pofterieure dans le fens
contraife, c’eft-à-dire, dans celui oh il eft plus libre
& moins contraint. Dans le fécond ca s, il ne falli-
£e fa ligne que par la mauvaife habitude qu on lui
a fuggérëe ; & l’on peut dire qu’il ne s mablc que
pour avoir été trop entablé.
Il fuffit de connoître la fource de Ce mouvement
faux ôc defordonné, pour être inftruit des moyens
d’y remédier. Le derrière du cheval fe meut toujours
dans le fens oppofé à celui oii fe meut le devant : ce
principe eft d’autant plus confiant, qu’il eft tire de
la ftrufture de l’animal. Or lorfqu’il s’agira de maintenir
la croupe en liberté, ou de l’affujettir propor-
îionnément à la capacité du cheval ôc au genre d action
, à laquelle je le follicite, je déterminerai toujours
plus ou moins l’épaule, félon ce genre d action
& Ion pouvoir : pour cet effet je croiferai plus ou
moins ma rene de dehors, en la portant en-dedans,
& l’épaule étant conftamment libre, le derrière ne
fera jamais trop affervi. D e plus , fi les hanches ten-
doient, attendu la grande facilite que je leur confer-
v e , à s’éloigner du centre, plutôt qu à s e „ approcher
, c’eft-à-dire, à s’élargir plûtot qu à fe rétrécir,
ie les foûtiendrois ; non d’abord avec ma jambe de
dehors, mais en croifant ma rene de dedans en-dehors,
Ôc en mettant en fécond lieu ma rene de dehors
à moi, & je n’approcherois ma jambe qu autant
que lies effets réfultans de ma main feroient îm-
puiffans. , ..... H H ... ft: H
‘ Mais il n’eft pas queftion ici d’indiquer les moyens
de commencer à mettre un cheval fur deux piftes, ce
détail appartient à l’article qui concerne les voltes ou
leschangemensdemain : je nedoisdonc mepropofer
dans celui-ci, que de rechercher les voies de corriger
4’animal qui Rentable. De quelque caufe que provienne
le retréciffement de fon dernere, on y obviera
i° par le fecours de la rene de dehors , qui
étant croifée, renverfera l’épaule en-dedans ; z° par
celui de la rene de dedans à foi ; 30 enfin par celui
de la jambe de ce même côté, appliquée avec plus
ou moins de ménagement au corps du cheval. Ces
trois aides feront employées dans 1 ordre oh je les
décris : elles ne doivent être mifes en ufage que fuc-
ceflivement ; car réunies ôc données enfemble, elles
le furprendraient inévitablement. Il eft néanmoins
des chevaux qui ne peuvent être réduits a 1 obeiffan-
ce que parles châtimens ôc par le fer;tels font les chevaux
ramingues, coleres, obftines, & dans lefquels
cette habitude eft invétérée. II eft bon , apres avoir
laffé Ôc épuifé fa patience , d’en venir prudemment
aux aâes de rigueur ; mais on ne fauroit traiter avec
trop de douceur ôc trop d’égard , ceux qui ont une
débilité naturelle, puifque l’exécution leur coûte
plus qu’à d’autres , & ceux qui montrent beaucoup
d’ardeur & de vivacité, parce qu’on courtoit rif-
que de les gendarmer & de les confirmer dans lëuj
v ic e , plutôt que de lés en guérir. Du relie ’a me
fhode la plus affûrée , relativement au cheval qui
Rentable coriféquemment aux fauffes leçons qu il a
reçues, eft de le remettre aux premiers principes de
l’école, & de les;lui faire entendre. Lorfqu on 1 aura
cÔnduit, & qu’on l’aura fait paffer avec ordre par
tous ceux qui peuvent le préparer à décrire des voltes
ou des changemens de main larges ôc étroits, en
obfervant les hanches , on tentera de le faire- paffa-
ger fur ces différentes formes de terrein : s’il perfe-»
vere dans fôn retréciffement, ôc s’il fe relient toujours
des anciennes impreflions, on le châtiera félon
fon naturel ÔC fon inclination : on le foûtiendra, orr
l’attaquera difcretement avec la jambe de dedans ^
on le fera marcher quelques pas par le droit ; ôc lorf-
que les hanches feront élargies , on l’arrondira d©
nouveau, ou on le rappellera fur une diagonale*
J’obferverai encore que les chevaux s entablent plus
fréquemment dans les changemens de main , lori-.
qu’ils font larges que lorfqu’ils font étroits ; la Ion-,
gueur de la ligne fatigue ceux qui font foibles , oC
révolte les autres.
En coupant ou en interrompant fouvent la marche
du cheval qui travaille de deux piftes , pour n©
le faire cheminer que fur une feule ÔC droit devant
lui, & en paffant alternativement de l’une à 1 autre
de ces aftions, on eft en quelque façon allure de
l’empêcher enfin de s'cntabler, Il eft meme à-propos 9
îorfqu’il Rentable avec précipitation , & qu il jette
violemment fon derrière en-dedans, de le pincer
vivement du talon du même côté, 8c de profiter du
port ou de la fituation aftuelle de fon épaulé en-dehors
pour le contre-changer. Au bout de quelque»
pas on le remet par le droit ; on le fait rentrer enluite
fur la ligne oblique, & on le contfe-changë de nôu-*
veau lorfqu’il commet la même faute, .
Si le terme d'entabler, de entabler eft uniquement
reftraint à la feule fignification du retréciffement du derrière,
quel fera le fens dans lequel nous employerons
celui d’acculer, de s'acculer ? Il me femble que cette
queftion eft facile à réfoudre , d’autant plus que ce
dernier mot préfente en quelque forte à l ’efprit 1 id.ee
d€ l’aftion même qu’il défigne. Suppofons que par
une caufe quelconque les jambes antérieures foient
tellement rejettées en-arriere , ou les jambes pofte-
rieures tellement rejettées en-avant, que les pies da
derrière outre-pâffent le centre de gravité de ranimai
, il eft certain que dès - lors les hanches étant
non-feulement furenargées , ainfi que les jarrets ,
mais étant hors de leur point de force & de foûtien ^
elles fléchiront de maniéré que le cheval s’accroupira
, s’il m’eft permis de m’exprimer ainfi ; ôc voilà
ce que nous appelions en général être acculé. Que.
s’il demeuroit un certain intervalle de tems dans
cette fauffe pofition, fa chute en-arriere feroit inévi-;
table. Les chevaux qui ont peu de reins, des j arrêtai
foibles & mous, Ôc dont le derrière peche par quel-;
que maladie, font plus fujéts à s'acculer que les au-;
très. Lorfque pour élargir le derrière du cheval qui
Rentable, 8c pour renverfer l’épaule en - dedans *'
nous agiffons de la main , de maniéré que l’effet d©
notre rene de dehors qui ne croife point affez, con-;
traint la partie que nous voudrions dégager, noua
acculons l’animal. Nous l'entablons 8c l’acculons encore
en même tems, quand nous le renfermons fi
fort, que d’une part la fujétion dans laquelle il elt
l’oblige de fe refferrer du derrière, 8c de 1 autre de
reculer du devant, ce même derrière étant immo-£
bile 8c fixé en-dedans- Enfin tout cheval peut etr©
acculé dans les piliers, au parer, au reculer, &c*
Voyez ces mots a leur place. On conçoit d’avanc©
qu’il ne peut être tiré de cet état chancelant ôc incertain
, qu’autant que les piés antérieurs acquerront
la liberté de s’éloigner de ceux de derrière ; ^ou qu V
enfin ceux de derrière, par vin effort que n acconfc*
I pagne jamais la grâce , parviendront eux-memes *
| fe dégager, (e)
* ENT ACAGE , f. m. {Manuf. en Velours.') c’eft *
lin affemblàge de différentes baguettes, qui fe place
en une chanéë ou logement pratiqué à l’enfuple de
devant des métiers à velourï;
Cette enfuple étoit, avant l’invention de cette
machine ingénieufe, garnie de petites pointes qui
pafloient à-travers le velours, ôc qui le tenoient appliqué
fur l’enfuple. On étoit oblige d’employer ces
pointes aux velours , parce que fi l’on eût enroulé
cette étoffe fur elle-même, commé les autres, fon
poil fe feroit écrafé, n ’auroit pû fe rédreffer, & l’é-
itoffe eût été gâtée ; mais d’un autre côté les pointes
l’érailloient, la cribloient de petits trous , 8c nui-
foîent beaucoup à fa qualité. Ce fut ce qui détermina
un ouvrier à chercher un rëmede à ces incoft-
véniens ; ôc il trouva l'entacage, qui confifte à faire
faij-e plufieurs tours au velours , fur des baguettes
auxquelles fon envers eft toûjours appliqué, ôc contre
le (quelles il eft fi fortement retenu par le feul
frotement, qu’on déchireroit plutôt l’étoffe que de
t’en féparer. Entre ces baguettes il y en a à la vérité
une de fer affez large , ôc dont la furface eft
toute hachée, afin d’augmenter le frotement par ces
inégalités. On trouvera à l'article V e l o u r s une
defeription plus détaillée de cette invention, Ôc l’on
en verra la figure ôc la coupe dans nos Planches de
foierie. En attendant nous propofons à ceux qui
Voudront fentir tout le mérite de cette invention,
de réfoudre ce problème de Méchanique : Subjlituer
aux pointes de l ’enfuple, une machine telle que l'étoffe
foit tenue fortement & également tendue fur toute fa largeur,
fans la percer de trous ni ecrafer fon poil.
ENTAILLE, f. f. en Architecture; c’eft une ouverture
qu’on fait pour joindre quelque chofe avec une
autre. Les entailles fe font quarrément de la demi-
épaiffeur du bois, par embrévent à queue d'aronde, en
àdent, ôcc. ainfi que les affemblages. On fait des entailles
dans les incruftations de pierre ou de marbre ,
pour y placer les morceaux poftiches. On fait en-
jeore des entailles à queue d'aronde, pour mettre un
ienon de noeud de bois de chêne, ou un crampon de
fer ou de bronze incrufté de fon épaiffeur, pour retenir
uh fil dans un quartier de pierre , ou dans un
fcfoc de marbre. (P)
Entaillés , ( Lutherie. ) ce font dans le fommier
de l’orgue , ces vuides ou mortoifes que l’on fait
aux longs côtés du chaflïs, pour recevoir l’es barres
qui forment les gravures. Voyei S o m m i e r d e
•g r a n d O r g u e . Entailles , ce font auffi lés Ouvertures que l’on
fait derrière les tuyaux de montre, pour les amener
à leur ton. Ce font de grands trous aab ( figure J i .
Planche d'Orgue) , dont l’ufage eft de déterminer là
longueur du tuyau, lorfqu’on l ’a fait plus long qu il
ne faut pour remplir la face du fuft d orgue. L entaille
ou ouverture inférieure b , qui met le tuyau à
fon ton, a plufieurs fentes à fa partie inférieure, qui
forment plufieurs lambeaux qu’on n’ôte pas tout-à-
fait, & avec lefquels, comme avec les oreilles, on
accorde les tuyaux. Vjye^ Oreilles.
ENTAILLOIRS droits 6- courbes, {Luth.)
tepréfentés fg .c , & $ . n°. 2. PI. X de Lutherie-Mu-
feu. font des outils ou efpeces de petites equoines
dont les Fadeurs de mufettes fe fervent pour féparer
en deux les éminences qu’ils ont.refervees au-dehors
des chalumeaux, pour fervir de tenons aux clés.
Voye^ Musette, & la figure des chalumeaux, dans
nos Planches de Lutherie.
ENTALINGUER, {Mar.) voye{ T alinguer.
* ENTAMER, v. ad. au phyfîque, c’eft féparer
d’un corps qu’on confidere comme un tout, une partie
qu’on regarde comme la première, qu’on appelle
Ventamure. Au figuré, il eft fynonyme à commencer',
ainfi entamer une négociation, c’eft la commencerK
Entamer , {Manég.) terme que nous employons
en divers fens,
Entamer un cheval, ou commencer à lui faire comr
prendre lés premières leçons duManége, expré (fions
fynonymës : ce cheval nefi qu'entamé.
Entamer une volte, un changement de main , fe dit
pour défigner l’inftant où l’on commence cette volte
ou ce changement de main : Vous n'aveç pasfaijî les
terris jufies par lefquels vous devie1 entamer votre changement
de main.
Entamer fe dit encore en parlant du térieiii que
l’animal dmbraffe, & de la jambe qui précède , ou
qui eft la première à l’embraffer. Au galop à droite
la jambe de devant du hors-montoir, 8ç au galop la
jambe de devant du montoir, doivent entamer. Voy. Galop. C ’eft-à-dire qu’à l’un la jambe droite doit
précéder la gauche, ôc qu’à l’autre la janibe gauche
doit devancer la droite, {è)
ENTAMÜRE, f. f. {Chirurgie.) divifion dé continuité
qui fe fait avec les inftrumens tranchans, tant
fur les parties dures que fur les parties molles.
Les anciens ont diftingué cinq maniérés de faire
une entâmure fur les parties dures ; favoir en troiiarit
ou trépanant -, en raclant, en feiant, en limant, ôc
en coupant.
On trôiie ou on trépane avec un inftrumertt tranchant
en forme de feie ronde, appellée trépan. On
racle avec un infiniment nommé rugirie ; cette opération
emporte la fuperficie des ds corrompus, ce
qui rend plus pfompt l’effet des remèdes appliqué«.
On foie les os des membres qu’on doit amputer. On
lime les dents pour les féparer, pour les rendre égales
, Ôc pour en emporter la càrîe. On coupe avec
des tenailles irteifives les extrémités dés os caftes ,
dont les pointes peuvent piquer certaines parties,
On coupe les os mêmes dans leur continuité, lorfqu’on
ne peut les foier, ou les féparer dans leur contiguïté.
VoyeiTrépan, Rugine, Scie , Lim e ,
& Tenailles incisives en Chirurgie1
Les anciens ont aufli diftingué douze maniérés d®
faire une entamüre aux parties molles ; ,1’aplotomie ,
la phlébotomie , l’artériotomie , l’oncofomie , le
catacafmos , le périérèfë, l’hypofpatifme , le pé-
rifoithifme , l’encopé, l’acroteriafme, l’angëïoto-
mie , ôc la lithotomie. La définition de tous ces
mots , que nous allons ajoûter ici contre-notre coû-
tume, ne tiendra guere plus d’efpace que la défigna-
tion des renvois.
L’aplotomie eft une (impie ouverture faitç à une
partie molle ; la phlébotomie eft l’ouverture d’uné
veine; l'artériotomie* celle d’une artere ; ôc l’on-
cotomie, celle d’un abcès. Le catacafmos eft cô
qu’on appelle en françois fcarification : il y en à dé
trbis fortes ; favoir, la moucheture, qui ne va pas
au-delà de la peau ; l’incifidn, qui pénetfë jufqu’aux
mufoles; ôc là taillade * qui va jufqu’aitx os. La pé-i
rierèfe eft une efpecë d’incifion que les anciens fai-
foient autour des grands abcès ; l’hypofpatifme eft:
une incifioil qu’ils pratiquoient àii-devant de la tête*
ÔC qui pénétroit jufqu’à l’os ; le périftithifme eft un©
incifion circulaire qu’ils continuoient depuis un©
tempe jufqu’à l’autre, ôc qui pénétroit jufqu’à l’os.
La cruauté de ces trois efpeces d’opérations, ôc leur,
peu de fuccès, les ont proferites. L’encôpé eft l’amputation
d’une petite partie , par exemple r d’un
doigt ; l’acrotériafme eft l’ampiitation d’un membre
confidérablé, par exemple d’une jambe ; l’an-
géiotomie eft l’ouverture d’un vaifleau ; 1 a lithotomie
eft une ouverture qu’em fait à la veflîe pour en
tirer une pierre. Principes de Chirurgie. Artictë de Mi.
le Chevalier D E JA Ü C O U R T .
E n t a m ü r e , en Architecture : ce mot fe dit dés
premières pierres d’une carrière nouvellement dé*
ççuYerte, {P)