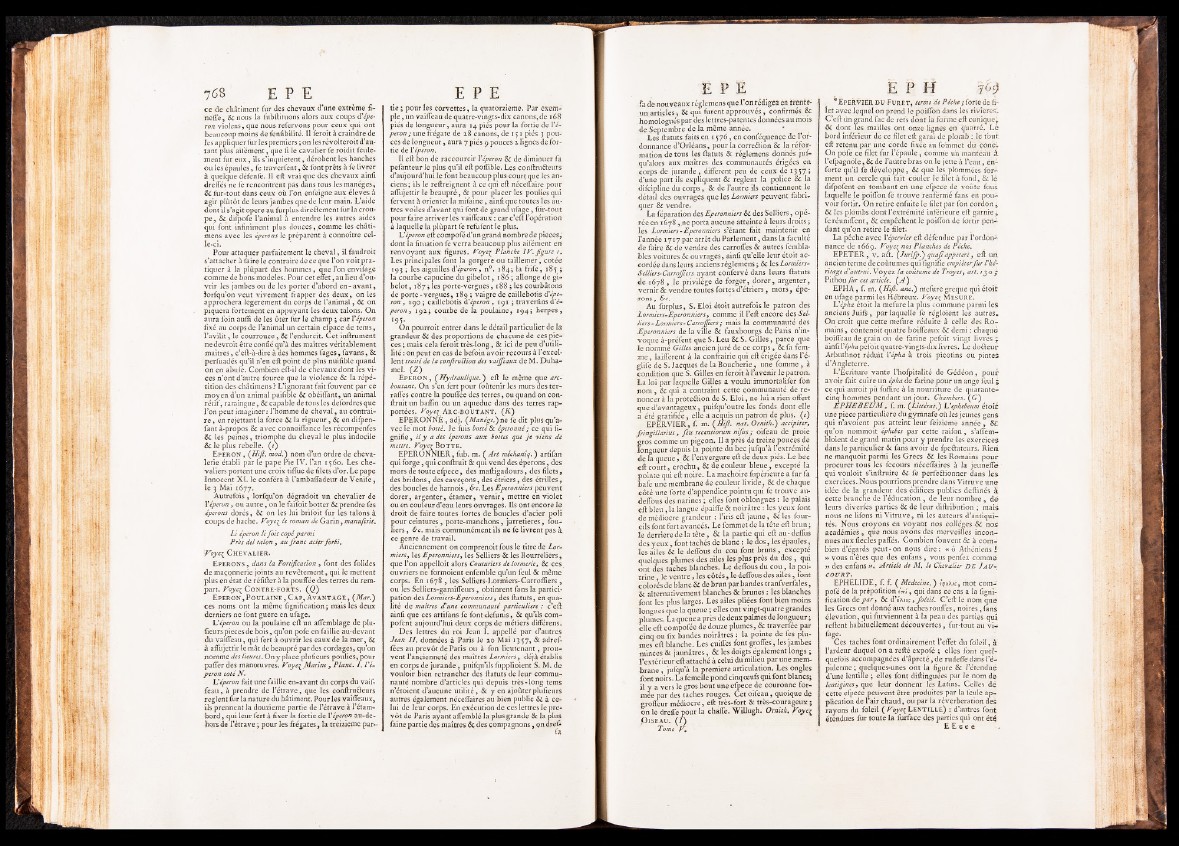
768 E P E
ce de châtiment fur des chevaux d’une extrême fi-
neffe, & nous la fubftituons alors aux coups 'éperon
violens, que nous refervons pour ceux qui ont
beaucoup moins de fenfibilité. Il feroit à craindre de
les appliquer fur les premiers ; on les révolteroit d’autant
plus aifément, que fi le cavalier fe roidit feulement
fur eux, ils s’inquiètent, dérobent les hanches
ou les épaules., fe traverfent, & font prêts à fe livrer
à quelque défenfe. 11 eft vrai que des chevaux ainfi
dreffés ne fe rencontrent pas dans tous les manèges,
& fur-tout dans ceux où l’on enfeigne aux éleves à
agir plutôt de leurs jambes que de leur main. L’aide
dont il s’agit opéré au furplus direûement fur la croup
e , & dilpofe l ’animal à entendre les autres aides
qui font infiniment plus douces,^comme les châti-
mens avec les éperons le préparent à connoître celle
ci.
Pour attaquer parfaitement le cheval, il faudroit
s’attacher à faire le contraire de ce que l’on voit pratiquer
à la plupart des hommes, que l’on envifage
comme de bons modèles. Pour cet effet, au lieu d’ouvrir
les jambes ou de les porter d’abord en-avant,
lorfqu’on veut vivement frapper des deux, on les
approchera legerement du corps de l’animal, & on
piquera fortement en appuyant les deux talons. On
aura foin aufli de les ôter fur le champ ; car l’éperon
fixé au corps de l’animal un certain efpace de tems,
l ’avilit, le courrouce, & l’endurcit. Cet infiniment
ne devroit être confié qu’à des maîtres véritablement
maîtres, c’eft-à-dire à des hommes fages , favans, &
perfuadés qu’il n’en eft point de plus nuifible quand
on en abufe. Combien eft-il de chevaux dont les vices
n’ont d’autre fource que la violence & la répétition
des châtimens ? L’ignorant fait fouvent par ce
moyen d’un animal paifible & obéiffant, un animal
rétif, ramingue, & capable de tous les defordresque
l’on peut imaginer : l’homme de cheval, au contraire
, en rejettant la force & la rigueur, & en difpen-
fant à-propos & avec connoiffance les récompenfes
& les peines, triomphe du cheval le plus indocile
& le plus rebelle, (e) Eperon , ( Hijl. moi?) nom d’un ordre de chevalerie
établi par le pape Pie IV. l’an 1 560. Les chevaliers
portent une croix tiffue de filets d’or. Le pape
Innocent XI. le conféra à l’ambaffadeur de Venife,
le 3 Mai 1677.
Autrefois , lorfqu’on dégradoit un chevalier de
Xéperon, ou autre, on le faifoit botter & prendre fes
éperons dorés, & on les lui brifoit fur les talons à
coups de hache. Voye£ Le roman de Garin, manufcrit.
Li éperon li foit copé parmi
Pris del talon , au franc aciçr forbi.
!Foyei Chevalier.
Eperons , dans la Fortification, font des folides
de maççnnerie joints au revêtement, qui le mettent
plus en état de réfifter à la pouffée des terres du rempart.
Voye{ Contre-forts. (Q) Eperon , Poulainf. , Cap, Avantage , {Mar.)
ces noms ont la même fignification ; mais les deux
derniers ne font guere en ufage.
Uéperon ou la poulaine eft un affemblage de plufieurs
pièces de bois, qu’on pofe en faillie au-devant
du vaiffeau, qui fert à ouvrir les eaux de la mer, &
à afliijettir le mât de beaupré par des cordages, qu’on
nomme des Heures. On y place plufieurs poulies, pour
paffer des manoeuvres. Voye^ Marine , Plane. I. Vê-
peron coté N.
Véperon fait une faillie en-avant du corps du vaif-
feau, à prendre de l’étrave, que les conftruâeurs
règlent fur la nature du bâtiment. Pour les vaiffeaux,
ils prennent la douzième partie de l’étrave à l’étam-
bord, qui leur fert à fixer la fortie de Xéperon au-de-
hors de l’étrave ; pour les frégates, la treizième par-
E P E
tie ; pour les corvettes, la quatorzième. Par exemple
, un vaiffeau de quatre-vingts-dix canons, de 168
piés de longueur, aura 14 piés pour la fortie de l’é-
peron; une frégate de 28 canons, de 151 piés 3 pouces
de longueur, aura 7 piés 9 pouces 1 lignes de fortie
de X éperon.
Il eft bon de raccourcir Xéperon & de diminuer fa
pefanteur le plus qu’il eft poflible. Les conftruâeurs
d’aujourd’hui le font beaucoup plus court que les anciens
; ils le reftreignent à ce qui eft néceffaire pour
affujettir le beaupré, & pour placer les poulies qui
fervent à orienter la mifaine, ainfi que toutes les autres
voiles d’avant qui font de grand u fage, fur-tout
pour faire arriver les vaiffeaux : car c’eft l’opération
à laquelle la plupart fe refufent le plus.
L’éperon eft compofé d’un grand nombre de pièces,'
dont la fituation fe verra beaucoup plus aifément ert
renvoyant aux figures, Voye^ Planche IV. figure ti
Les principales font la gorgere ou taillemer, cotée
193 ; les aiguilles d’éperon, n°. 184; la frife, 185 ;
la courbe capucine du gibelot, 186 ; allonge de gi-
belot, 187 ; les porte-vergues, 188 ; les courbâtons
de porte - vergues, 189 ; vaigre de caillebotis à?éperon
, 190; caillebotis a éperon, 191 ; traverfins dV-
peron, 192; courbe de la poulaine, 194; herpes,
195*
On pourroit entrer dans le détail particulier de la
grandeur & des proportions de chacune de ces pièces
; mais cela feroit très-long, & ici de peu d’utili-
lité : on peut en cas de befoin avoir recours à l’excellent
traité de la confirutlion des vaiffeaux de M. Duhamel.
(Z ) Eperon, {Hydraulique.) eft le même que arc-
boutant. On s’en fert pour foûtenir les murs des ter-
raffes contre la pouffée des terres, ou quand on con-
ftruit un ballin ou un aqueduc dans des terres rapportées,
F'oyei Arc-boutant. (X)
EPERONNÉ , adj. {Manège.) ne fe dit plus qu’avec
le mot botté. Je fuis botté & èperonnè; ce qui lignifie
, H y a des éperons aux bottes que je viens de
mettre. Voye^ Botte.
EPERONNfER, fub. m. ( Art mechattiq. ) artifan
qui forge, qui conftruit & qui vend des éperons, des
mors de toute efpece, des maftigadours, des filets,
des bridons, des caveçons, des étriers, des étrilles,
des boucles de harnois, &c. Les Eperonniers peuvent
dorer, argenter, étamer, vernir, mettre en violet
ou en couleur d’eau leurs ouvrages. Ils ont encore le
droit de faire toutes lortes de boucles d’acier poli
pour ceintures, porte-manchons, jarretières, fou-
liers, &c. mais communément ils ne fe livrent pas à.
ce genre de travail.
Anciennement on comprenoit fous le titre de Lor-
miersy les Eperonniers, les Selliers & les Bourreliers,
que l’on appelloit alors Couturiers de lormerie, & ces
ouvriers ne formoient enfemble qu’un feul & même
corps. En 1678 , les Selliers-Lormiers-Carrofliers ,
ou les Selliers-garniffeurs, obtinrent fans la participation
des Lorrniers-E peronniers, des ftatuts, en qualité
de maîtres (Tune communauté particulière : c’eft
ainfi que ces artifans fe font-deftmis, & qu’ils com-
pofent aujourd’hui deux corps de métiers différens.
Des lettres du roi Jean I. appellé par d’autres
Jean II. données à Paris le 20 Mai 1357, & adref-
fées au prévôt de Paris ou à fon lieutenant, prouvent
l’ancienneté des maîtres Larmiers, déjà établis
en corps de jurande, puifqu’ils fupplioient S. M. de
vouloir bien retrancher des ftatuts de leur communauté
nombre d’articles qui depuis très-long tems
n’étoient d’aucune utilité, & y en ajoûter plufieurs
autres également néceffaires au bien public & à celui
de leur corps. En exécution de ces lettres le prévôt
de Paris ayant affemblé la plus grande & la plus
faine partie des maîtres & des compagnons, on drefi
H H
E P E
fa dè nouveaux réglemens que l’on rédigea én trentè-
un articles', & qui furent approuvés, confirmés &
homologués par des lettres-patentes données au mois
de Septembre de la même année.
Les ftatuts faits en 1576, en conléqüerice de l’ordonnance
d’Orléans, pour la correction & la réformation
de tous les ftatuts & réglemens donnés jiil-
qu’alors aux maîtres des communautés érigées en
corps de jurande , different peu de ceux de 13 57 ;
d’une part ils expliquent & règlent la police & la
difeipline du corps, & de l’autre ils contiennent le
détail des ouvrages que les Lorrniers peuvent fabri-r
quer & vendre.
La féparation des Eperonniers & des Selliers, opérée
en 1678, ne porta aucune atteinte à leurs droits ;
lés Lorrniers-Eperonniers s’étant fait maintenir en
l’année 1717 par arrêt du Parlement, dans la faculté
de faire & de vendre des carroffes & autres fembla-
bles voitures & ouvrages, ainfi qu’elle leur étoit accordée
dans leurs anciens réglemens ; & les Lormïers-
Selliers-CarroJfiers ayânt cônfervé dans leurs ftatuts
de 1678 , le privilège de forger, dorer, argenter,
vernir & vendre toutes fortes d’étriers, mors, éperons
, &c.
Au furplus, S. Eloi étoit autrefois le patron des
Lormiers-Eperonniersy comme il l’eft encore des Selliers
- Lorrniers-Carroffiers ; mais la communauté des
Eperonniers de la ville ÔC fauxbourgs de Paris n’invoque
à-préfent que S. Leu & S. Gilles, parce que
le nommé Gilles ancien juré de ce corps, & fa femme
, laifferent à la confrairie qui eft érigée dans l’é-
glife de S. Jacques de la Boucherie, une fomme, à
condition que S. Gilles en feroit à l’avenir le patron.
La loi par laquelle Gilles a voulu immortalifer fon
nom , & qui a contraint cette communauté de renoncer
à la protection de S. Éloi, ne lui a rien offert
que d’avantageux, puifqu’outre les fonds dont elle
a été gratifiée, elle â acquis un patron de plus, {e)
EPERVIER, f. m. {Hijl. nat. Ôrnith.) accipiter,
fringillarius, feu recentiorum nifus ,* oifeau de proie
gros comme un pigeon. Il a près de treize pouces dé
longueur depuis la pointe du bec jufqu’à l’extrémité
de la queue, & l’envergure eft de deux piés. Le bec
eft court, crochu, & de couleur bleue, excepté là
pointe qui eft noire. La mâchoire fupérieüre a fur fa
bafe une membrane de couleur livide, & de chaque
côté une forte d’appendice pointu qui fe trouve aii-
deffous des narines ; elles font oblongues : le palais
eft b leu, la langue épailîe & noirâtre : les yeux font
de médiocre grandeur : l’iris eft jaune, & le s four-
cils font fort avancés. Le fommet de la tête eft brun ;
le derrière de la tête, & la partie qui eft au - deffus
des y e u x , font tachés de blanc : le dos, les épaules,
les ailes & le deffous du cou font bruns , excepté
quelques plumes des ailes les plus près du dos , qui
ont des taches blanches. Le deffous du cou , la poitrine
le ventre, les côtés, le deffous des ailes, font
colorés de blanc & de brun par bandes tranfverfales,
& alternativement blanches & brunes : les blanches
font les plus larges. Les ailes pliées font bien moins
longues que la queue ; elles ont vingt-quatre grandes
plumes. La queue a près de deux palmes de longueur ;
elle eft cômpofée de douze plumes, & traverfée par
cinq ou fix bandes noirâtres : la pointe de fes plumes
eft blanche. Les cuiffes font groffes, les jambes
minces & jaunâtres, & les doigts également longs ;
l ’extérieur eft attaché à celui du milieu par une membrane
, jufqu’à la première articulation. Les ongles
font noirs. La femelle pond cinq oeufs qui font blancs;
il y a vers le gros bout une efpece de couronne formée
par des taches rouges. Cet oifeau, quoique de
groffeur médiocre, eft très-fort & très-courageux ;
on le dreffe pour la châffe, 'Willugh. Ornithy Voye1 «Oiseau, (ƒ)
Tome V»
e p h m
* EPERVIER DU Furet, terme de Pèche / forte de filet
avec lequèl on prend le poiffôh dans les rivières'.
C ’eft un grand fac de rets dont la forme eft conique!
& dont les mailles ont onze lignes eh quarré. Le
bord inférieur dé ce filet eft garni de plomb : .le tout
eft retenu par une cordé fixée au fommet du 'cône;
On pôfe ce filet fur l’épaule, comme un mariteàii â
l’efpagnôle, & de l’autre bras on le jette à l’eaii, én-
forte qu’il fe développé, & que les plommées forment
un cercle qui fait couler le filet à fond, & lè
difpofent èif tombant en une efpece de voûte fous
laquelle le poiffon fé trouve renférnié fans en pouvoir
fortir. On retire enfuite le filet par fori cordon ;
& les plôriibs dont l’extrémité inférieure eft garnie ^
fe réunifient, & empêchent le poiffon de fortir pendant
qu’on retire le filet:
La pêche avec Xèpervier eft défendue par l’ordonnance
de 1669. Voye^ nos Planches de Pêché.
EPETER, v . aft. {Jurifp.) quafi'appeterê, eft un.
ancien terme de coûtumes qui lignifie empiéter fur l'héritage
d'autrui. Voyez la coutume de Troyesy art. 130 j
Pithou fur cet article. {A )
EPHA, f. m. {Hijl. anc.) mefurè greque qui étoit èn ufage parmi les Hébreux. Voye^ Mesure.
Uépha étoit la mefure la plus commune parmi les
anciens Juifs, par laquelle fe régloient les autres.
On croit que cette mefiire réduite à celle des Romains,
contenoit quatre boiffeaux &c demi : chaque
boiffeau de grain ou de farine pefoit vingt livres 5
ainfi Xépha pefoit quatre-vingts-dix livres. Le dofteur
Arbuthnot réduit Xépha à trois picotins où pintes
d’Angleterre.
L’Écriture vante l’hofpitalité de Gédéôn, pour
avoir fait cuire un épha de farine pour un ange feul ;
ce qui auroit pu fuffire à la nourriture de quarante-
cinq hommes pendant un jour. Chambers. {G)
EPIIEBEUMy {. m. {Littèrat.) Uephebeum étoit
une piece particulière du gyninafe où les jeunes gens
qui n’avoient pas atteint leur féiziémè année, &
qu’on nommoit èphebes par cette raifori, s’affem-
bloient de grand matin pour y prendre les exercices
dans le particulier & fans avoir de fpe&ateurs. Rieà
ne manquoit parmi les Grecs & les Romains pour
procurer tous les fecoiirs néceffaires à la jeunefle
qui vouloit s’inftruire & fe perfectionner dans les
exercices. Nous pourrions prendre dans Vitriive une
idée de la grandeur des édifices publics déftinés à
cette branche de l’éducation , de leur nombre, dé
leurs diverfes parties & de leur diftribution ; mais
nous ne lifons ni V itruvé, ni les autéurs d’antiquités.
Nous croyons en voyant nos collèges & noà
académies , que noiis avons des merveilles inconnues
aux fiecles paffés. Combien fouvent & à combien
d’égards peut - on nous dire : « ô Athéniens I
» vous n’êteS que des enfans, vous penfez comme
>> des enfans »; Article dé M. le Chevafier d e Ja u -
c o u r t .
EPHELIDE, f. f. ( Médecine.) îçnX/ç, mot com-
pofé de la prépofition éV/ , qui dans ce câs a la fignification
de par y & d’jiA/o?, foleil. C ’eft le nom qué
les Grecs ont donné aux taches rouffes, noires, fans
élévation, qui furviennent à là peau des parties qui
reftent habituellement découvertes, fur-tout au vi-
fage.
Ces taches font ordinairement l’effet du foleil, à
l’ardeur duquel on a refté expofé ; elles font quelquefois
accompagnées d’âpreté, de rudeffé dans l’épiderme;
quelques-unes ont la figure & l ’étendue
d’une lentille ; elles font diftinguees par le nom de
lentigines, que leur donnent les Latins. Celles dè
cette efpece peuvent être produites par la feule application
de l’àir chaud, ou par la réverbération deâ
rayons du foleil ( Voye£ Lentille) : d’autres font
étendues fur toute lâ furface des parties qui ont été
E E e e e
ü i