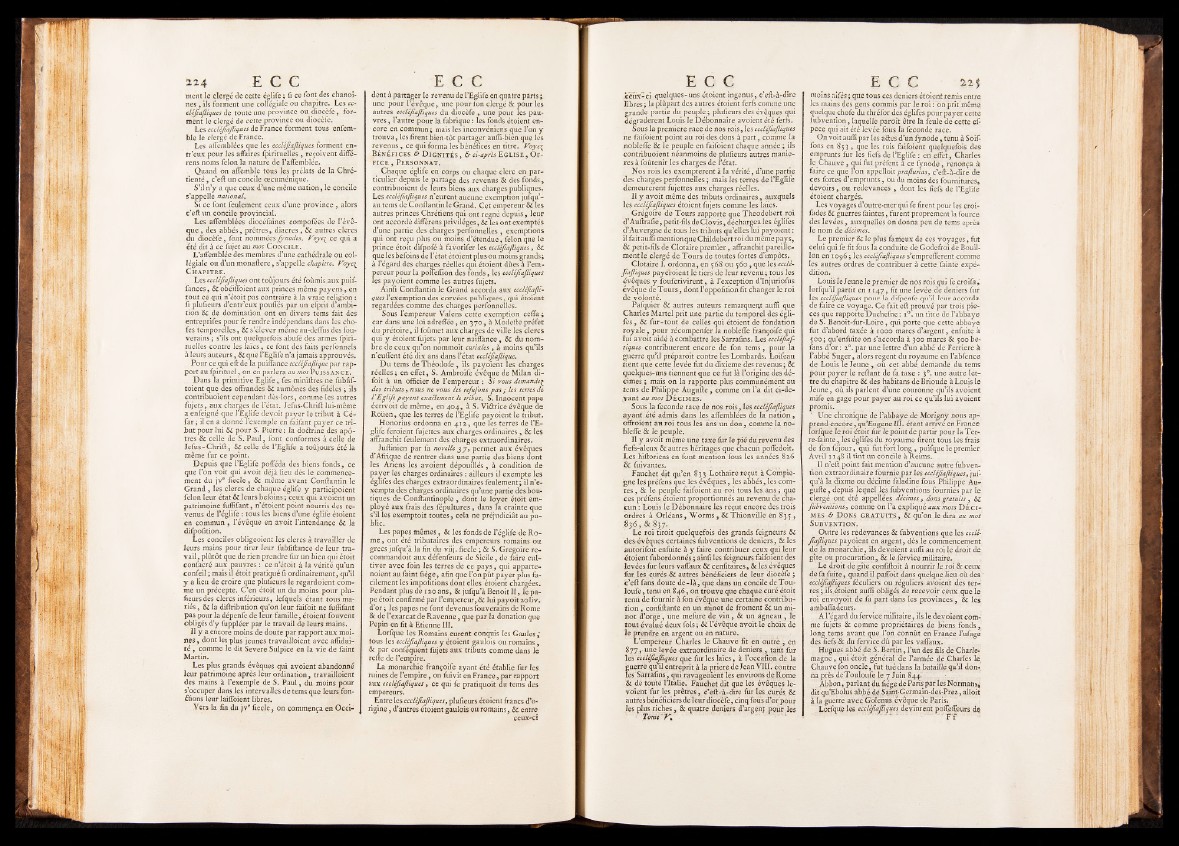
ment le clergé de cette églife ; fi ce font des chanoines
, ils forment une collégiale ou chapitre. Les ec-
cléflafliques de toute une province ou diocèfe, forment
le clergé de cette province ou diocèfe.
Les eccïéjiafliques de France forment tous enfem-
ble le clergé de France.
Les affemblées que les eccïéjiafliques forment en-
tr’eux pour les affaires fpirituelles , reçoivent diffé-
rens noms félon la nature de l’affemblée. .
. Quand on affemble tous les prélats de la Chrétienté
, c’eft un concile oecuménique.
S’il n’y a que ceux d’une même nation, le concile
s’appelle national.
. Si ce font feulement ceux d’une province, alors
c’eft un concile provincial.
Les affemblées diocéfaines compofées de l’évêq
u e , des abbés, prêtres, diacres, & autres clercs
du diocèfe, font nommées Jynodes. Voye^ ce qui a
été dit à ce fujet au mot C o n c il e .
L’affemblée des membres d’une cathédrale ou collégiale
ou d’un monaftere, s’appelle chapitre. Voye{
C h a p i t r e .
Les eccïéjiafliques ont toujours été fournis aux puif-
fances, & obéiffoient aux princes même payens, en
tout ce qui n’étoit pas contraire à la vraie religion :
fi plufieurs d’entr’eux pouffés par un efprit d’ambition
& de domination ont en divers tems fait des
entreprifes pour fe rendre indépendans dans les cho-
fcs temporelles, & s’élever meme au-deffus des fou-
verains ; s’ils ont quelquefois abufé des armes fpiri-
ruelies contre les laïcs, ce font des faits perfonnels
à leurs auteurs, & que l’Eglife n’a jamais approuvés.
Pour ce qui eft de la puiffance eccléflaflique par rapport
au fpirituel, on en parlera au mot P u is s a n c e .,
Dans la primitive Eglife, fes miniftres ne fubfifi-
toient que des offrandes & aumônes des fidèles ; ils
contribuoient cependant dès-lors, comme les autres
fujets, aux charges de l’état. Jefus-Chrift lui-même
a enfeigné que l’Eglife deyoit payer le tribut à Cé-
far; il en a donné l’exemple en faifant payer ce tribut
pour lui & pour S. Pierre : la doélrine des apôtres
& celle de S. Paul, font conformes à celle de
Jefus-Chrift, & celle de l ’Eglife a toujours été la
même fur ce point.
Depuis que l’Eglife pofféda des biens fonds, ce
que l’on voit qui avoir déjà lieu dès le commencement
du jve fiecle, & même avant Conftantin le
Grand, les clercs de chaque églife y participoient
félon leur état & leurs befoins; ceux qui avoient un
patrimoine fuffifant, n’étoient point nourris des revenus
de l’églife : tous les biens d’une églife étoient
en commun , l’évêque en avait l’intendance & la
difpofition.
Les conciles obligeoienî les clercs à travailler de
leurs mains pour tirer leur fubfiftance de leur travail
, plutôt que de rien prendre fur un bien qui étoit
confacré aux pauvres : ce n’étoit à la vérité qu’un
confeil ; mais il étoit pratiqué fi ordinairement, qu’il
y a lieu de croire que plufieurs le regardoient comme
un précepte. C ’en étoit un du moins pour plufieurs
des clercs inférieurs, lefquels étant tous mariés
, & la diftribution qu’on leur faifoit ne fuffifant
pas pour la dépenfe de leur famille, étoient fouvent
obligés d’y fuppléer par le travail de leurs mains.
Il y a encore moins de doute par rapport aux moines,
dont les plus jeunes travailloient avec aflidui-
té , comme le dit Severe Sulpice en la vie de faint
Martin.
Les plus grands évêques qui avoient abandonné
leur patrimoine après leur ordination, travailloient
des mains à l’exemple de S. Paul, du moins pour
s’occuper dans les intervalles de tems que leurs fonctions
leur laiffoient libres.
Vers la fin du jve fiecle, on commença en Occident
à partager le revenu de l’Eglife en quatre parts ;
une pour l’évêque, une pour Ion clergé & pour les
autres eccléjîajliques du diocèfe , une pour les pauvres
, l’autre pour la fabrique : les fonds étoient en-
' core en commun ; mais les inconvéniens que l’on y
trouva, les firent bien-tôt partager àufli-bien que les
revenus, ce qui forma les bénéfices en titre. Voye%
Bénéfices & D ignités , & ci-aprh Eglise , Office
,. Personnat.
Chaque églife en corps ou chaque clerc en particulier
depuis le partage des revenus & des fonds,
contribuoient de leurs biens aux charges publiques.
Les eccïéjiafliques n’eurent aucune exemption julqu’-
au tems de Conftantin le Grand. Cet empereur & les
autres princes Chrétiens qui ont régné depuis, leur
ont accordé différens privilèges, & les ont exemptés
d’une partie des charges perfonnelles , exemptions
qui ont reçu plus ou moins, d’étendue, félon que le
prince étoit difpofé à favorifer les eccïéjiafliques , &
que les befoins de l’état étoient plus ou moins grands;
à l’égard des charges réelles qui étoient dues à l’empereur
pour la poffeflion des fonds, les eccïéjiafliques
les payoient comme les autres fujets.
Ainfi Conftantin le Grand accorda aux eccléjiafli-
ques l’exemption des corvées publiques, qui étoient
regardées comme des charges perfonnelles.
Sous l’empereur Valens cette exemption ceffa ;
car dans une loi adreffée, en 3 70, à Modefte préfet
du prétoire, il foumet aux charges de ville les clercs
qui y étoient fujets par leur naiffance, & du nombre
de ceux qu’on nommoit curiales , à moins qu’ils
n’euffent été dix ans dans l’état eccléflaflique.
Du tems deThéodofe , ils payoient les charges
réelles ; en effet, S. Ambroife évêque de Milan di-
foit à un officier de l’empereur. : Si vous demandeç
des tributs , nous ne vous les refuj'ons pas ; les terres de
l'Eglife payent exactement le tribut. S. Innocent pape
écrivoit de même, en 404, à S. Viétrice évêque de
Rouen , que les terres de l’Eglife payoient le tribut.
Honorius ordonna en 412 , que les terres de l’Eglife
feroient fujettes aux charges ordinaires , & les
affranchit feulement des charges extraordinaires.
Juftinien par fa novelle 3 y, permet aux évêques
d’Afrique de rentrer dans une partie des biens dont
les Ariens les avoient dépouillés, à condition de
payer les charges ordinaires : ailleurs il exempte les
églifes des charges extraordinaires feulement; il n’exempta
des charges ordinaires qu’une partie des boutiques
de Conftantinople , dont le loyer étoit employé
aux frais des fépultures, dans la crainte que
s’il les exemptoit toutes, cela ne préjudiciât au public.
Les papes mêmes, & les fonds de l’églife de Rome
, ont été tributaires des empereurs romains ou
grecs jufqu’à la fin du viij. fiecle ; & S. Grégoire re-
commandoit aux défenfeurs de Sicile, de faire cultiver
avec foin les terres de ce pays, qui appartenaient
au faint fiége, afin que l’on pût payer plus facilement
les importions dont elles étoient chargées.
Pendant plus de 120 ans, & jufqu’à Benoit II, le pape
étoit confirmé par l’empereur, & lui payoit 2oliv.
d’or ; les papes ne font devenus fouverains de Rome
& de l’exarcat de Ravenne, que par la donation que
Pépin en fit à Etienne III.
Lorfque les Romains eurent conquis les Gaules
tous les eccïéjiafliques y étoient gaulois ou romains ,
& par confequent fujets aux tributs comme dans le
relie de l’empire.
La monarchie françoife ayant été établie fur les
ruines de l’empire, on fuivit en France, par rapport
aux eccléfiafliques , ce qui fe pratiquoit du tems des
empereurs.
Entre les eccïéjiafliques, plufieurs étoient francs d’origine
, d’autres étoient gaulois ou romains, &: entre
ceux-ci
.céïix-ci quelques-uns étoient ingénus, c’eft-à-dire
libres ; la plupart des autres étoient ferfs comme une
grande partie du peuple ; plufieurs des évêques qui
dégradèrent Louis le Débonnaire avoient été ferfs.
Sous la première race de nos rois, les eccïéjiafliques
ne faifoient point au roi des dons à part, comme la
nobleffe & le peuple en faifoient chaque année ; ils
contribuoient néanmoins de plufieurs autres maniérés
à foûtenir les charges de l’état.
Nos rois les exemptèrent à la vérité, d’une partie
des charges perfonnelles ; mais les terres de l’Eglife
demeurèrent fujettes aux charges réelles.
II y avoit même des tributs ordinaires, auxquels
les eccïéjiafliques étoient fujets comme les laïcs.
Grégoire de Tours rapporte que Theodebert roi
d’Auftrafie, petit-fils de Clovis, déchargea les églifes
d’Auvergne de tous les tributs qu’elles lui payoient:
il fait auflï mention que Childebertroi du même pays,
& petit-fils de Clotaire premier, affranchit pareillement
le clergé de Tours de toutes fortes d’impôts.
Clotaire I. ordonna, en 568 ou 560, que les ecclé-
Jiafliques payeraient le tiers de leur revenu; tous les
évêques y loufcrivirent, à l’exception d’Injuriofus
évêque de Tours, dont l’oppofition fit changer le roi
de volonté.
Pafquier & autres auteurs remarquent aufîi que
Charles Martel prit une partie du temporel des églife
s , & fur-tout de celles qui étoient de fondation
royale, pour récompenfer la nobleffe françoife qui
lui avoit aidé à combattre les Sarrafins. Les eccléjiaf-
tiques contribuèrent encore de fon tems, pour la
guerre qu’il préparoit contre les Lombards. Lpifeau
tient que cette levée fut du dixième des revenus ; &
quelques-uns tiennent que ce fut là l’origine des décimes
; mais on la rapporte plus communément au
tems de Philippe Augufte, comme on l’a dit ci-de-
yant au mot D é c im e s .
Sous la fécondé race de nos rois, les eccïéjiafliques
ayant „été admis dans les affemblées de la nation,
offraient an roi tous les ans un don, comme la nobleffe
& le peuple.
Il y avoit même une taxe fur le pié du revenu des
fiefs-aleux & autres héritages que chacun poffedoit.
Les hiftoriens en font mention fous les années' 826
èc fuivantes.
Fauchet dit qu’en 833 Lothaire reçut à Compïègne
lespréfens que les évêques, les abbés, lès comtes
, & le peuple faifoient au roi tous les, ans ; que
ces préfens étoient proportionnés au revenu de chacun
: Louis le Débonnaire les reçut encore des trois
ordres à Orléans, "Worms, & Thionville en 835,
.836 , & 837.
Le roi tiroit quelquefois des grands feigneurs &
des évêques certaines fubventions de deniers, & les
autofifoit enfuite à y faire contribuer ceux qui leur
étoient fubordonnés ; ainfi les feigneurs faifoient des
levées fur leurs vaffaux & cenfitaires, & les évêques
fur lés çiirés & autres bénéficiers de leur diocèfe ;
é’eft fans.doute de -là, que dans un concile deTou-
loufe, tenu en 846, on trouve que chaque curé étoit
tenu de fournir à fon évêque une certaine contribution
, confiftante en un minot de froment & un mi-
not d’o rgè, une melùre, de v in , & un agneau , le
tout évalué deux fols ; & l’évêque avoit.le choix de
le prendre en argent ou en nature.
L’èmpèreur Charles lé Chauve fit en outre ; en
877,-une levée extraordinaire de deniers , tant fur
les eccïéjiafliques que fur les laïcs, à l’occafion dé la
guerre qü il entreprit à la priere de Jean VTII. contre
les Sarrafins., qui ravageôièht les environs de Rome
& de toutë l ’Italie. Fauchet dit que les évêques lë-
voieîit fur les prêtres , c’eft-à-dire fur les .çurés. &
autres bénéficiers de leur diocèfe, cinq fous d’ôr'pour
les plus riches, & quatre deniers d’argent pour les 1 Tome’ J\
moins aifés; que tous ces deniers étoientremis entre
les mains des gens commis par le roi : ôn prit.même.
quelque chpfe du thréfor. des églifes pour payer cette
fubvention, laquelle paroît être la feule de cette el-
pece qui ait été levée fous la fécondé race.
On voit auflï par les aftes d’un lynode, tenu à Sôif-
fons en 8 5 3 , que les rois faifoient quelquefois des
emprunts fur les fiefs de l’Eglife : en.effet , Charles
le Chauve , qui fut préfent à ce fynôdë, renonça à
faire ce que l’on appelloit proeflurias, c’eft-à-dire dé
ces fortes d’emprunts, ou du moins des fournitures,
deyoirs, ou, redevances , dont les fiefs de l’Eglife
étoient chargés.
Les voyages d’outre-mer qui fe firent pour les croi-
fades. & guerres faintes, furent proprement la fource
des levées, auxquelles on donna peu.de tems après
le nom de décimes.
Le premier & le plus fameux de ces voyages, fut
celui qui fe fit fous la conduite dé Godefrai de Bouillon
en 1096 ; les eccïéjiafliques s’emprefferent comme
les autres ordres de contribuer à cette, fainte expédition.
Louis le Jeûne lé premier de nos rois qui fe Croifa S
Iorfqu’il partit en 1147 , fit une levée de deniers fur
les eccïéjiafliques pour la difpénfe qu’il leur accorda
de faire ce voyage. Ce fait eft prouvé par trois pièces
que rapporte Duchefne : i° . un titre de l’a.bbayè
de S. Benoît-fur-Loire, qui porte que cette abbaye
fut d’abord taxée à 1000 marcs d’argent, enfuite à
500 ; qu’enfuite oii s’accorda à 300 marcs & 500 be-
lans d’or : 20. par une lettre d’un abbé de Ferriere à
l’abbé Suger, alors régent du royaume en l’abfence
de Louis le Jeune ,. où cet abbe demandé du tems
pour payer le reliant de fa taxe •: 30. une autre lettre
du chapitre & des habitans de Brioude à Louis le
Jeune, où ils parlent d’une couronne qu’ils avoient
mife en gage pour payer au roi ce qu’ils lui avoient
promis.
Une chronique de l’abbaye de Morigny nous ap-
prend encôre, qu’Eugene III. étant arrive en France
lorfque le roi étoit fur le point de partir pour la Ter-
re-fainte, les églifes du royaume firent tous les frais
de fon féjour, qui fut fort long , puifque le premier
Avril 1148 il tint un concile à Reims.
Il n’eft point fait.mention d’aucune autre fubven-
tiôn extraordinaire fournie par les eccïéjiafliques, jufqu’à
la dixme ou décime faladine fous Philippe Augufte
, depuis lequel .lçs fubventions fournies par le
clergé ont été appèllëes décimes, dons gratuits, 6c
fubventions, comme On l’a expliqué aux mots D é c i m
e s & D o n s g r a t u it s , & qu’on le dira mot
Su b v e n t io n .
, Outré les redevances & fubventions que les ecclé-
Jiafliques payoient en argent, dès le commencement
de la monarchie, ils dévoient aufli au roi le droit dé
gîte ou procuration, & lè fervice militaire.
. Le droit de gîté confiftoit .à nourrir le roi dt ceux
de fa fuite, quand il paffoit dans quelque lieu où des "
eccïéjiafliques féculièrs ou réguliers'avoient dés terres
;.ils.étoient auflï obligés de recevoir ceux que le
foi envoypit de fa part dans les provinces , & les
ambaffaaeurs.
A l ’egard du fervicë militaire, ils le dévoient comme
fujéts & comme propriétaires de biens fonds,
long tems avant que l’on connût en France l’ufage
des fiefs & du feryiçè dû par les vaffaux.
Hugues abbé de S. Bertin, l’un des fils de Charlemagne,
qui étoit général de l’armée , dé Charles lé.
Chauve Ion oncle, fut tué dans la bataille qu’il donna
près de Touloufe le 7 Juin 844.
Âbbon, parlant du fiége de Paris par les Normans,
dit qu’Ebolus abbé,dë.Saint;Germain-desTPrez, alloit
à la guerre avec Golénus. évêque ide Paris»
Lorfque les eccléflafliqües devinrent poffeffeurs dç