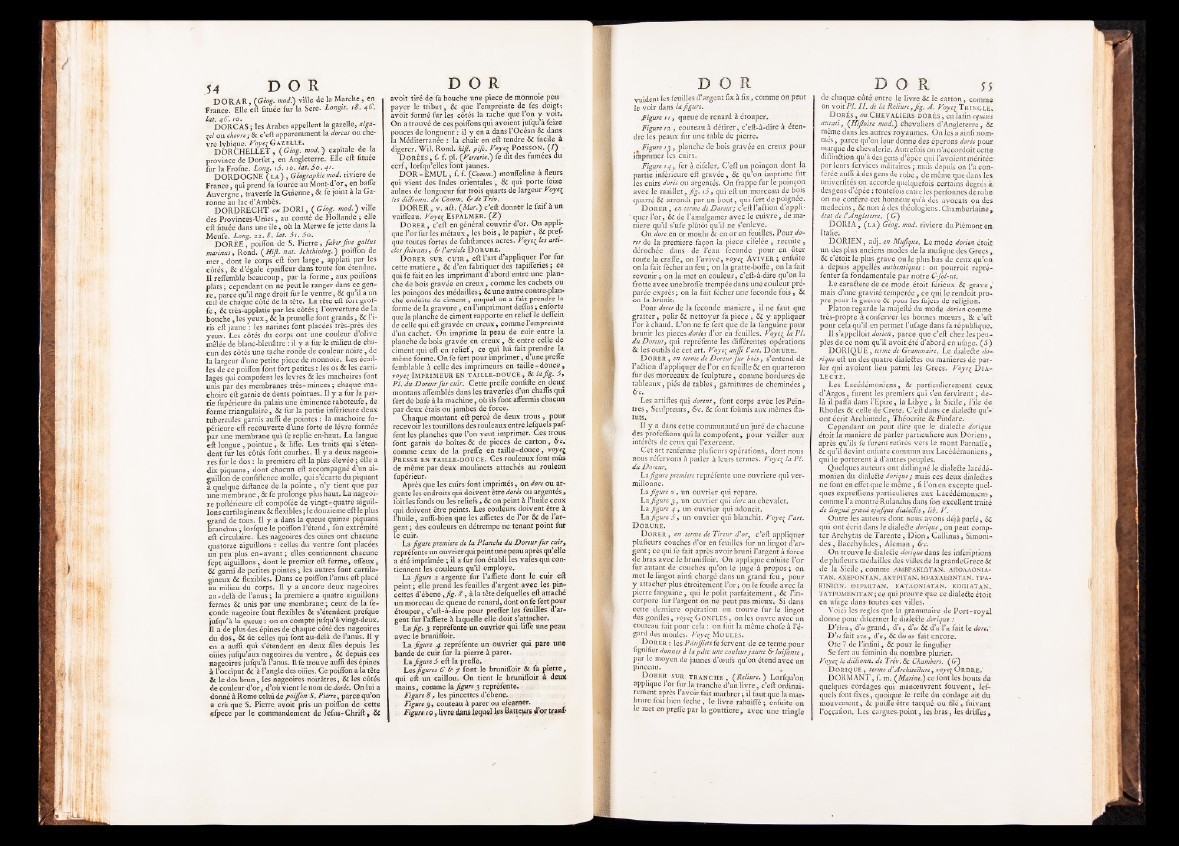
D O R A R , (Giog. mod.) ville de la Marche, en
France. Elleeft fituée fur la Sere. Longit. iS. 46.
lut. 46. 10. 11 /
DORCAS ; les Arabes appellent la gazelle, alga-
p l ou ckevre; & c’eft apparemment la dorcas ou chèvre
lybique. Voyez Gazelle» . ,
DORCHELLET, (Géog. mod. ) capitale de la
province de Dorfet, en Angleterre. Elle eft fituée
fur la Frofne. Long. iS. 10. lat.J0.41. ,
DORDOGNE ( l a ) , Géographie mod. riviere de
France, qui prend fa fource au Mont-d’o r , en baffe
Auvergne, traverfe la Guienne, & fe joint à la Garonne
au lac d’Ambès.
DORDRECHT ou DORI, ( Geog. mod.) ville
des Provinces-Unies, au comté de Hollande ; elle
eft fituée dans une île , où la Merwe fe jette dans la
Meufe. Long. 22. 8. lat. 61. 5o.
D ORÉE, poiffon de S. Pierre , faberjive gallus
marinus, Rond. (Hifi. nat. Ichthiolog.) poiffon de
mer, dont le corps eft fort large, applati par les
côtés, 8c d’égale épaiffeur dans toute Ion étendue.
Il reffemble beaucoup, par la forme, aux poiffons
plats ; cependant on ne peut le ranger dans ce genre
, parce qu’il nage droit fur le ventre, 8c qu’il a un
oeil de chaque côté de la tête. La tête eft fort grof-
f e , 8c très-applatie par les côtés ; l ’ouverture de la
bouche, les yeux, 8c la prunelle font grands, 8c l’iris
eft jaune : les narines font placées très-près des
yeux. Les côtés du corps ont une couleur d’olive
mêlée de blanc-bleuâtre : il y a fur le milieu de chacun
des côtés une tache ronde de couleur noire, de
la largeur d’une petite piece de monnoie. Les écailles
de ce poiffon font fort petites : les os & les cartilages
qui compofent les levres & les mâchoires font
unis par des membranes très-minces; chaque mâchoire
eft garnie de dents pointues. Il y a fur la partie
fupérieure du palais une éminence raboteufe, de
forme triangulaire, & fur la partie inférieure deux
tubercules garnis aufli de pointes : la mâchoire fu-
périéure eft recouverte d’une forte de lèvre formée
par une membrane qui fe replie en-haut. La langue
eft longue, pointue r & liffe. Les traits qui s’étendent
fur les côtés font courbes. Il y a deux nageoires
fur le dos : la première eft la plus élevée ; elle a
dix piquans, dont chacun eft accompagné d’un aiguillon
de confiftence molle, qui s’écarte du piquant
I quelque diftance de la pointe , n’y tient que par
une membrane, & fe prolonge plus haut. La nageoire
poftérieure eft compofée de vingt-quatre aiguillons
cartilagineux 8c flexibles ; le douzième eft le plus
grand de tous. Il y a dans la queue quinze picpans
branchus ; lorfque le poiffon l ’étend, fon extrémité
eft circulaire. Les nageoires des oüies ont chacune
quatorze aiguillons : celles, du ventre font placées
un peu'plus en-avant; elles contiennent chacune
fept aiguillons, dont le premier eft ferme, offeux,
& garni de petites pointes ; les autres font cartilagineux
& flexibles. Dans ce poiffon l’anus eft placé
au milieu du corps. Il y a encore deux nageoires
au-delà de l’anus ; la première a quatre aiguillons
fermes 8c unis par une membrane ; ceux de la fécondé
nageoire font flexibles & s’étendent prefque
jufqu’à la queue : on en compte jufqu’à vingt-deux.
II a de plus des épines de chaque côté des nageoires
du dos, 8c de celles qui font au-delà de l’anus. Il y
en a aufli qui s’étendent en deux files depuis les
oüies jufqu’aux nageoires du ventre, 8c depuis ces
nageoires jufqu’à l’anus. Il fe trouve aufli des épines
à l’occiput 8c à l’angle des oüies. Ce poiffon a la tête
& le dos brun, les nageoires noirâtres, 8c les côtés
de couleur d’or, d’où vient le nom de dorée. On lui a
donné à Rome celui de poiffon S. Pierre, parce qu’on
a crû que S. Pierre avoit pris un poiffon de cette
efpece par le commandement de 1 efus - Chrift, &
avoit tiré de fa bouche une piece de monnoie pou
payer le tribut, & que l’empreinte de fes doigta
avoit formé fur les côtés la tache que l’on y voit*
On a trouvé de ces poiffons qui avoient jufqu’à feize
pouces de longueur : il y en a dans l’Océan 8c dans
la Méditerranée : la chair en eft tendre & facile à
digerer. Wil. Rond. hift. pifc. Voye.ç Poisson. (/) •
D orées , f. f. pl. (Verrerie.) fe dit des fumées au
cerf, lorfqu’elles font jaunes.
D O R -ÉM U L , f. f. (Comm.) mouffeline à fleurs
qui vient des Indes orientales , 8c qui porte feize
aulnes de longueur fur trois quarts de largeur Voyez
les diclionn. du Comm. & de Trèv.
DORER, v. aft. (Mar.) c’eft donner le fuif à un
vaiffeau. Voyez Espalmer. (Z )
D orer , c’eft en général couvrir d’or. On applique
l’or fur les métaux, les bois, le papier, & prefque
toutes fortes de fubftances acres. V>yez les arti-.
des fuivanSy G Carticle DORURE.
D orer sur cuir , eft l’art d’appliquer l’or fur
cette matière , 8c d’en fabriquer des tapifferies ; ce
qui fe fait en les imprimant d’abord entre une planche
de bois gravée en creux, comme les cachets ou
les poinçons des médailles ; 8c une autre contre-planche
enduite de ciment, auquel on a fait prendre la
forme de la gravure, en l’imprimant deffus ; enforte
que la planche de ciment rapporte en relief le deffein
de celle qui eft gravée en creux, comme Pempreinte
d’un cachet. On imprime la peau de cuir entre la
planche de bois gravée en creux, & entre celle de
ciment qui eft en relief, ce qui lui fait prendre là
même forme. On fe fert pour imprimer, d’une preffe
femblable à celle des imprimeurs en taille-douce ,
voyez Imprimeur en ta il le -d o u c e , & la fig. 6,
Pl. du Doreur fur cuir. Cette prefle confifte en deux
montans affemblés dans les traverfes d’un chaflis qui
fert de bafe à la machine, où ils font affermis chacun
par deux étais ou jambes de force.
Chaque montant eft percé de deux trous , pour
recevoir les tourillons des rouleaux entre lesquels paf-
fent les planches que l’on veut imprimer. Ces trous
font garnis de boîtes 8c de pièces de carton, &c*
comme ceux de la preffe en taille-douce, voye^
Presse en taille-d ou ce. Ces rouleaux font mus
de même par deux moulinets attachés au rouleau
fupérieur.
Après que les cuirs font imprimés, on dore ou argente
les endroits qui doivent être dores ou argentes»
foit les fonds ou les reliefs, 8c on peint à l’huile ceux
qui doivent être peints. Les couleurs doivent être à
l’huile, aufli-bien que les aflietes de l’or & de l’argent
; des couleurs en détrempe ne tenant point fur
le cuir.
La figure première de la Planche du Doreur fur cuir»
repréfente un ouvrier qui peint une peau après qu’elle
a été imprimée ; il a fur fon établi les vaîes qui contiennent
les couleurs qu’il employé.
La figure 2. argente fur l’afliete dont le cuir eft
peint ; elle prend les feuilles d’argent avec les pincettes
d’ébene, fig. 8 , à la tête desquelles eft attaché
un morceau de queue de renard, dont onfe fert pour
étouper, c’eft-à-dire pour preffer les feuilles d’argent
fur l’afliete à laquelle elle doit s’attacher.
La fig. 3 repréfente un ouvrier qui liffe une peau
avec le bruniffoir.
La figure 4 repréfente un ouvrier qui pare une
bande de cuir fur la pierre à parer.
La figure 5 eft la preffei.
Les figures G & y font le bruniffoir & fa pierre ,
qui eft un caillou. On tient le bruniffoir à deux
mains , comme la figure g repréfente.
Figure 8 , les pincettes d’éb«ne>..i :
. Figure 5), couteau à parer ou efçgrner. •
Figure. 10 , livre «Uns lequel les Batteurs d’or tranf*
vuident les feuilles d’argent fix à fix, comme on peut
le voir dans la figure.
Figure 1 1, queue de renard à étouper.
Figure 12, couteau à détirer, c’eft-à-dire à étendre
les peaux fur une table de pierre.
Figure 13, planche de bois gravée en creux pour
imprimer les cuirs.
Figure 14, fer à cifeler, C’eft un poinçon dont la
partie inférieure eft gravée, & qu’on imprime fur
les cuirs dorés ou argentés. On frappe fur le poinçon
avec le maillet, fig. / i , qui eft un morceau de bois
quarré 8c arrondi par un bout, qui fert de poignee.
D orer , en terme de Doreur; c’eft l’a&ion d’appli-
' quer l’or, 8c de l’amalgamer avec le cuivre, de maniéré
qu’il s’ufe plûtôt qu’il ne s’enleve.
On dore en or moulu & en or en feuilles. Pour dorer
de la première façon la piece cifelée , recuite,
dérochée dans de l’eau fécondé pour en ôter
toute la craffe, on l ’avive, voyez Aviv er ; enfuite
on la fait fécher au feu ; on la gratte-boffe, on la fait
revenir ; on la met en couleur, c’eft-à-dire qu’on la
frotte avec unebroffe trempée dans une couleur préparée
exprès ; on la fait fécher une fécondé fois, &
on la brunit.
Pour dorer de la fécondé maniéré, il ne faut que
gratter, polir 8c nettoyer fa piece , 8c y appliquer
l’or à chaud. L’on ne fe fert que de la fanguine pour
brunir les pièces dorées d’or en feuilles. Voyez la P l.
du Doreury qui repréfente les différentes opérations
& les outils de cet art. Voyez auJfi Purt. D orure.
D orer , en terme de Doreur fur bois, s’entend de
l’aâion d’appliquer de l’or en feuille 8c en quarteron
fur des morceaux de fculpture, comme bordures de
tableaux, piés de tables, garnitures de cheminées,
&c.
Les artiftes qui dorent, font corps avec les Peintres
, Sculpteurs, &c. 8c font foûmis aux mêmes fta-
tuts.
Il y a dans cette communauté un juré de chacune
des profeflions qui la compofent, pour veiller aux
intérêts de ceux qui l’exercent.
Cet art renferme plufieurs Opérations, dont nous
nous réfervons à parler à leurs termes. Voyez PP
du Doreur.
La figure première repréfente une ouvrière qui ver-
millonne.
La figure 2 , un ouvrier qui repare.
La figure 3 , un ouvrier qui dore au chevalet.
La figure 4 , un ouvrier qui adoucit.
La figure 5 , un ouvrier qui blanchit. Voyez Part.
D orure.
D orer , en terme de Tireur d'or, c ’eft appliquer
plufieurs couches d’or en feuilles fur un lingot d’argent
; ce qui fe fait après avoir bruni l’argent à force
de bras avec le bruniffoir. On applique enfuite l’or
fur autant de couches qu’on le juge à propos ; ou
met le lingot ainfi chargé dans un grand feu, pour
y attacher plus étroitement l’or ; on le foude avec la
pierre fanguine , qui le polit parfaitement, & l’incorpore
fur l’argent on ne peut pas mieux. Si dans
cette derniere opération on trouve fur le lingot
des gonfles, voyez G onfles , on les ouvre avec un
couteau fait pour cela : on fait la même chofe à l’égard
des moules. Voyez Moules.
D orer : les Pâtiffiets fe fervent de ce terme pour
fignifier donner a la pâte une couleur jaune & luifante ,
par le moyen de jaunes d’oeufs qu’on étend avec un
pinceau.
D orer sur t r a n ch e , (Reliure.) Lorfqu’on
applique l’or fur la tranche d’un livre, c’eft ordinairement
après l’avoir fait marbrer ; il faut que la marbrure
foit bien feche, le livre rabaiffé ; enfuite on
le met en prefle par la gouttière, avec une tringle
de chaque coté entre le livre 8c le carton, comme
on voit Pl. I I . de la Reliure, fig. A. Voyez T ringle.
D orés , ou C hevaliers dorés , en latin équités
aurati, (Hifloire mod.) chevaliers d’Angleterre, 8c
même dans les autres royaumes. On les a ainfi nommes
, parce qu’on leur donne des éperons dorés pour
marque de chevalerie. Autrefois on n’accordoit cette
diftinftion qu’à des gens d’épée qui l’avoient méritée
P^'r leurs fervices militaires ; mais depuis on l’a conférée
aufli à des gens de robe, de même que dans les
univerfités pn accorde quelquefois certains degrés à
des gens d’épée : toutefois entre les perfonnes de robe
on ne conféré cet honneur qu’à des avocats ou des
médecins, & non à des théologiens. Chamberlaine,
état de P Angleterre. (G)
DORI A , (l a ) Géog. mod. riviere du Piémont en
Italie.
DORIEN, adj. en Mufique. Le mode dorien étoit
un des plus anciens modes de la mufique des Grecs,
& c’étoit le plus grave ou le plus bas de ceux qu’on
a depuis appellés authentiques : on pourroit repré-*
fenter fa fondamentale par notre C-fol-ut.
Le caraftere de ce mode étoit férieux 8c grave
mais d’une gravité temperée, ce qui le rendoit propre
pour la guerre 8c pour les fujets de religion.
Platon regarde la majefté du mode dorien comme
très-propre à conferver les bonnes moeurs, & c’eft
pour cela qu’il en permet l’ufage dans fa république.
Il s’appelloit dorien, parce que c’eft chez les peuples
de ce nom qu’il avoit été d’abord en ufage. (£)
DORIQUE, terme de Grammaire. Le dialeâe dorique
eft un des quatre dialeftes ou maniérés de parler
qui avoient lieu parmi les Grecs. Voyez D ial
e c t e .
Les Lacédémoniens, & particulièrement ceux
d’Argos, furent les premiers qui s’en fervirent ; delà
il paffa dans I’Epire, la Lib ye, la Sicile, l’île de
Rhodes 8c celle de Crete. C ’eft dans ce dialeéte qu’ont
écrit Archimede, Théocrite ôcPindare.
Cependant on peut dire que le dialeûe dorique
étoit la maniéré de parler particulière aux Doriens,
après qu’ils fe furent retirés vers le mont Parnaflè,
8c qu’il devint enfuite commun aux Lacédémoniens,
qui le portèrent à d’autres peuplesi.
Quelques auteurs ont diftingué le dialefte lacédé-
monien du dialeûe dorique; mais ces deux dialeéles
ne font en effet que le même, fi l’on en excepte quelques
expreflions particulières aux Lacédémoniens,
comme l’a montré Rulandus dans fon excellent traité
de linguâ grcecà ejufque dialeclis , lib. V.
Outre les auteurs dont nous avons déjà parlé, &
qui ont écrit dans le dialefte dorique, on peut compter
Archytas de Tarente , Dion, Callinus, Simoni-
des , Bacchylides, Alcman, &c.
On trouve le dialeéte dorique dans les inferiptions
de plufieurs médailles des villes.de la grandeGrece &
de la Sicile, comme ambpakiutan. aiioaaonia-
TAN. AXEPONTAN. AXTPITAN. HPAXAEflNTAN. TPA-
KINinN. ©EPMITAN. KATAONIATAN. KOIIIATAN.
tatpomenitan ; ce qui prouve que ce dialeûe étoit
en ufage dans toutes ces villes.
Voici les réglés que la grammaire de Port-royal
donne pour dilcerner le dialeâe dorique :
D ’Hto. , d’a grand, d’e, d’«o 8c d’« l’a fait le dore,"
D'u fait «ra, d’«, 8c d<o av fait encore.
Ote 1 de l ’infini, 8c pour le fingulier
Se fert au féminin du nombre plurier.
Voyez le diclionn. de Trèv. 8c Chambers. (G)
DORIQUE, terme d.'Architecture, voyez Ordre.'
DORMANT, f. m. (Marine.) ce font les bouts de
quelques cordages qui manoeuvrent fouvent, lesquels
font fixes, quoique le refte du cordage ait du
mouvement, & puiffe être tarqué ou filé, fuivant
l’occafion. Les cargues-point, les bras, les drilles,