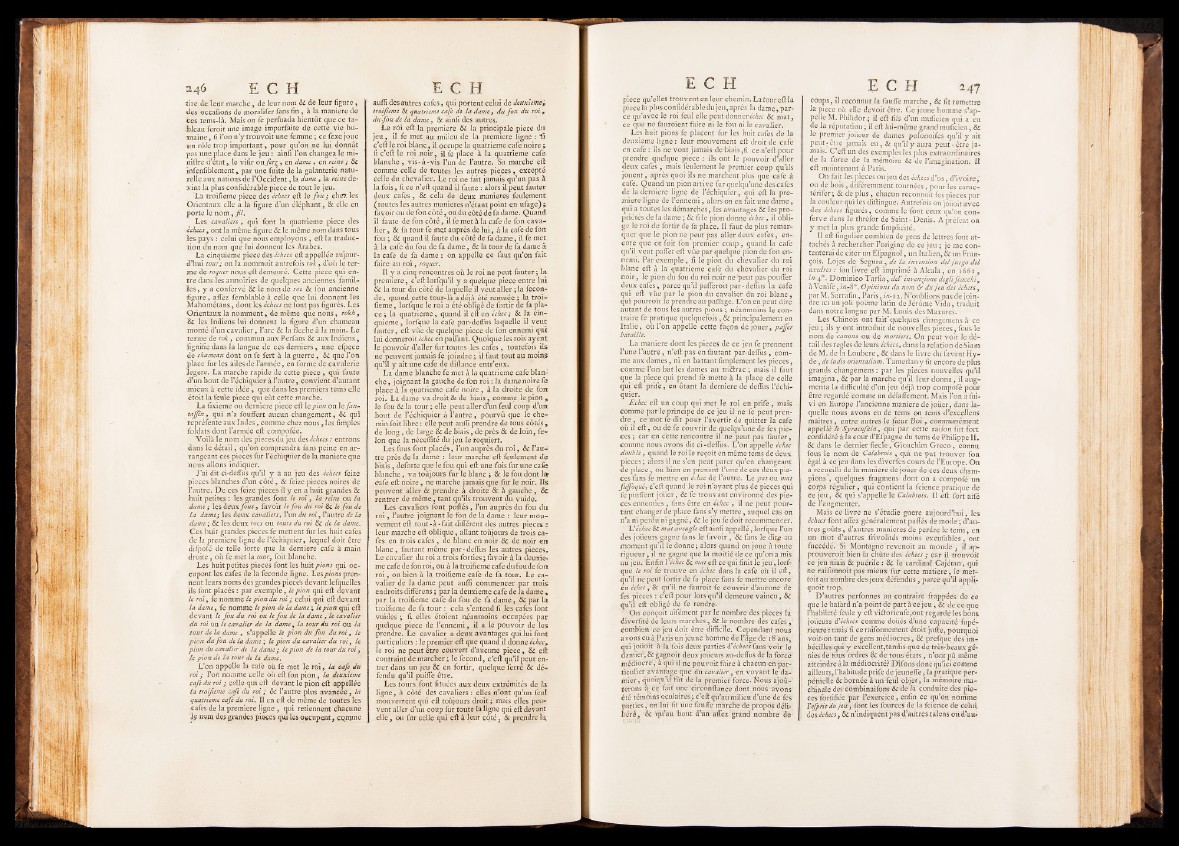
tire de leur marche, de leur nom Ôc de leur figure ,
des occafiorts de moralifer fans fin, à la maniéré de
te s tems-là. Mais on fe perfuada bientôt que ce tableau
feroit une image imparfaite de cette vie humaine
, fi l ’on n’y trouvoit une femme ; ce fexe joue
un rôle trop important, pour qu’on ,ne lui donnât
pas une.place dans le jeu : ainfi l’on changea le mi-
nîftre d’etat, le vifir ou fer£, en dame , en reine ; ôc
infenfiblement , par une fuite de la galanterie naturelle
aux nations de l’Occident, la dame , la reine devint
la plus confidérable piece de tout le jeu.
La troifieme piece des échecs eft le fou ; cheî les
Orientaux elle a la figure d’un éléphant, & elle en
porte le nom, fil.
Les cavaliers, qui font la quatrième piece des
échus, ont la même figure ôc le même nom dans tous
les pays : celui que nous employons , eft la traduction
du nom que lui donnent les Arabes.
La cinquième piece des échecs eft appellée aujourd’hui
tour; on la nommoit autrefois rok , d’oii le terme
de roquer nous eft demeuré. Cette piece qui entre
dans les armoiries de quelques anciennes familles
, y a confervé ôc le nom de roc & fon ancienne
Ligure, affez femblable à celle que lui donnent les
Mahométans., dont les échecs ne font pas figurés. Les
Orientaux la nomment, de même que nous, rokh,
ÔC les Indiens lui donnent la figure d’un chameau
monté d’un cavalier, l’arc ôc la fléché à la main. Le
terme de rok, commun aux Perfans ôc aux Indiens,
lignifie dans la langue de ces derniers , une efpece
de chameau dont on fe fert à la guerre, ôc que l’on
place fur les ailes de l’armée, en forme de cavalerie
legere. La marche rapide de cette piece, qui faute
d’un bout de l’échiquier à l’autre, convient d’autant
mieux à cette idée , que dans les premiers tems elle
'étoit la feule piece qui eût cette marche.
La iixieme ou derniere piece eft le pion ou le fan-
tajjîn, qui n’a fouffert aucun changement, ôc qui
repréfente aux Indes, comme chez nous, les fimples
foldats dont l’armée eft compôfée.
Voilà le nom des pièces du jeu des échecs : entrons
dans le détail, qu’on comprendra fans peine en arrangeant
ces pièces fur l’échiquier de la maniéré que
nous allons indiquer.
J ’ai dit ci-defliis qu’il y a au jeu des échecs feize
pièces blanches d’un côté, & feize pièces noires de
l’autre. De ces feize pièces il y en a huit grandes &
ihuit petites : les grandes font le roi', la reine ou la
dame ; les deux fous, favoir le fou du roi Ôc le fou de
la dame; les deux cavaliers, l’un du roi, l’autre de la
dame ; ÔC les deux rocs ou tours du roi ÔC de la dame.
Ces huit grandes pièces fe mettent fur les huit cafés
de la première ligne de l ’échiquier, lequel doit être
difpofé de telle forte que la derniere café à main
droite, oii fe met la toury foit blanche.
Les huit petites pièces font les huit pions qui occupent
les cafés de la fécondé ligne. Les pions prennent
leurs noms des grandes piece’s devant Iefquelles
ils font placés : par exemple, le pion qui eft devant
le roi, fe nomme le pion du roi ; celui qui eft devant
la dame, fe nomme le pion de la dame ; le pion qui eft
devant le fou du roi ou le fou de la dame , le cavalier
du roi ou le cavalier de la dame, la tour du roi ou la
tour de la dame , s’appelle le pion du fou du roi, le
pion du fou. de la dame ; le pion du cavalier du roi, le
pion du cavalier de la dame ; le pion de la tour du roi ,
le pion de la tour de la dame.
L’on appelle la café où fe met le ro i, la café du
roi ; l’on nomme celle oii eft fon pion, la deuxieme
café du roi ; celle qui eft devant le pion eft appellée
la troifieme café du roi ; ÔC l’autre plus avancée, la
quatrième café du roi. Il en eft de même de toutes les
cafés de la première ligne, qui retiennent chacune
Je nom des grandes pièces qui les occupent, co.mme
aufli des autres cafés, qui portent celui de deuxieine>
troifieme & quatrième café de la dame, du fou du roi,
du fou de la dame, & ainfi des autres.
Le rôi eft la première ôc la principale piece dit
jeu , il. fe met au milieu de la première ligne :
c’eft le roi blanc, il occupe la quatrième café noire ;
li c’eft le roi noir, il fe place à la quatrième café
blanche, vis-à-vis l’un de l’autre. Sa marche eft
comme celle de toutes les autres pièces, excepté
celle du chevalier. Le roi ne fait jamais qu’un pas à
la fois, fi ce n’eft quand il faute : alors il peut fauter
deux cafés, ôc cela de deux maniérés feulement
(toutes les autres maniérés n’étant point qn ufage) ;
favoir ou de fon côté, ou du côté de fa dame. Quand
il faute de fon côté, il fe met à la café de fon cavalier,
& fa tour fe met auprès de lui, à la café de fon
fou ; ôc quand il faute du côté de fa dame, il fe met
à la café du fou de fa dame, ôc la tour de fa dame à
la café de fa dame : on appelle ce faut qu’on fait
faire au ro i, roquer.
Il y a cinq rencontres où le roi ne peut fauter ; la
première,,c’eft:lorfqu’il y a quelque piece entre lui
Ôc la tour du côté de laquelle il veut aller ; la fécondé,
quand cette tour-là a déjà été remuée ; la troifieme
, lorfque le roi a été obligé de fortir de fa place
; la quatrième, quand il eft en échec; & la cinquième
, lorfque la café par-deflùs laquelle il veut
fauter, eft vue d,e quelque piece de fon ennemi qui
lui donneroit échec en paffant. Quoique les rois ayent
le pouvoir d’aller fur toutes les cales , toutefois ils
ne peuvent jamais fe joindre ; il faut tout au moins
qu’il y ait une café de diftance entr’eux.
La dame blanche fe met à la quatrième café blanche
, joignant la gauche de fon roi : la dame noire fe
place à la quatrième café noire, à la droite de fon
roi. La dame va droit & de biais, comme le pion ,
le fou ôc la tour ; elle peut aller d’un feul coup d’un
bout de l’échiquier à l’autre , pourvu que le cher
min foit libre : elle peut aufli prendre de tous côtés ,
de long, de large ôc de biais, de près & de loin, félon
que la néceflité du jeu le requiert.
Les fous font placés, l’un auprès du ro i, ôc l’autre
près de la dame : leur marche eft feulement de
biais, deforte que le fou qui eft une fois fur une café
blanche, va toujours fur le blanc ; & le fou dont I»
café eft noire, ne marche jamais que fur le noir. Ils
peuvent aller & prendre à droite & à gauche, ÔC
rentrer de même, tant qu’ils trouvent du vuide.
Les cavaliers font poftés, l’un auprès du fou du
ro i, l’autre joignant le fou de la dame : leur mouvement
eft tout-à-fait différent des autres pièces r
leur marche eft oblique, allant toujours de trois cafés
en trois cafés , de blanc en noir ôc de noir en
blanc, fautant même par-deffus les autres pièces.
Le cavalier du roi a trois forties ; favoir à la deuxie-
me café de fon roi, ou à la troifieme café du fou de fon
ro i, ou bien à la troifieme café de fa tour. Le cavalier
de la dame peut aufli commencer-par trois
endroits différens ; par la deuxieme café de la dame „
par la troifieme café du fou de fa dame, ôc par la
troifieme de fa tour : cela s’entend fi les cafés font
vuides ; fi. elles étoient néanmoins occupées par
quelque piece de l’ennemi, il a le pouvoir de les
prendre. Le cavalier a deux avantages qui lui font
particuliers : le premier eft que quand il donne échec,
le roi ne peut être couvert d’aucune piece, ôc eft:
contraint de marcher ; le fécond, c ’eft qu’il peut entrer
dans un jeu ôc en fortir., quelque ferre ôc défendu
qu’il puiflë être.
Les tours , font fituées aux deux extrémités de la
ligne, à côté des cavaliers : elles n’ont qu’un feu!
mouvement qui eft toujours droit; mais elles peuvent
aller d’un coup fur toute la ligne qui eft devant
elle, ou fur celle qui eft à leur côté, & prendre l^
i l L H
piece qu’elles trouvent en leur chemin. La tour eft la
piece la plus confidérable du jeu, après la dame, parce
qu’avec le roi feul elle peut donner échec ôc mat,
ce que ne fauroient faire ni le fou ni le cavalier.
Les huit pions fe placent fur les huit cafés de la
deuxieme ligne..: leur mouvement eft droit de café
en café : iis ne vont jamais'de biais,fi ce n’eft pour
prendre quelque piece : ils ont le pouvoir d’aller
deux cafés , mais feulement le premier coup qu’ils
jouent, après quoi ils né marchent plus que café à
café. Quand un pion arrive fur quelqu’une des cafés
de la derniere ligne de l’échiquier, qui eft la première
ligne de l’ennemi, alors on en fait une dame,
qui a toutes les démarches, les avantages ôc les propriétés
de la dame ; ôc fi le pion donne échec, il oblige
le roi de fortir de fa place. Il faut de plus remarquer
que le pion ne peut pas aller deux cafés, encore
que ce foit fon premier coup , quand la café
qu’il veut paffer eft vue par quelque pion de fon ennemi.
Par exemple, fi le pion du chevalier du roi
blanc eft à la quatrième café du chevalier du roi
noir, le pion du fou du roi noir ne peut pas pouffer
deux cafés, parce qu’il pafferoit par - deffus la café
qui eft vue par le pion du cavalier du roi blanc,
qui pourroit le prendre au paffage. L’on en peut dire
autant de tous les autres pions ; néanmoins le contraire
fe pratique quelquefois, ôc principalement en
Italie, où l’on appelle cette façon de jouer, paffer
bataille.
La maniéré dont les pièces de ce jeu fe prennent
l ’une l’autre, n’eft pas en fautant par-deflùs, comme
aux dames, ni en battant Amplement les pièces,
comme l’on bat les dames au triétrac ; mais il faut
que la piece qui prend fe mette à la place de celle
qui eft prife, en ôtant la derniere de deffus l’échiquier.
Echec eft un coup qui met le roi en prife , mais
comme par le principe de ce jeu il ne fe peut prendre
, ce mot fe dit pour l’avertir de quitter la café
où il eft, ou de fe couvrir de quelqu’une de fes pièces
; car en cette rencontre il ne peut pas fauter,
comme nous avons dit ci-deffus. L’on appelle échec
double, quand le roi le reçoit en même tems de deux
pièces ; alors il ne s’en peut parer qu’en changeant
de place, ou bien en prenant l’une de ces deux pièces
fans fe mettre en échec de l’autre. Le pat ou mat
fuffoquè, c’eft quand le roi n’ayant plus de pièces qui
fe puiffent joiier, ôc fe trouvant environné des pièces
ennemies , fans être en échec , il ne peut pourtant
changer de place fans s’y mettre, auquel cas on
n’a ni perdu ni gagné, & le jeu fe doit recommencer.
U échec ÔC mat aveugle eft ainfi appellé, lorfque l’un
des joueurs gagne fans le favoir , ôc fans le dir£ au
moment qu’il le donne ; alors quand on joue à toute
rigueur, il ne gagne que la moitié de ce qu’on a mis;
au jeu. Enfin Véchec ôc mat eft ce qui finit le jeu, lorfque
le roi fe trouve en échec dans la café où il eft,
qu’il ne peut fortir de fa place fans fe mettre encore
én échec, & qu’il ne fauroit fe couvrir d’aucune dé
fes pièces : c’eft pour lors qu’il demeure vaincu, ôc
qu’il eft çsbligé de fé rendre.
' On conçoit aifément par le nombre des pièces la
diverfité de leurs marches, & lé nombre des cafés
combien ce jeu doit être difficile. Cependant nous:
avons eu à.Paris un jeûné homme de l’âge de 1-8'ans;
qui joiiôit à:la fois deuxparties échecs fans voir le
damier, & gagnoit deux joueurs au-deffus de la force
médiocre', à qui il ne pouvoit faire à chacun en particulier
avantage que d\\ cavalier, -en voyant le damier,
qüôiqu’il fût de la premier force. Nous ajôû-
ferôns ai ce'fait une-'circonstance dont.noire avons
été témôins'oçulairesi; c’eft qu’au milieu d’une de fes'
parties, on lui fit une fauffe marche dé propos délibéré,
ôc qu’au bout d’un affez grand nombre de
C H 247
coups, il reconnut la fauffe marche, ôc fit remettre
la piece où elle devoit être. Ce jeune homme s’appelle
M. Philidor ; il eft fils d’un muficien qui a eu
de la réputation ; il eft lui-même grand muficien, ôc
le premier joueur de dames polonoifes qu’il y ait
Pei.lf j etre jamais eu , & qu’il y aura peut - être jamais.
C ’eft un des exemples les plus extraordinaires
de la force de la mémoire ôc de l’imagination. II
eft maintenant à Paris.
On fait les pièces ou jeu des échecs d’o s , d’ivoire,'
ou de bois, différemment tournées, pour les carac-
térifer ; &>de plus, chacun reconnoît fes pièces par
la couleur qui les diftingue. Autrefois on joiioit avec
des échecs figurés, comme le font ceux qu’on con-
ferve dans le thréfor de Saint-Denis. A préfent on
y met la plus grande fimplicité.
Il eft fingulier combien de gens de lettres font attachés
à rechercher l’origine de ce jeu ; je me contenterai
de citer un Efpagnol, un Italien, ôc un François.
Lojes de Segura, de la invention deljuego del
axedres : fon livre eft imprimé à A lcala, en 1661 ,
in-40. Dominico Tarfia, del' invenfione degli fcacçhi,
àVenife, in-B°. Opinions du nom & du jeu des échets.
parM. Sarrafin, Paris, in-i 2. N’oublions pas de joindre
ici un joli poème latin de Jérôme V ida, traduit
dans notre langue par M. Louis des Mazures.
Les Chinois ont fait*quelques changemens à ce
jeu ; ils y ont introduit de nouvelles pièces, fous le
nom de canons ou de mortiers. On peut voir le détail
des réglés de leurs échecs, dans la relation de Siam
de M. de la Loubere, ôc dans le livre du favant Hy-
de, de ludis orientalium. Tamerlan y fit encore de plus
grands changemens : par les pièces nouvelles qu’il
imagina, ôc par la marche qu’il leur donna, il augmenta
la difficulté d’un jeu déjà trop compofé pour
être regardé comme un délaffement. Mais l’on a fui-
v i en Europe l’ancienne maniéré de jouer, dans la?-
quelle nous avons eu de tems en tems d’excellens
maîtres, entre autres le fleur B o i, communément
appellé le Syracufain, qui- par cette raifon fut fort
confidéré à la cour d’Efpagne du tems de Philippe II.
ôc dans le dernier fiecle, Gioachim Greco, connu
fous le nom de Calabrois , qui ne put trouver fon
égal à ce jeu dans les diverfes cours de l’Europe. On
a recueilli de la maniéré de joiier de ces deux champions
, quelques fragmens dont on a compofé un
corps régulier, qui contient la fcience pratique dé
Ce jeu , ôc qui s’appelle le Calabrois. 11 eft fort aifé
de l’augmenter.
Mais ce livre ne s’étudie guère aujourd’hui, les
échecs font affez généralement pafles de mode ; d’autres
goûts, d’autres maniérés de perdre le tems, en
un mot d’autres frivolités moins exeufables , ont
fuccédé. Si Montagne revenoit au monde , il ap-
prouyeroit bien la chûte des échecs ; car il trou voit
ce jeu niais & puérile : ôc le cardinal Cajétan', qui
ne raifohnoit pas mieux fur cette matière , le met-
toit au nombre dès jeux défendus, parce qu’il appli-
quoit trop.
D ’autres perfonnes au çontrairé frappées1 de ce
que lé hafard n’a point de part à ce jeu , ôe de ce que
l’habileté feu-le y eft vi£forieufe,ont regardé les bons
joueurs d'échecs comme doués d’uiié capacité fupé-
rieure-: mais fi ce raifonnement étoit jufte, pourquoi
voit-on tant de gens médiocres, ôc prefque des im-
bécillesiqui y excellent,tandis-que de très-beaux génies
dé tous ordres & de tous états , :n’ônt pû.même
atteindre à la médiocrité? Diforis donc qu’ici comme
ailleurs., l’habitude prife de jeuneffe, la pratique per-
pémellè ôc.bprnée à'un feul objet, la mémoire machinale
des cprh'binaifons ôc de là eonduitë des pièces
fortifiée par l’exercice, enfin ce qu’on nomme
Fefpfit dujeü; font les foiirces de la fciericè de célui-
des échecs y ôc n’indiquént pâs d’autres .tàlens où d’au