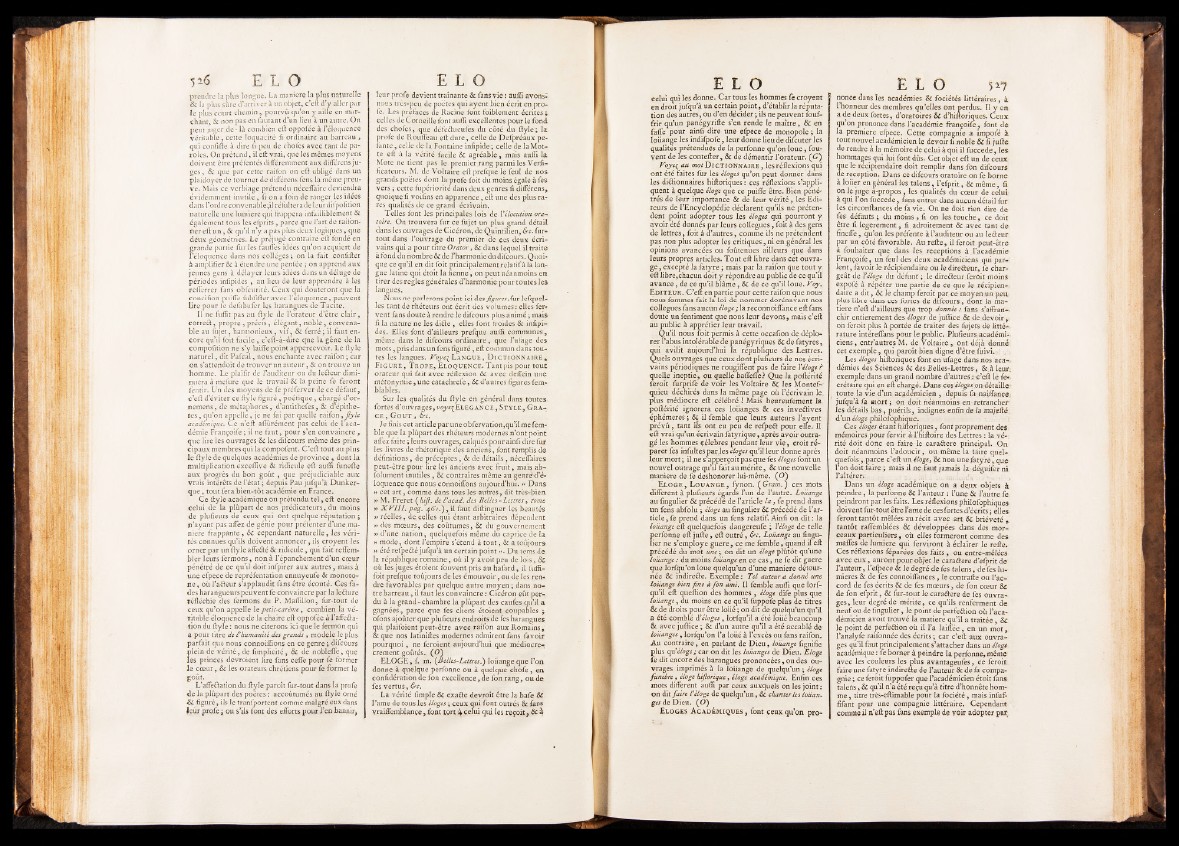
prendre la plus longue. La maniéré la plus naturelle
& la plus sûre d’arriver à un objet, c’eft d’y aller par
le plus court chemin , pourvu qu’on y aille en marchant,
& non pas en fautant d’un lieu à un autre. On
peut juger de - là combien eft oppofée à l’éloquence
véritable, cette loquacité fi ordinaire au barreau,
qui confifte à dire ü peu de chofes avec tant de paroles.
On prétend, il eft vrai, que les mêmes moyens
doivent être préfentés différemment aux différens juges
, Sc que par cette raifon on eft obligé dans un
plaidoyer de tourner de diiférens fens la même preuve.
Mais ce verbiage prétendu néceffaire deviendra
évidemment inutile, fi on a foin de ranger les idées
dans l’ordre convenable;il réfultera de leur difpofxtion
natxirelle une Ixxfniere qui frappera infailliblement &
également tous les efprits , parce que l’art de raifon-
ner eft un, & qu’il n’y a pas plus deux logiques, que
deux géométries. Le préjugé contraire eft fondé en
grande partie fur les fauflés idées qu’on acquiert de
l ’éloquence dans nos collèges ; on la fait confifter
à amplifier & à étendre une penfée ; on apprend aux
jeunes gens à délayer leurs idées dans un déluge de
périodes infipides , au lieu de leur apprendre à les
refîèrrer fans obfcurité. Ceux qui douteront que la
concifxon puiffe fubfifter avec l ’eloquence, peuvent
lire pour le defabufer les harangues de Tacite.
Il ne fuffit pas au ftyle de l’orateur d’être, clair,
correct, propre, précis, élégant, noble, convenable
au fujet, harmonieux, v if , & ferré ; il faut encore
qu’il foit facile , c’eft-à-dire que la gêne de la
compofxtion ne s’y laiffe point appercevoir. Le ftyle
naturel, dit Pafcal, nous enchante avec raifon; car
on s’attendoit de trouver un auteur, & on troxxve un
homme. Le plaifir de l’auditeur ou du-Jedeur diminuera
à mefxire que le travail & la peine fe feront
fentir. Un des moyens de fe préferver de ce défaut,
c ’eft d’éviter ce ftyle figuré, poétique, chargé d’or-
nemens, de métaphores, d’antithefes, & d’épithe-
te s , qu’on appelle, je ne fai par quelle raifon, ftyle
académique. Ce n’eft aflïirément pas celui de l’académie
Françoife ; il ne faut, pour s’en convaincre,
que lire les ouvrages &c les difeours même des principaux
membres qui la compofent. C ’eft tout au plus
le ftyle de quelques académies de province , dont la
multiplication excefîive & ridicule eft aufli funefte
aux progrès du bon goût , que préjudiciable aux
vrais intérêts de l’état ; depuis Pau jufqu’à Dunkerque
, tout fera bien-tôt académie en France.
Ce ftyle académique ou prétendu te l, eft encore
celui de la plûpart de nos prédicateurs, du moins
de plufieurs de ceux qui ont quelque réputation ;
n’ayant pas aflez de génie pour préfenter d’une maniéré
frappante, & cependant naturelle, les vérités
connues qu’ils doivent annoncer, ils croyent les
orner par un ftyle affedé & ridicule, qui fait reffem-
bler leurs fermons, non à l’épanchement d’un coeur
pénétré de ce qu’il doit infpirer aux autres, mais à
line efpece de repréfentation ennuyeufe & monoton
e, oix Fadeur s’applaudit fans être écouté. Ces fades
harangueixrs peuvent fe convaincre par la ledure
réfléchie des fermons du P. Maflillon, fur-tout de
ceux qu’on appelle le petit-carême, combien la véritable
éloquence de la chaire eft oppofée à l’affeda-
tion du ftyle : nous ne citerons ici que le fermon qui
a pour titre de /’humanité des grands, modèle le plus
parfait que nous connoiflions en ce genre ; difeours
plein de vérité, de {imp lic ite& de noblefl'e, que
les princes devraient lire fans ceffe pour fe former
le coeur, & les orateurs chrétiens pour fe former le
goût. ■
L’affedation dix ftyle paroît fur-tout dans la profe
de la plûpart des poètes : accoûtumés au ftyle orné
& figuré, ils le tranfportent comme malgré eux dans
J.eur profe ; ou s’ils font des efforts pour l’en bannir,
leur profe devient traînante & fans vie : aufli avons-
nous très-peu de poètes qui ayent bien écrit en profe.
Les préfacés de Racine font foiblement écrites ;
celles de Corneille font aufli excellentes pour le fond
des chofes,,que défedueufes du côté du ftyle; la
profe de Roufleau eft dure, celle de Defpréaux pelante
, celle de la Fontaine infxpide; celle de la Motte
eft à la vérité facile & agréable, mais aufli la
Mote ne tient pas le premier rang parmi les Verfi-
ficateurs. M. de Voltaire eft prefque le feul de nos
grands poètes dont la profe foit du moins égale à fes
vers ; cette fupériorité dans deux genres li différens,
quoique fi voifins en apparence, eft une des plus rares
qualités de ce grand écrivain.
Telles font les principales lois de l'élocution oratoire.
On trouvera fur ce fujet un plus grand détail
dans les oxxvrages de Cicéron, de Quintilien, &c. fur-
tout dans l’ouvrage du premier de ces deux écrivains
qui a pour titre Orator, & dans lequel il traite
à fond du nombre & de l’harmonie du difeours. Quoique
ce qu’il en dit foit principalement relatif à la langue
latine qui étoit la fienne, on peut néanmoins en
tirer des réglés générales d’harmonie pour toutes les
langues.
Nous ne parlerons point ici des figures,{itr lefquel-
les tant de rhéteurs ont écrit des volumes : elles fervent
fans doute à rendre le difeours plus animé ; mais
fi la nature ne les diète , elles font froides & infipides.
Elles font d’ailleurs prefque aufli communes,
même dans le difcoixrs ordinaire, que l’ulage des
mots, pris dans un fens figuré, eft commun dans toutes
les langues. Voye^ Langue, D ictionnaire,
Figure , Trope, Eloquence. Tant pis pour tout
orateur qui fait avec réflexion & avec deffein une
métonymie, une catachrefe, & d’autres figures fem-
blables.
Sur les qualités du ftyle en général dans toutes
fortes d’ouvrages, vo/^ E legance , Style, Grâc
e ,G oût, 6‘c.
. Je finis cet article par une obfervation,qu’il me fem-
ble que la plûpart des rhéteurs modernes n’ont point
aflez faite ; leurs ouvrages, calqués pour ainfi dire fur
les livres de rhétorique des anciens, font remplis de
définitions, de préceptes , & de détails , iléceffaires
peut-être pour lire les anciens avec fruit, mais ab-
folument inutiles, &: contraires même au genrèd’é-
loquence que nous cônnoiffons aujourd’hui. « Dans
» cet art, comme dans tous les autres, dit très-fiien
» M. Freret ( hift. de l'acad. des Belles -Lettresy tome
» X V I I I . pag. 46'/.), il faut diftinguer les beautés
« réelles, de, celles qui étant arbitraires dépendent
«des moeurs, des coûtumes, & du gouvernement
« d’une nation, quelquefois même du caprice de la
« mode, dont l’empire s’étend à tout, & a toujours
« été refpedé jufqu’à un certain point ». Du tems de
la république romaine, où il y avoit peu de lois, 8c
où les juges étoient fouvent pris au hafard, il liiffx-
foit prefque toûjours de les émouvoir, ou de les rendre
favorables par quelque autre moyen ; dans notre
barreau , il faut les convaincre : Cicéron eût perdu
à la grand-chambre la plûpart des caufes qu’il a
gagnées, parce que fes cliens étoient coupables ;
ofons ajoûter que plufieurs endroits de fes harangues;
qui plaifoient peut-être avec raifon aux Romains,
& que nos latiniftes modernes admirent fans favoir
pourquoi, ne feroient aujourd’hui que médiocre-
crement goûtés. (O)
ELOGE, f. m. (.Belles-Lettres.) loiiange que l’on
donne à quelque perfonne ou à quelque chofe, en
confidération de fon excellence, de fon rang, ou de
fes vertus, &c.
La vérité fimple & exade devroit être la bafe &
l ’ame de tous les éloges ; ceux qui font outrés & fans
vraiffemblance, font tort à celui qui les reçoit, de à
celui qui les donne. Car tous les hommes fe crôyent
en droit jufqu’à un certain point, d’établir la réputation
des autres, ou d’en décider ; ils ne peuvent fouf-
frir qu’un panégyrifte s’en rende le maître, & en
faffe pour ainfi dire une efpece de monopole ; la
loiiange les indifpofe, leur donne lieu de difeuter les
qualités prétendues de la perfonne qu’on loue, fou-
vent de les contefter, & de démentir l’orateur. ( G)
Voye{ au. mot Dictionnaire ,.les réflexions qui
ont été faites fur les éloges qu’on peut donner dans
les didionnaires hiftoriques : ces réflexions s’appliquent
à quelque éloge que ce puiffe être. Bien pénétrés
de leur importance & de leur vérité, les Editeurs
de l’Encyclopédie déclarent qu’ils ne prétendent
point adopter tous les éloges qui pourront y
avoir été donnés par leurs collègues, foit à des gens
de lettres, foit à d’autres, comme ils ne prétendent
pas non plus adopter les critiques, ni en général les
opinions avancées ou foûtenues ailleurs que dans
leurs propres articles. Tout eft libre dans cet ouvrage
, excepté la fatyre ; mais par la raifon que tout y
eft libre,chacun doit y répondre au public de ce qu’il
avance, de ce qu’il blâme, & de ce qu’il loue. V7y. Editeur. C ’eft en partie pour cette raifon que nous:
nous fommes fait la loi de nommer dorénavant nos
collègues fans aucun éloge ; la reconnoiffance eft fans,
doute un fentiment que nous leur devons, mais c’eft
au public à apprétier leur travail.
Qu’il nous foit permis à cette oecafion de déplorer
l’abus intolérable de panégyriques & de fatyres,
qui avilit aujourd’hui la republique des Lettres.
Quels ouvrages que ceux dont plufieurs de nos écrivains
périodiques ne rougiffent pas de faire Véloge ?
quelle ineptie, ou quelle baffeffe? Que la poftérité
feroit furprife de voir les Voltaire & les Montefi--
quieu déchirés dans la même page où l’écrivain le.
plus médiocre eft célébré 1 Mais heureufement la
poftérité ignorera ces louanges & ces inventives
éphémères ; & il femble que leurs auteurs Rayent
prévu, tant iis ont eu peu de refped pour elle. II
eft vrai qu’un écrivain fatyrique, après avoir outragé
les hommes célèbres pendant leur v ie, croit réparer
fes infultes parles éloges qu’il leur donne après
leur mort ; il ne s’apperçoit pas que fes éloges font un
nouvel outrage qu’il fait au mérite, &: une nouvelle
maniéré de fe deshonorer lui-même. (O)
E l o g e , L o u an g e , fynon. (Gram.) ces mots
different à plufieurs égards l’un de l’autre. Loiiange
au fingulier & précédé de l’article la , fe prend dans
tin fens abfolu ; éloge au fingulier & précédé de l’article
, fe prend dans un fens relatif. Ainfi on dit : la
loiiange eft quelquefois dangereufe ; IVloge de telle
perfonne eft jufte , eft outré, &c. Loiiange au fingulier
ne s’employe guere, ce me femble, quand il eft
précédé du mot une ; on dit un éloge plûtôt qu’une
louange : du moins loiiange en ce cas, ne fe dit guere
que lorfqu’on loue quelqu’un d’une maniéré détournée
&C indirede. Exemple : Tel auteur a donné une
loiiange bien fine à fon ami. Il femble aufli que lorf-
qu’il eft queftion des hommes , éloge dife plus que
loiiange, du moins en ce qu’il fuppofe plus de titres
& de droits pour être loiié ; on dit de quelqu’un qu’il
a été comblé d'éloges, lorfqu’il a été loué beaucoup
& avec juftice ; & d’un autre qu’il a été accablé de
loiianges, lorfqu’on l’a loiié à l’excès ou fans raifon.
Au contraire, en parlant de Dieu, loiiange lignifie
plus qu’éloge ; car on dit les loiianges de Dieu. Eloge
le dit encore des harangues prononcées, ou des ouvrages
imprimés à la loiiange de quelqu’un ; éloge
funebre , éloge hifiorique , éloge académique. Enfin ces
mots different aufli par ceux auxquels on les joint :
on dit faire l'éloge de quelqu’un, & chanter les louanges
de Dieu. (O)
Eloges Académiques , font ceux qu’on prononce
dans les académies & fociétés littéraires, à
l’honneur des membres qu’elles ont perdus. Il y en
a de deux fortes, d’oratoires & d’hiftoriques. Ceux
qu’on prononce dans l’académie françoife, font de
la première efpece. Cette compagnie a impofé à
tout nouvel académicien le devoir fi noble & fi jufte
de rendre à la mémoire de celui à qui il fuccede, le s
hommages qui lui font dûs. Cet objet eft un de ceux
que le récipiendaire doit remplir dans fon difeours
de réception. Dans ce difeours oratoire on fe borne
à loiier en général les talens, l’efprit, & même, fi
on le juge à-propos , les qualités du coeur de celui
à qui l’on fuccede, fans entrer dans aucun détail fur
les circonftances de fa vie. On ne doit rien dire de
fes défauts ; du moins, fi on les touche, ce doit
être fi legerement, fi. adroitement & avec tant de
fineffe, qu’on les préfente à l’auditeur ou au lecteur
par un côté favorable. Au refte, il feroit peut-être
à fouhaiter que dans les réceptions à l’académie
Françoife, un feul des deux, académiciens qui parlent,
favoir le récipiendaire ou le directeur, fe chargeât
de Véloge du défunt ; le directeur fgrôit moins
expofé à répéter une partie de ce que le récipien-*-
daire a dit, & le champ feroit par ce moyen un peif
plus libre dans ces fortes de difeours , dont la matière
n’eft d’ailleurs que trop donnée : fans s’afifan*.
chir entièrement des éloges de juftice & de devoir 1
oh feroit plus à portée de traiter des fujets de litté-.
rature intéreffans pour le public. Plufieurs.académie
ciens, entr’autres M. de Voltaire,, ont déjà donné
cet exemple, qui paroît bien digne d’être fuiviv.'
Les éloges hiftoriques font enufage dans nos aca->
démies des Sciences & des Belles-Lettres, &. à leut;
exemple dans urt grand nombre d’autreSiç’eft le fe*.
crétaire qui en eft chargé. Dans ce§ éloges],on détaille*
toute la vie d’un académicien $ depuis fa naiffance.
jufqu’à fa mort ; on doit néanmoins en retrancher
les détails bas, puérils, indignes enfin de la majefté.
d’un éloge philosophique.
Ces éloges étant hiltoriques, font proprement des
mémoires pour fervir à l ’hiftoire des Lettres : la vé-:
rité doit donc en faire le caradere principal. On
doit néanmoins l’adoucir, ou même la taire quelquefois
,.parce c’eft un éloge, & non une fatyré ,.que
l’on doit faire ; mais il ne faut jamais la-déguifer ni
raïtéren., • -c J ;(i ... .
Dans un éloge académique on a deux objets à
peindre, la perfonne & l ’auteur : l’une & l’autre fe
peindront par les faits. Les réflexions philofophiques
doivent fur-tout être l’ame de ces fortes d’écrits ; elles'
feront tantôt mêlées au réçit avec art & brièveté ,
tantôt raffemblées & développées dans des morceaux
particuliers, où elles formeront comme des
maffes de lumière qui ferviront à éclairer le refte»
Ces reflexions leparées des faits , ou entre-mêlées
avec eux, auront pour objet le caraélere d’efprit de
l’auteur, l’efpece & le degré de fes talens, de fes lumières
& de fes connoiffances., le contrafte ou l’accord
de fes écrits & de fes moeurs, de fon coeur ôs
de fon efprit, & fur-tout le caradere de fes ouvrages,
leur degré de mérite, ce qu’ils renferment de
neuf ou de fingulier, le point de perfection où l’académicien
avoit trouvé la matière qu’il a traitée, Sc
le point de perfe&ion où il l’a laiffée, en un mot,
l’analyfe raifonnée des écrits ; car c’eft aux ouvrages
qu’il faut principalement s’attacher dans un élogt
académique : fe borner à peindre la perfonne, même
avec les couleurs les plus avantageufes, ce feroit.
faire une fatyre indirede de l’auteur & de fa compagnie
; ce feroit fuppofer que l’académicien étoit fans
talens, & qu’il n’a été reçu qu’à titre d’honnête homme
, titre très-eftimable pour la fociété, mais infufi
fifant pour une compagnie littéraire. Cependant
comme il n’eft pas fans exemple de yoir adopter pat;