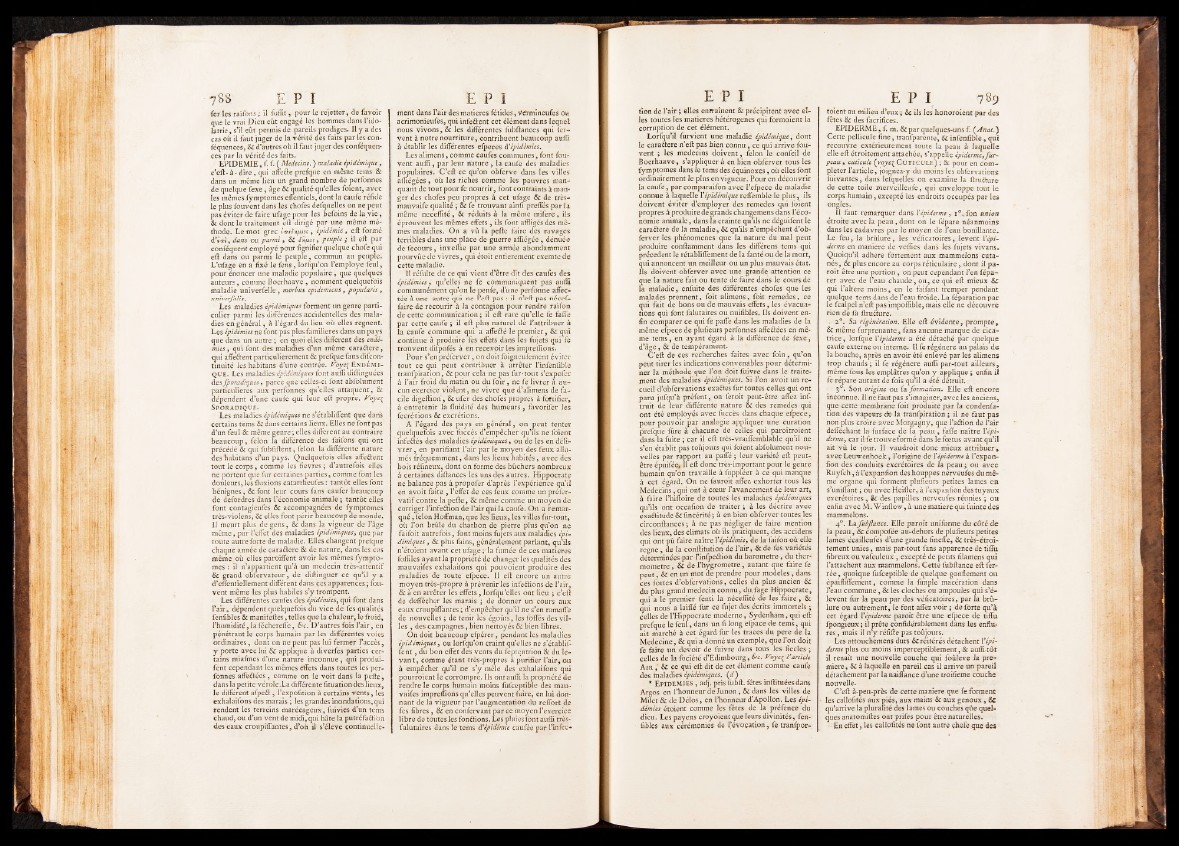
fer les raifons ; il fuffit, pour le rejetter, de favoir
que le vrai D ieu eût engagé les hommes dans l’ido-
latrie, s’il eût permis de pareils prodiges. Il y a des
cas où il faut juger de la vérité des faits par les con-
féquences, & d’autres où il faut juger des conféquen-
ces par la vérité des faits.
EPIDEMIE, f. f. ( Médecine. ) maladie épidémique ,
c’eft-à-dire , qui affeôe prefque en même tems &
dans un même lieu un grand nombre de perfonnes
de quelque fexe, âge & qualité qu’elles foient, avec
les mêmes fymptomes effentiels, dont la caufe réfide
le plus fouvent dans les chofes defquelles on ne peut
pas éviter de faire ufage pour les befoins de la.vie,
& dont le traitement eft dirigé par une même méthode.
Le mot grec îmS'»/juoç, épidémie , eft forme
d’» ■ wi, dans ou parmi, & S'vp.oç, peuple ; il eft par
conféquent employé pour fignifier quelque chofe qui
eft dans ou parmi le peuple, commun au peuple;
L ’ufage en a fixé le fens, lorsqu’on l’employe feul,
pour énoncer une maladie populaire, que quelques
auteurs, comme Boerhaave , nomment quelquefois
maladie univerfelle, morbus epidemicus , popularis ,
univerfalis.
Les maladies épidémiques forment un genre particulier
parmi les différences accidentelles des maladies
en général, à l’égard du lieu où elles régnent.
Les épidémies ne font pas plus familières dans un pays
que dans un autre ; en quoi elles different des endémies
, qui font des maladies d’un même caraftere,
qui affeftent particulièrement & prefque fans difeon-
tinuité les habitans d’une contrée. Foye^ Endémique.
Les maladies épidémiques font auflî diftinguées
des fporadiques, parce que celles-ci font abfolument
particulières aux perfonnes qu’elles attaquent, &
dépendent d’une caufe qui leur eft propre. Fyye^ Sporadique.
Les maladies épidémiques ne s’établiffent que dans
certains tems &dans certains lieux. Elles ne font pas
d’un feul & même genre ; elles different au contraire
beaucoup, félon la différence des fail'ons qui ont
précédé & qui fubfiftent, félon la différente nature
des habitans d’un pays. Quelquefois elles affeftent
tout le corps, comme les fievres ; d’autrefois elles
ne portent que fur certaines parties, comme font les
douleurs, les fluxions catarrheufes : tantôt elles font
bénignes, & font leur cours fans caufer beaucoup
de defordres dans l’économie animale ; tantôt elles
font contagieufes & accompagnées de fymptomes
très-violens, & elles font périr beaucoup de monde.
Il meurt plus de gens, & dans la vigueur de l’âge
même, par l’effet des maladies épidémiques, que par
toute autre forte de maladie. Elles changent prefque
chaque année de cara&ere & de nature, dans les cas
même, où elles pâroiffent avoir les mêmes fymptomes
: il n’appartient qu’à un médecin très-attentif
& grand obfervateur, de diftinguer ce qu’il y a
d’effentiellement différent dans ces apparences; fou-
vent même les plus habiles s’y trompent.
Les différentes caufes des épidémies, qui font dans
Pair, dépendent quelquefois du vice, de fes qualités
fenfibles & manifeftes, telles que la chaleur, le froid,
l’humidité, la féchereffe, &c. D ’autres fois l’air, en
pénétrant le corps humain par les différentes voies
ordinaires, dont on ne peut pas lui fermer l’accès,
y porte avec lui &: applique à diverfes parties certains
miafmes d’une nature inconnue, qui produi-
fent cependant les mêmes effets dans toutes les perfonnes
affeftées, comme on le voit dans la pefte,
dans la petite vérole.La différente fituation des lieux,
le différent afpeéf, l’expofition à certains vents, les
exhalaifons des marais ; les grandes inondations, qui
rendent les terreins marécageux, fuivies d’un tems
chaud, ou d’un vent de midi, qui hâte la putréfaâi'on
des eaux croupiffantes, d’où il s’élève continuellement
dans P air des matières fétides, Vtfrmineufes ou
acrimonieufes, qui infe&ent cet élément dans lequel
nous vivons, & les différentes fubftances qui fervent
à notre nourriture, contribuent beaucoup aufîi
à établir les différentes efpeces d’ épidémies.
Les aîimens, comme caufes communes, font fou-
vent aufîi, par leur nature, la caufe des maladies
populaires. C ’eft ce qu’on obferve dans les villes
afliégées, où les riches comme les pauvres manquant
de tout pour fe nourrir, font contraints à manger
des chofes peu propres à cet ufage & de très-
mauvaife qualité ; & fe trouvant ainfi preffés par la
même neceflité, & réduits à la même mifere, ils
éprouvent les mêmes effets, ils font affligés des mêmes
maladies. On a vû la pefte faire des ravages
terribles dans une place de guerre afliégée, dénuée
de fecours, invertie par une armée abondamment
pourvûe de v ivres, qui étoit entièrement exemte d§
cette maladie.
Il réfulte de ce qui vient d’être dit des caufes des
épidémies, qu’elles ne fe communiquent pas aufîi
communément qu’on le penfe, d’une perfdnne affectée
à une autre qui ne l’ eft pas : il n’eft pas nécef-
faire de recourir à la contagion pour rendre raifon
de cette communication ; il eft rare qu’elle fe faffe
par cette caufe ; il eft plus naturel de l’attribuer à
la caufe commune qui a affetté le premier, & qui
^continue à produire fes effets dans les fujets qui fe
troûvent difpofés à en recevoir les impreflions.
Pour s’en préferver, on doit foigneüfement éviter
tout ce qui peut contribuer à arrêter l’infenfibîe
tranfpiration, & pour cela ne pas fur-tout s’expofer
à l’air froid du matin ou du foir , ne fe livrer a aucun
exercice violent, ne vivre que d’alimens de facile
digeftion", & ufer des chofes propres à fortifier,
à entretenir la fluidité des humeurs, favorifer les
fecrétions & excrétions.
A l’égard des pays en général, on peut tenter
quelquefois avec fuccès d’empêcher qu’ils ne foient
infeftés des maladies épidémiques, ou de les en délivrer
, en purifiant l’air par le moyen des feux allumés
fréquemment, dans les lieux habités, avec des
bois réfineux, dont on forme des bûchers nombreux
à certaines diftances les uns des autres. Hippocrate
ne balance pas à propofer d’après l’expérience qu’il
en avoit faite , l’effet de ces feux comme un préfer-
vatif contre la pefte, & même comme un moyen de
corriger l’infe&ion de l’air qui la caufe. On a remarqué
, félon Hoffman, que les lieux, les villes fur-tout,
où l’on brûle du charbon de pierre plus qu’on në
faifoit autrefois, font moins fujets aux maladies épidémiques
, & plus fains, généralement parlant, qu’ils
n’étoient avant cet ufage;-la fumée de ces matières
fofîiles ayant la propriété de changer les qualités des
mauvaifes exhalaifons qui pouvoient produire des
maladies de toute efpece. 11 eft encore un autre
moyen très-propre à prévenir les infe&ions de l’air,
& à en arrêter les effets, lorfqu’elles ont lieu ; c’eft
de deffécher les marais ; de donner un cours aux
eaux croupiffantes ; d’empêcher qu’il ne s’en ramaffe
de nouvelles ; de tenir les égoûts, les fortes des yil-
les , des campagnes, bien nettoyés & bien libres.
On doit beaucoup efpérer, pendant les maladies
épidémiques, ou lorsqu’on craint qu’elles ne s’établiffent
, du bon effet des vents du feptentrion & du lev
an t , comme étant très-propres à purifier l’air, ou
à empêcher qu’il ne s’y mêle des exhalaifons qui
pourroient le corrompre. Ils ont aufîi la propriété de
rendre le corps humain moins fufceptible des mauvaifes
impreflions qu’elles peuvent faire, en lui donnant
de la vigueur par l’augmentation du reffort de
fes fibres, & en confervant par ce moyen l’exercice
libre de toutes les fondions. Les pluies font aufîi très-
falutaires dans le tems d'épidémie caufée par l’infcc«
tîon de l’air ; elles entraînent & précipitent avec elles
toutes les matières hétérogènes qui formoient la
corruption de cet élément.
Lorfqu’il furvient une maladie épidémique, dont
le carattere n’eft pas bien connu, ce qui arrive fou-
vent ; les médecins doivent, félon le confeil de
Boerhaave, s’appliquer à en bien obferver tous les
fymptomes dans le tems des équinoxes, où elles font
ordinairement le plus en vigueur. Pour en découvrir
la caufe, par comparaifon avec l’efpece de maladie
connue à laquelle l’épidémique reffemble le plus, ils
doivent éviter d’employer des remedes qui foient
propres à produire de grands changemens dans l’économie
animale, dans la crainte qu’ils ne déguifent le
cara&ere de la maladie, & qu’ils n’empêchent d’ob-
ferver les phénomènes que la nature du mal peut
produire conftamment dans les différens tems qui
précèdent le rétabliffement de la fanté ou de la mort,
qui annoncent un meilleur ou un plus mauvais état.
Ils doivent obferver avec une grande attention ce
que la nature fait ou tente de faire dans le cours de
la maladie, enfuite des différentes chofes que les
malades prennent, foit alimens, foit remedes, ce
qui fait de bons ou de mauvais effets, les évacuations
qui font falutaires ou nuifibles. Ils doivent enfin
comparer ce qui fe paffe dans les maladies de la
même éfpece de plufieurs perfonnes affe&ées en même
tems, en ayant égard à la différence de fexe,
d’âge, & de tempérament.
C ’eft de ces recherches faites avec foin, qu’on
peut tirer les indications convenables pour déterminer
la méthode que l’on doit fuivre dans le traitement
des maladies épidémiques. Si l’on avoit un recueil
d’obfervations exaftes fur toutes celles qui ont
paru jufqu’à préfent, on feroit peut-être affez inf-
truit de leur différente nature & des remedes qui
ont été employés avec fuccès dans chaque efpece ,
pour pouvoir par analogie appliquer une curation
prefque fûre à chacune de celles qui pâroîtroient
dans la fuite ; car il eft très-vraiffemblable qu’il ne
s’en établit pas toûjours qui foient abfolument nouvelles
par rapport au parte ; leur variété eft peut-
être épuifée* Il eft donc très-important pour le genre
humain qu’on travaille à fuppiéer à ce qui manque
à cet égard. On ne fauroit affez exhorter tous les
Médecins, qui ont à coeur l’avancement de leur art,
à faire l’hiftoire de toutes les maladies épidémiques
qu’ils ont occalion de traiter ; à les décrire avec
exa&itude & fincérité ; à en bien obferver toutes les
circonftances ; à ne pas négliger de faire mention
des lieux, des climats où ils pratiquent, des accidens
qui ont pû faire naître Vépidémie, de la faifon où elle
régné, de la conftitution de l’air, & de fes variétés
déterminées par l’infpeûion du baromètre, du thermomètre
, & de l’hygrometre, autant que faire fe
peut, & en un mot de prendre pour modèles, dans
ces fortes d’obfervations, celles du plus ancien &
du plus grand médecin connu, du,fage Hippocrate,
qui a le premier fenti la néceflité de les faire, &
qui nous a laiffé fur ce fujet des écrits immortels ;
celles de l’Hippocrate moderne, Sydenham, qui eft
prefque le feul, dans un li long efpace de tems, qui
ait marché à cet égard fur les traces du pere de la
Medecine, & qui a donné un exemple, que l’on doit
fe faire un devoir de fuivre dans tous les fiecles ;
celles de la fociété d’Edimbourg, &c. Fryeç l'article
A ir ,' & ce qui eft dit de cet élément comme caufe
des maladies épidémiques, (d)
* Epidémies , adj. pris fubft. fêtes inftituéesdans
Argos en l’honneur de Junon, & dans les villes de
Milet & de D élos, en l’honneur d’Apollon. Les épidémies
étoient comme les fêtes de la préfence du
dieu. Lespayens croyoient que leurs divinités, fen-
fibles aux cérémonies de révocation, fe tranfportoient
au milieu d’eux ; & ils les honoroient par des
fêtes & des facrifices.
EPIDERME, f. m. & par quelques-uns f. (Anat.)
Cette pellicule fine, tranfparente, &infenfible, qui
recouvre extérieurement toute la peau à laquelle
elle eft étroitement attachée, s’appelle épiderme, fur-
peau , cuticule (voyt[ Cuticule) ; & pour en compléter
l’article, joignez-y du moins les obfervations
fuivantes, dans lefquelles on examine la ftrufture
de cette toile merveilleufe, qui enveloppe tout le
corps humain, excepté les endroits occupés par les
ongles.
Il faut remarquer dans Vépiderme, i^ fq n union
étroite avec la peau, dont on le fépare néanmoins
dans les cadavres par le moyen de l’eau bouillante.
Le feu, la brûlure, les véficatoires, lèvent Yépiderme
en maniéré de veflïes dans les fujets vivans.
Quoiqu’il adhéré fortement aux mammelons cutanés
, & plus encore au corps réticulaire, dont il parait
etre une portion, on peut cependant l’en fépa-
rer avec de l’eau chaude, ou, ce qui eft mieux &:
qui l’altere moins, en le faifant tremper pendant
quelque tems dans de l’eau froide. La féparation par
le fcalpel n’eft pas impoflible, mais elle ne découvre
rien de fa ftruchire.
. 20. Sa régénération. Elle eft évidente, prompte,
& même furprenante, fans aucune marque de cicatrice
, lorfque Yépiderme a été détaché par quelque
caufe externe ou interne. Il fe régénéré au palais de
la bouche, après en avoir été enlevé par les alimens
trop chauds ; il fe régénéré aufîi par-tout ailleurs,
même fous les emplâtres qu’on y applique ; enfin il
fe répare autant de fois qu’il a été détruit.
30. Son origine ou fa formation. Elle eft encore
inconnue. Il ne faut pas s’imaginer, avec les anciens,
que cette membrane foit produite par la condenfa-
tion des vapeurs de la tranfpiration ; il ne faut pas
non plus croire avec Morgagny, que l’aâion de l’air
defféohant la furface de la peau, faffe naître Y épiderme,
car il-fe trouve formé dans le foetus avant qu’il
ait vû le jour. Il vaudroit donc mieux attribuer,
avec Leuwenhoek, l’origine de Y épiderme à l’expan-
fion des conduits excrétoires de la peau ; ou avec
Ruyfch, à l’expanfion des houppes nerveufes du même
organe qui forment plufieurs petites lames eu
s’unifiant ; ou avec Heifter, à l’expanfion des tuyaux
excrétoires , &c des papilles nerveufes réunies ; ou
enfin avec M. Winfl®\7, à une matière qui fuinte des
mammelons.
40. La fubfiance. Elle paroît uniforme du côté de
la peau, & compofée au-dehors de plufieurs petites
lames écailleufes d’une grande fineffe, & très-étroi-
tement unies, mais par-tout fans apparence de tiffu
fibreux ou vafculeux, excepté de petits filamens qui
l’attachent aux mammelons. Cette fubftance eft ferrée
, quoique fufceptible de quelque gonflement ou
épaifliffement, comme la fimple macération dans
l’eau commune, & les cloches ou ampoules qui s’élèvent
fur la peau par des véficatoires, par la brûlure
ou autrement, le font affez voir ; de forte qu’à
cet égard Y épiderme paroît être une efpece de tiffu
fpongieux ; il prête confidérablement dans les enflures
, mais il n’y réfifte pas toûjours.
Les attouchemens durs & réitérés détachent Yépi-
derme plus ou moins imperceptiblement, & aufîï-tôt
il renaît une nouvelle couche qui foûleve la première
, & à laquelle en pareil cas il arrive un pareil
détachement par la naiffance d’une troifieme couche
nouvelle.
C ’eft à-peu-près de cette maniéré que fe forment
les callofités aux piés, aux mains & aux genoux, &
qu’arrive la pluralité des lames ou couches que quelques
anatomiftes ont prifes pour être naturelles.
En effet, les callofités ne font autre chofe que des