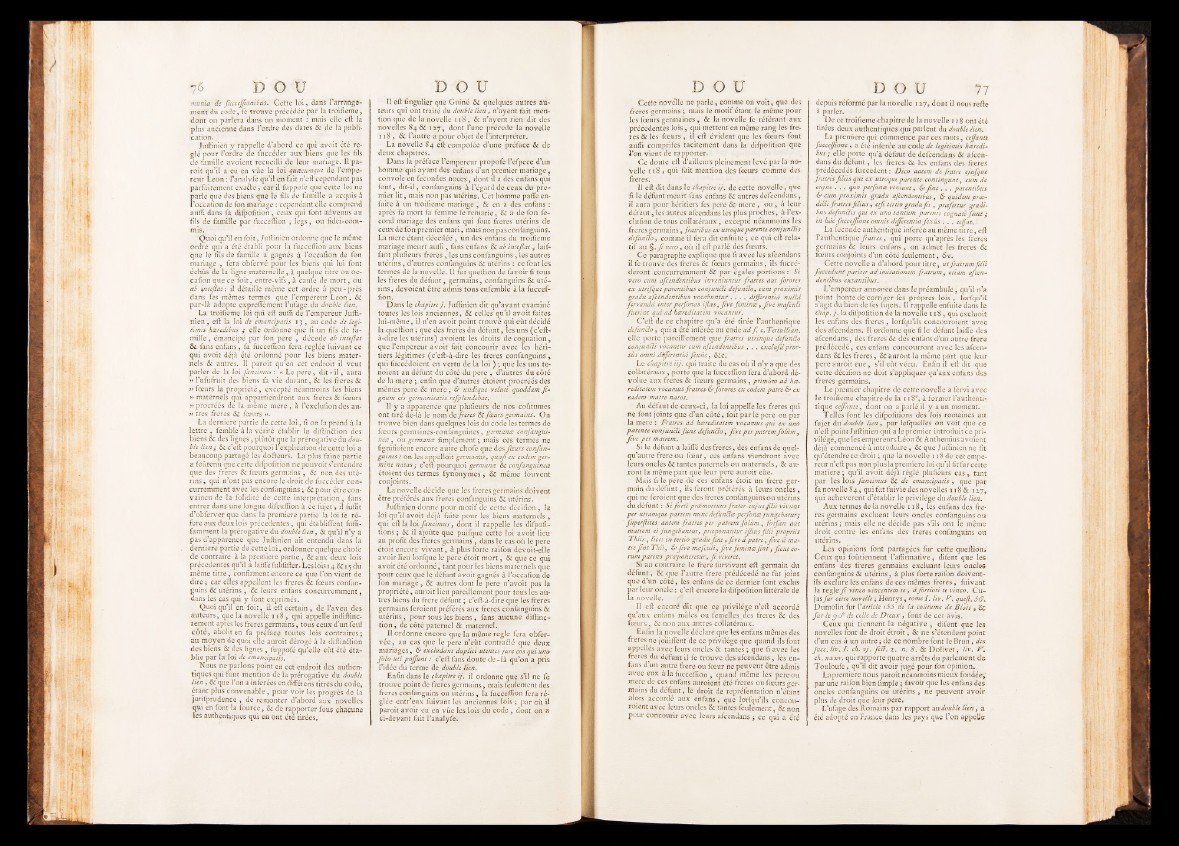
munia cle fucctjfionibns. Cette lo i, dans l ’arrange-
ment du code, le trouve précédée par la troilieme,
dont on parlera dans un moment : mais elle eft la
plus ancienne dans l’ordre des dates & de la publication.
Juftinien y rappelle d’abord ce qui avoit été recelé
pour l’ordre de fuccéder aux biens que les fils
de famille avoient recueilli de leur mariage. Il pa-
roît qu’il a eu en vue la loi quoecumque de l’empereur
Leon : l’analyfe qu’il en fait n’eft cependant pas
parfaitement exafte, car il fuppofe que cette loi ne
parle que des biens que le fils de famille a acquis à
l’occafion de fon mariage : cependant elle comprend
aufli dans fa difpofition, ceux qui font advenus au
fils de famille par fuccefîion , legs, ou fidei-com-
Quoi qu’il en foit, Juftinien ordonne que le même
Ordre qui a été établi pour la fuccefîion aux biens
que le fils de famille a gagnés à i’occafion de fon
mariage , fera obfervé pour les biens qui lui font
échûs de la ligne maternelle, à quelque titre ou oc-
cafionque ce foit, entre-vifs, à caille de mort, ou
ab intejlat: il détaille même cet ordre à peu-près
dans les mêmes termes que l’empereur Leon, ôc
par-là adopte expreflement l’ufage du double lien.
La troifieme loi qui eft aufli de l’empereur Juftinien
, eft la loi de emancipatis 13 , au code de legi-
timis koeredibus ; elle ordonne que fi un fils de famille,
émancipé par fon pere , décédé ab intejlat
ôc fans enfans, fa fuccefîion fera réglée fuivant ce
qui avoit déjà été ordonné pour les biens maternels
& autres. Il patoît qu’en cet endroit il veut
parler de la loi fancimus : « Le pere, dit - i l , aura
» l’ufufruit des biens fa vie durant, ôc les freres &
» foeurs la propriété, excepté néanmoins les biens
» maternels qui appartiendront aux freres & foeurs
» procréés de la même mere, à l’exclufion des au-
» très freres ÔC foeurs ».
La derniere partie de cette lo i, fi on la prend à la
lettre , femble à la vérité établir la diftinftion des
biens ôc des lignes, plûtôt que la prérogative du double
lien; Ôc c’eft pourquoi l’explication de cette loi a
beaucoup partagé les do&eurs. La plus faine partie
a foûtenu que cette difpofition ne pouvoit s’entendre
que des freres ôc foeurs germains , ôc non des utérins
, qui n’ont pas encore le droit de fuccéder concurremment
avec les confanguins ; ôc pour être convaincu
de la folidité de cette interprétation, fans
entrer dans une longue difeuflion à ce fujet, il fufîit
d’obferver que dans la première partie la loi fe référé
aux deux lois précédentes, qui établiflent fuffi-
famment la prérogative du double lien, ôc qu’il n’y a
pas d’apparence que Juftinien ait entendu dans la
derniere partie de cette lo i, ordonner quelque chofe
de contraire à la première partie , ôc aux deux lois
précédentes qu’il a laifle fubfifter. Les lois 14 ôci 5 du
même titre, confirment encore ce que l’on vient de.
dire ; car elles appellent les freres ôc foeurs confanguins
ôc utérins , ôc leurs enfans concurremment,
dans les cas qui y font exprimés.
Quoi qu’il en foit, il eft certain, de l’aveu des
auteurs, que la novelle 1 18 , qui appelle indiftinc-
tement après les freres germains, tous ceux d’un feul
côte, abolit en fa préface toutes lois contraires;
au moyen de quoi elle auroit dérogé à la diftin&ion
des biens & des lignes, fuppofé qu’elle eût été établie
par la loi de emancipatis.
Nous ne parlons point en cet endroit des authentiques
qui font mention de la prérogative du double
lien, ôc que l’on a inférées en différens titres du code,
étant plus convenable, pour voir les progrès de la
jurifprudence , de renjonter d’abord aux novelles
qui en font la fource, ôc de rapporter fous chacune
les authentiques qui en ont été tirées.
Il eft fingulier que Guiné ôc quelques autres auteurs
qui ont traité du double lien, n’ayent fait mention
que de la novelle 118 , St n’ayent rien dit des
novelles 84 ôc 127, dont l’une précédé la novelle
118 , ôc l’autre a pour objet de l’interpréter.
La novelle 84 eft compofée d’une préface ôc de
deux chapitres.
Dans la préface l’empereur propofe I’efpece d’un
homme qui ayant des enfans d’un premier mariage ,
convole en fécondés noces, dont il a des enfans qui
font, dit-il, confanguins à l’égard de ceux du premier
lit , mais non pas utérins. Cet homme pafle en-
fuite à un troifieme mariage , ôc en a des enfans :
après fa mort fa femme fe remarie, ôc a de fon fécond
mariage des enfans qui font freres utérins de
ceux de fon premier mari, mais non pas confanguins.
La mere étant déçedée , un des enfans du troifieme
mariage meurt aufli, fans enfans ôc ab intejlat ÿ laif-
fant plufieurs freres, les uns confanguins, les autres
utérins , d’autres confanguins ôc utérins : ce font les
termes de la novelle. Il fut queftion de favoir fi tous
les freres du défunt, germains, confanguins ôc utérins
, dévoient être admis tous enfemble à la fuccef-
fion.
Dans le chapitre j . Juftinien dit qu’ayant examiné
toutes les lois anciennes, ôc celles qu’il avoit faites
lui-même, il n’en avoit point trouvé qui eût décidé
la queftion ; que des freres du défunt, les uns (c’eft-
à-dire les utérins) avoient les droits de cognation ,
que l’empereur avoit fait concourir avec les héritiers
légitimes (c’eft-à-dire les freres confanguins
qui fuccédoient en vertu de la loi ) ; que les uns te-
noient au défunt du côté du pere , d’autres du côté
de la mere ; enfin que d’autres étoient procréés des
mèmès pere ôc mere, & undique veluti quoddam Ji-
gnum eis germanitads refplendebat.
Il y a apparence que plufieurs de nos coûtumes
ont tiré de-là le nom de freres ÔC foeurs germains. On
trouve bien dans quelques lois du code les termes de
foeurs germaines-confanguines, germante conjangui-
nece, ou germante Amplement ; mais ces termes ne
fignifioient encore autre chofe que des foeurs confan-
guines : on les appelloit germaniis, quajî ex codent ger-
mine natas ; c’eft pourquoi germante ÔC confanguinete
étoient des termes fynonymes , ôc même fouvent
conjoints.
La novelle décide que les freres germains doivent
être préférés aux freres confanguins ôc utérins.
Juftinien donne pour motif de cette décifion , la
loi qu’il avoit déjà faite pour les biens maternels ,
qui eft la loi fancimus, dont il rappelle les difpofi-
tions ; ôc il ajoûte que puifque cette loi avoit lieu
au profit des freres germains , dans le cas oii le pere
étoit encore vivant, à plus forte raifon devoit-elle
avoir lieu lorfque le pere étoit mort, ôc que ce qui
avoit été ordonné, tant pour les biens maternels que
pour ceux que le défunt avoit gagnés à l’occafion de
fon mariage, ôc autres dont le pere n’avoit pas la
propriété, auroit lieu pareillement pour tous les autres
biens du frere défunt ; c’eft-à-dire que les freres
germains feroient préférés aux freres confanguins &
utérins, pour tous les biens , fans, aucune diftinc-
tion, de côté paternel & maternel.
Il ordonne encore que la même réglé fera obfer-
v é e , au cas que le pere n’eût contraélé que deux
mariages, & excludant duplici utentes jure eos qui un»
folo uti poffunt : c’eft fans doute de-là qu’on a pris
l’idée du terme de double lien.
Enfin dans le chapitre ij. il ordonne que s’il ne fe
trouve point de freres germains, mais feulement des
freres confanguins ou utérins, la fuccefîion fera réglée
entr’èux fuivant les anciennes lois ; par où il
paroît avoir eu en vûe les lois du code, dont on a
ci-deyant fait l’analyfe.
Cette novelle ne parle, côfiime on voit, que des
freres germains ; mais le motif étant le même pour
les foeurs germaines , & la novelle fe référant aux
précédentes lois, qui mettent en même rang les freres
& les foeurs , il eft évident que les foeurs font
aufli comprifes tacitement dans la difpofition que
l’on vient de rapporter»
Ce doute eft d’ailleurs pleinement levé par la novelle
1 18 , qui fait mention de$ foeurs comme des
freres.
II eft dit dans le chapitre ij. de cette novelle, que
fi le défunt meurt fans enfans ôc autres defeendans,
il aura pour héritiers fes pere ôc mere o u , à leur
défaut, les autres afeendans les plus proches, à l’exclufion
de tous collatéraux, excepté néanmoins les
freres germains, fratribus ex utroqueparente corijuncHs
defunao, comme il fera dit enfuite ; ce qui eil relatif
au §,.Jî v.ero , où il eft parlé des foeurs;
Ce paragraphe explique que fi avec les afeendans
il fe trouve des freres ôc foeurs germains, ils fuccé-
deront concurremment ôc par égales portions : Si
vero cum afeendentibus inveniuntur fratres aut forores
ex utrifque parentibus conjuncli defunclo, cum proximis
gradu afeendentibus vocabuntur . . . . dijferentiâ nullâ
Jervandâ inter perfonas ijlas,jive femince , Jive mafeuli
fuerint qui ad htereditatem vôcantur.
C ’eft de ce chapitre qu’a été tirée l’authentique
defunclo, qui a été inférée au code ad f . c.Tertullian.
elle porte pareillement que fratres utrinque defunclo
conjuncli vôcantur cum afeendentibus , . . exclufâpror-
sus omni d'efferendâ fexûs, ôcc.
Le chapitre iij. qui traite du cas où il n’y a que des
collatéraux, porte que la fuccefîion fera d’abord dévolue
aux freres ôc foeurs germains, primiim ad hte-
reditatem vocamus fratres & forores ex eodem pâtre & ex
eadem matre tiatos.
Au défaut de ceux-ci, la loi appelle les freres qui
île font joints que d’un côté, foit par le pere ou par
la mere : Fratres ad htereditatem vocamus qui ex uno
parente conjuncli funt defunclo , Jive per patrem folùm ,
Jive per matrem.
Si le défunt a laifle des freres, des enfans de quel-
qu’autre frere ou foeur, ces enfans viendront avec
leurs oncles ôc tantes paternels ou maternels, & auront
la même part que leur pere auroit eûe.
Mais fi le pere de ces enfans étoit un frere germain
du défunt, ils feront préférés à leurs oncles,
qui ne feroient que des freres confanguins ou utérins
du défunt : Si forte prcemortuus f rater cujusJHïi vivant
per utramque partem nunc defunclce per fonce jungebatur;
fuperfiites auteni fratres per patrem fôliim, forfan aut
matrem ei jungebantur, preeponantur ijlius filii propriis
Tkiis, licet in tertio gradu fini tfive à pâtre ,Jive à ma-
.nfint Thii, &fivc mafeuli, fivcfiminccfine, ficmco-
rum parens prteponeretur, Ji vivent.
Si au contraire le frere furvivant eft germain du
défunt, ôc que l’autre frere prédécedé ne fût joint
que d’un côté, les enfans de ce dernier font exclus
par leur oncle : c’eft encore la difpofition littérale de
la novelle.
Il eft encoré dit que ce privilège n’eft accordé
qu’aux enfans mâles ou femelles ,des freres ôc des
iceurs, ôc non aux autres cdllàtéraux.
Enfin la novelle déclare que les enfans mêmes des
freres ne joiiiflent de ce privilège que quand ils font
appelles avec leurs oncles ôc tantes ; que fi avec les
freres du défunt il fe trouve des afeendans, les enfans
d un autre frere ou foeur ne peuvent être admis
avec eux à la fuccefîion , quand même les pere ou
mere de ces enfans auroient été freres ou foeurs germains
du défunt, le droit de repréfentation n’étant
alors accorde aux enfans, que lorfqu’ils concou-
roient avec leurs oncles ôc tantes feulement, ôc non
pour concourir avec leurs afeendans ; ce qui a été
depuis réformé par la novelle 117, dont il nous refte
à parler.
De ce troifieme chapitre de la novelle 1 18 ont été
tirées deux authentiques qui parlent du double lien.
La première qui commence par ces mots, cejjantt
fuccejjione, a été inferée au code de legitimis hteredi-
bus ; elle- porte qu’à défaut de defeendans & afeendans
du défunt, les freres ôc les enfans des freres
predecedes fuccedent : Dico autan de fratre ejufque
fratris filiis qui ex utroque parente contingunt, eum de
cujus , . , quo perfonce veniunt, & Jine. . . parentibus
& cum proximis gradu afeendentibus, <S* quidem proe-
dicli fratris filius , etji tertio gradu f i t , preefertur gradi-
bus defunclis qui ex uno tantum parente cognati funt ;
in hâc fuccejjione omnis dijferentiâ fexûs . . . cejjat.
La fécondé authentique inferée au même titre, eft
l’authentique fratres, qui porte qu’après les freres
germains ôc leurs enfans , on admet les freres ôc
foeurs conjoints d’un côté feulement, &c.
Cette novelle a d’abord pour titre, ut fratrumfilii
fuccedünt pariter ad imitationetn fratrum, etiarn afeendentibus
extantibus.
L’empereur annonce dans le préambule, qu’il n’a
point honte de corriger fes propres lois , lorfqu’il
s’agit du bien de fes fujets. Il rappelle enfuite dans le
chap.j. la difpofition de la novelle 118 , qui excluoit
les enfans des freres, lorfqu’ils concouroient avec
des afeendans. Il ordonne que fi le défunt laifle des
afeendans, des freres ôc des enfans d’un autre frere
predécedé, ces enfans concourront avec les afeendans
ôc les freres, ôc auront la même part que leur
pere auroit eue, s’il eût vécu. Enfin il eft dit que
cette décifion ne doit s’appliquer qu’aux enfans des
freres germains.
Le premier chapitre de cette novelle a fervi avec
le troifieme chapitre de la 1 18e, à former l’authenti-
tique cejfante, dont on a parlé il y a un moment.
Telles font les difpofitions des lois romaines au
fujet du double lien, par lefquelles on voit que ce
n’eft point Juftinien qui a le premier introduit ce privilège,
que les empereurs Léon ôc Anthemius avoient
déjà commencé à introduire , ÔC que Juftinien ne fit
qu’étendre ce droit ; que la novelle 118 de cet empereur
n’eft pas non plus la première loi qu’il fit fur cette
matière ; qu’il avoit déjà réglé plufieurs cas > tant
par les lois fancimus ôc de emancipatis, que par
fa novelle 84, qui fut fuivie des novelles 118 & 127,
qui achevèrent d’établir le privilège du double lien.
Aux termes de la novelle 1 18 , les enfarts des freres
germains excluent leurs oncles confanguins ou
utérins ; mais elle ne décide pas s’ils ont le même
droit contre les enfans des freres confanguins ou
utérins.
Les opinions font partagées fur cette queftion.'
Ceux qui foûtiennent l’affirmative, difent que les
enfans des freres germains excluant leurs oncles
confanguins & utérins, à plus forte raifon doivent-
ils exclure les enfans de ces mêmes freres , fuivant
la réglé J i vinco vincentem te , à fortiori te vinco.- Cujas
fur cette novelle ; Henrys, tome I. liv. V. quefi. £(y.
Dumolin fur l’article <55 de la coutume de Blois, ÔC
fur le c)oe de celle de Dreux, font de cet avis.
Ceux qui tiennent la négative , difent que les
novelles font de droit étroit, 8t ne s’étendent point
d’un cas à un autre ; de ce nombre font le Brun, des
fucc. liv. I. ch. vj. fiel. z . n. 8. ôc Dolivet, liv. V.
ch. xxxv. qui rapporte quatre arrêts du parlement de
Touloufe, qu’il dit avoir jugé pour fon opinion.
L a prem ière n o u s p a ro ît néanm oins m ieu x fondée^
p a r une raifo n b ie n fim ple ; fav oir qu e les enfans des
oncles co nfanguins ou utérins , n e p e u v e n t a v o ir
plus de d ro it que leu r pere.
L’ufage des Romains par rapport au double lien, a
été adopté en France dans les pays que l’on appelle