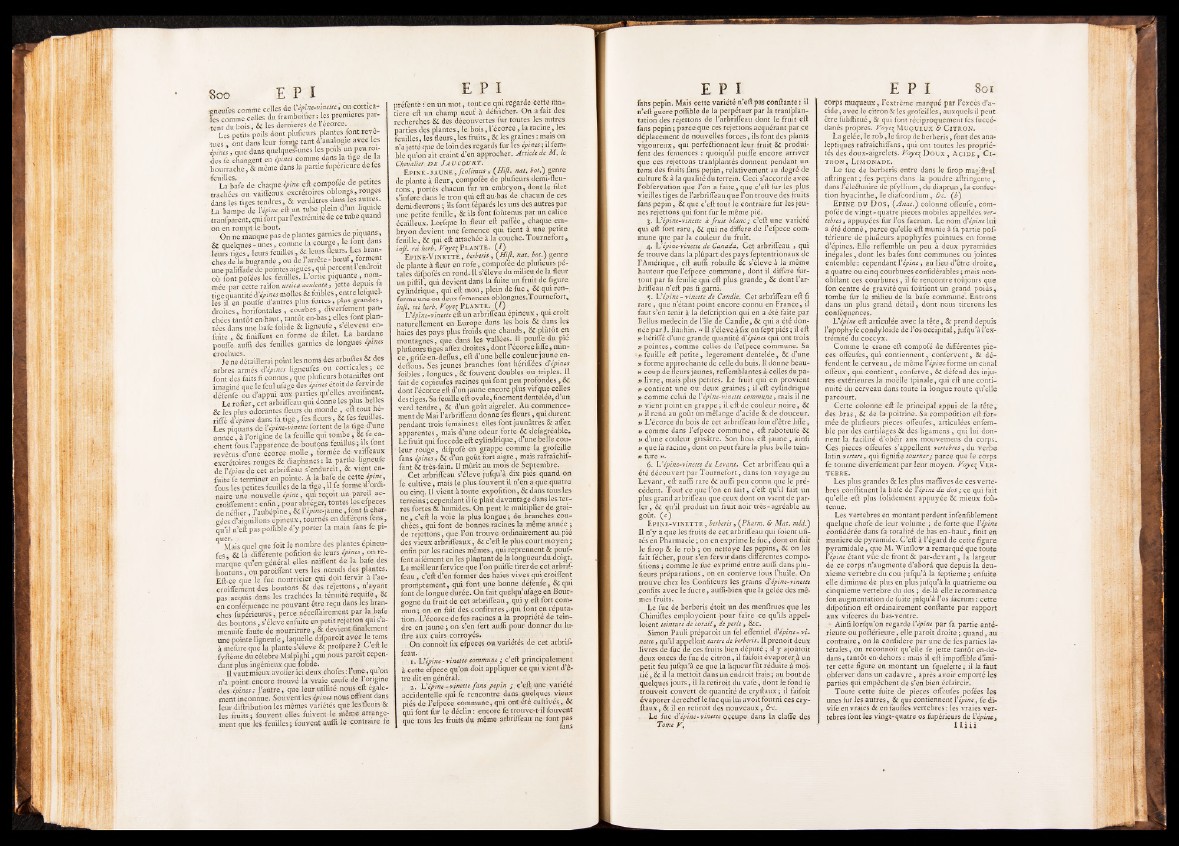
J Ê È S È coifliiie celles de l'épine-vinette, ou cortica-
g § comme celles du framboifier : les premières par-
-tent du bois Les petits ,p &oil sle ds odnetr npilèurleiesu crlse lp’elacnotrecse ,f onIt revenues
ont dans leur forme tant d’analogie avec les
-épines, que dans quelqueSunes les poils un peu roi-
des fe changent en épines comme dans la tige de la
bourrache, & même dans la partie lupèneure de les
La baie de chaque épine eft contpofée de petites
trachées ou vaiffeaux'excrétoires oblongs, rouges
dans les tiges tendres , & verdâtres dans .les autres.
La hampe de l’ épine eft un tube plein d un liquide
tranfparent, qui fort par l’extrémite de ce tube quand
on en rompt le bout. . , .
On ne manque pas de plantes garnies cie piquans >
& quelques - unes . comme la courge, le font dans
leurs tiges, leurs feuilles,, 8c leurs fleurs. Les branches
de la bugrande , ou .de l’arrête - boeuf . forment
une paliffade de pointes aiguës, qui percent 1 endroit
oit font pofées les feuilles. L’ortie piquante, nom-
mée par cette raifon urtica aculeata, jette depuis la
ti^e quantité à.’épines molles & foibles, entre lefquel-
les il en pouffe d’autres plus fortes, plus grandes,
droites horifontales , courbes , diverfement.pan-
chées tantôt en-haut, tantôt en-bas; elles font plantées
dans une bafefolide & ligneufe,: s’élèvent enfuite
, 8c fmiffent en forme de ftilet. La bardane
pouife aufli dés feuilles garnies de longues epines
crochues. : , . _ „ ,
. Je ne détaillerai point les noms des arbuftes & des
arbres armés d * épines ligneufes ou corticales ; ce
font des faits fi connus, que plulieurs botamftes ont
imaginé que le feul ufage des épines qtoit de feryir de
défenfe ou d’appui aux parties qu elles avoifinent.
Le rolier, cet arbriffeau qui donne les plus belles
& les plus odorantes fleurs du monde , eft tout he-
riffé d’épines dans fa tige, fes fleurs, & fes feuilles.
Les piquans de Y épine-vinette fortent delà tige d une
année, à l’origine de la feuille qui tombe, Sf fe cachent
fous l’apparence.de boutons feuillus;.11$ font
revêtus d’une écorce molle, formée de vaiffeaux
excrétoires rouges & diaphanes: la partie ligneufe
de Vépine de cet arbriffeau s’endurcit, & viejit en-
fuite fe terminer en pointe. A la bafe de ce\te eptne,
fous les petites feuilles de la tige, il fe forme;d. ordinaire
une nouvelle épine, qui reçoit un .pareil ac-
croiffement : enfin, pour abréger, toutes l,es elpeces
de néflier, l’aubépine, & l’e>me-jaune, font fi chargées
d’aiguillons epineux, tournés en differens fens,
qu’il n’eft pas poflible d’y porter la main fans fe pi-
^ Mais quel que foit le nombre des plantes epineu-
fes & la différente pofitiori de leurs épine s, on remarque
qii’en général elles naiffent de la bafe des
boutons, ou paroiffent vers les noeuds des plantes.
Eft-ce que le fuc nourricier qui doit fervir à 1 ac-
croiffementdes boutons & des rejetions, nayant
pas acquis dans les trachées la ténuité requife , &
en conféquence ne pouvant être reçu dans les branches
fupërieures, perce néeeffairement par la baie
des boutons, s’élève enfiîite en petit rejetton qui s a-
menuife faute de nourriture , & de.vient finalement
une pointe ligneufe, laquelle difparoît avec le tems
à mefure que la plante.s’élève & profpere C eft le
fyftème du célébré Malpighi, qui .nous paroit cependant
plus ingénieux que lofide. '
Il vaut mieux avouer ici deux chofes : l’une, qu: on
n’a point, encore trouvé la vraie caufe de l’origine
des : épines : l’autre, que leur utilité nous eft également
inconnue. Souvent les épines^ nous offrent dans
leur diftribution les mêmes variétés que les fleurs*&
les fruits ; 'fouvent elles fiiivent le même .arrangement
que les feuilles.;' fouvent aufli le contraire fe
préfentè en un mot, tout ce qui regarde cette matière
eft uo champ neuf à défricher. On a fait des
recherches 8c des découvertes fur toutes les autres
parties des plantes, le. bois, l ’écorce, la racine, les
feuilles, les fleurs, les fruits, 8c les graines.: mais on
n’a jetté que de loin des regards fur les épines ; il fem-
ble qu’on ait craint d’en approcher. Article de M. le
CheEvalier.POE Ja U cou RT. pine - J aune , ß tolimut, {Hiß. tint. éol.). genre
de plante à fleur, compofée de plufieurs,demi-fleurons,
portés chacun fur un embryon, dont.le filet
s’infere dans le trou qui eft au-bas de chacun de ces
demi-fleurons ; ils font fepares les uns des autres par
une petite feuille, 8c ils font foutenus par un calice
écailleux. Lorfque la fleur eft paffée, chaque embryon
devient une femence qui tient à une petite
feuille, 8c qui eft attachée à la couche. Tournefort,
in f t . rciherb. Vpyei PLANTE. (/) Epine-Vinette, berberis, {Hiß. nat. bot.) genre
de plante à fleur en rofe, compofée de plufieurs pétales
difpofés en rond. 11 s’élev.e du milieu, de la fleur
un piftil, qui devient dans la fuite un fruit de figure
cylindrique, qui eft mou, plein de fu c , 8c qui.ren-,
ferme une ou deux femences oblongues.Tournefort,
inß..r(iherb, Plante. „(/). . ,
L’épine-vinette eft un arbriffeau épineux , qui croit
naturellement eu Europe dans les bois 8c dans les
haies des pays plus froids que chauds, 8c plutôt en
montagnes, que dans les vallees. Il pouffe du pie
plufieurs tiges allez droites, dont l’éeorce lifte, minc
e , grife en-deffus, eft d’une belle couleur jaune en-
deffous. Ses jeunes branches font hériffées 4’épines
foibles ..longues, 8c fouvent doubles ou triples. IL
fait-de' cbpieufes racines qui font peu profondes, 8c
dont l’écorce eft d’un jaune encore plus v if que celles
des tiges. Sa feuille eft ovale, finement dentelée, d’un
verd tendre, 8c d’un goût aigrelet. Au commencement
de Mai l’arbriffeau donne fes fleurs, qui durent
pendant trois femaines,: elles font jaunâtres 8c affez
apparentes, mais d’une odeur forte 8c clefagreable.
Le fruit qui fuccede eft cylindrique, d’une belle cou-
■ leur.rouge, difpofé en grappe comme la grojeille
fans épines, 8c d’un goût fort aigre, mais rafraîchi!—
fant 8c très-fain: Il mûrit au mois de Septembre.
Cet arbriffeau s’éleye’ jufqu’à dix piés- quand on
le cultive, mais le plus fouvent il n’en a que quatre
ou cinq. Il vient à toute expofition, 8c dans tous les
terreins ; cependant il fe plaît davantage dans les, terres
fortes 8t humides. On peut le multiplier de grain
e , c’eft la voie la plus longue ; de branches couchées
, qui font de bonnes racines la même annee ;
de rejetions, que Bon trouve ordinairement au. pié
des vieux arbriffeaux, 8c c’eft le plus court moyen ;
enfin par les racines mêmes, qui reprennent 8c pouffent
aifément en les plantant de la longueur du doigt.
Le meilleur fervice que l’on puiffe tirer de. cet arbriffeau
, ç’eft d’en former des haies vives qui çroiffent
promptement, qui font une bonne défenfe, 8cqui
font- de longue durée- On fait quplqu’uijiee en Bourgogne
du fruit de cet arbriffeau, qui y eft fort commun
; on en fait des. confitures ,-.qui (ont en réputation.
L’éçorce de fes racines, a la propriété.de teindre
en jaune ; on- sien fert aufli pour donner du lu-
ftre aux çuirs corroyés, : ■ g;, '. : , . ,.
On connoît fix efpeççs ou.yatiétés de cet arbrif-
feau.i'b'î , pS'pK :a>Bfov_id ipv-g zêrfoif
• i. L’épine-vinette commune ; c eft principalement
à cette efpece qu’on-doit .appliquer ce qui vient d’ê-
treidit en général.;, , : .. -. ,
, a. \dcpint-vinettt fans pépin ,- c’eft, une variété
accidentelle: qui.fe rencontre dans cpelques vieux
piés de l’efpece commune, qui ont été cultivés,, 8c
qui font fur le déclin : encore fe tro u v e ra fouvept
que tous les fruits du même arbriffeau ne font pas
’ fans
fans pépin. Mais cette variété n’eft pas confiante : il
n’eft guere poflible de la perpétuer par la tranfplan-
tation des rejettons de l’arbriffeau dont le fruit eft
fans pépin ; parce que ces rejettons acquérant par ce
déplacement de nouvelles forces, ils font des plants
vigoureux, qui perfe&ionnent leur fruit & produi-
fent des femences : quoiqu’il puiffe encore arriver
que ces rejettons tranfplantés donnent pendant un
tems des fruits fans pépin, relativement au degré de
culture & à la qualité du terrein. C eci s’accorde avec
l’obfervation que l’on a faite,, que c’eft fur les plus
vieilles tiges de l’arbriffeau que l’on trouve des fruits
fans pépin, & que c’eft tout le contraire fur les jeunes
rejettons qui font fur le même pié.
j . L'épine-vinette à fruit blanc; c’eft une variété
qui eft fort rare, & qui ne diffère de l’efpece commune
que par la couleur du fruit.
4. L ’épine-vinette de Canada. Cet arbriffeau , qui
fe trouve dans la plupart des pays feptentrionaux de
l’Amérique, eft aufli robufte & s’élève à la même
hauteur que l’efpece commune, dont il différé fur-
tout par fa feuille qui eft plus grande, & dont l’ar-
briffeau n’eft pas fi garnii
5. U épine-vinette de Candie. Cet arbriffeau eft fi
rare, que n’étant point encore connu en France, il
faut s’en tenir à la defeription qui en a été faite par
Bellus médecin de l’île de Candie, & qui a été donnée
par J. Bauhin. « Il s’élève à fix ou fept piés ; il eft
» hériffé d’une grande quantité d’épines qui ont trois
» pointes, comme celles de l’efpece commune. Sa
«»feuille eft petite, legerement dentelée, & d’une
» forme approchante de celle du buis. Il donne beau-
» coup de fleurs jaunes, reffemblantes à celles du pa-
» livre, mais plus petites. Le fruit qui en provient
» contient une oirdeux graines; il eft cylindrique
» comme celui de Y épine-vinette commune, mais il ne
» vient point en grappe ; il eft de couleur noire, &
» il rend au goût ûn mélange d’acide & de douceur.
» L’écorce du bois de cet arbriffeau loin d’être liffe,
»» comme dans l’efpece commune, eft raboteulè &
» d’une couleur grisâtre. Son bois eft jaune, ainfi
» que fa racine, dont on peut faire la plus belle tein-
» ture ».
6. L 'épine-vinette du Levant. Cet arbriffeau qui a
été découvert par Tournefort, dans fon voyage au
Levant, eft aufli rare & aufli peu connu que le précédent.
Tout ce que l’on en fait, c’eft qu’il fait un
plus grand arbriffeau que ceux dont on vient de parle
r , & qu’il produit un fruit noir très-agréable au
goût, (c ) Epine-vinette , berberis, (Pharm. & Mat. méd.')
Il n’y a que les fruits de cet arbrifleau qui foient uli-
tés en Pharmacie ; on en exprime le fuc, dont on fait
le firop & le rob ; on nettoye les pépins, & on les
fait fécher, pour s’en fervir dans différentes compo-
iitions ; comme le fuc exprimé entre aufli dans plu-
fieurs préparations, on en conferve fous l’huile. On
trouve chez les Confileurs les grains $ épine-vinette
.confits avec le fucre, aufll-bien que la gelée des mê-
.mes fruits.
Le fuc de berberis étoit lin des menftrues que les
Chimiftes employoient pour faire ce qu’ils appela
ien t teinture de corail, de perle, &c.
Simon Pauli préparoit un fel effentiel d’épine-vinette
, qu’il appelloit tartre de berberis. Il prenoit deux
livres de fuc de ces fruits bien dépuré ;,il y ajoutoit
.deux onces de fuc de citron, il faifoit évaporer à un
petit feu jufqu’à ce que la liqueur fût réduite à moitié
, & il la mettoiit dans un endroit frais ; au bout de
quelques jours, il la retiroit du vafe, dont le fond fe
trouvoit couvert de quantité de cryftaux ; il faifoit
évaporer derechef le fuc qui lui avoit fourni ces cryftaux
, & il en retiroit des nouveaux, &c.
Le fuc d'épine-vinette occupe dans la dalle des
Tome V.
corps muqueux, l’extrême marqué par l’excès d’acide
, avec le citron & les grofeiiles, auxquels il peut
être fubftitué, & qui font réciproquement fes fuccé-
danés propres. Voye^ Muqueux & Citron.
La gelée, le rob, le firop de berberis, font des analeptiques
ratraîchiffans, qui ont toutes les propriétés
des doux-aigrelets. Foye^ D o u x , Acide , C itron,
Limonade.
Le lue de berberis entre dans le firop magiftral
aftringent ; fes pépins dans la poudre aftringente ,
dans l’éleôuaire de pfyllium, de diaprun, la confection
hyacinthe, le diafeordium, &c. ( f) Epine du D os, (Anat.) colonne oflèufe, compofée
de vingt-quatre pièces mobiles appellées vertèbres
, appuyées fur l’os facrum. Le nom d’épine lui
a été donné, parce qu’elle eft munie à fa partie pof-
térieure de plufieurs apophyfes pointues en forme
d’épines. Elle reffemble un peu à deux pyramides
inégales, dont les bafes font communes ou jointes
enfemble : cependant Y épine, au lieu d’être droite,
a quatre ou cinq courbures confidérables ; mais non-
obftant ces courbures, il fe rencontre toûjours que
fon centre de gravité qui foûtient un. grand poids ,
tombe fur le milieu de la bafe commune’. Entrons
dans un plus grand détail, dont nous tirerons les
conféquences.
U épine eft articulée avec la tête, & prend depuis
l’apophyfe condyloïde de l’os occipital, jufqu’à l’ex-
tremité du coccyx.
Comme le crâne eft compofé de différentes pièces
offeufes, qui contiennent, confervent, & défendent
le cerveau, de même Y épine forme un canal
offeux, qui contient, conferve, & défend des injures
extérieures la moelle fpinale, qui eft une continuité
du cerveau dans toute la longue route qu’elle
parcourt.
Cette colonne eft le principal appui de la tête,'
des bras, &.de la- poitrine. Sa compofition eft formée
de plufieurs pièces offeufes, articulées enfemble
par des cartilages & des ligamens , qui lui donnent
la facilité. d’obéir aux mouvemens du corps.
Ces pièces offeufes s’appellent vertebres, du verbe
latin vertere, qui lignifie tourner j parce que le corps
fe tourne diverfement par leur moyen. Voyeç Vertèbre.
Les plus grandes & les plus mafîives de ces vertebres
conftituent la bafe de Y épine du dos ; ce qui fait
qu’elle eft plus folidement appuyée & mieux foû-
tenue.
Les vertebres en montant perdent infenfiblement
quelque chofe de leur volume ; de forte que Yépine
confédérée dans fa totalité de bas en-haut, finit en
maniéré de pyramide. C ’eft à l’égard de cette figure
pyramidale, que M. Winflow a remarqué que toute
Yépine étant vûe de front & par-devant, la largeur
de ce corps n’augmente d’abord que depuis la deuxieme
vertebre du cou jufqu’à la feptieme ; enfuite
elle diminue de plus en plus jufqu’à la quatrième ou
cinquième vertebre du dos ; de-là elle recommence
fon augmentation de fuite jnfqu’à l’os facrum : cette
difppfition eft ordinairement confiante par rapport
aux vifeeres du bas-ventre.
• Ainfi lorfqu’on regarde Yépine par fa partie antérieure
ou poftérieure, elle paroît droite ; quand, au
contraire, on la confédéré par une de fes parties latérales
, on reconnoît qu’elle fe jette tantôt en-dedans
, tantôt en-dehors : mais il eft impofiible d’imiter
cette figure en montant Un fqueletre ; il la faut
obferver dans un cadavre, après avoir emporté les
parties qui empêchent de s’en bien éclaircir.
Toute cette fuite de pièces offeufes pofées les
unes fur les autres, & qui contiennent Yépine, fe di-
vife en vraies & en fauflès vertebres : les vraies vertebres
font les vingt-quatre os fupérieurs de Yépine j
I l i i i