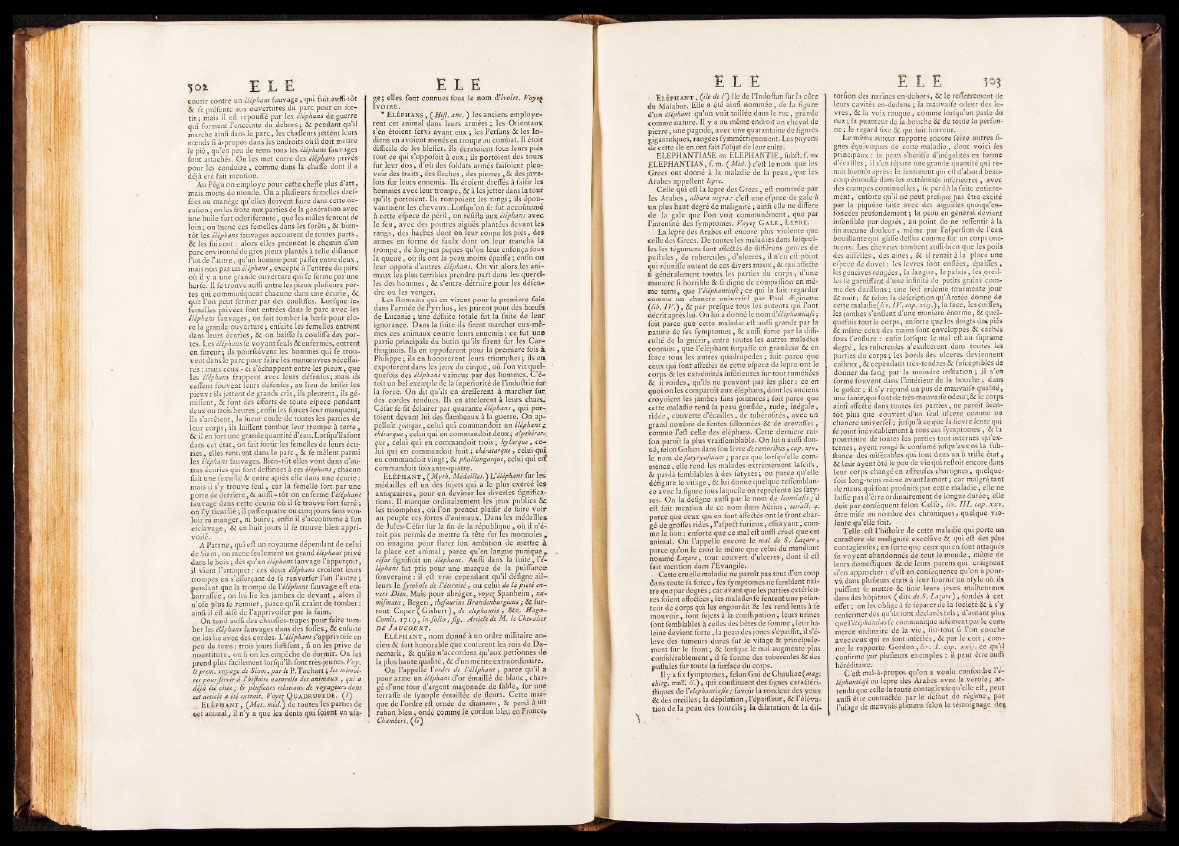
cotirir contre un éléphant fiiuvage, qui -fuit auffi-tot ■
& fe préfente aux ouvertures du parc pour en for-
tir; mais il eft reppufle par les éléphans de guerre
qui forment l’enceinte du dehors ; &c pendant qu’il
marche ainfi dans le parc , les chaffeurs jettent leurs
noeuds fi à-propos dans lesèndroits où il doit, mettre
le pie, qu’en peu detemstous les éléphans fauvages
font attachés. Onles met entre des éléphdns privés
pour les conduire , comme-dans l'a chafle: dont il a
déjà été fait mention.
Au Pégu on employé pour cette chafle plus d’art,
friais, moins de monde. On a plufieurs femelles dref-
fées au manège qu’ elles doivent faire dans cette ôc-
cafion; on les ff ote aux parties de la génération avec
une huile fort odoriférante, que les mâles fentent de
loin; on'înene ces femelles dans, les forets, & bientôt
les éléphans fauvages accourent de toutes parts,
& les fuivent : alors elles prennent le chemin d’un
parc environné de gros pieux plantés à telle diftance
l ’un de l’autre, qu’un homme peut paffer entre deux,
mais non pas un éléphant, excepté à l’entrée du parç
pii il y a une grande ouverture qui fe ferme par une
herfe. Il fe trouve aufîi entre les pieux plufieurs portes
qui communiquent chacune dans une écurie, &
que Pon peut fermer par des couliffes. Lorfque les
femelles privées font entrées dans le parc avec les
éléphans fauvages, on fait tomber la herfe pour clore
la grande ouverture; enfuite les femelles entrent
dans leurs écuries, &c on baille la couliffe des portes.
Les éléphans fe voyant feuls & enfermés, entrent
en fureur ; ils pourfuivent les hommes qui fe trouvent
dafis le parc pour faire les manoeuvres néceffai-
res : mais ceux - ci s’échappent entre les pieux, que
les éléphans frappent avec leurs défenfes ; mais ils
caffent fouvent leurs défenfes, au lieu de brifer les
pieux : ils jettent de grands cris, ils pleurent, ils gé-
miffent, & font des efforts de toute efpece pendant
deux ou trois heures ; enfin les forces leur manquent,
ils s’arrêtent, la Tueur coule de toutes les parties de
leur corps, ils laiffent tomber, leur trompe à terre,
& il en fort une grandequantité d’eau. Lorfqu’ils font
dans cet état, on fait fortir les femelles de leurs écuries
, elles rentrent dans le parc, & fe mêlent parmi
les éléphans fauvages. Bien-tôt,elles vont dans d’autres
écuries qui font deftinées à ces éléphans ; chacun
fuit une femelle & entre après elle dans une écurie :
mais il s’y trouve feul, car la femelle fort par une
porte de derrière, & aufîi - tôt on enferme Péléphant
fauvage dans cette écurie oü il fe trouve fort ferré ;
on Py tient lié ; il paffe quatre ou cinq jours fans vouloir
ni manger, ni boire; enfin il s’accoutume à fon
efclavage, &c en huit jours il fe trouve bien appri-
yoifé. T
A Patane, qui eft un royaume dépendant de celui
de Siam, on mene feulement un grand éléphant privé
dans le bois ; dès qu’un éléphant fauvage l’apperçoit,
il vient l’attaquer : ces deux éléphans croifent leurs
trompes en s’efforçant de fe renverfer l’un l’autre ;
pendant que la trompe de Y éléphant fauvage eft em-
fiarraffée, on lui lie les jambes de devant, alors il
n’ofe plus fe remuer, parce qu’il craint de tomber:
ainfi il eft aifé de i’apprivoifer par la faim.
On tend auffi des chauffes-trapes pour faire tomber
les éléphans fauvages dans des foffes, & enfuite
on les Jie avec des cordes. L’éléphant s’apprivoife en
peu de tems : trois jours fuffifent, fi on les prive de
pourriture, pu fi on les empêche de dormir. On les
prend plus facilement lorfqu’ils font très-jeunes. Voy.
Uprtm. voyage de Siam, par le P.Tachart ; les mémoir
rfs pour, jervirà Ihijloire naturelle des animaux , qui a
déjà été citée-; 6* plusieurs relations: de voyageurs dont
cet article a été extrait. Voyer QUADRUPEDE. (/) w Eléphant,. (Mat. medj)Ae toutes les parties de
«et animai, il n’y a que les dents qui foient en ufa*
ge ; elles font connues fous le nom ôYivoire. P'oye^ Ivoire.
* Eléphans , (ffijï. anc. ) les anciens employèrent
cet animal dans leurs armées ; les Orientaux
s’en ètoient fervi avant eux ; les Perfans & les Indiens
en avoient menés en troupe au combat. Il étoit
difficile de les bleffer. Ils écraloient fous leurs piés
tout ce qui s’oppofoit à eux ; ils portoient des tours
fur leur dos, d’où des foldats armés faifoient pleuvoir
des traits, des fléchés, des pierres, & des javelots
fur leurs ennemis. Ils étoient dreffés à faifir les
hommes avec leur trompe, & à les jetter dans la tour
qu’ils portoient. Ils rompoient les rangs ; ils épou-
vantoiènt les chevaux. Lorfqu’on fe fut accoutume
à cette efpece de péril, on refifta aux éléphans avec
le feu, avec des poutres aiguës plantées devant les
rangs, des haches dont on leur coupa les pies, des
armes en forme de faulx dont on leur trancha la
trompe, de longues piques qu’on leur enfonça fous
la queue, où ils ont la peau moins épaifle ; enfin on
leur oppofa d’autres éléphans. On vit alors les animaux
les plus terribles prendre part dans les querelles
des hommes, & s’entre-détruire pour les défendre
ou les venger.
Les Romains qui eh virent pour la première fois
dans l’armée de Pyrrhus, les prirent pour dés boeufe
de Lucanie ; une défaite totale fut la fuite de leur
ignorance. Dans la fuite ils firent marcher eux-me-
mes ces animaux contre leurs ennemis : ce fut une
partie principale du butin qu’ils firent fur les Car-,
thaginois. Ils en oppoferent pour la première fois à.
Philippe ; ils en honorèrent leurs triomphes ; ils ea
expoferentdans les jeux du cirque, oit l’on vit quelquefois
des éléphans vaincus par des hommes. C e—
toit un bel exemple de la fupériorité de l’induftrie fur
la forcé. On dit qu’ils en dreflerent à marcher fur.
des cordes tendues. Ils en attelèrent à leurs chars«;
Céfar fe fit éclairer par quarante éléphans, qui por-
toient devant lui des flambeaux à la guerre. On ap-
pelloit ^oarque, celui qui commandoit un éléphant
thérarque , celui qui en commandoit deux; alpthérar-,
que, celui qui en commandoit trois ; hylarque, celui
qui en commandoit huit ; chératarque, celui quî
en commandoit vingt ; & phallangarque, celui qui eiî
éommandoit foixante-quatre.
Elé ph an t , (' Myth. Médailles.') L’éléphant fur lés
médailles eft un des fujets qui a le plus exercé les
antiquaires , pour en deviner les diverfes lignifications.
Il marque ordinairement les jeux publics ôc
les triomphes, où l’on prenoit plaifir de faire voir
au peuple ces fortes d’animaux. Dans les médailles
de Jules-Céfar fur la fin de la république , où il n’é-
toit pas permis de mettre fa tête fur ies monnoies»1
on imagina pour flater fon ambition de mettre à
la place cet animal ; parce qu’en langue punique -J
céfar fignifioit un éléphant. Aufll dans la fuite, IV-
léphant fut pris pour une marque de la puiffance
fouverainè : il eft vrai cependant qu’il défigne ailleurs
le fymbole de léternité , ou celui de la piété envers
Dieu. Mais pour abréger, voye%_ Spanheim, nu-
mifmata ; Begeri, thefaurius Brandenburgicus ; & fur-
tout Cuper ( Gisbert ) , de elephantis , & c . Hagce-
Comit. 1719 , in-folio , fig. Article de M. le Chevalier,
D E J A U COU RT . Eléphant , nom donné à un ordre militaire ancien
& fort honorable que confèrent les rois de Danemark
, & qu’ils n’accordent qu’aux perfonnes dé
la plus haute qualité, &C d’un mérite extraordinaire.,
On l’appelle Y ordre de l'.éléphant, parce qu’il a
pour arme un éléphant d’or émaillé de blanc, chargé
d’une tour d’argent maçonnée de fable, fur une
terraffe de fynople émaillée de fleurs. Cette mar-r
que de l’ordre eft ornée de diamans, & pend à, un
ruban bleu, ondé comme le cordon blçu çn France^
Çhambers, (G)
Eléphant , (il? de l ) île de IThdôftan fur la côte
du Malabar. Elle a été ainfi nommée , de la figure
d’un éléphant qu’on voit taillée dans le roc, grande
comme nature. Il y a au même endroit un cheval de
pierre, une pagode, avec une quarantaine de figurés
gigantefques, rangées fymmétriquement. Les payens
de cette île en ont fait Fobjet de leur cuire.
ELEPHANTIASE ou ELEPHANTIE, fubft. f. ou
ELEPHANTIAS, f. m. ( Med. ) c’eft le nom que les
Grecs ont donné à la maladie de la peau, que les
Arabes appellent lepre.
Celle qui eft la lepre des Grecs, eft nommée par
les Arabes, albara nigra : c’eft une efpece de gale a
lin plus haut degré de malignité ; ainfi elle ne différé
de la gale que l’on voit communément, que par
l’intenfité des fymptomes. Voye^ G ale , Lepre.
La lepre des Arabes eft encore plus violente que
celle des Grecs. De toutes les maladies dans lefquel-
les les tégumens font afferiés de différens genres de
puftules, de tubercules, d’ulceres, il n’en eft point
qui réunifie autant de ces divers maux, & qui afferie
fi généralement toutes les parties du corps, d’une
maniéré fi horrible & fi digne de compaffion en même
tems, que Y éléphantiafe ; ce qui la fait regarder
comme, un chancre univerfel par Paul Æginette
(Jib. IK ) , & par prefque tous les auteurs qui l’ont
décrit après lui. On lui a donné le nom d’éléphantiafe ;
foit parce què cette maladie eft auffi grande par la
fratiire de fes fymptomes, & auffi forte par la difficulté
de la guérir, entre toutes les autres maladies
connues, que l’éléphant furpàffe en grandeur & en
force tous les autres quadrupèdes ; Toit parce que
ceux qui font afferiés de cette efpece de lepre ont le
corps & les extrémités inférieures fur-tout tuméfiées
& fi roides, qu’ils ne peuvent pas les plier : ce en
quoi on les comparoit aux éléphans, dont les anciens
crOyoient les jambes fans jointures ; foit parce que
cette maladie rend la peau gonflée, rude, inégale’,
ridée, couverte d’écailles, de tubérofités, avec un
grand nombre de fentes fillonnées & de crevaffes,
comme l’eft celle des éléphans. Cette derniere rai-
fon paroît la plus vraiflemblable. On lui a auffi donné,
félon Galien dans fon livre de tumoribus, cap. xjv.
le nom de fatyryafmum ; parce que lorfqu’elle com-
mènee, elle fend les malades extrêmement lafeifs ,
& par-là femblables à des fatyres ; ou parce qu’elle
défigure le vifage, & lui donne quelque feflemblan-
ce avec la figure fous laquelle on repréfente les fatyres.
On la défigne auffi par le nom de leontiafis ; il
çft fait mëntion de ce nom dans Aëtius, tetraci. 4.
parce que ceux qui en font affeâés ont le front chargé
de groffes rides, l’afpeû furieux, effrayant, corn-
oie le lion : enforte que ce mal eft auffi cruel que cet
animal. On l’appelle encore le mal de S. Lazaret
parce qu’on le croit le même que celui du manaiant
nomme Lazare, tout couvert d’ulceres, dont il eft
fait mention dans l’Evangile*
Cette cruelle maladie ne paroît pas tout d’un coup
dans toute fa force, fes,fymptomes ne femblent naître
que par degrés ; car avant que les parties extérieures
foient affe&ées, les malades fe fentent une pefan-
teur de cofps qui les engourdit &c les rend lents à fe
mouvoir, font fujets à la conftipation, leurs urines
font femblables à celles des bêtes de fommç, leur haleine
devient forte, la peau des joues s’épaiffit,il s’élève
des tumeurs dures fur le vifage & principalement
fur le front ; & lorfque le mal augmente plus
confidérablement, il.fe forme des tubercules &c des
puftules fur toute la furface du corps.
Il y a fix fymptomes, félon Gui de Chauliac (mag;
thirg. tracl. C. ) , qui conftituent des fignes caraâéri-
ftiques de Yelephantiafîs ;ïnvo\r la rondeur des yeux
& des oreilles ; la dépilation, l’épaiffeur, & l’élévation
de la peau des fourcils ; la dilatation & la diftorfiôn
des narines en-dehors, & le reffefrement de
leurs cavités en-dedans ; la mauvaife odeur des lèvres,
& la voix rauque, comme lorfqu’on parle du
nez ; la puanteur de la bouche & de toute la perfon-
ne ; le regard fixe & qui fait horreur.
Le même auteur rapporte encore feize autres fignes
équivoques de cette maladie, dont voici les
principaux : la peau s’hériffe d’inégalités en forme
d’écailles ; il s’en fépare une grande quantité qui renaît
bientôt après : le fentiment qui eft d’abord beaucoup
émoufle dans les extrémités inférieures , 'avec
des crampes continuelles, fe perd à la fuite entièrement
, enforte qu’il ne peut prefque pas être excité
par la piquûre faite avec des aiguilles quoiqu’en-
foncées profondément ; la peau en général devient
infenfible par degrés, au point de ne reffenrir à la
fin aucune douleur , même par l’afperfion de l’eaü
bouillante qui gliffe defliis comme fur un corps onctueux.
Les cheveux tombent aüffi-bien que les poils
des aiffelles , des aines , & il renaît à la place une
efpece de duvet : IesleVres font enflées, épaiftes ,
les gencives rongées, la langue, le palais, lés^oreil-
les le garniflent d’une infinité de petits grains comme
des durillons ; une foif ardente tourmente ’joui?
& nuit ; & félon la defeription qu’Aretée donne de
cette maladie(/iv. ÎV. cap. xiij.)> la face, les cuiffes*
lqs jambes s’enflent d’une maniéré énorme, & quelquefois
tout le corps, enforte que les doigts de*.piés
& même ceux des mains font enveloppés & cachés
fous l’enflure : enfin lorfque le mal eft au fuprème
degré, les tubercules s’exuleerent dans toutes les
parties du corps ; les bords des ulcérés deviennent
calleux, & cependant très-tendres & fufcèptibles de
donner du fang par la moindre irritation ; ,il sert
forme fouvent dans l’intérieur de la bouche > dans
le gofier ; il s’y répand un pus de mauvaife qualité,
une fanie,qui font de très-mauvaife odeur;& le corps
ainfi affeâé dans toutes fes parties, ne paroît bientôt
plus que couvert d’un feul ulcéré comme un
chancre univerfel ; jufqu’à ce que la fievre lente qui
fé joint inévitablement à tous ces fymptomes , & la
pourriture de toutes les parties tant internes qu’externes
, ayent rongé & confumé jufqu’aux os la fub-
ftance des miférables qui font dans un fi trifte état,
&c leur ayent ôté le peu de vie qui reftoit encore dans
leur corps changé en affreufes charognes, quelque?
fois long-tems même avant la mort ; car malgré, tant
de niaux qui font produits par cette maladie, elle ne
laifle pas d’être ordinairement de longue durée ; elle
doit par Conféquenî félon Gelfe , liv. III. cap. xxv»
être mife au nombre des chroniques, quelque violente
qu’elle foit.
Telle êft l ’hiftoire de cette maladie qui porte un
cara&ere de malignité exceffive & qui eft des plus
contagieufes ; en forte que ceux qui en font attaqués
fe voyent abandonnés de tout le monde, même de
leurs domeftiques & de leurs parens qui craignent
d’en approcher : c’eft en conféquence qu’on a pourvu
dans plufieurs états à leur fournir un afyle qù ils
puiffent fe mettre & finir leurs jours malheureux
dans des hôpitaux ( dits de S. Lazare) , fondés à cet
effet ; on les oblige à fe féparer de la foeiété & à. s’y
renfermer dès qu’ils font déclarés tels ; d’autant plus
que Yéléphantias fe communique aifément par le com?
merce ordinaire de la v ie , fur-tout fi l’on couche
avec ceux qui en font infe&és, & par le coït ; comme
le rapporte Gordon, liv% I. tap. xxij. ce qu’il
confirme par plufieurs exemples : il peut être Auffi
héréditaire* : : : ^ • ,
C ’eft mal-à-propos qu’on a voulu confondre l «-
léphantiafe ou lepre des Arabes avec la verole; attendu
que celle-latoute contagieufequ’elle eft, peut
auffi être contrariée par le défaut de régime, par
l’ufage de mauvais alimens félon le témoignage de§