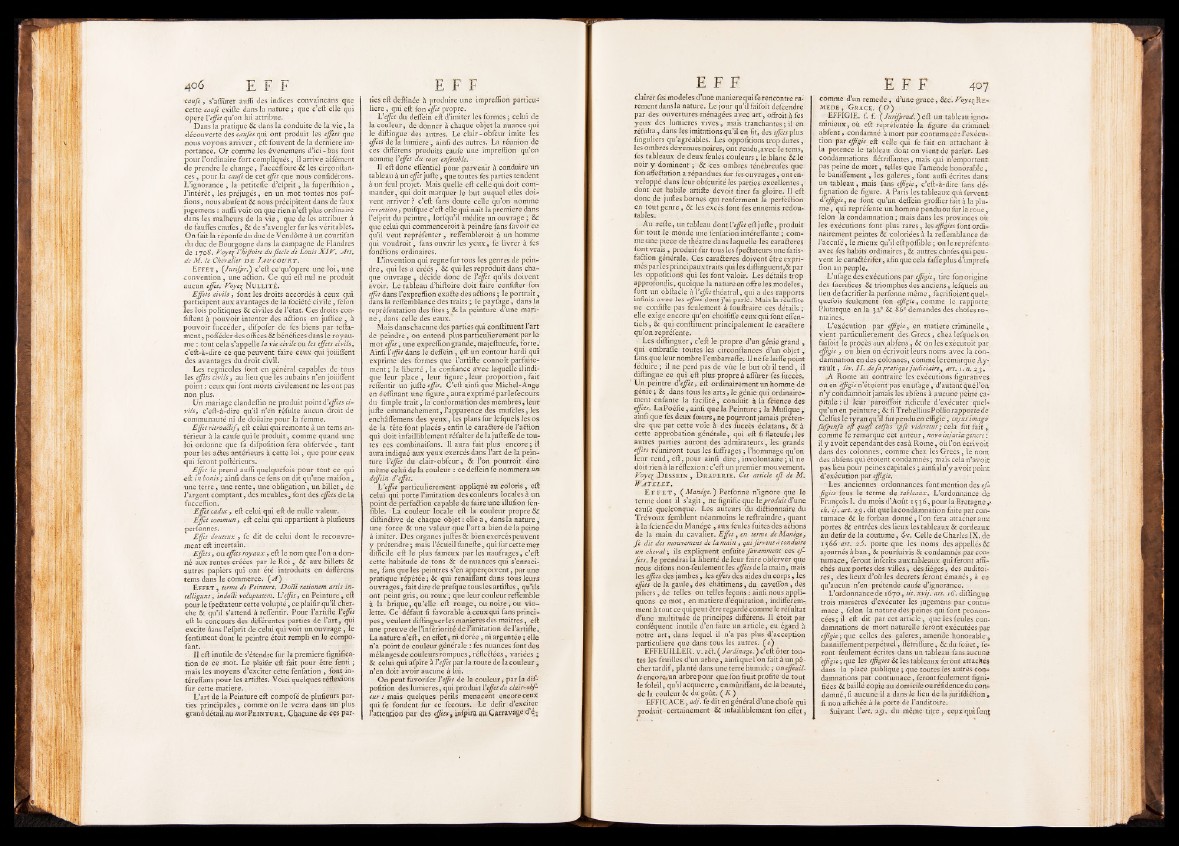
caufe, s’affûrer auffi des indices convaincans que
cette caufe exifte dans la nature ; que c’eft elle qui
opéré Yeffet qu’on lui attribue.
Dans la pratique & dans la conduite de la v ie , la
découverte des caufes qui ont produit les effets que
nous voyons arriver, eft fouvent de la derniere importance.
Or comme les évenemens d’ici-bas font
pour l’ordinaire fort compliqués, il arrive aifément
de prendre le change, l’accefl'oire & les circonftan-
ces, pour la caufe de cet effet que nous confidérons.
L’ignorance , la petiteffe d’elprit, la fuperftition ,
l ’intérêt, les préjugés, en un mot toutes nos paf-
lions, nous abufent & nous précipitent dans de faux
' jugemens : auffi voit-on que rien n’eft plus ordinaire
dans les malheurs de la v ie , que de les attribuer à
de fauffes caufes, & de s’aveugler fur les véritables.
On fait la réponfe du duc de Vendôme à un courtifan
du duc de Bourgogne dans la campagne de Flandres
de 1708. Foye[ l'hijloire du jiecle de Louis X IV . Art.
de M. le Chevalier D E J a ü COURT . Effet , (Jurifpr.) c’eft ce'qu’opere une loi, une
convention , une aftion. Ce qui eft nul ne produit
aucun effet. Voye{ Nullité.
Effets civils, font les droits accordés à ceux qui
participent aux avantages de la fociété civile, félon
les lois politiques & civiles de l’état. Ces droits confident
à pouvoir intenter des a étions en juftice , à
pouvoir fuccéder, difpofer de fes biens par teftar
ment, pofféder des offices & bénéfices dans le royaume
: tout cela s’appelle la. vie civile ou les effets civils,
c’eft-à-dire ce que peuvent faire ceux qui joiiiffent
des avantages du droit civil.
Les regnicoles font en général capables de tous
les effets civils , au lieu que les aubains n’en joüifTent
point : ceux qui font morts civilement ne les ont pas
non plus.
Un mariage clandeftin ne produit point d'effets civils,
c’eft-à-dire qu’il n’én réfulte aucun droit de
communauté ni de douaire pour la femme.
Effet rétroactif, eft celui qui remonte à un tems antérieur
à la caufe qui le produit, comme quand une
loi ordonne que fa difpofition fera obfervée, tant
pour les aétes antérieurs à cette lo i, que pour ceux
qui feront poftérieurs.
Effet fe prend auffi quelquefois pour tout ce qui
eft in bonis; ainfi dans ce fens on dit qu’une maifon,
une terre, une rente, une obligation, un billet, de
l’argent comptant, des meubles, font des effets de là
fucceffion.
Effet caduc, eft celui qui eft de nulle valeur.
. Effet commun, eft celui qui appartient à plufieurs
perfonnes.
Effet douteux , fe dit de celui dont le recouvrement
eft incertain.
Effets , ou effets royaux , eft le nom que l’on a donné
aux rentes créées par le R o i, & aux billets &
autres papiers qui ont été- introduits en différens
tems dans le commerce. (^ ) Effet , terme de Peinture. Docti rationem artis in-
telligunt, indocli voluptatem. L’effet, en Peinture, eft
pour le fpeftateur cette volupté, ce plaifir qu’il cherche
& qu’il s’attend à reffentir. Pour l’artifte Y effet
eft le concours des différentes parties de l’art., qui
excite dans l’efprit de celui qui voit un ouvrage, le
lentiment dont le peintre étoit rempli en le compo-
fant.
Il eft inutile de s’étendre fur la première lignification
de ce mot. Le plaifir eft fait pour être fenti ;
mais les moyens d’exciter cette fenfation , font ira-r
téreffans pour les artiftes. Voici quelques réflexions
fur cette matière.
L’art de la Peinture eft compofé de plufieurs parties
principales, comme on le verra dans un plus
grand détail au mot Peinture, .Chacune de ces parties
eft deftinée à produire une impreffion particulière
, qui eft fon effet propre.
U effet du deffein eft d’imiter les formes ; celui de
la couleur, de donner à chaque objet la nuance qui
le diftingue des autres. Le clair-obfcur imite les
effets de la lumière, ainfi des autres. La réunion de
ces différens produits caufe une impreffion qu’on
nomme Yeffet du tout enfemble.
Il eft donc effentiel pour parvenir à conduire un
tableau à un effet jufte, que toutes fes parties rendent
à un feul projet. Mais quelle eft celle qui doit commander
, qui doit marquer le but auquel elles doivent
arriver ? c’eft fans doute celle qu’on nomme
invention, puifque c’eft elle qui naît la première dans
l’efprit du peintre, lorfqu’il médite un ouvrage ; &
que celui qui commenceroit à peindre fans fa voir ce
qu’il veut repréfenter, reffembleroit à un homme
qui voudroit, fans ouvrir les yeux, fe livrer à fes
fon étions ordinaires.
L’invention qui régné fur tous les genres de peindre
, qui les a créés , & qui les reproduit dans chaque
ouvrage, décide donc de Yeffet qu’ils doivent
avoir. Le tableau d’hiftoire doit faire confifter fon
effet dans l’expreffion exaéte des aérions ; le portrait,
dans la reffemblance des traits ; le payfage, dans la
repréfentation des fîtes ; & la peinture d’une marine
, dans celle des eaux.
Mais dans chacune des parties qui conftituent l’art
de peindre, on entend plus particulièrement par le
mot effet, une expreffion grande, majeftueufe, forte J
Ainfi Yeffet dans le deffein, eft un contour hardi qui
exprime des formes que l’artifte connoît parfaitement;
la liberté, la confiance avec laquelle il indique
leur place , leur figure,leur proportion, fait
reffentir un jufte effet. C ’eft ainfi que Michel-Ange
en deffinant une figure, aura exprimé par le fecours
du fimple trait, la conformation des membres, leur,
jufte emmanchement,l’apparence des mufcles,les
enchâffemens des yeux, les plans fur lefquels les os
de la tête font placés, enfin le caraétere de l’aérion
qui doit infailliblement réfulter de la jufteffe de toutes
ces combinaifons. Il aura fait plus encore ; il
aura indiqué aux yeux exercés dans l’art de la peinture
Yeffet du clair-obfcur, & l’on pourroit dire
même celui de la couleur : ce deffein fe nommera un
deffein d'effet.
L'effet particulièrement appliqué au coloris, eft
celui qui porte l’imitation des couleurs locales à un
point de perfeérion capable de faire une illufion fen-
fible. La couleur locale eft la couleur propre &
diftinérive de chaque objet : elle a , dans la nature ,
une force & une valeur que l’art a bien de la peine
à imiter. Des organes juftes& bien exercés peuvent
y prétendre; mais l’écueil fiinefte, qui fur cette mer
difficile eft le plus fameux par les naufrages, c’eft
cette habitude de tons & de nuances qui s’enracine,
fans que les peintres s’en apperçoivent, par une
pratique répétée ; & qui renaiffant dans tous leurs:
ouvrages, fait dire de prefque tous les artiftes, qu’ils
ont peint gris, ou roux ; que leur couleur reffemble
à la brique, qu’elle eft rouge, ou noire, ou violette.
Ce défaut fi favorable à ceux qui fans principes
, veulent diftinguer les maniérés des maîtres, eft
une preuve de l’infériorité de l’imitation de l’artifte.1
La nature n’eft, en effet, ni dorée, ni argentée ; elle
n’a point de couleur générale : fes nuances font des
mélanges de couleurs rompues, réfleétées, variées ;
& celui qui afpire à Yeffet parla route de la couleur ,
n’en doit avoir aucune à lui.
On peut favorifer Yeffet de la couleur, par la difpofition
des lumières, qui produit Y effet du clair-obf-
cur : mais quelques périls menacent encore ceux
qui fe fondent fur ce fecours. Le defir; d’exciter
l’attention par des # « , infpira au Carravage d’éj
clairer fes modèles d’unê maniéré qui fe rencontre rarement
dans la nature. Le jour qu’il faifoit defeendre
par des ouvertures ménagées avec art, offioità fes
yeux des lumières viv es , mais tranchantes ; il en
réfulta, dans les imitations qu’il en fit, des effets plus
finguliers qu’agréables. Les oppofitions trop dures,
les ombres devenues noires, ont rendu,avec le tems,
fes tableaux de deux feules couleurs ; le blanc &: le
noir y dominent ; & ces ombres ténébreufes que
fon affeéfation a répandues fur fes ouvrages, ont en-
veloppé dans leur obfcurité les parties- excellentes, r
dont cet habile artifte devoit tirer fa gloire. Il eft
donc de juftes bornes qui renferment la perfeérion
en tout genre, & les excès-font fes ennemis redoutables.
. Au refte, lin tableau dont Yeffet eft jufte, produit
fur tout le monde une fenfation intéreffante ; comme
une piece de théâtre dans laquelle les caraéferes
font vrais, produit fur tous les fpeéfateurs une fatis-
feérion générale. Ces caraéferes doivent être expri-
mes.paries principaux traits qui les diftinguent,& par
les oppofitionS qui les font valoir. Les détails trop
approfondis, quoique la nature en offre les modèles,
font un obftacle à Yeffet théâtral, qui a des rapports
infinis avec les effets dont j’ai parlé. Mais la réuffite
ne confifte pas feulement à fouftraire ces détails ;
elle exige encore qu’on choififfe ceux qui font effen-
tiels, & qui conftituent principalement le caraéfere
qu’on repréfente.
■ Les diftinguer, c’eft le propre d’un génie grand ,
qui embraffe toutes les circonftances d’un objet,
fans.que leur nombre Pembarraffe. Il ne fe laiffe point
féduire ; il ne perd pas de vue le but où il tend, il
diftingue ce qui eft plus propre à aflurer fes fuccès.
Un peintre d'effet, eft ordinairement un homme de
génie ; & dans tous les arts, le génie qui ordinairement
enfante la facilité, conduit à la feience des
effets. LaPoéfie, ainfi que la Peinture ; la Mufique ,
ainfi que fes deux foeurs, ne pourront jamais prétendre
que par cette voie à des luccès éclatans, & à
cette approbation générale, qui eft fi fkteufe ; les
autres parties auront des admirateurs, les grands
effets réuniront tous les fuffrages ; l’hommage qu’on
leur rend, eft, pour ainfi dire, involontaire ; il ne
doit rien à la réflexion : c’eft un premier mouvement.
Voye^ .Dessein , Draperie. Cet article ejl de M.
Wa t e l e t .
E f f e t , ( Manège. ) Perfonne n’ignore que le
terme dont il s’agit, ne lignifie que le produit d’une
caufe quelconque. Les auteurs dii dictionnaire du
Trévoux femblent néanmoins le reftraindre, quant
à la fcience du Manège , aux feules fuites des aérions
de la main du cavalier. Effet, en terme de Manège,
fe dit des mouvemens de la main , qui fervent à conduire
un cheval ; ils expliquent enfuite favamment ces effets.
Je prendrai la liberté de leur faire obferver que
nous difons non-feulement les effets de la main, mais
les effets des jambes, les effets des aides du corps , les
effets de la gaule, des châtimens, du caveffon, des
piliers, de telles ou telles leçons : ainfi nous appliquons
ce mot, en matière d’équitation, indifféremment
à tout ce qui peut être regardé comme le réfultat
d’une multitude de principes différens. Il étoit par
conféquent inutile d’en faire un.article, eu égard à
notre art, dans lequel il n’a pas plus d’acception
particulière que dans tous les autres. ( e)
EFFEUILLER. v. aét. ( Jardinage. ) c ’eft ôter toutes
les feuilles d’un arbre, ainfi que l’on fait à un pêcher
tardif, planté dans une terre humide ; or\ effeuille
encore*un arbre pour que fon fruit profite de tout
le foleil, qu’il acquierre, enmûriffant, de la beauté,
de la couleur & du goût. ( K )
EFFICACE, adj. fe dit en général d’une chofe qui
produit certainement & infailliblement fon effet,
comme d’un remede, d’une grâce ; &c. Voye%_ Re-
MEDE , Gr A ce. ( (?) : ; : ; -
EFFIGIE, f. f. ( Jurifprud. ) eft un tableau ignominieux
, où eft repréfentée la figure du criminel,
abfent, condamné à mort par contumace : l’exécu-.
tion par effigie eft celle qui fe fait en attachant à
la potence le tableau dont on vient de parler. Les
condamnations flérriffantes, mais qui n’emportent.
pas peine de mort, telles que l’amende honorable ,
le baniffement, les galeres, font auffi écrites dans
un tableau, mais fans effigie, c’eft-à-dire fans dé-
fignation de figure. A Paris les tableaux qui fervent
d’effigie, ne font qu’un deffein groffier fait à la plu-;
me, qui repréfente un homme pendu ou fur la roue y
félon la condamnation ; mais dans les provinces oii
les exécutions font plus rares, les effigies font ordinairement
peintes & coloriées à la reffemblance de
l’accufé, le mieux qu’il eft poffible ; on lerepréfente.
avec fes habits ordinaires, & autres chofes qui peuvent
le caraélérifer, afin que cela faffeplus d’impref*
lion au peuple.
L’ufage des exécutions par effigie, tire fon origine
des facrifices & triomphes des anciens, lefquels au
lieu defacrifierlaperfonne même, facrifioientquelquefois
feulement fon effigie, comme le rapporte
Plutarque en la 31e àc 86e demandes des chofes romaines.
L’exécution par effigie, en matière criminelle ,
vient particulièrement .des Grecs, chez Içfquelson
faifoit le procès aux abfens , & on les exécutqit par
effigie , ou bien on ecrivoit leurs noms avec la condamnation
en dés colonnes, comme le remarque A yrault,
liv. II. de fa pratique judiciaire, art. t.n, g j . J
X Rome au contraire les exécutions figuratives
oii en èffgiefféioièni pas en ûfage ,• d’àufânt ^ué l’on
n’y condamiioit jamais lès abfens à aucune peine capitale
: il leur paroiffoit ridicule- d’exécuter quel*
qu’un en peinture; & fiTrebelliusPoIliorapporte de
CelfüS le tyran qu’il fut pendu en effigie, cujus imago
fufpenfa efi quaffi celfus ïpfe videretur; cela fut fait ,
comme le remarque cet auteur, novoinjuriotgenerei
il y a voit cependant des cas à Rome, où l’on éerivolt
dans des-colonnes", comme chez les G recs, le nom
des abfens qui étoient condamnés ; mais cela n’avoit
pas lieu pour peines capitales ; ainfi il n’y avoit point
d’exécution par effigie.
Les anciennes ordonnances font mention des effi
figies fous le terme de tableaux. L’ordonnance de
François I. du mois d’Août 1536, pour la Bretagne ,v
ch. ij. art. 2$. dit que la condamnation faite par contumace
& le forban donné, l’on fera attacher aux
portes & entrées des lieux les tableaux & cordeaux
au defir de la coutume, &c. Celle de Charles IX. de
1^66 art. 26. porte que les noms des appellés &c
ajournés à ban, & pourfuivis & condamnés par contumace
, feront inferits aux tableaux quiferont affichés
aux portes des villes, des lièges, des auditoires
, des lieux d’où les decrets feront 'émanés, à ce
qu’aucun n’en prétende caufe d’ignorance.
L’ordonnance de 1670 , tit.xvij. art. iC. diftingue
trois maniérés d’exécuter les jugemens par contumace
, félon la nature des; peines qui font prononcées;
il eft dit par cet article, que les feules condamnations
de mort naturelle feront exécutées par
effigie ; que celles des galeres, amende honorable ,
banniffement perpétuel, flétriffure, & du fouet, feront
feulement écrites dans un tableau fans aucune
effigie ; que les effigies & les tableaux feront attaché^
dans la place publique ; que toutes les autres condamnations
par contumace, feront feulement lignifiées
& baillé copie au domicile ouréfidence du condamné
, fi aucune il a dans le lieu de la jùrifdiérion ,
fi non affichée à la porte de l’auditoire.
Suivant Y are, 2<), du mêjne titre, cepx qpi fonÇ