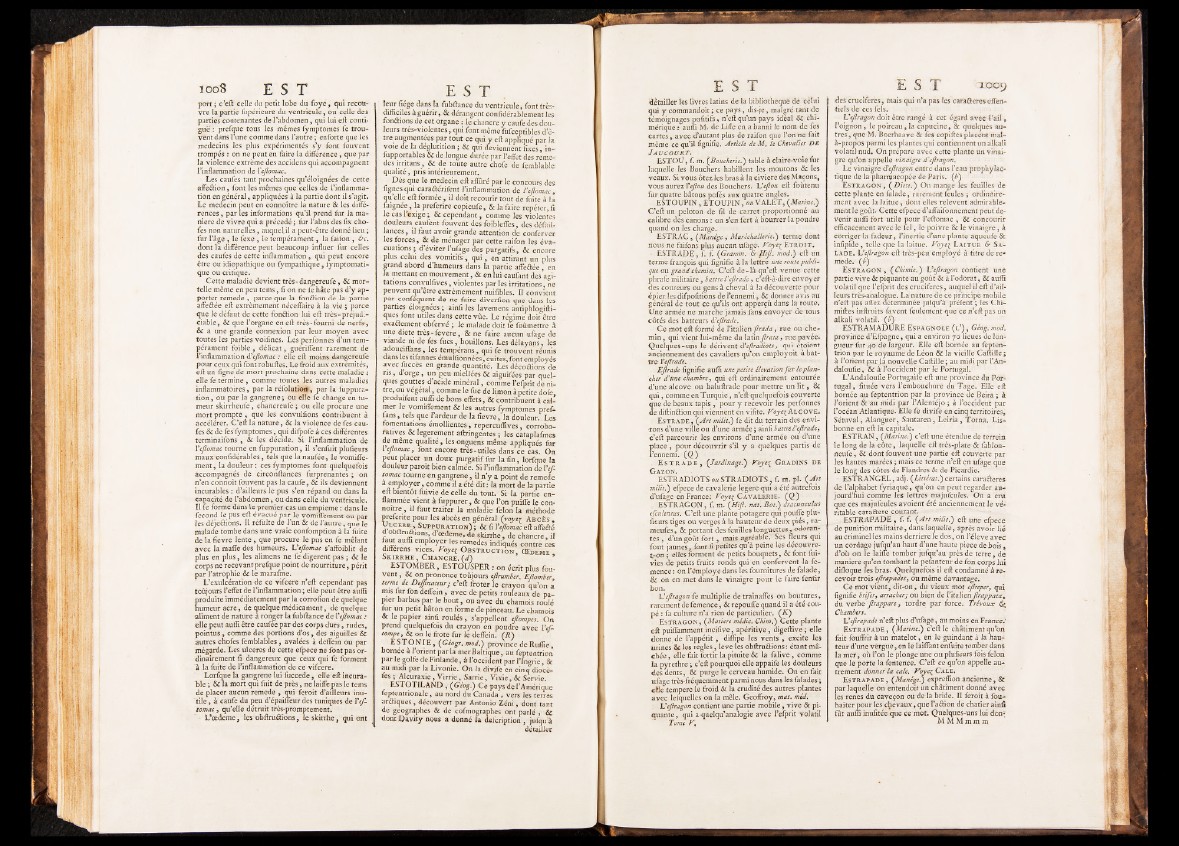
port ; c'eût celle du petit lobe du fo y e , qui recouvre
la partie fupérieure du ventricule, ou celle des
parties contenantes de l ’abdomen, qui lui eft contiguë
: prefque tous les mêmes fymptomes fe trouvent
dans l’une comme dans l’autre ; enforte que les
médecins les plus expérimentés s’y font fouvent
trompés : on ne peut en faire la différence, que par
la violence extrême des accidens qui accompagnent
l’inflammation de l’ejlomac.
Les caufes tant prochaines qu’éloignées de cette
affeâion, font les mêmes que celles de l’inflammation
en général, appliquées à la partie dont il s’agit.
Le médecin peut en connoître la nature & les différences
, par les informations qu’il prend fur la maniéré
de vivre qui a précédé ; fur l’abus des fix cho-
fes non naturelles, auqueül a peut-être donné lieu ;
fur l’âge , le fexe , le tempérament, la faifon , &c.
dont la différence peut beaucoup influer fur celles
des caufes de cette inflammation , qui peut encore
être ou idiopathique ou fympathique, fÿmptomati-
que ou critique.
Cette maladie devient très-dangereufe, & mortelle
même en peu tems, fi on ne fe hâte pas d’y apporter
remede , parce que la fonâion de la partie
âffeûée eft extrêmement néceffaire à la vie ; parce
que le défaut de cette fonâion lui eft très-préjudiciable,
& que l’organe en eft très-fourni de nerfs*,
& a une grande connexion par leur moyen avec
toutes les parties voifines. Les perfonnes d’un tempérament
foible, délicat, guériffent rarement de
l’inflammation d'ejlomac : elle eft moins dangereufe
pour ceux qui font robuftes. Le froid aux extrémités,
èft un ligne de mort prochaine dans cette maladie :
elle fe termine , comme toutes les autres maladies
inflammatoires, par la réfolutio#, par la fuppura-
tion, ou par la gangrené ; ou elle fe change en tumeur
skirrheufe, chancreufe ; ou elle procure une
mort prompte , que les convulfions contribuent à
accélérer. C ’eft la nature, & la violence de fes caufes
& de fes fymptomes, qui difpofe à ces différentes
terminaifons , & les décide. Si l’inflammation de
Y ejlomac tourne en fuppuration, il s’enfuit plulieurs
maux confidérables, tels que la naufée, le vomiffe-
ment, la douleur : ces fymptomes font quelquefois
accompagnés de circonftances furprenantes ; on
n’en connoît fouvent pas la caufe, & ils deviennent
incurables : d’ailleurs le pus s’en répand ou dans la
capacité de l’abdomen, ou dans celle du ventricule.
Il fe forme dans le premier cas un empieme : dans le
fécond le pus eft évacué par le Vomiffement ou par
les déjeâions. Il réfulte de l’un & de l’autre, que le
malade tombe dans une vraie confomption à la fuite
de la fievre lente, que procure le pus en fe mêlant
avec la maffe des humeurs. Vejlomac s’affoiblit de
plus en plus, les alimens ne fe digèrent pas ; & le
corps ne recevant prefque point de nourriture, périt
par l’atrophie & le marafme.
L’exulcération de ce vifeere n’eft cependant pas
toûjours l’effet de l’inflammation ; elle peut être aufli
produite immédiatement par la corrofion de quelque
humeur acre, de quelque médicament, de quelque
aliment de nature à ronger la fubftanee de Y ejlomac :
elle peut aufli être caufee par des corps durs, rudes,
pointus, comme des portions d’o s, des aiguilles &
autres chofes femblables, avalées à deflein ou par
mégarde. Les ulcérés de cette efpece ne font pas ordinairement
fi dangereux que ceux qui fe forment
à la fuite de l’inflammation de ce vifeere.
Lorfque la gangrené lui fuccede , elle eft incurable
; & ia mort qui fuit de près, ne laifle pas le tems
de placer aucun remede , qui feroit d’ailleurs inutile
, à caufe du peu d’épaiffeur des tuniques de Yef-
tomac, qu’elle détruit très-promptement.
L’oedeme, les obftru&ions , le skirrhe, qui ont
leur fiege dans la fubftanee du ventricule, font très-
difficiles à guérir, & dérangent confidérablement les
fondrions de cet organe : le chancre y caufe des douleurs
très-violentes, qui font même fufceptibles d’ê-
tre augmentées par tout ce qui y eft appliqué par la
voie de la déglutition ; & qui deviennent fixes, in-
fupportables & de longue durée par l’effet des reme-
des irritans, & de toute autre chofe de femblable.
qualité, pris intérieurement.
Dès que le médecin eft aflïiré par le concours des
lignes qui caraftérifent l’inflammation de Vejlomac,
qu’elle eft formée, il doit recourir tout de fuite à la
faignée, la preferire copieufe, & la faire repéter, fi
le cas l’exige ; & cependant, comme les violentes
douleurs caufent fouvent des foibleffes, des défaillances,
il faut avoir grande attention de conferver
les forces, & de ménager par cette raifon les évacuations
; d’éviter l’ufage des purgatifs, & encore
plus celui des vomitifs, q u i, en attirant un plus
grand abord d’humeurs dans la partie aflefrée , en
la mettant en mouvement, & en lui caufant des agitations
convulfives, violentes par les irritations, ne
peuvent qu’être extrêmement nuifibles. Il convient
par conséquent de ne faire diverfion que dans les
parties éloignées ; ainfi les lavemens antiphlogifti-
ques font utiles dans cette vûe. Le régime doit être
exactement obfervé ; le malade doit fe foûmettre à
une diete très-fevere, & ne faire aucun ufage de
viande ni de fes fucs, bouillons. Les délayans, les
adouciffans, les tempérans, qui fe trouvent réunis
da.ns les tifannes emulfionnées, cuites, font employés
avec fuccès en grande quantité. Les décoctions de
r is , d’orge, un peu miellées & aiguifées par quelques
gouttes d’acide minéral, comme l’efprit de ni-
tre, ou végétal, comme le fuc de limon à petite dofe,
produifent aufli de bons effets, & contribuent à calmer
le vomiffement & les autres fymptomes pref-
fans, tels que l’ardeur de la fievre, la douleur..Les
fomentations émollientes, repereuflives, corroboratives
& legerement aftringentes ; les cataplafmes
de meme qualité, les onguens même appliqués fur
Y ejlomac, font encore très-utiles dans ce cas. On
peut placer un doux purgatif fur la fin, lorfque la
douleur paroît bien calmée. Si l’inflammation de Yef-
tomac tourne en gangrené, il n’y a point de remede
à employer, comme il a été dit : la mort de la partie
eft bientôt fuivie de celle dn tout. Si la partie enflammée
vient à fuppurer, & que l’on puiffe le con-
noitre , il faut traiter la maladie félon la méthode
preferite pour les abcès en général (yoyt^ Abcès ,
Ul c é r é , Suppuration); 8c f i l’tflomaceftafferié
d obftrua.ons d’oedeme, de skirrhe, de chancre, il
faut aufli employer les remedes indiqués contre ces
différens vices. Voyt{S Obstruction, OEdeme kirrhe , Chancre, td)
ESTOMBER, ESTOUSPER : on écrit plus fouvent
, & on prononce toûjours tftrumhr. Efiombcr,
lirmt de Deffinauur; c’eft froter le crayon qu’on a
mis fur fon deflein, avec de petits rouleaux de papier
barbus par le bout, ou avec du chamois roulé
fur un petit bâton en forme de pinceau. Le chamois
& le papier ainfi roulés , s’appellent eftompes. On
prend quelquefois du crayon en poudre avec l ’ef-
tompe, & on le frote fur le deflein. (R)
E S T O N IE , ( Gèogr. mod.) province de Ruflîc,
bornée à l’orient parla mer Baltique, au feptentrion
par le golfe de Finlande, à l’occident par l’Ingrie, &
au midi par la Livonie. On la divjfe en cin q diocè-
fes ; Alcuraxie, Virrie, Sarrie, Vixie, & Servie.
ESTOTILAND , (Géogj Ce pays de l’Amérique
feptentrionale, au nord du Canada , vers les terres
aréiques, découve« par Antonio Zéni, dont tant
de géographes & de cofmographes ont parlé , &
dont Davity nous a donné la defeription , jufqu’à
détailler
«détailler les livres latins de la bibliothèque dé celui
qui y commandoit ; ce pays, dis-je, malgré tant de
témoignages pofitifs, n’eft qu’un pays idéal & chimérique
c aufli M-. de Lifte en a banni le nom de fes
cartes,. avec d’autant plus de raifon que l’on ne fait
même ce qu’il fignifie. Article de M. le Chevalier DE
J a u c o u r t . .
ESTOU, f. m. (Boucherie J table à Claire-voie fur
laquelle les Bouchers habillent les moutons & les
veaux. Si vous ôtez les bras à la civiere des Maçons,
Vous aurez Yefiou des Bouchers. L’cfiou eft foûtenu
fur quatre bâtons pofés aux quatre angles.
ESTOUPIN, ÉTOUPIN, ou VALET, (Marine.)
C ’eft un peloton de fil de carret proportionné au
calibre des canons : on s’en fert à bourrer la poudre
quand on les charge.
ESTRAC, (Manège , Maréckallerie.) terme dont
nous ne faifons plus aucun ufage. Foye{ Étroit.
ESTRADE, f. f. (Gramm. & Hiß. mod.) eft un
terme françois qui fignifie à la lettre une route publique
ou grand chemin. G’eft de-là qit’eft venue cette
phrafe militaire, battre Vefirade , c’eft-à-dire erivoyer
des coureurs ou gens à cheval à la découverte pour
épier.lesdifpofitions de l’ennemi, & donner avis au
général de tout ce qu’ils ont apperçû dans la route»
Une armée ne marche jamais fans envoyer de tous
côtés des batteurs (Vefirade.
Ce mot eft formé de l’italien firada, rue ou chemin
, qui vient lui-même du latin firata , rue, pavee.
Quelques-uns le dérivent d’efiradiots, qui étôient
anciennement des cavaliers qu’on employoit à battre
Yefirade.
Efirade fignifie aufli une petite élévation fur le plancher
d'une chambre, qui eft ordinairement entourée
d’une alcôve ou baluftrade pour mettre un l i t , &
qui, comme en Turquie, n’eft quelquefois couverte
que de beaux tapis, pour y recevoir les perfonnes
de diftinftion qui viennent en vifite. Voye^ Alcôve.
Estrade , (Art milit.) fe dit du terrain des environs
d’une ville ou d’une armée ; ainfi battre Vefirade,
c’eft parcourir les environs d’une' armée ou d’une
place , pour découvrir s’il y a quelques partis de
l ’ennemi. (Q ) . E s t r a d e , (Jardinage.) Voye^ Gradins de
Gazon.
ESTRADIOTS ou STRADIOTS, f. m. pl. (A n
milit.) efpece de cavalerie legere qui a été autrefois
d’ufage en France: Voyeç Cavalerie. (Q)
ESTRAGON, f. m. (Hifi. nat. Bot.) dracunculus
efculentus. C ’eft une plante potagère qui pouffe plu-
fieurs tiges ou verges à la hauteur de deux piés, ra-
meufes, & portant des feuilles longuettes, odorantes
, d’un goût fo r t , mais agréable. Ses fleurs qui
font jaunes, font û petites qu à peine les decouvre-
tron ; elles forment de petits bouquets, & font fiii-
vies de petits fruits ronds qui en confervent la fe-
mence : on l’émploye dans les fournitures de falade,
& on en met dans le vinaigre pour le faire fentir
bon.
Vcfiragonfe multiplie detraînaffes ou boutures,
rarement de femence, & repouffe quand il a été coupé
: fa culture n’a rien de particulier. (Ä ) Estragon , (Matière médic. Chim.) Cette plante
eft puiffamment incifive, apéritive, digeftive ; elle
donne, de l’appétit, diflipe les vents , excite les
urines & les réglés, leve les obftruâions : étant mâchée
, elle fait lortir la pituite & la falive, comme
la pyrethre ; c’eft pourquoi elle appaife les douleurs
des dents, & purge le cerveau humide. On en fait
ufage très-fréquemment parmi nous dans les falades ;
cHe tempere le froid & la crudité des autres plantes
avec lefquelles on la mêle. Geoffroy, mat. méd.
Veftragon contient une partie mobile, vive & piquante,
qui a-quelqu’analogie avec l’efprit volatil
Tome K.
des crüciferes, niais qui n’a pas les cara&eres efferi-
tiels de ces fels.
L'efiragon doit être rangé à cet égard avec Va.il,
l’oignon, le poireau, la capucine, & quelques autres",
que M. Boerhaave & fes copiftes placent malà
propos parmi les plantes qui contiennent un alkali
volatil nud. On prépare avec cette plarite un vinaigre
qu’on appelle vinaigre d'efiragon.
Le vinaigre Vefiragon entre dans l’eau prophylactique
de la pharmacopée de Paris, (b) Estragon , (Diete.) On mange les feuilles de
cette plante en falade, rarement feules ; ordinairement
avec la laitue, dont elles relevent admirablement
le goût. Cette efpece d’affaifonnement peut devenir
aufli fort utile pour l’eftomac , &: concourir
efficacement avec le fe l, le poivre & le vinaigre, à
corriger la fadeur, l’inertie d’une plante aqueufe &
infipide, telle que la laitue. Voye^ Laitue & Salade.
L'efiragon eft très-peu employé à titre de re*
mede.- (b) Estragon , (Chimie.) Wefiragon contient une
partie vive & piquante au goût & à l’odorat, & aufli
volatil que l’efprit des crüciferes, auquel il eft d’ailleurs
très-analogue. La nature de ce principë mobile
n’eft pas affez déterminée jufqu’à préfent ; les Chi-
miftes inftruits favent feulement que ce n’eft pas un
alkali volatil. (£)
ESTRAMADURE Espagnole (l’) , Gèog. mod.
province d’Efpagne, qui a environ 70 lieues de longueur
fur 40 de largeur. Elle eft bornée au feptentrion
par le royaume de Léon & la vieille Caftille ;
à l’orient par la nouvelle Caftille ; au midi par l’An-
daloufie, & à l’occident par le Portugal.
L’Andaloufie Portugaife eft une province du Portugal,
fituée vers l’embouchiire du Tage. Elle eft
bornée au feptentrion par la province de Beira ; à
l ’orient & au midi par l’AIentéjo ; à l’occident par
l’océan Atlantique. Elle fe divife en cinq territoires,
Sétuval, Alanguer, Santaren, Leiria, Torna. Lisbonne
en eft la capitale.
ESTRAN, (Marine.) c’eft une étendue de terrein
le long de la côte, laquelle eft très-plate & fablon-
neufe, & dont fouvent une partie eft couverte par
les hautes marées ; mais ce terme n’eft en ufage que
le long des côtes de Flandres & de Picardie.
ESTRANGEL, adj. (Littérat.) certains cara&eres
de l’alphabet fyriaque, qu’on en peut regarder aujourd’hui
comme les lettres majufcules. On a cru
que ces majufcules avoient été anciennement le véritable
caraâere courant.
ESTRAPADE , f. f. (Art milit.) eft une efpece
de punition militaire, dans laquelle, après avoir lié
au criminel les mains derrière le dos, on l’éleve avec
un cordage jufqu’au haut d’une haute piece de bois,
d’oii on le laifle tomber jufqu’au près de terre, de
maniéré qu’en tombant la pefanteur de fon corps lui.
difloque les bras. Quelquefois il eft condamné à recevoir
trois efirapades, ou même davantage.
Ce mot vient, dit-on, du vieux mot ejlreper, qui
fignifie brifer, arracher; ou bien de l’italien firappata,
du verbe firappare, tordre par force. Trévoux <S*
Chambers.
Vefirapade n’eft plus d’ufage, au moins en France.1 Estrapade , (Marine.) c’eft le châtiment qu’on
fait fouffrir à un matelot, en le guindant à la hauteur
d’une vergue, en le laiffant enfuite tomber dans
la mer, oh l’on le plonge une ou plulieurs fois félon
que le porte la fentence. C ’eft ce qu’on appelle autrement
donner la cale. J^oye^ CALE. Estrapade, (Manège.) expreffion ancienne, &
par laquelle on entendoit un châtiment donné avec
les renes du caveçon ou de la bride. Il feroit à fou-
haiter pour les chevaux, que l’afrion de châtier ainfi
fût aufli inufitée que ce mot. Quelques-uns lui don-; M M M mm m