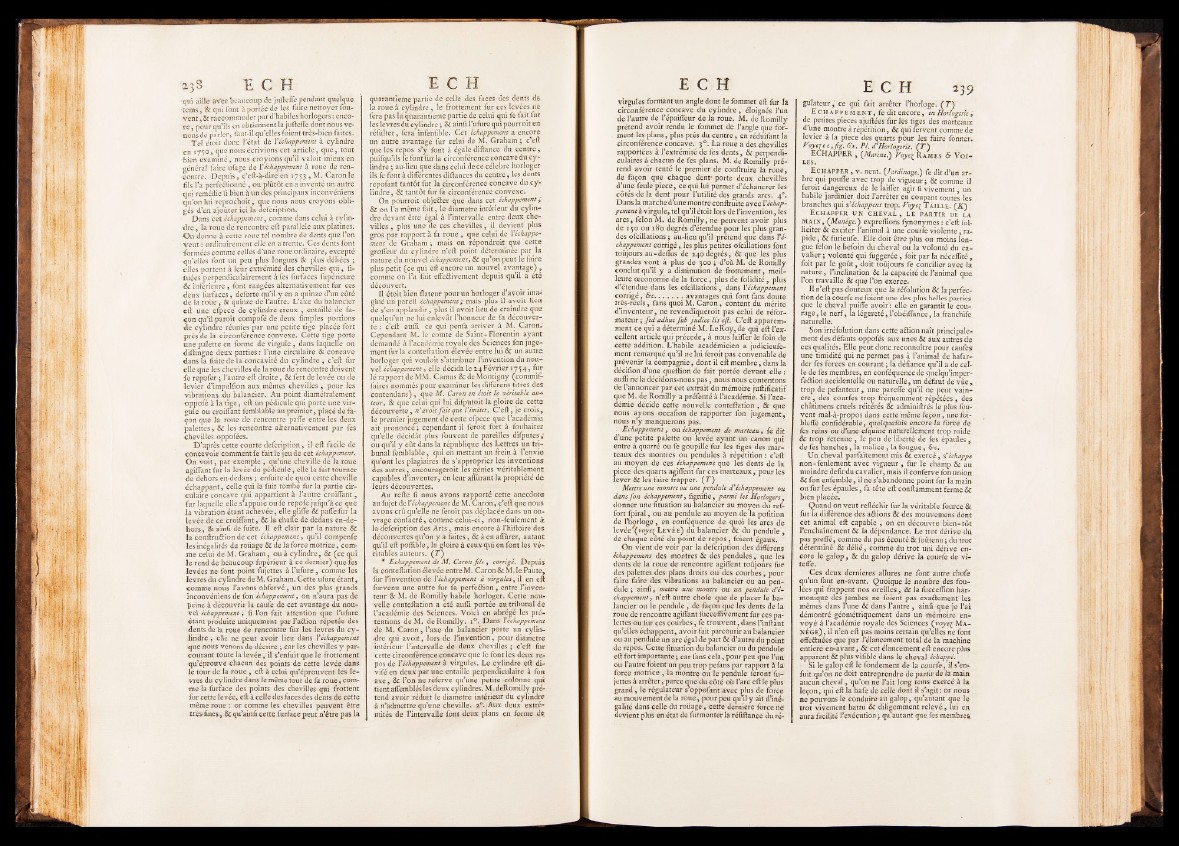
•qui aille aVec'beaucoup de jufteffe pendant quelque
-tems, & qui font à portée de les faire nettoyer fou-
vent & raccommoder par d habiles horlogers : enco-
Te, pour qu’ils en obtiennent la jufteffe dont nous venons
de parler, faut-il qu’elles foient très-bien faites.
Tel étoit donc l ’état de Yéchappement à cylindre
en 1750, que nous écrivions cet article, que, tout
bien examiné, nous croyions qu’il valoit mieux en
«énéral faire ufage de Y échappement à roue de rencontre.
Depuis, c’eft-à-dire en 1753 , M. Caronle
•fils l’a perfectionné , ou plûtôt en a inventé un autre
qui remédie fi-bien à un des principaux inconvéniens
■ qu’on lui reprochoit, que nous nous croyons obligés
d’en ajoûter ici la defeription.
Dans cet échappement, comme dans Celui à cylindre
, la roue de rencontre eft parallèle aux platines.
On donne à cette roue tel nombre de dents que l’on
veut : ordinairement elle en a trente. Ces dents font
formées comme celles d’une roue ordinaire, excepté
•qu’elles font un peu plus longues & plus déliées ;
elles portent à leur extrémité des chevilles qui, fi-
luées perpendiculairement à fes furfaces fupérieure
& inférieure , font rangées alternativement fur ces
deux furfaces, deforte qu’il y en a quinze d’un côté
de la roiie, & quinze de l’autre. L’axe du balancier
eft une efpece de cylindre creux , entaillé de façon
qu’il paroît compôfé de deux fimples portions
de cylindre réunies par une petite tige placée fort
près de la circonférence convexe. Cette tige porte
une palette en forme de virgule , dans laquelle on
dïftingue deux parties : l ’une circulaire & concave
dans la fuite de la concavité du cylindre , c ’eft fur
«lie que les chevilles de la roue de rencontre doivent
fe repofer ; l’autre eft droite, & fert de levée ou de
levier d’impulfion aux mêmes chevilles , pour les
vibrations du balancier. Au point diamétralement
oppofé à la tige, eft un pédicule qui porte une virgule
ou croiflant femblable au premier, placé de façon
que la roue de rencontre paffe entre les deux
palettes, & les rencontre alternativement par fes
'chevilles oppofées.
D ’après cette courte defeription, il eft facile de
concevoir comment fe fait le jeu de cet échappement*
On v o it , par exemple , qu’une cheville de la roue
agiflant fur la levée du pédicule, elle la fait tourner
de dehors en-dedans ; enfuite de quoi cette cheville
échappant, celle qui la fuit tombe fur la partie circulaire
concave qui appartient à l ’autre croiflant,
fur laquelle elle s’appuie ou fe repofe jufqu’à ce que
la vibration étant achevée, elle gliffe & paffe fur la
levée de ce croiffant, & la chaffe de dedans en-dehors
, & ainfi de fuite. Il eft clair par la nature &
la conftru&ion de cet échappement, qu’il compenfe
les inégalités du roiiage & de la force motrice, comme
celui de M. Graham, ou à cylindre, & (ce qui
le rend de beaucoup fupérieur à ce dernier) que les
levées ne font point fujettes à l’ufure , comme les
levres du cylindre de M. Graham. Cette ufure étant,
comme nous l’avons obfervé, un des plus grands
inconvéniens de fon échappement, on n’aura pas de
peine à découvrir la caufe de cet avantage du nouvel
échappement, fi l’on fait attention que l’ufure
étant produite uniquement par l’a&ion répétée des
dents de la roue de rencontre fur les levres du cylindre
, elle ne peut avoir lieu dans Yéchappement
que nous venons de décrire ; car les chevilles y parcourant
toute la levée, il s’enfuit que le frottement
qu’éprouve chacun des points de cette levée dans
le tour de la roue , eft à celui qu’éprouvent les levres
du cylindre dans le même tour de fa roue, comme
la furface des points des chevilles qui frottent
fur cette levée, eft à celle des faces des dents de cette
même roue : or comme les chevilles peuvent être
très-fines,-ôc qu’ainfi cette furfaçe peut n’être pas la
quarantième partie de celle dés faces des dents de
la roue à cylindre , le frottement fur ces levées nè
fera pas la quarantième partie de celui qui fe fait fut
les levres du cylindre ; & ainfi l’ufure qui pOurroit en
réfulter, fera infenfible, Cèt échappement a encore
un autrè avantage fur celui de M. Graham ; c’eft:
qlie les repos s’y font à égaie diftapce du centre -,
puifqu’ils fe font fur la circonférence concave du cylindre
; au-lieu que dans celui de ce célébré horloger
ils fe font à différentes diftances du centre, les dents
repofant tantôt fur la circonférence concave du c y lindre
, & tantôt fur fa circonférence convexe»
On pourroit objeCter que dans cet échappement £
& on l’a même fait, le diamètre intérieur du cylindre
devant être égal à l’intervalle entre deux chevilles
, plus une de ces chevilles, il devient plus
gros par rapport à fa roue , que celui de Yéchappe*
ment de Graham ; mais on répondroit que cette
groffeur du cylindre n’eft point déterminée par la
nature du nouvel échappement, & qu’on peut le faire
plus petit (ce qui eft encore un nouvel avantage) ,
comme on l’a fait effectivement depuis qu’il a été
découvert.
Il étoit bien dateur pour un horloger d’avoir imaginé
un pareil échappement ; mais plus il avôit lieu
de s’en applaudir, plus il avoit lieu de craindre que
quelqu’un ne lui enlevât l’honneur de fa découverte
: c’eft aufli ce qui penfa arriver à M. Caron-
Cependant M. le comte de Saint-Florentin ayant
demandé à l’acâdémië royale des Sciences fon jugement
fur la conteftation élevée entre lui & un autre
horloger qui vouloit s’attribuer l’invention du nouvel
échappement, elle décida le Z4Février 1754, fur
le rapport de MM. Camus & deMontigny (commit
faires nommés pour examiner les différens titres des
contendans) , que M. Caron en étoit le véritable au*
leur, & que celui qui lui difpütoit la gloire de cette
découverte, n avoit fait que Vimiter. C’eft, je crois,
le premier jugement de cette efpece que l ’académie
ait prononcé ; cependant il feroit fort à fouhaiter
qu’elle décidât plus fouvent de pareilles difputes }
ou qu’il y eût dans la république des Lettres un tribunal
femblable, qui eh mettant un frein à l’envie
qu’ont les plagiaires de s ’approprier les inventions
des autres, encourageroit les génies véritablement
capables d’inventer, en leur affürant la propriété de
leurs découvertes.
Au refte fi nous avons rapporté cette anecdote
au fujet deY échappement de M. Caron, c’eft que nous
avons crû qu’elle ne feroit pas déplacée dans un ouvrage
confacré, comme celui-ci, non-feulement à
la defeription des Arts, mais encore à l’hiftoire des
découvertes qu’on y a faites, & à en affûrer, autant
qu’il eft poflible, la gloire à ceux qui en font les vé*.
ritables auteurs. (T )
* Echappement de M, Caron f ils , corrigé. Depuis
la conteftation élevée entre M. Caron & M. le Paute,'
fur l’invention de Yéchappement à virgules, il en eft
furvenu une autre fur fa perfection, entre l’inventeur
& M. de Romilly habile horloger. Cette nouvelle
conteftation a été aufli portée au tribunal de
l’académie des Sciences. Voici en abrégé les prétentions
de M. de Romilly. i° . Dans Y échappement
de M. Caron, l’axe du balancier porte un cylindre
qui avoit, lors de l ’invention, pour diamètre
■ intérieur l’intervalle de deux chevilles ; c’eft fur
cette circonférence concave que fe font les deux repos
de Y échappement à virgules. Le cylindre eft di-
vifé en deux par une entaille perpendiculaire à fon
axe, & l’on ne réferve qu’une petite -colonne qui
tient affemblés les deux cylindres. M. deRomilly prétend
avoir réduit le diamètre intérieur du cylindre
à n’admettre qu’une cheville. 20. Aux deux extrémités
de l’intervalle font deux plans en forme de,
virgules formant un angle dont le fommet eft fur la
circonférence concave du cylindre, éloignés l’un
de l’autre de l’épaiffeur de la roue. M. de Romilly
prétend avoir rendu le fommet de l’angle que for-
. ment les plans, plus près du centre, en réduifant la
circonférence concave. 30. La roue a des chevilles
rapportées à l’extrémité de fes dents, & perpendiculaires
à chacun de fes plans. M. de Romilly prétend
avoir tenté le premier de conftruire la roue,
de façon que chaque dent* porte deux chevilles
d’une feule piece, ce qui lui permet d’échancrer les
côtés de la dent pour l’utilité des grands arcs. 40.
Dans la marche d’une montre conftruite avec Yéchap-
pement à virgule, tel qu’il étoit lors de l’invention, les
arcs, félon M. de Romilly, ne peuvent avoir plus
de 150 ou 180 degrés d’étendue pour les plus grandes
ofcillations ; au-lieu qu’il prétend que dans 17-
chappement corrigé, les plus petites ofcillations font
toûjours au-deffus de 240degrés, & que les plus
grandes vont à plus de 300 ; d’où M. de Romilly
conclut qu’il y a diminution de frottement, meilleure
oeconomie de la force, plus de folidité, plus
d’étendue dans les ofcillations , dans Yéchappement
corrigé, &c...............avantages qui font fans doute
très-réels, fans quoi M. Caron, content du mérite
d’inventeur, ne revendiqueroit pas celui de réformateur
; fed adhuc fub judice lis efi. C ’eft apparemment
ce qui a déterminé M. Le Roy, de qui eft l’excellent
article qui précédé, à nous laiffer le foin de
cette addition. L’habile académicien a judicieufe-
ment remarqué qu’il ne lui feroit pas convenable de
prévenir la compagnie, dont il eft membre, dans la
décifion d’une queftion de fait portée devant elle :
aufli ne la décidons-nous pas, nous nous contentons
de l’annoncer par cet extrait du mémoire juftificatif
que M. de Romilly a préfenté à l’académie. Si l’académie
décide cette nouvelle conteftation , & que
nous ayons occafion de rapporter fon jugement,-
nous n’y manquerons pas.
Echappement , on échappement de marteau, fe dit
d’une petite palette ou levée ayant un canon qui
entre à quarré ou fe goupille fur les tiges des marteaux
des montres ou pendules à répétition : c’eft
au moyen de ces échappemens que les dents de la
piece des quarts agiflent fur ces marteaux, pour les
lever & les faire frapper. (T )
Mettre une montre ou une pendule d'échappement ou
dans fon échappement, lignifie, parmi les Horlogers,
donner une fituation au balancier au moyen du ref-
fort fpiral, ou au pendule au moyen de la polition
de l’horloge, en conféquence de quoi les arcs de
levée^voy^ L e v é e ) du balancier & du pendule ,
de chaque côté du point de repos, foient égaux.
On vient de voir par la defeription des différens
échappemens des montres & des pendules, que les
dents de la roue de rencontre agiffent toûjours fur
des palettes des plans droits ou des courbes ', pour
faire faire des vibrations au balancier ou au pendule
; ainfi, mettre une montre ou un pendule d'échappement
, n’eft autre chofe que de placer le balancier
ou le pendule , de façon que les dents de la
roue de rencontre agiflant fucceflîvement fur ces palettes
ou fur ces courbes, fe trouvent, dans l’inftant
qu’elles échappent, avoir fait parcourir au balancier
ou au pendule un arc égal de part & d’autre du point
de repos. Cette fituation du balancier ou du pendule
eft fort importante ; car fans cela, pour peu que l’un
ou l’autre foient un peu trop pefans par rapport à la
force motrice , la montre ou le pendule feront fujettes
à arrêter, parce que du côté où l’arc eft le plus
grand, le régulateur s’oppofant avec plus de force
au mouvement de la roue, pour peu qu’il y ait d’inégalité
dans celle du roiiage, cette derniere force rie'
devient plus en état de furmonter là réfiftance durégulateur,'
ce qui fait arrêter l’horlogei ( T )
E c h a p p e m e n t , fe dit encore, en Horlogerie ;
de petites pièces ajuftées fur les tiges des marteaux
d’une montre à répétition, & qui fervent comme de
levier à la piece des quarts pour les faire fonner.
V o y e^ e e ,f ig . 62. P l . d'Horlogerie. ( T )
ECHAPPER , (Marine.) Foy er R a m e s & VOILES.
E c h a p p e r , v. neut. (Jardinage.) fe dit d’un arbre
qui pouffe avec trop de vigueur ; & comme il
feroit dangereux de le laiffer agir fi vivement un
habile jardinier doit l’arrêter en coupant toutes les
branches qui s'échappent trop. Foye^ T a il l e . (/£)
E c h a p p e r u n c h e v a l , l e p a r t ir d e l a
m a in , (Manège.) expreflioiis fynonymes : c’eft fol-
liciter & exciter l’animal à une courfe violente, rapide
, & furieufe. Elle doit être plus ou moins longue
félon le befoin du cheval ou la volonté1 du cavalier
; volonté qui fuggerée, foit par la néceffité,
foit par le goût, doit toûjours fe concilier ayec la
nature, l’inclination & la capacité de l’animal que
l’on travaille & que l’on exerce.
Il n’eft pas douteux que la réfolution & la perfection
de la courfe ne foient une des plus b e lle s parties
que le cheval puiffe avoir“: elle en garantit le courage,
le nerf, la légèreté, l’obéiffance, la franchife
naturelle.
Son irréfolution dans cette a&ion naît principalement
des défauts oppofés aux unes & aux autres de
ces qualités. Elle peut donc reconnoître pour caufes
une timidité qui ne permet pas à l’animal de hafar-
der fes forces en courant ; la défiance qu’il a de celle
de fes membres, en conféquence de quelqu’imper-
fe&ion accidentelle ou naturelle, un défaut de vûe,
trop de pefanteur, une pareffe qu’il ne peut vaincre
, des courfes trop fréquemment répétées , des
châtimens cruels réitérés & adminiftrés le plus fou-
vent mal-à-propos dans cette même l e ç o n , une fo i-
bleffe confidérable, q u e lq u e fo is e n c o r e la fo r c e d e
fe s reins ou d’une e fq u in e naturellement trop rôide
& trop retenue , le peu de liberté de fes épaules ,
de fes hanches, la malice, la fougue, & c .
■ Un cheval parfaitement mis & exercé, Réchappe
non-feulement avec vigueur , fur le champ & au
moindre defir du cavalier, mais il conferve fon union
& fon enfemble, il ne s’abandonne point fur la main
ou fur les épaules, fa tête eft conftamment ferme &
bien placée.
Quand On veut réfléchir fur la véritable fource &
fur la différence des a&ioris & des mouvemens dont
cet animal eft capable , on en découvre bien-tôt
Tenchaîriement & la dépendance. Le trot dérive du
pas preffé, comme du pas écouté & foûtenu; du trot
déterminé & délié, comme du trot uni dérive encore
le galop, & du galop dérive la eoürfe de vî-
teffe.
Ces deux dernieres allures ne font autre chofe
qu’un faut en-avant. Quoique le n om br e dés foulées
qui frappent nos oreilles, & la fucceflion harmonique
des jambes ne fo ie n t pas exactement les
mêmes dans l’une & dans l’autre , ainfi que je l’ai
démontré géométriquement dans un mémoire envoyé
à l’académie royale des Sciences (voye^ M a n
è g e ) , il n’en eft pas moins certain qu’elles ne font
effectuées que par l’élancement total de la ‘machine
entière en-avant, & cet élancement eft encore plus
apparent & plus vifible dàns le cheval échappé.
Si le galop eft le fondement de la courfe, il s’enfuit
qu’on ne doit entreprendre de partir de la main
aucun cheval, qu’on ne l’ait long rems exercé à la
leçon, qui eft la bafe de celle dont il s’agit: or nous
ne pouvons le conduire au galop, qu’autant que le
trot vivement battu & diligemment relevé, lui en
aura facilité l’exécution j qu’autant que. fes membres