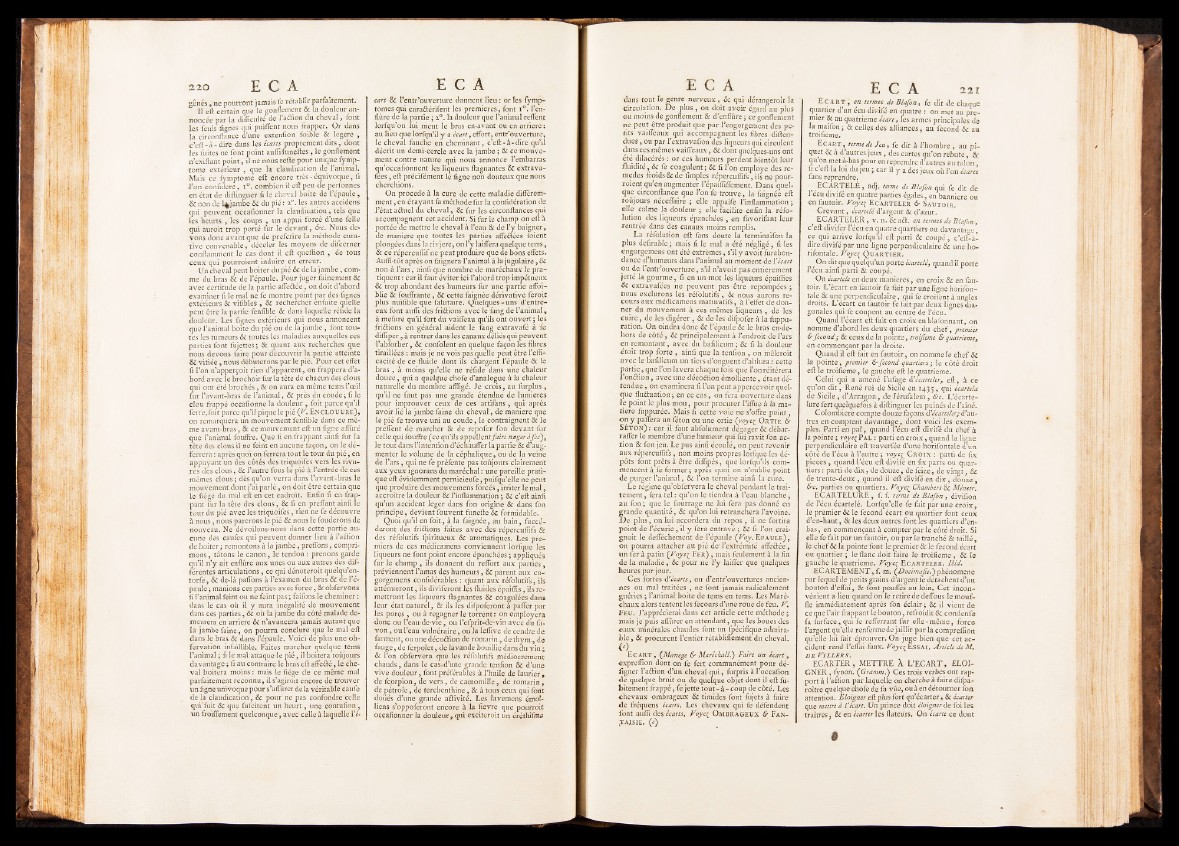
220 E C A gênés, ne pourront jamais fc rétablir parfaitement.
U eft certain que le gonflement & la douleur annoncée
par la difficulté de l’attion du cheval, font
les feuls lignes qui puiffent nous frapper. Or dans
îa circonflance d’une extenfion foible & legere ,
-•c’efl - à - dire dans les écarts proprement dits, dont
les fuitesne font point auffi funeftes, le gonflement
n’exiftant point, il ne nous relie pour unique fymp-
-tome extérieur , que la claudication de l’animal.
Mais ce fymptome ell encore très - équivoque, fi
l ’on confidere, i° . combien il eft peu de perl'onnes
en état de dillinguer li le cheval boîte de l’epaule,
& non de l^jambe 8c du pié : z°. les autres accidens
qui peuvent occalionner la claudication, tels que
les heurts , les coups , un appui forcé d’une felle
qui auroit trop porté fur le devant, &c. Nous devons
donc avant que de prefcrire la méthode curat
iv e convenable, déceler les moyens de difcerner
conllamment le cas dont il ell quelîion , de tous
ceux qui pourroient induire en erreur.
Un cheval peut boiter du pié & de la jambe, comme
du bras 8c de l’épaule. Pour juger fainement 8c
avec certitude de la partie affectée, on doit d’abord
examiner fi le mal ne fe montre point par des lignes
extérieurs & vifibles , 8c rechercher enfuite quelle
peut être la partie fenfible & dans laquelle réfide la
douleur. Les Agnes extérieurs qui nous annoncent
que l’animal boite du pié ou de la jambe , font toutes
les tumeurs & toutes les maladies auxquelles ces
parties font fujettes ; & quant aux recherches que
nous devons faire pour découvrir la partie atteinte
8c v itiée, nous débuterons par le pié. Pour cet effet
fi l’on n’apperçoit rien d’apparent, on frappera d’abord
avec le brochoir fur la tête de chacun des clous
qui ont été brochés, & on aura en même tems l’oeil
fur l’avant-bras de l’animal, 8c près du coude ; fi le
clou frappé occafionne la douleur , foit parce qu’il
ferre,foit parce qu’il pique le pié (V. Enclouure) ,
on remarquera un mouvement fenfible dans ce même
avant-bras, & ce mouvement eft un ligne affûré
que l’animal fouffre. Que fi en frappant ainfi fur la
tête des clous il ne feint en aucune façon, on le déferrera
: après quoi on ferrera tout le tour du pié, en
appuyant un des côtés des triquoifes vers les rivu-
res des clous, 8c l’autre fous le pié à l’entrée de ces
mêmes clous; dès qu’on verra dans l’avant-bras le
mouvement dont j’ai parlé, on doit être certain que
le fiége du mal eft en cet endroit. Enfin fi en frappant
fur la tête des clous, & fi en preffant ainfi le
tour du pié avec les triquoifes, rien ne fe découvre
à nous, nous parerons le pié 8c nous le fouderons de
nouveau. Ne dévoilons-nous dans cette partie aucune
des caufes qui peuvent donner lieu à l’attion
de boiter ; remontons à la jambe, preffons, comprimons
, tâtons le canon, le tendon : prenons garde
qu’il n’y ait enflure aux unes ou aux autres des différentes
articulations, ce qui dénoteroit quelqu’en-
torfe, & de-Ià paffons à l’examen du bras 8c de l’épaule
; manions ces parties avec force, & obfervons
fi l ’animal feint ou ne feint pas ; faifons le cheminer :
dans le cas où il y aura inégalité de mouvement
dans ces parties, 8c où la jambe du côté malade demeurera
en arriéré 8c n’avancera jamais autant que
la jambe faine, on pourra conclure que le mal eft
dans le bras 8c dans l’épaule. Voici de'plus une ob-
fervation infaillible. Faites marcher quelque tems
l’animal ; fi le mal attaque le pié, il boitera toujours
davantage ; fi au contraire le bras eft affetté, le cheval
boitera moins : mais le fiége de ce même mal
parfaitement reconnu, ils’agiroit encore de trouver
lin ligne univoque pour s’affûrer delà véritable caufe
de la claudication, 8c pour ne pas confondre celle
qui'fuit & que fufcitent un heurt, une contufion,
un fxoiffement quelconque, avec celle à laquelle IVE
C A cari & l’entr’ouverture donnent lieu : or les fymp-
tomes qui carattérifent les premières, font i° i l’en-
flûre de la partie ; z°. la douleur que l’animal relient
lorfqu’on lui meut le bras en-avant ou en arriéré :
au lieu que lorfqu’il y a écart, effort, entr’ouverture,
le cheval fauche en cheminant, c’eft-à-dire qu’il
décrit un demi-cercle avec la jambe ; & ce mouvement
contre nature qui nous annonce l’embarras
qu’occafionnent les liqueurs ftagnantes 8c extrava-
lees, eft précifément le ligne non douteux que nous
cherchions.
On procédé à la cure de cette maladie différemment
, en étayant fa méthode fur la confidération de
l’état attuel du cheval, 8c fur les circonftances qui
accompagnent cet accident. Si fur le champ on eft à
portée de mettre le cheval à l’eau & de l’y baigner,
de maniéré que toutes les parties affettées loient
plongées dans la rivjere, on l’y laiffera quelque tems,
& ce répercuffif ne peut produire que de bons effets.
Auffi-tôt après on faignera l’animal à la jugulaire, 8c
non à l’ars, ainfi que nombre de maréchaux le pratiquent
: car il faut éviter ici l’abord trop impétueux
8c trop abondant des humeurs fur une partie affoi-
blie & fouffrante, 8c cette faignée dérivative feroit
plus nuifible que falutaire. Quelques-uns d’e.ntre-
eux font auffi des frittions avec le fang de l’animal,
à mefure qu’il fort du vaiffeau qu’ils ont ouvert ; les
frittions en général aident le lang extravafé à fe
diffiper, à rentrer dans les canaux déliés qui peuvent
l’abforber, & confolent en quelque façon les fibres
tiraillées : mais je ne vois pas quelle peut être l’efficacité
de ce fluide dont ils chargent l’épaule & le
bras , à moins qu’elle ne réfide dans une chaleur
douce, qui a quelque chofe d’analogue à la chaleur
naturelle du membre affligé. Je crois, au furplus ,
qu’il ne faut pas une grande étendue de lumières
pour improuver ceux de ces artifans, qui après
avoir lié la jambe faine du cheval, de maniéré que
le pié fe trouve uni au coude, le contraignent & le
preffent de marcher & de repofer fon devant fur
celle qui fouffre (ce qu’ils appellent faire nager àfeef
le tout dans l’intention d’échauffer la partie 8c d’augmenter
le volume de la céphalique, ou de la veine
de l’ars, qui ne fe préfente pas toujours clairement
aux yeux ignorans du maréchal : une pareille pratique
eft évidemment pernicieufe,puifqu’elle ne peut
que produire des mouvemens forcés, irriter le mal,
accroître la douleur 8c l’inflammation ; 8c c’eft ainfi
qu’un accident leger dans fon origine & dans fon
principe, devient fouvent funefte 8c formidable.
Quoi qu’il en foit, à la faignée, au bain, fuccé-
deront des frittions faites avec des répereuffifs &
des réfolutifs fpiritueux 8c aromatiques. Les premiers
de ces médicamens conviennent lorfque les
liqueurs ne font point encore épanchées ; appliqués
fur le champ , ils donnent du reffort aux parties,
préviennent l’amas des humeurs, 8c parent aux en-
gorgemens confidérables : quant aux réfolutifs, ils
atténueront, ils diviferont les fluides épaiffis, ils remettront
les liqueurs ftagnantes & coagulées dans
leur état naturel, & ils les difpoferont à paffer par
les pores , ou à regagner le torrent : on employera
donc ou l’eau-de-vie, ou l’efprit-de-vin avec du fa-
v o n , ou l’eau vulnéraire, ou la leffive de cendre de
farment, ou line décottion de romarin, de thym, de
fauge, de ferpolet, de lavande bouillie dans du vin ;
& l’on obfervera que les réfolutifs médiocrement
chauds, dans le cas. d’une grande tenfion 8c d’une
vive douleur, font préférables à l’huile de laurier,
de fçorpion, de vers , de camomille, de romarin,
de pétrole, de terebenthine, & à tous ceux qui font
doués d’une grande attivité. Les lavemens émoi-
liens s’oppoferont encore à la fievre que pourroit
occafionner la douleur, qui exciteroit un éréthifme
E G A
clans tout le genre nerveux, 8c qui dérangeroit la
circulation. De plus, on doit avoir égard au plus
ou moins de gonflement & d’enflûre ; ce gonflement
ne peut être produit que par l’engorgement des petits
vaiffeaux qui accompagnent les fibres diften-
dues, ou par l’extravafion des liqueurs qui circulent
dans ces mêmes vaiffeaux, 8c dont quelques-uns ont
été dilacérés : or ces humeurs perdent bientôt leur
fluidité, 8c fe coagulent ; 8c li l’on employé des re-
medes froids & de fimples répereuffifs, ils ne pourroient
qu’en augmenter l’épaiffiffement. Dans quelque
circonflance que l’on fe trouve, la faignée eft
toujours néceffaire ; elle appaife l ’inflammation ;
elle calme la douleur ; elle facilite enfin la réfo-
lution des liqueurs épanchées , en favorifant leur
rentrée dans des canaux moins remplis.
La réfolution eft fans doute la terminaifon la
plus defirable ; mais fi le mal a été négligé, fi les
engorgemens ont été extrêmes, s’il y avoit furabon-
dance d’humeurs dans l’animal au moment de Y écart
ou de l’entr’ouverture, s’il n’avoit pas entièrement
jette la gourme, fi en un mot les liqueurs épaiffies
8c extravafées ne peuvent pas être repompées ;
nous exclurons les réfolutifs , & nous aurons recours
aux médicamens maturatifs, à l’effet de donner
du mouvement à ces mêmes liqueurs , dè les
cuire, de les digérer, & de les difpofer à la fuppu-
ration. On oindra donc 8c l’épaule 8c le bras en-dehors
de cô té , 8c principalement à l’endroit de l’ars
en remontant, avec du bafilicum ; 8c fi la douleur
étoit trop forte , ainfi que la tenfion , on mêleroit
avec le bafilicum un tiers d’onguent d’althæa : cette
partie, que l’on lavera chaque fois que l’on réitérera
l ’onttion, avec une décottion émolliente, étant détendue
, on examinera fi l’on peut appercevoir quelque
fluttuation; en ce cas, on fera ouverture dans
le point le plus mou, pour procurer l’iffue à la matière
fuppurée. Mais fi cette voie ne s’offre point,
°n y paffera un féton ou une ortie (voyez O r t i e &
S é t o n ) : car il faut abfolument dégager 8c débar-
raffer le membre d’une humeur qui lui ravit fon action
& fon jeu. Le pus ainfi écoulé, on peut revenir
aux répereuffifs, non moins propres lorfque les dé-
ppts font prêts à être diffipés, que lorfqu’ils commencent
à fe former ; après quoi on n’oublie point
de purger l’animal, 8c l’on termine ainfi la cure.
Le régime qu’obfer’vera le cheval pendant le traitement
, fera tel : qu’on le tiendra à l’eau blanche,
au fon ; que le fourrage ne lui fera pas donné en
grande quantité, 8c qu’on lui retranchera l’avoine.
D e plus, on lui accordera du repos , il ne fortira
point de l’écurie, il y fera entravé ; & fi l’on crai-
gnoit le defféchement de l’épaule (Voy. Epaule) ,
on pourra attacher au pié de’ l’extrémité affettée,
un fer à patin ( Voyez F e r ) , mais feulement à la fin
de la maladie, 8c pour ne l’y laiffer que quelques
heures par jour.
Ces fortes à?écarts, ou d’entr’ouvertures anciennes
ou mal traitées , ne font jamais radicalement
guéries; l’animal boite de tems en tems. Les Maréchaux
alors tentent les fecours d’une roue de feu. V
Feu. J’apprécierai dans cet article cette méthode ;
mais je puis affûrer en attendant , que les boues des
eaux minérales chaudes font un fpécifique admirable
, & procurent l’entier rétabliffement du cheval.
m . . .
■ Ecart , (Manege & Maréchall.j Faire un écart,
expreffion dont on fe fert communément pour dé-
figner l’attion d’un cheval qui, furpris à l’occafion
de quelque bruit ou de quelque objet dont il eft fu-
bitement frappé, fe jette tout - à - coup de côté. Les
chevaux ombrageux 8c timides font fujets à faire
de fréquens écarts. Les chevaux qui fe défendent
font auffi des écarts t Voyez OMBRAGEUX & FANTAISIE.
(e)
E C A 221
E c a r t , en termes de Blafon, fe dit de chaque
quartier d’un écu divifé en quatre : on met au premier
& au quatrième écart, les armes principales de
la maifon ; & celles des alliances, au fécond 8c au
troifieme.
E c a r t , terme de Jeu, fe dit à l’hombre , au piquet
8c à d’autres jeux, des cartes qu’on rebute, &
qu on met à-bas pour en reprendre d’autres au talon,
fi c eft la loi du jeu ; car il y a des jeux où l’on écarte
fans reprendre.
,, ECARTELÉ, ad), terme de Blafon qui fe dit de
l’écu divifé eh quatre parties égales, en bannière ou
en fautoir. Voyez E c a r t e l e r & Sa u t o ir .
Crevant, écartelé d’argent & d’azur.
s ECARTELER, v . n. 8c att. en termes de Blafon ,
c’eft divifer l’écu en quatre quartiers ou davantage
ce qui arrive lorfqu’il eft parti & coupé, c’eft-à-
dire divifé par une ligne perpendiculaire 8c une ho-
rifontale. Voyez Q u a r t i e r .
; On dit que quelqu’un porte écartelé, quand il porte
l’écu ainfi parti & coupé.
On écartele en deux maniérés, en croix & en fautoir.
L’écart en fautoir fe fait par une ligne horifon-
tale & une perpendiculaire, qui fe croifent à angles
droits. L’écart en fautoir fe fait par deux lignes diagonales
qui fe coupent au centre de l’écu.
Quand l’écart eft fait en croix enblafonnant, on
nomme d’abord les deux quartiers du chef, premier
& fécond; 8c ceux de la pointe, troifieme & quatrième*
en commençant par la droite.
Quand il eft fait en fautoir, on nomme le chef &
la pointe, premier & fécond quartiers ; le côté droit
eft le troifieme, le gauche eft le quatrième.
Celui qui a amené l’ufage d'écarteler, eft, à ce
qu’on dit, René roi de Sicile en 1435, T-1* écartela
de Sicile, d’Arragon, de Jérufalem , &c. L’écarte-
lure fert quelquefois à dillinguer les puînés de l’aîné.
Colombiere compte douze façons à?ecarteler; d’autres
en comptent davantage, dont voici les exemples.
Parti en p a l, quand l’écu eft divifé du chef à
la pointe ; voyez P a l : parti en croix, quand la ligne
perpendiculaire eft traverfée d’une horifontale d’un
côté de l’écu à l’autre ; voyez C r o ix : parti de fix
pièces, quand l’écu eft divifé en fix parts ou quartiers
: parti de d ix, de douze, de feize, de vingt, 8c
de trente-deux, quand il eft divifé en d ix, douze ,
&c. parties ou quartiers. Voyez Chambers 8c Ménetr.
ECARTELURE , f. f. terme de Blafon , divifion
de l’écu écartelé. Lorfqu’elle fe fait par une croix,
le premier 8c le fécond écart ou quartier font ceux
d’en-haut, & les deux autres font les quartiers d’en-
bas, en commençant à compter par le côté droit. Si
elle fe fait par un fautoir, ou par le tranché & taillé,
le chef & la pointe font le premier & le fécond écart
ou quartier ; le flanc doit faire le troifieme , 8c le
gauche le quatrième. Voyez E c a r t e l e r . Ibid.
ECARTEMENT, f. m. (Docimafie.') phénomène
par lequel de petits grains d’argentfe détachent d’un
bouton d’effai, & font pouffés au loin. Cet inconvénient
a lieu quand on le retire de deffous le mouf-
fle immédiatement après fon éclair ; 8c il vient de
ce que l’air frappant le bouton, refroidit 8c condenfe
fa furface, qui fe refferrant fur elle - même, force
l’argent qu’elle renferme de jaillir par la compreffion
qu’elle lui fait éprouver. On juge bien que cet accident
rend l’effai faux. Voyez E s s a i. Article de M.
DE VlLLERS.
ECARTER, METTRE À L’E C ART, ELOIGNER
, fynon. ( Gramm.) Ces trois verbes ont rapport
à l ’attion par laquelle on cherche à faire difpa-
roître quelque chofe de fa vûe, ou à en détourner ion
attention. Eloigner eft plus fort qu’écarter , & écarter
que mettre à l'écart. Un prince doit éloigner de foi les
traîtres, 8c en écarter les dateurs. On écarte ce dont