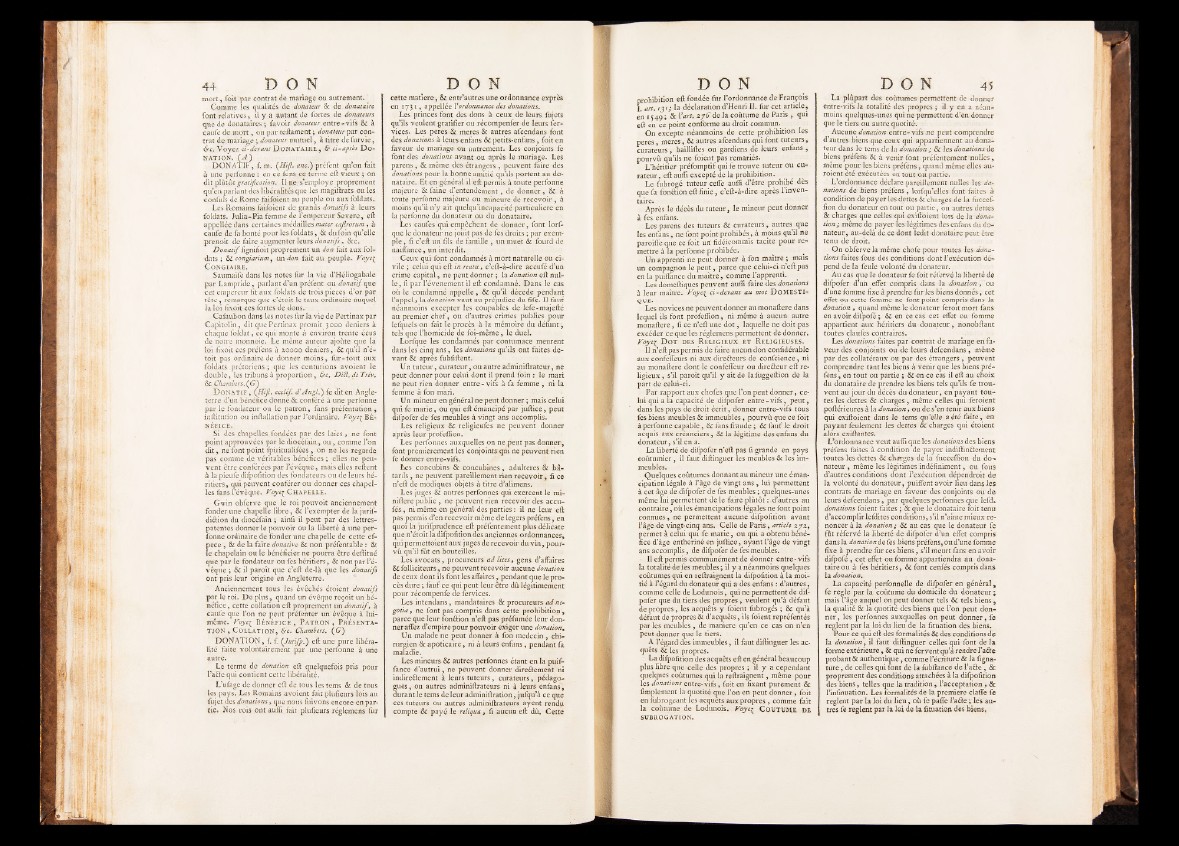
mort , foit par contrat de mariage ou autrement.
Comme les qualités de donateur 8c de donataire
font relatives, il y a autant de fortes de donateurs
que de donataires ; fa voir donateur entre-vifs 8c à
-caufe de mort, ou par teftament ; donateur par contrat
de mariage ; donateur mutuel, à titre de furvie,
<S*c. Voyez ci-devant DONATAIRE, & ci-après DONATION,
(A ) _
DONATIF, f. m. (Hiß. anc.') préfent qu’on fait
•à une perfonne : en ce fens ce terme eft vieux ; on
dit plutôt gratification. Il ne s’employe proprement
qu’en parlant des libéralités que les magiftrats ou les
eonfuls de Rome faifoient au peuple ou aux foidats.
Les Romains faifoient de grands donàtifs à leurs
foidats. Julia-Pia femme de l’empereur Severe, eft
appellée dans certaines médailles mater caftrorum, à
caufe de fa bonté pour les foidats, & du foin qu’elle
prenoit de faire augmenter leurs donàtifs, &c.
Donatif fignifioit proprement un don fait aux foidats
; & congiarium, un don fait au peuple. Voyez
ÇONGIAIRE.
Saumaife dans les notes fur la vie d’Héliogabale
par Lampride, parlant d’un préfent ou donatif que
cet empereur fit aux foidats de trois pièces d’or par
tête, remarque que c’étoit le taux ordinaire auquel
la loi fixoit ces fortes de dons.
Cafaubon dans les notes fur la vie de Pertinax par
Capitolin, dit que Pertinax promit 3000 deniers à
chaque foldat, ce qui monte à environ trente écus
de notre monnoie. Le même auteur ajoute que la
loi fixoit ces préfens à zoooo deniers, 8c qu’il n’é-
toit pas ordinaire de donner moins, fur-tout aux
foidats prétoriens ; que les centurions avoient le
double, les tribuns à proportion, &c. Dicl, de Trév.
8c Chambers.(G')
D o na tif , (Hiß. eccléf. d'Angl.') fe dit en Angle-
terre d’un bénéfice donné & conféré à une perfonne
par le fondateur ou le patron, fans préfentation ,
inftitution ou inftallation par l ’ordinaire. Voyez Bén
é f ice.
Si des chapelles fondées par des laïcs, ne font
point approuvées par le diocéfain, ou , comme l’on
d it , ne font point fpiritualifées, on ne les regarde
pas comme de véritables bénéfices ; elles ne peuvent
être conférées par l’évêque, mais elles relient
à la pieufe difpofition des fondateurs ou de leurs héritiers,
qui peuvent conférer ou donner ces chapelles
fans l’évêque. Voyez CHAPELLE.
Gwin obferve que le roi pouvoit anciennement
fonder une chapelle libre, 8c l’exempter de la jurif-
diriion du diocéfain ; ainfi il peut par des lettres-
patentes donner le pouvoir ou la liberté à une perfonne
ordinaire de fonder une chapelle de cette ef-
pece , & de la faire donative 8c non préfentable : &
le chapelain ou le bénéficier ne pourra être deftitué
que par le fondateur ou fes héritiers, & non par l’évêque
; 8c il paroît que c’eft de-là que les donàtifs
ont pris leur origine en Angleterre.
Anciennement tous les évêchés étoient donàtifs
par le roi. De plus, quand un évêque reçoit un bénéfice
, cette collation eft proprement un donatif, à
caufe que l’on ne peut préfenter un évêque à lui-
même. Voye1 Bén é f ic e , Pa t r o n , Présentation
,.C o lla t io n , &c. Chambers. ( G)
DONATION, f. f. (Jurifp.) eft une pure libéralité
faite volontairement par une perfonne à une
autre.
Le terme de donation eft quelquefois pris pour
Tarie qui contient cette libéralité.
L’ufage de donner eft de tous les tems & de tons
les pays. Les Romains avoient fait piufieurs lois au
fujet des donations, que nous lui'vons encore en partie.
Nos rois ont aufîi fait piufieurs réglemens fur
cette matière, 8c entr’autres une ordonnance exprès
en 173 1 , appellée l’ordonnance des donations.
Les princes font des dons à ceux de leurs fujets
qu’ils veulent gratifier ou récompenfer de leurs fer-
vices. Les peres 8c meres & autres afeendans font
des donations à leurs enfans 8c petits-enfans, foit en
faveur de mariage ou autrement. Les conjoints fe
font des donations avant ou après le mariage. Les
parens , 8c même des étrangers , peuvent faire des
donations pour la bonne amitié qu’ils portent au donataire.
Et en général il eft permis à toute perfonne
majeure & faine d’entendement, de donner, & à
toute perfonne majéure ou mineure de recevoir , à
moins qu’il n’y ait quelqu’incapacité particulière en
la perfonne du donateur ou du donataire.
Les caufes qui empêchent de donner, font lorf-
que le donateur ne joiiit pas de fes droits ; par exemple
, fi c’eft un fils de famille , un muet & fourd de
naiflance, un interdit.
Ceux qui font condamnés à mort naturelle ou civile
; celui qui eft in reatu, c’eft-à-dire accufé d’un
crime capital, ne peut donner ; la donation eft nulle
, fi par l’évenement il eft condamné, Dans le cas
où le condamné appelle, 8c qu’il décédé pendant
l’appel, la donation vaut au préjudice du fifç. Il faut
néanmoins excepter les coupables de lefe-majefté
au premier chef, ou d’autres crimes publics pour
lefquels on fait le procès à la mémoire du défunt
tels que l’homicide de foi-même, le duel.
Lorfque les condamnés par contumace meurent
dans les cinq ans, les donations qu’ils ont faites devant
8c après fubfiftent.
Un tuteur, curateur, ou autre adminiftrateur, ne
peut donner pour celui dont il prend foin : le mari
ne peut rien donner entre - vifs à fa femme , ni la
femme à fon mari.
Un mineur en général ne peut donner ; mais celui
qui fe marie, ou qui eft émancipé par juftice, peut
difpofer de fes meubles à vingt ans accomplis.
Les religieux 8c religieufes ne peuvent donner
après leur profefllon.
Les perfonnes auxquelles on ne peut pas donner j
font premièrement les conjoints qüi ne peuvent rien
fe donner entre-vifs.
Les concubins & concubines, adultérés & bâtards
, ne peuvent pareillement rien recevoir , fi ce
n’eft de modiques objets à titre d’alimens.
Les juges & autres perfonnes qui exercent le mi-
niftere public , ne peuvent rien recevoir des accu-
fés , ni même en général des parties : il ne leur eft
pas permis d’en recevoir même de légers préfens, en
quoi la jurifprudènce eft préfentement plus délicate
que n’étoit la difpofition des anciennes ordonnances,
qui permettoient aux juges de recevoir du vin, pourvu
qu’il fût en bouteilles.
Les avocats, procureurs ad lues, gens d’affaires
8c. folliciteurs, ne peuvent recevoir aucune donation
de ceux dont ils font les affaires, pendant que le procès
dure ; fauf ce qui peut leur être dû légitimement
pour récompenfe de fervices.
Les intendans, mandataires & procureurs ad ne-
gotia, ne font pas compris dans cette prohibition ,
parce que leur fonriion n’eft pas préfumée leur donner
affez d’empire pour pouvoir exiger une donation.
Un malade ne peut donner à fon médecin , chirurgien
& apoticaire, ni à leurs enfans, pendant fa
maladie.
Les mineurs 8c autres perfonnes étant en la puif-
fance d’autrui, ne peuvent donner directement ni
indirectement à leurs tuteurs, curateurs, pédagogues
, ou autres adminiftrateurs ni à leurs enfans'l
durant le tems de leur adminiftration, jufqu’à ce que
ces tuteurs ou autres adminiftrateurs ayent rendu
compte 8c payé le reliqua, fi aucun eft dû. Cette
prohibition eft fondée fur l’ordonnance de François
I. art. 131; la déclaration d’Henri II. fur cet article,
en 1549 ; & l'art. 2.76 de la coûtume de Paris , qui
eft en ce point conforme au droit commun.
On excepte néanmoins de cette prohibition les
peres, meres, 8c autres afeendans qui font tuteurs ;
curateurs, bailliftes ou gardiens de leurs enfans ,
pourvû qu’ils ne foient pas remariés.
L’héritier préfomptif qui fe trouve tuteur ou curateur
, eft aufîi excepté de la prohibition.
Le fubrogé tuteur ceffe aufîi d’être prohibe dès
que fa fonûion eft finie, c’eft-à-dire après l’inventaire.
Après le décès du tuteur, le mineur peut donner
à fes enfans.
Les parens des tuteurs & Curateurs, autres que
les enfans, ne font point prohibés, à moins qu il ne
paroifle que ce foit un’ fidéicommis tacite pour remettre
à la perfonne prohibée. ^
Un apprenti ne peut donner à fon maître ; mais
un compagnon le peut, parce que celui-ci n’eft pas
en la puiffance du maître, comme l’apprenti.
- Les domeftiques peuvent aufîi faire des donations
à leur maître. Voyez ci-devant au mot DOMESTIQUE.
Les novices ne peuvent donner au monaftere dans
lequel ils font profefïion, ni même à aucun autre
monaftere, fi ce n’eft une dot, laquelle ne doit pas
excéder ce que les réglemens permettent de donner.
Voye^ D o t des Religieux et Religieuses.
Il n’eft pas permis de faire aucun don confidérable
aux confeffeurs ni aux directeurs de confcience, ni
au monaftere dont le confeffeur ou directeur eft religieux
, s’il paroît qu’il y ait de la fuggeftion de la
part de celui-ci.
Par rapport aux chofes que l’on peut donner, celui
qui a la capacité de difpofer entre-vifs, peut,
dans les pays de droit écrit, donner entre-vifs tous
fes biens meubles & immeubles, pourvû que ce foit
à perfonne capable, 8c fans fraude ; 8c fauf le droit
acquis aux créanciers, 8c la légitime des enfans du
donateur, s’il en a.
La liberté de difpofer n’éft pas fi grande en pays
eoûtumier, il faut diftinguer les meubles & les immeubles.
Quelques coûtumes donnant au mineur une émancipation
légale à l’âge de vingt ans , lui permettent
à cet âge de difpofer de fes meubles ; quelques-unes
même lui permettent de le faire plûtôt : d’autres au
contraire, où les émancipations légales ne font point
connues, ne permettent aucune difpofition avant
l’âge de vingt-cinq ans. Celle de Paris, article 272,
permet à celui qui fe marie, ou qui a obtenu bénéfice
d’âge entheriné en juftice, ayant l’âge de vingt
ans accomplis, de difpofer de fes meubles.
• Il eft permis communément de donner entre - vifs
la totalité de fes meubles ; il y a néanmoins quelques
coûtumes qui en reftraignent la difpofition à la moitié
à l’égard du donateur qui a des enfans : d’autres,
comme celle de Lodunois,. qui ne permettent de difpofer
que du tiers des propres, veulent qu’à défaut
de propres, les acquêts y foient fubrogés ; 8c qu’à
défaut de propres & d’acquêts, ils foient repréfentés
par les meubles, de maniéré qu’en ce cas on n’en
peut donner que le tiers.
A l’égard des immeubles, il faut diftinguer les acquêts
8c les propres.
La difpofition des acquêts eft en général beaucoup
plus libre que celle des propres ; il y a cependant
quelques coûtumes qui la reftraignent, même pour
les donations entre-vifs, foit en fixant purement 8c
Amplement la quotité que l’on en peut donner , foit
en fubrogeant les acquêts aux propres , comme fait
la coûtume de Lodunois, Voyez C outume de
subrogation.
La plupart des coûtumes permettent de donner
entre-vifs la totalité des propres ; il y en a néanmoins
quelques-unes qui ne permettent d’én donner
que le tiers ou autre quotité.
Aucune donation entre-vifs ne peut comprendre
d’autres biens que ceux qui appartiennent au donateur
dans le tems de la donation ; 8c les donations de
biens préfens 8c à venir font , préfentement nulles,
même pour les biens préfens, quand même elles auraient
été exécutées en tout ou partie.
L’ordonnance déclare pareillement nulles les donations
de biens préfens, lorfqu’elles font faites à
condition de payer les dettes & charges, de la fuccef-
fion du donateur en tout ou partie, ou autres dettes
& charges que celles qui exiftoient lors de la donation;
même de payer les légitimes des enfans du donateur,
au-delà de ce dont ledit donataire peut être
tenu de droit.
On obferve la même chofe pour toutes les dénotions
faites fous des conditions dont l’exécution dépend
de la feule volonté du donateur.
Au cas que le donateur fe foit réfervé la liberté de
difpofer d’un effet compris dans la donation, ou
d’une fomme fixe à prendre fur les biens donnés, cet
effet ou cette fomme ne font point compris dans la
donation , quand même le donateur ferait mort fans
en avoir dilpofé ; & en ce cas cet effet ou fomme
appartient aux héritiers du donateur, nonobftant
toutes çlaufes contraires.
Les donations faites par contrat de mariage en faveur
des conjoints ou de leurs defeendans , même
par des collatéraux ou par des étrangers, peuvent
comprendre tant les biens à venir que les biens préfens
, en tout ou partie ; & en ce cas il eft au choix
du donataire de prendre les biens tels qu’ils fe trouvent
au jour du décès du donateur, en payant toutes
les dettes 8c charges, même celles qui feraient
poftérieures à la donation, ou de s’en tenir aux biens
qui exiftoient dans le tems qu’elle a été faite, èn
payant feulement les dettes & charges qui étoient
alors exiftantes.
L’ordonnance veut aufli que les donations des biens
préfens faites à condition de payer indiftinriement
toutes les dettes & chargés de la fucceflion du donateur
, même les légitimes indéfiniment, ou fous
d’autres conditions dont l’exécution dépendrait de
la volonté du donateur, puiffent avoir lieu dans les
contrats de mariage en faveur des conjoints oiv de
leurs defeendans, par quelques perfonnes que lefd,
donations foient faites ; & que le donataire loit tenu
d’accomplir lefdites conditions, s’il n’aime mieux renoncer
à la donation; 8c au cas que le donateur fe
fût réfervé la liberté de difpofer d’un effet compris
dans la donation de fes biens préfens, ou d’une fomme
fixe à prendre fur ces biens, s’il meurt fans en avoir
difpofé , cet effet ou fomme appartiendra au donataire
ou à fes héritiers, 8c font cenfés compris dans
la donation..
La capacité perfonnelle de dilpofer en général,
fe réglé par la coûtume du domicile du donateur ;
mais l’âge auquel on peut donner tels 8c tels biens,
la qualité & la quotité des biens que l’on peut donner',
les perfonnes auxquelles on peut donner, fe
règlent par la loi du lieu de la fituation des biens.
Pour ce qui eft des formalités 8c des conditions dé
la donation, il faut diftinguer celles qui font de la
forme extérieure, & qui ne fervent qu’à rendre l’a rie
probant & authentique, comme l’écriture & la figna-
ture, de celles qui font de la fubftance de Tarie, &
proprement des conditions attachées à la difpofition
des biens, telles que la tradition, l’acceptation , &
l’infinuation. Les formalités de la première claffe fe
règlent par la loi du lieu, où fe paffe Tarie ; les autres
fe règlent par la loi de la fituation des biens.