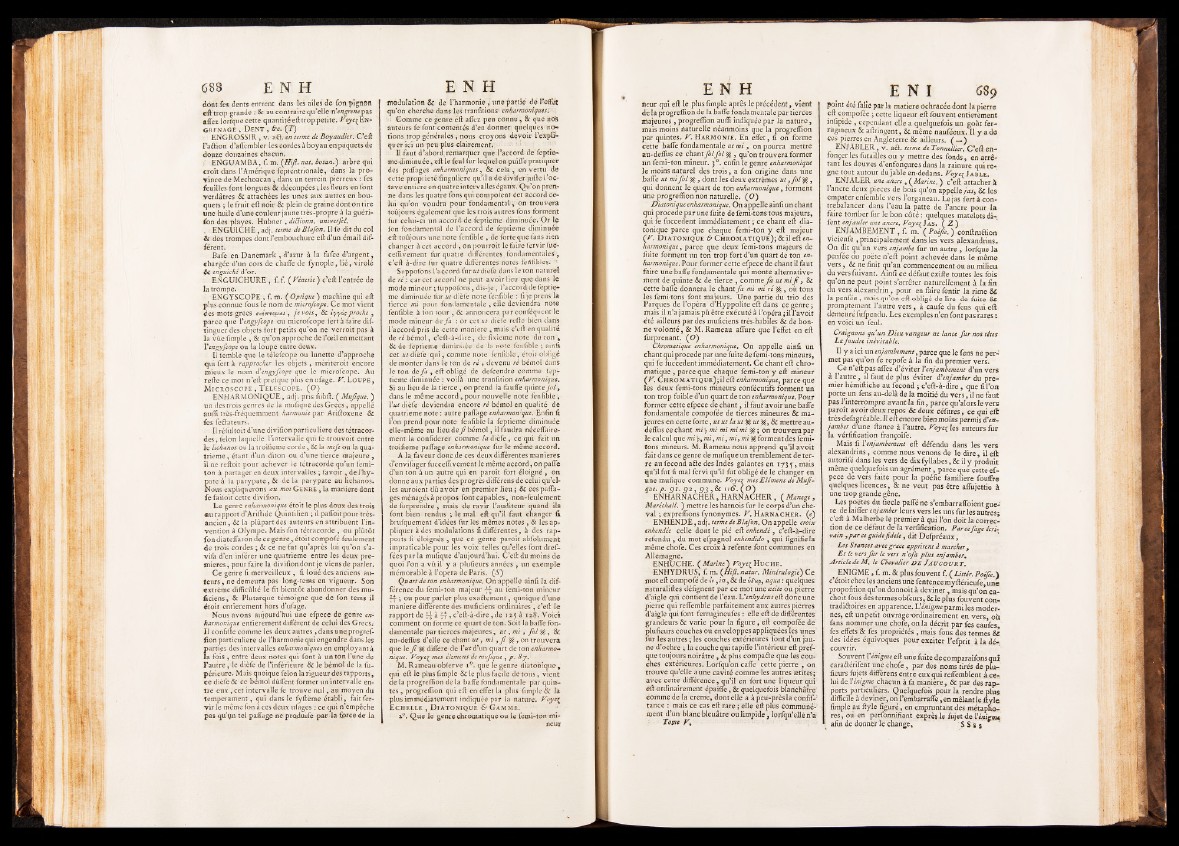
$ 8 8 E N H
dont fes dents entrent dans les ailes de fon pignon
eft trop grande : & au contraire qu’elle Vengfene pas
affez lorique cette quantité efttroppetite. Vcye%En-*-
crfnage , Dent , &c. (T)
ENGROSSIR , V; aû. en terme de Boyaudier. C’eft
l’aûion d’affembler les cordes à boyau enpàquets de
douze'douzaines chacun..
b ÈNGUAMBA, f. m. {Hiß. nat. botanJ) arbre qui
croît dans l’Amérique feptentrionalé, dan? la province
de Mechoacan, dans un terrein pierreux : fes
feuilles font longues & découpées ; les fleurs en font
verdâtres & attachées les unes aux autres en bouquets
; le fruit eft noir & plein de graine dont on tire
une huile d’une couleur jaune très-prppre à la guéri-
fon des playes. Hühner , diclionn. univerfel.
. ENGU1CHÉ, adj. terme de Blafon. Il fe dit du col
& dès trompes dont l’embouchure eft d’un émail différent.
Bafe en Danemark , d’azur à la fafce d’argent,
chargée d’un cors de chaffe de fynople, lié, virole
6c enguiché d’or. 3 ENGUICHURE , f. f. ( Vénerie ) c’eft l’entrée de
la trompe.
ENGYSCOPE , f. m. ( Optique ) machine qui eft
plus connue fous le nom de microfcope. Ce mot vient
des mots grecs a/À 7tT 0fx< ti, je vois, 6c t y y ù ç proche ,
parce que Vengyfcope ou microfcope fert à faire dif-
tinguer des objets fort petits qu’on ne verroit pas à
la vuefimple , & qu’on approche de l’oeil en mettant
Vengyfcope ou la loupe entre deux.
Il femble que le télefcope ou lunette d’approche
qui fert à rapprocher les objets , mériteroit encore
mieux le nom Vengyfcope que le microfcope. Au
refte ce mot n’eft prefque plus en ufage. V. Loupe,
Microscope , Telescope. (O )
ENHARMONIQUE, adj. pris fubft. ( Mußque. )
un.des trois genres de la mufique des Grecs , appelle,
aufll trèsffréquemment harmonie par Ariftoxene 6c
fes feôateurs.
Il réliiltoit d’une divifion particulière des tétracor-
des, lelon laquelle l’intervalle qui le trouvoit entre
le lichanôs ou la troifieme corde, 6c la mefe ou la quatrième
, étant d’un diton ou d’une tierce majeure ,
il ne reftoit pour achever le tétracorde qu’un femi-
ton à partager en deux intervalles ; favoir, del’hy-
pate à la parypate, & de la parypate au lichanôs.
Nous expliquerons au mot Genre , la maniéré dont
fe failoit cette divifion.
Le genre enharmonique étoit le plus doux des trois
«u rapport d’Ariftide Quintilien ; il paffoit pour très-
ancien , 6c la plûpart des auteurs en attribuent l’invention
à Olympe. Mais fon tétracorde , pu plûtôt
fon diateffaron de ce genre, étoit compofé feulement
de trois cordes ; & ce ne-fut qu’après lui qu’on s’a-
vifà d’en inférer une quatrième entre les deux premières,
pour faire la diviliondont je viens de parler.
Ce genre fi merveilleux , fi loué des anciens auteurs
, ne demeura pas long-tems en vigueur. Son
extrême difficulté le fit bientôt abandonner des mu-
iiciens, & Plutarque témoigne que de fon tems il
étoit entièrement hors d’ufage.
Nous avons aujourd’hui une efpece de genre en*
harmonique entièrement différent de celui des Grecs;
Il confifte comme les deux autres , dans une, progref-
fion particulière de l’harmonie qui engendre dans les
parties des intervalles enharmoniques en employant à
la fois , entre deux notes qui font à un ton Tune de
l’autre, le dièfe de l’inférieure & le bémol de la fu-
périeure. Mais quoique félon la rigueur des rapports,
ce dièfe & ce bémol duffent former un intervalle entre
eux , cet intervalle fe trouve nul, au moyen du
tempérament, qui dans le fyftème établi, fait fer-
vir le même fon a ces deux ufages : ce qui n’empêche
pas qu’yn tel paffage ne produife par la force de la
E N H
modulation & de’ l ’harmonie ,« une partie de l’effet
qu’on cherche dans lès tranfitions1 enharmoniquesi ;
: Comme ce genre éft a fiez peu connu, & que nOfc
auteurs fie font-contentés d’en'donner quelques1 notions
:trop générales , nous croyons -devoir l’explï*
quer ici un peq plus clairement.
Il faut d’abord; remarquer que l ’accord de féptïè-
me-diminuée, eft le feul fur lequel onpuiffe pratiquer
des paffages enharmoniques, & cela , en vertu de
cette propriété finguhère qu’il a dedivifer jufte 1 »octave
entière en quatre intervalles égaux. Qu’on prenne
dans les quatrê fons qui compofènt cet accord celui
qu’on voudra pouf fondamental'v on trouvera
toujours également que les trois autres fons forment
fur celui-ci un accord de feptieme diminuée. Or le
fon fondamental de l’accord de feptieme diminuée
eft toujours une note fenfible , de forte que fans rien
changer à cet accord, on pourroit le faire fervir fuc-
ceffivement fur quatre différentes, fondamentales ,
c ’eft à-dire fur quatre différentes notes feilfibles. ’•
Suppofons l’accord fur «r diefe dansleton naturel
de ré,: car cet accord-ne peut avoir lieu que dans le
mode mineur ; fuppofons, dis-je', l’accordde feptie'-
me diminuée fur «r dièfe note fénfible i fijeprens la
tierce mi pour fondamentale , elle deviendra note
fenfible à ion tour, 6c annoncera par coiiféquent lé
mode mineur de-fa : or cet ut dièfe refte bien dans
l ’accord pris de-cette maniéré , mais c’eft en qualité
de ré bémol, c’eft-à-dire, de fixieme note du ton
& de feptieme diminuée de la note fenfible ; ainfi
cet «rdièfe qui, comme note fenfible, étoit obligé
de monter dans le ton de ré , devenu ré bémol dans
le ton de f a , eft obligé de defcendre comme fepf
tieme diminuée : voilà-une tranfition enharmonique.
Si au lieu de la tierce, on prend ia fauffe quinte Joly
dans le même accord, pour nouvelle note fenfible;
Vut dièfe deviendra encore ré bémol en qualité de
quatrième note : autre paffage enharmon'-que. Enfin fi
l’on prend pour note fenfible la feptieme diminuée
elle-même au lieu de f i bémol, il faudra néceffaire-
ment la confiderer comme la dièfe , ce qui fait un
troifieme paffage enharmonique fur le même accord;
A la. faveur donc de ces deux différentes maniérés
d’envifager fucceflivemeht le même accord, on paffe
d’un ton à un autre qyti en paroît fort éloigné , on
donne aux parties des progrès différens de celui qu’elles
auroient dû avoir en premier lieu ; & ces paffa-
ges ménagés à propos font capables, non-feulement
ae furprendre , mais de ravir l’auditeur quand ils
font bien rendus ; le mal eft qu’il faut changer fi
brufquement d’idées fur les mêmes notes-, & les ap?
pliquer à des modulations fi différentes, à des rapports
fi éloignés , que ce genre paroît abfolument
impraticable pour les voix telles qu’elles font dref-
fées par la mufique d’aujourd’hui. C’eft du moins de
quoi l’on a vu il y a plufieurs années , un exemple
mémorable à l’opéra de Paris. {SJ
Quart de ton enharmonique. On appelle ainfi la différence
du femi-ton majeur au lemi-ton mineur
7Y ; ou pour parler plus exactement, quoique d’une
maniéré différente des mttficiens ordinaires , c’eft le
rapport de à f-f, c’eft-à-dire, de 115 à 128. Voici
comment on forme ce quart de ton. Soit la baffe fondamentale
par tierces majeures, u t, mi, fol % , &
au-deffus d’elle ce chant u t, m i, f i % , on trouvera
que 1 e f i % différé de Vue d’un quart de ton enharmonique.
Voye[ mes élemens de mufique , p. 8y.
M. Rameau obferve i°. que le genre diatonique,'
qui eft le plus fimple 6c le plus facile de tous, vient
de la progreflîon de la baffe fondamentale par quintes
, progreflîon qui eft en effet la plus fimple & là
plus immédiatement indiquée par la nature. Voye^ Echelle , Diatonique & Gamme.
a9. Que le genre chromatique ou le femi-ton mi-
neuf
E N H
rieur qui eft le plus fim ple ap rès le p ré c é d e n t, vient
d e là p rogreflîon de la baffe fon d am en tale p a r tierces
m ajeu res , progreflîon auflî indiquée p a r la n a tu re ,
m ais m oins n atu relle néanm oins que la p rogreflîon
p a r q u in tes. V , H a r m o n ie . E n e ffe t, fi o n form e
c e tte baffe fon d am en tale ut mi, on p o u rra m ettre
au-deffus ce c h a n t fol fo l % , qu ’o n tro u v e ra form er
u n fem i-to n m ine ur. 30. enfin le gen re enharmonique
le m oins n atu rel des tro is , a fon O rigine dan s u n e
baffe ut mi fo l % , d o n t les deux ex trêm es ut ,fo l % ,
q u i d o n n en t le q u a rt de to n enharmonique, fo rm en t
u n e pro g reflîo n non n atu relle. (O )
Diatonique enharmonique. On appelle ainfi un chant
qui procédé par une fuite de femi-tons tous majeurs,
qui fe fuccedent immédiatement ; ce chant eft diatonique
parce que chaque femi-ton y eft majeur
( V. D ia t o n iq u e & C h r o m a t iq u e ) ; & il eft enharmonique,
parce que deux femi-tons majeurs de
fuite forment un ton trop fort d’un quart de ton enharmonique.
Pour former cette efpece de chant il faut
faire une baffe fondamentale qui monte alternativement
de quinte & de tierce , commè fa ut mi f i , 6c
cette baffe donnera le chant fa mi mi ré , oît tous
les femi-tons font majeurs. Une partie du trio des
Parques de l’opéra d’Hyppolite eft dans ce genre ;
mais il n’a jamais pû être exécuté à l’opéra ; il l’avoit
été ailleurs par des muficiens très-habiles 6c de bonne
volonté, & M. Rameau affure que l’effet en eft
furprenant. (O)
Chromatique enharmonique. On appelle ainfi un
chant qui procédé par une fuite de femi-tons mineurs,
qui fe fuccedent immédiatement. Ce chant eft chromatique
, parce que chaque femi-ton y eft mineur
{ V . C h r o m a t iq u e ) ; il eft enharmonique, parce que
les deux femi-tons mineurs confécutifs forment un
ton trop foible d’un quart de ton enharmonique. Pour
former cette efpece de chant, il faut avoir une baffe
fondamentale compofée de tierces mineures & majeures
en cette forte, ut ut la ut %ut%95c mettre au-
deffus ce chant mi |? mi mi mi mi % ; on trouvera par
le calcul que mi t , mi, mi, mi, mi ^ forment des femi-
tons mineurs. M. Rameau nous apprend qu’il avoit
fait dans ce genre de mufique un tremblement de terre
au fécond, aâe des Indes galantes en 173 5, mais
qu’il fut fi mal fervi qu’il fut obligé de le changer en
une mufique commune. Voyer mes Elémens de Mufique.
p. cfi. $ 2 , $ 3 ,6c u 6 . (O )
ENHARNACHER, HARNACHER, ( Manege,
Maréchall. ) m ettre les harno is fur le co rps d’u n chev
a l ; expreflions fyn o n ym es. V . H a r n a c h e r , ( c)
' ENHENDÉ, adj. terme de Blafon. On appelle croix
tnhendée celle dont le pié eft enhendé, c’eft-à-dire
refendu , du mot efpagnol enhendido , qui fignifiela
même chofe. Ces croix à refente font communes en
Allemagne.
ENHUCHE. ( Marine ) Voye{ H u c h e .
ENHYDRUS, f. m. {Hifl. natur. Minéralogie) Ce
mot eft compofé de eV ,in , 6c de vS'up, aqua : quelques
naturaliftes défignent par ce mot uneoetite ou pierre
d’aigle qui contient de l’eau. Uenhydrus eft donc une
pierre qui reffemble parfaitement aux autres pierres
d’aigle qui font ferrugineufes : elle eft de différentes
grandeurs & varie pour la figure, eft compofée de
plufieurs couches ou enveloppes appliquées les unes
fur les autres ; les couches extérieures font d’un jaune
d’ochre ; la couche qui tapiffe l’intérieur eft prefque
toujours noirâtre, & plus compa&e que les couches
extérieures. Lorfqu’on caffe cette pierre , on
trouve qu’elle a une cavité comme les autres ætites;
avec cette différence, qu’il en fort une liqueur qui
éft ordinairement épaiffe, & quelquefois blanchâtre"
comme de la creme, dont elle a à peü-près la cônfif--
tance : mais ce cas eft rare ; elle eft plus communément
d’un blanc bleuâtre ou limpide , lorfqu’ellè n’a
Tome V%
E N I $89
point été falîe par la matière ochracée dont là pierre
eft compofée ; cette liqueur eft fouvent entièrement
mfipide , cependant elle a quelquefois un goût ferrugineux
& aftring’ent, 6c même nauféeux. Il y a de
ces pierres en Angleterre 6c ailleurs. ( — )
ENJABLER, v. ad. terme dcTonnellier. C ’efl: en-
fonçer les futailles ou y mettre des fonds, en arrêtant
les douves d’enfonçures dans la rainure qui régné
tout autour du jable en-dedans. Voye%_ Jable.
^ ENJALER une ancre , ( Marine. ) c’eft attacher à
l’ancre deux pièces de bois qu’on a p p e l l e 6c les
empâter enfemble vers l’organeau. Le jas fert à contrebalancer
dans l’eau la patte de l’ancre pour la
faire tomber fur le bon côté : quelques matelots di-
fent enjauler une ancre, Voyeq_ J AS. ( Z )
ENJAMBEMENT , f. m. ( Poéfie. ) conftru&ion
Vicieufe , principalement dans les vers alexandrins.
On dit qu’un vers enjambe fur un autre , lorfque la
penfée du poète n’eft point achevée dans le même
vers, 6c ne finit qu’au commencement ou au milieu
du vers fuivant. Ainfi ce défaut exifte toutes les fois
u’on ne peut point s’arrêter naturellement à la fin
u vers alexandrin, pour en faire ïentir la rime 6C
la penfée, mais qu’on eft obligé de lire de fuite 6c
promptement l’autre vers, à caufe du fens qui eft
demeuré fufpendu. Les exemples n’en font pas rares •
en voici un feul.
Craignons quun Dieu vangeur ne lance fur nos têtes
La foudre inévitable.
Il y a ici un enjambement, parce que le fens ne permet
pas qu’on fe repofe à la fin du premier vers.
Ce n’eft pas affez d’éviter Venjambement d’un vers
à 1 autre, il faut de plus éviter Venjamber du premier
hémiftiche au fécond ; c’eft-à-dire, que fi l’on
porte un fens au-delà de la moitié du vers, il ne faut
pas l’interrompre avant la fin, parce qu’alors le vers
paroît avoir deux repos & deux céfures, ce qui eft
très-defagréable. Il eft encore bien moins permis Venjamber
d’une fiance à l’autre. Voye^ les auteurs fur
la vérfification françoife.
Mais fi Venjambement eft défendu dans les vers
alexandrins, comme nous venons de le dire, il eft
autorifé dans les vers de dix fyllabes, 6c il y produit
même quelquefois un agrément, parce que cette efpece
de vers faite pour la poéfie familière fouffre
quelques licences, & ne veut pas être affujettie à
une trop grande gêne.
Les poètes du fiecle pafféne s’embarraffoient guère
de laiffer enjamber leurs, vers les uns fur les autres;
c ’eft à Malherbe le premier à qui l’on doit la correction
de ce défaut de la vérfification. Parcefage écri*
vain, par ce guide fidele, dit Defpréaux,
Les S tances avec grâce apprirent à marcher,
Et le vers fur le vers n'ofa plus enjamber.
Article de M. le Chevalier DE J a u COURT.
1 ENIGME, f. m. & plus fouvent f. ( Littér. Poéfie.)
c’étoit chez les ancièns une fentence myftérieufe, une
propofition qu’on donnoit à deviner, mais qu’on ca-
choit fous des termes obfcurs, 6c le plus fouvent contradictoires
en apparence. L’énigme parmi les modernes,
eft un petit ouvrage «ordinairement en vers oîi
fans nommer une chofe, on la décrit par fes caufes
fes effets & fes propriétés , mais fous des termes &
des idées équivoques pour exciter l ’efprit à la découvrir.
Souvent Venigme eft une fuite de çomparaifons qui
caraClerifent une chofe, par des noms tirés de plufieurs
fujèts différens entre eux qui reffemblent à celui
de.l'énigme chacun à fa maniéré, 6c par des rapports
particuliers. Quelquefois pour la rendre plus
difficile à deviner, on l’embarraffe, en mêlant le ftyle
j fimple au ftyle figuré, en empruntant des métapho-
1 res, où- en perforinifiant exprès le fujet de Vénigmt,
■ afin de donnèr le change, S S s s