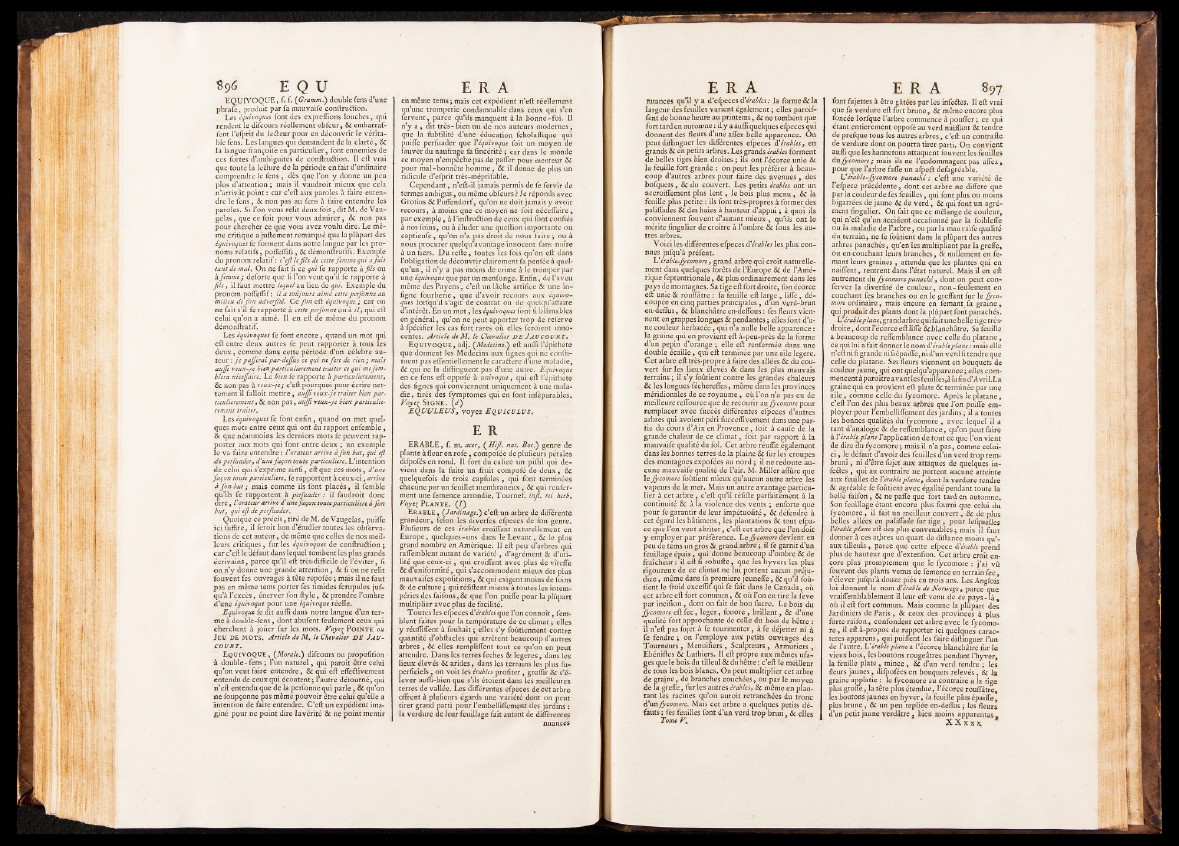
8S><5 E Q U EQUIVOQUE, f. f. (Gramm.} double fens d’une
phrafe, produit par fa mauvaife conftruüion^
Les équivoques font des expreflions louches, qui
rendent le difcours réellement obfcur, & embarraf-
fent l’efprit du le&eur pour en découvrir le véritable
fens. Les langues qui demandent de la clarté, 8c
la langue françoile en particulier, font ennemies de
ces fortes d’ambiguités de conftru&ion. Il eft vrai
que toute la leéture de la période en fait d’ordinaire
comprendre le fens , dès que l’on y donne un peu
plus d’attention ; mais il vaudroit mieux que cela
n’arrivât point : car c’eft aux paroles à faire entendre
le fens, & non pas au fens à faire entendre les
paroles. Si l’on vous relit deux fois, dit M. de Vau-
gelas, que ce foit pour vous admirer, 8c non pas
pour chercher ce que vous avez voulu dire. Le même
critique a juftement remarqué que la plûpart des
équivoques fe forment dans notre langue par les pronoms
relatifs, poffeflifs, 8cdémonftratifs. Exemple
du pronom relatif : c’ejl le fils de cette femme qui a fait
tant de mal. On ne fait fi ce qui fe rapporte à fils ou
à femme j deforte que fi l’on veut qu’il fe rapporte à
fils , il f aut mettre lequel au lieu de qui. Exemple du
pronom poffeflif : U a toujours aimé cette perfonne au
■ milieu de fon adverfité. Ce fon ell équivoque ; car on
ne fait s’il fë rapporte à cette perfonne ou à i l , qui ell
celui qu’on a aimé. Il en ell de même du pronom
démonllratif.
Les équivoques fe font encore, quand un mot qui
eft entre deux autres fe peut rapporter à tous les
deux, comme dans cette période d’un célébré auteur
: je pajferai par-dejfus ce qui ne fert de rien ; mais
auJJiveux-jc bien,particulièrement traiter ce qui me fem-
blera néccjfaire. Le bien fe rapporte à particulièrement,
& nonpas à veux-je; c’ell pourquoi pour écrire nettement
il falloit mettre, aujfi veux-je traiter bien particulièrement,
8c non pas, aufjiyeux-je bien particulièrement
traiter.
Les équivoques fe font enfin, quand on met quelques
mots entre ceux qui ont du rapport enfemble,
& que néanmoins les derniers mots fe peuvent rapporter
aux mots qui font entre deux ; un exemple
le va faire entendre : V orateur arrive à fon but, qui ejl
de perfuader, d’une façon toute particulière. L’intention
de celui qui s’exprime ainfi, ell que ces mots, d’une
façon toute particulière, fe rapportent à ceux-ci, arrive
à fon but ; mais comme ils font placés, il femble
qu’ils fe rapportent à perfuader : il faudroit donc
dire., l ’orateur arrive d’une façon toute particulière à fon
but, qui ejl de perfuader.
Quoique ce précis , tiré de M. de Vaugelas, puiffe
ici fuffire, il feroit bon d’étudier toutes les observations
de cet auteur, de même que celles de nos meilleurs
critiques, fur les équivoques de conftruflion ;
car c’ell le défaut dans lequel tombent les plus grands
écrivains, parce qu’il eft très-difficile de l’éviter, fi
on. n’y donne une grande attention, & fi on ne relit
fouvent fes ouvrages à tête repofée ; mais il ne faut
pas en même tems porter fes timides fcrupules juf-
qu’à l’excès, énerver fon fly le, 8c prendre l’ombre
d’une équivoque pour une équivoque réelle.
Equivoque fe dit aulîi dans notre langue d’un terme
à double-fens, dont abufent feulement ceux qui
cherchent à jouer fur les mots. Voye^ Pointe ou
Jeu de mots. Article de M. le Chevalier DE Ja u -
. c o u RT.
Equivoque , (Morale,} difcours ou propofition •
«t double - fens ; l’un naturel, qui paroît être celui
qu’on veut faire entendre, 8c qui ell effectivement
entendu de ceux qui écoutent; l’autre détourné, qui
n’ell entendu que de la perfonne qui parle, 8c qu’on
ne foupçonne pas même pouvoir être celui qu’elle a
intention de faire entendre. C ’ell un expédient imaginé
pour ne point dire lavérité 8c ne point mentir
E R A
en même tems ; mais cet expédient n’ell réellement
qu’une tromperie condamnable dans ceux qui s’en
fervent, parce qu’ils manquent à la bonne-foi. Il
n’y a , dit très- bien un de nos auteurs modernes,
que la lubtilité d’une éducation fcholaltique qui
puiffe perfuader que Y équivoque foit un moyen de
fauver du naufrage fa fincérité ; car dans le monde
ce moyen n’empêche pas de palfer pour menteur 8c
pour mal-honnête homme, 8c il donne de plus un
ridicule d’efprit très-méprifable.
Cependant, n’ell-il jamais permis de fe fervir de
termes ambigus, ou même obfcurs i Je réponds avec
Grotius 8c Puffendorf, qu’on ne doit jamais y avoir
recours, à moins que ce moyen ne foit néceffaire ,
par exemple, à l ’inftru&ion de ceux qui font confiés
à nos foins, ou à éluder une quellion importante ou
captieufe, qu’on n’a pas droit de nous faire ; ou à
nous procurer quelqu’avantage innocent fans nuire
à un tiers. Du relie, toutes les fois qu’on ell dans
l’obligation de découvrir clairement fa penfée à quelqu’un
, il n’y a pas moins de crime à le tromper par
une équivoque que par un menfonge. Enfin, de l’aveu
même des Payens, c’ell un-lâche artifice & une in-
figne fourberie, que d’avoir recours aux équivoques
lorfqu’il s’agit de contrat ou de- quelqu’affaire
d’intérêt. En un mot, les équivoques font fi blâmables
en général, qu’on ne peut apporter trop de referve
à fpécifier les cas fort rares 911 elles feroient innocentes.
Article de M. le Chevalier DE J AU COURT.
Eq uivoq ue, adj. (.Medecine'.) ell aulîi l’épithete
que donnent les Médecins aux ugnes qui ne confti-
tuent pas elfentiellement le cara&ere d’une maladie,
8c qui ne la dillinguent pas d’une autre. Equivoque
en ce fens ell oppofé à univoque, qui ell l’épithete
des lignes qui conviennent uniquement à une maladie
, tirés des fymptomes qui en font inféparables.
Foye{ Sign e, (d}
EQUULEUS, voyez E q u iç u l u s .
E R
ERABLE, f. m. aur, ( Hifi. mu. Bot.) genre de
plante à fleur en rofe, compofée de plufieurs pétales
difpofés en rond. Il fort du calice un pillil qui devient
dans la fuite un fruit compofé de deux, 8c
quelquefois de trois capfules, qui font terminées
chacune par un feuillet membraneux, 8c qui renferment
une femence arrondie. Tournef. injt. rei herb.
Voyt{ Plante. (/)
Erable , (Jardinage.} c’ell un arbre de différente
grandeur, félon les diverfes efpecès de fon genre.
Plufieurs de ces érables croiflent naturellement en
Europe, quelques-uns dans le Levant, 8c le plus
grand nombre en Amérique. Il ell peu d’arbres qui
ralfemblent autant de variété , d’agrément & d’utilité
que ceux-ci, qui croiflent avec plus de vîteffe
8c d’uniformité, qui s’accommodent mieux des plus
mauvaifes expofitions, 8c qui exigent moins de foins
& de culture ; qui réfiftent mieux à toutes les intempéries
des faifons, 8c que l’on puilfe pour la plûpart
multiplier avec plus de facilité.
Toutes les efpeces àé érables que l’on connoît, fem-
blent faites pour la température de ce climat ; elles
y réuflilTent à fouhait ; elles s’y foûtiennent contre
quantité d’obftacles qui arrêtent beaucoup d’autres
arbres , 8c elles remplilfent tout ce qu’on en peut
attendre. Dans les terres feches 8c legeres, dans les
lieux élevés 8c arides, dans les terrains les plus fu-
perficiels, on voit les érables profiter, groflir & s’é-.
lever aufli-bien que s’ils étoient dans les meilleures
terres de vallée. Les différentes efpeces de cet arbre
offrent à plufieurs égards une variété dont on peut
tirer grand parti pour l’embelliflement des jardins :
la verdure de leur feuillage fait autant de différentes
nuances
E R A
nuances qu’il y a d’efpeces d’érables: la forme & la
largeur des feuilles varient également ; elles paroif-
fent de bonne heure au printems, 8c ne tombent que
fort tard en automne : il y a àuflî quelques efpeces qui
donnent des fleurs d’une alfez belle apparence. On
peut diflinguer les différentes efpeces d’érables, en
grands 8c en petits arbres. Les grands érables forment
de belles tiges bien droites ; ils ont l’écorce unie 8c
la feuille fort grande : on peut les préférer à beaucoup
d’autres arbres pour faire des avenues , des
bofquets, 8c du couvert. Les petits érables ont un
accroiffement plus len t , le bois plus menu, 8c la
feuille plus petite : ils font très-propres à former des
paliflades 8c des haies à hauteur d’appui ; à quoi ils
conviennent fouvent d’autant mieux , qu’ils ont le
mérite fingulier de croître à l’ombre & lous les autres
arbres.
Voici les différentes efpeces d’érables les plus connues
jufqu’à préfent.
Uerable-jycomore, grand arbre qui croît naturellement
dans quelques iorêts de l’Europe 8c de l’Amérique
feptentrionale, 8c plus ordinairement dans les
pays de montagnes. Sa tige ell fort droite, fon écorce
ell unie & roulfâtre : fa feuille ell large, lilfe, découpée
en cinq parties principales, d’un verd-brun
en-deffus, 8c blanchâtre en-delfous : fes fleurs viennent
en grappes lon g es & pendantes ; elles font d’une
couleur herbacée, qui n’a nulle belle apparence :
la graine qui en provient ell à-peu-près de la forme
d’un pépin d’orange ; elle ell renfermée dans une
double écaille, qui eft terminée par une aîle legere.
Cet arbre eft très-propre à faire des allées 8c du couvert
fur les lieux élevés & dans lès plus mauvais
terrains ; il s’y foûtient contre les grandes chaleurs
8c les longues féchereffes, même dans les provinces
méridionales de ce royaume, où l’on n’a pas eu de
meilleure reflource que de recourir au fycomore pour
remplacer avec fuccès différentes efpeces d’autres
arbres qui avoient péri fucceflivement dans une partie
du cours d’Aix en Provence , foit à caufe de la
grande chaleur de ce climat, foit par rapport à la
mauvaife qualité du fol. Cet arbre réuflit également
dans les bonnes terres de la plaine 8c fur les croupes
des montagnes expofées au nord ; il ne redoute aucune
mauvaife qualité de l’air. M. Miller aflure que
le fy comore foûtient mieux qu’aucun autre arbre les
vapeurs de la met. Mais un autre avantage particulier
à cet arbre, c’eft qu’il réfifte parfaitement à la
continuité & à la violence des vents ; enforte que
pour fe garantir de leur impétuofité , 8c défendre à
cet égard les bâtimens, les plantations 8c tout efpa-
ce que l’on veut abriter, c’eft cet arbre que l’on doit
y employer par préférence. Le fy comore devient en
peu de tems un gros & grand arbre ; il fe garnit d’un
feuillage épais, qui donne beaucoup d’ombre & de
fraîcheur : il eft fi robufte, que les hy vers les plus
rigoureux de ce climat ne lui portent aucun préjudice
, même dans fa première jeuneffe, 8c qu’il foûtient
le froid exceflif qui fe fait dans le Canada, où
cet arbre eft fort commun, 8c où l’on en tire la fève
par incifion, dont on fait de bon fucre. Le bois du
fy comore eft fec, leger, fonore , brillant, 8c d’une
qualité fort approchante de celle du bois de hêtre :
il n’eft pas fujet à fe tourmenter, à fe déjetter ni à
fe fendre ; on l’employe aux petits ouvrages des
Tourneurs, Menuifiers , Sculpteurs, Armuriers ,
iEbéniftes 8c Luthiers. Il eft propre aux mêmes ufa-
ges que le bois du tilleul & du hêtre : c’eft le meilleur
de tous les bois blancs. On peut multiplier cet arbre
de graine, de branches couchées, ou par le moyen
de la greffe, fur les autres érables, Sc même en plantant
les racines qu’on auroit retranchées du tronc
d’un fycomore. Mais cet arbre a quelques petits défauts
; fes feuilles font d’un verd trop brun , 8c elles
Tome
E R A 897
font fujettes à être gâtées par les infeéles. Il eft vrai
que fa verdure eft fort brune, 8c même encore plus
foncée lorfque l ’arbre commence à pouffer ; ce qui
étant entièrement oppofé au verd naiffant & tendre
de prefque tous les autres arbres, c ’eft un contrafte
de verdure dont on pourra tirer parti. On convient
auflï que les hannetons attaquent fouvent les feuilles
du Jycomore ; mais ils ne l’endommagent pas aflèz>
pour que l’arbre faffe un afpeél defagréable.
L érable-fycomore panaché : c’eft une variété de
l’efpece précédente, dont cet arbre ne diffère que
par la couleur de fes feuilles, qui font plus ou moins
bigarrées de jaune 8c de v erd, 8c qui font un agrément
fingulier. On fait que ce mélange de couleur,
qui n’eft qu’un accident occafionné par la foibleffe
ou la maladie de l’arbre, ou par la mauvaife qualité
du terrain, ne fe foûtient dans la plûpart des autres
arbres panachés, qu’en les multipliant par la greffe,
ou en couchant leurs branches, 8c nullement en fe-
mant leurs graines , attendu que les plantes qui en
naiflènt, rentrent dans l’état naturel. Mais il en eft
autrement du fycomore panaché , dont on peut con-
ferver la diverfité de couleur, non-feulement en
couchant fes branches ou en le greffant fur le fycomore
ordinaire, mais encore en femant fa graine ,
qui produit des plants dont la plûpart font panachés.
L’érableplane, grand arbre qui fait une belle tige très-
droite , dont l’écorce eftlifîè 8c blanchâtre. Sa feuille
a beaucoup de reffemblance avec celle du platane ,
ce qui lui a fait donner le nom d’érableplane : mais elle
n’eft ni fi grande ni fi épaiffe, ni d’un verd fi tendre que
celle du platane. Ses fleurs viennent en bouquets de
couleur jaune, qui ont quelqu’apparence ; elles commencent
à paraître avant les feuilles,à la fin d’Avril.La
graine qui en provient eft plate 8c terminée par une
aîle, comme celle du fycomore. Après le platane ,
c’eft l’un des plus beaux arbres que l’on puiffe employer
pour l’embelliffement des jardins ; il a toutes
les bonnes qualités du fycomore , avec lequel il a
tant d’analogie 8c de reffemblance, qu’on peut faire
à Y érable plane l’application de tout ce que l’on vient
de dire au fycomore; mais il n’a pas, comme celui-
ci , le défaut d’avoir des feuilles d’un verd trop rembruni
, ni d’être fujet aux attaques de quelques in-
feéles , qui au contraire ne portent aucune atteinte
aux feuilles de Y érable plane, dont la verdure tendre
8c agréable fe foûtient avec égalité pendant toute la
belle faifon, 8c ne paffe que fort tard en automne.
Son feuillage étant encore plus fourni que celui du
fycomore, il fait un meilleur couvert, 8c de plus
belles allées en paliffade fur tige , pour lefquelles
Yérable plane eft des plus convenables ; mais il faut
donner à ces arj>res un quart de diftance moins qu’aux
tilleuls , parce que cette efpece d'érable prend
plus de hauteur que d’extenfion. Cet arbre croît encore
plus promptement que le fycomore : j’ai vu
fouvent des plants venus de femence en terrain fec ,
s’élever jufqu’à douze piés en trois ans. Les Anglois
lui donnent le nom d’érable de Norwege, parce que
vraisemblablement il leur eft venu de ce pays-là ,
où il eft fort commun. Mais comme la plûpart des
Jardiniers de Paris, 8c ceux des provinces à plus
forte raifon, confondent cet arbre avec le fycomore
, il eft à-propos de rapporter ici quelques caractères
apparens, qui puiffent les faire diflinguer l’un
de l ’autre. Vérable plane a l’écorce blanchâtre fur le
vieux bois, les boutons rougeâtres pendant l’hyver,
la feuille plate, mince, & d’un verd tendre ; les
fleurs jaunes, difpofées en bouquets relevés, 8c la
graine applatie : le fycomore au contraire a la tige
plus groffe, la tête plus étendue, l’écorce rouffâtre,
les boutons jaunes en hyver, la feuille plus épaiffe,
plus brune, 8c un peu repliée en-deffus ; les fleurs
d’un petit jaune Yerdâtre. bien moins apparentes *
i l :