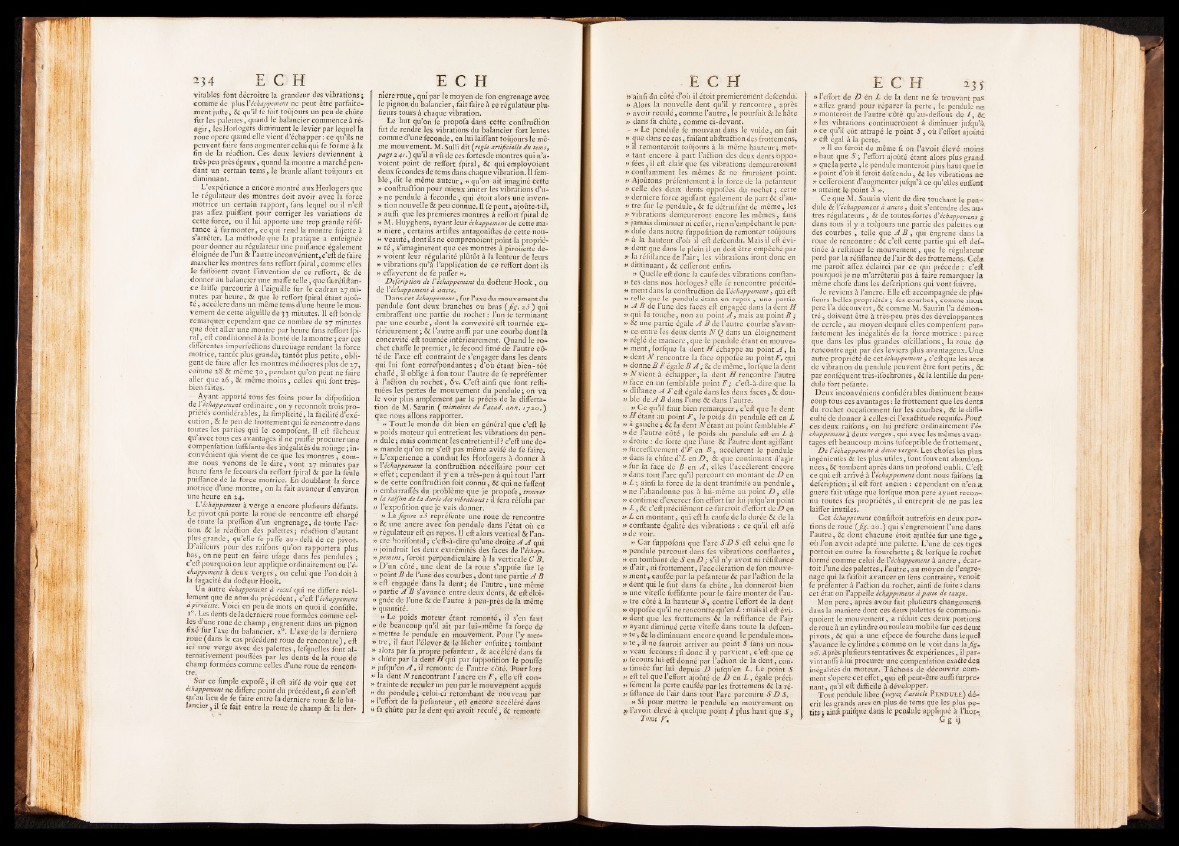
*34 E C H vitables font décroître la grandeur des vibrations ;
comme de plus l’échappement ne peut être parfaitement
jufte, & qu’il fe fait toûjours un peu de chute
fur les palettes, quand le balancier commence à réagir,
les Horlogers diminuent le levier par lequel la
roue opéré quand elle vient d’échapper : ce qu’ils ne
peuvent faire fans augmenter celui qui fe forme à la
nn de la réaction. Ces deux leviers deviennent à
très-peu près égaux, quand la montre a marché pendant
un certain tems, le branle allant toûjours en
diminuant.
L’expérience a encore montré aux Horlogers que
le régulateur des montres doit avoir avec la force
motrice un certain rapport, fans lequel ou il n’eft
pas affez puiffant pour corriger les variations de
cette force, ou il lui apporte une trop grande réfif-
tance à furmonter, ce qui rend la montre fujette à
s’arrêter. La méthode que la pratique a enfeignée
pour donner au régulateur une puiffance également
éloignée de l’un & l’autre inconvénient, c’en de faire
marcher les montres fans reflort fpiral, comme elles
le faifoient avant l’invention de ce reffort, & de
donner au balancier une maffe telle, que fa.réfiftan-
ce Iaiffe parcourir à l’aiguille fur le cadran 27 minutes
par heure, & que le reflort fpiral étant ajoû-
té , accéléré dans un même tems d’une heure le mouvement
dè cette aiguille de 33 minutes. Il eft bonde
remarquer cependant que ce nombre de 27 minutes
que doit aller une montre par heure fans reflort fpiral
, eft conditionnel à la bonté de la montre ; car ces
differentes imperfeélions du roiiage rendant la force
motrice, tantôt plus grande, tantôt plus petite, obligent
de faire aller les montres médiocres plus de 27,
comme 28 & même 30, pendant qu’on peut ne faire
aller que 26, & même moins, celles qui font très-
bien faites.
Ayant apporté tous fes foins pour la difpofition
de Vecha.ppc.mmt ordinaire, on y reconnoît trois propriétés
confidérables, la fimpïicité, la facilité d’exécution
, & le peu de frottement qui fe rencontre dans
toutes les parties qui le compofent. II efl: fâcheux
qu’avec tous ces avantages il ne puiffe procurer une
compenfation fuffifante des inégalités du roiiage ; inconvénient
qui vient de ce <Jue les 'montres, comme
nous venons de le dire, vont 27 minutes par
heure fans le fecours du reflort fpiral & par la feule
puiffance de la force motrice. En doublant la force
motrice d’une montre, on la fait avancer d’environ
Une heure en 24.
Véchappement à verge a encore plufieurs défauts.
Le pivot qui porte la roue de rencontre eft chargé
de toute la preflion d’un engrenage, de toute l’action
& la reaêlion des palettes ; réa&ion d’autant
plus grande, qu’elle fe paffe au-delà de ce pivot.
D ’ailleurs pour des railons qu’on rapportera plus
bas, on ne peut en faire ufage dans les pendules ;
c’eft pourquoi on leur applique ordinairement ou IV-
chappement à deux verges, ou celui que l’on doit à
la fagacité du doéleur Hook.
Un autre échappement à recul qui ne différé réel-
*,err?ent fl110 n0m fjjl précédent, c’eft l’échappement
a pirouette. Voici en peu de mots en quoi il eOnfifte.
ï 0* Les dents de la derniere roue formées comme celles
d’une roue de champ, engrenent dans un pignon
fixé fur Taxe du balancier. 20. L’axe de la derniere
roue (dans le cas précédent- roue de rencontre), eft
ici une verge avec des palettes, lefquelles font alternativement
pouffées par les dents-de la roue de
champ formées comme celles d’une roue de rencontre.
Sur ce Ample expofé, il eft aifé de vôir que cet
échappement ne différé point du précédent, fl ce n’eft
qu’au lieu de fe faire entre la derniere roue & le balancier
, il fe fait entre la roue de champ & là der-
E C H nïere foue, qui par le moyen de fon engrenage avec
le pignon du balancier, fait faire à ce régulateur plufieurs
tours à chaque vibration.
Le but qu’on fe propofa dans cette conftruélion
fut de rendre les vibrations du balancier fort lentes
comme d’une fécondé, en lui laiffant toûjours le même
mouvement. M. Sulli dit (réglé artificielle du tems9
page 24/.) qu’il a vû de ces fortes de montres qui n’a-
voient point de reflort fpiral, & qui employoient
deux fécondés de tems dans chaque vibration. Il fem-
ble, dit le même auteur, « qu’on ait imaginé cette
» conftruélion pour mieux imiter les vibrations d’u-
» ne pendule à fécondé, qui étoit alors une inven-
» tion nouvelle & peu connue. Il fe peut, ajoûte-t-il,
» aufli que les premières montres à reflort fpiral de
» M. Huyghens, ayant leur échappement de cette ma-
» niere, certains artiftes antagoniftes de cette nou-
» veauté, dont ils ne comprenoient point la proprié-
» t é , s’imaginèrent que ces montres à pirouette de-
» voient leur régularité plûtôt à la lenteur de leurs
» vibrations qu’à l’application de ce reflort dont ils
» effayerent de fe palier ».
Description de l'échappement du dofteur Hook, ou
‘ de Véchappement à ancre.
D ans cet échàppement, fur l’axe du mouvement du
^ pendule font deux branches ou bras (fig. z 5 ) qui
embraffent une partie du rochet l’un fe terminant
par une courbe, dont la convexité eft tournée extérieurement
; & l’autre aufli par une courbe dont là
concavité eft tournée intérieurement. Quand le rochet
chaffe le premier, le fécond fitué de l’autre côté
de l’axe eft contraint de s’engager dans les dents
qui lui font correfpondantes ; d’où étant bien-tôt
chaflé, il oblige à fon tour l’autre de fe repréfenter
à l’aétion du rochet, &c. C ’eft ainfi que font refti-
tiiéès les pertes de mouvement du pendule ; on va
le voir plus amplement par le précis de la differta-
tion de M. Saurin (mémoires de Yacad. ann, /720.)
que nous allons rapporter.
« Tout le monde dit bien en général que c’eft le
» poids moteur qui entretient les vibrations du pen-
» dule ; mais comment les entretient-il ? c’eft une de-*
» mande qu’on ne s’eft pas même avifé de fe faire.
>> L’experience a conduit les Horlogers à donner à
» Féchappement la conftruélion néceffaire pour cet
» effet ; cependant il y en a très-peu à qui tout l’art
» de cette conftruélion foit connu, & qui ne fuffent
>> embarraflés du problème que je propofe, trouver
» la raifon de la durée des vibrations: il fera réfolu par
» l’expofîtion que je vais donner.
» La figure z 5 repréfente une roue de rencontre
» & une ancre avec fon pendule dans l’état où ce
».régulateur eft en repos. Il eft alors vertical & l’an-
» erp horifontal ; c’eft-à-dire qu’une droite A A qui
» joindroit les deux extrémités des faces de Yéchap-
» pement, feroit perpendiculaire à la verticale C B .
» D ’un côté, une dent de la roue s’appuie fur le
» point B de l’une des courbes, dont Une partie A B
» eft engagée dans la dent ; de l’autre, une même
» partie A 5 s’avance entre deux dents, & eftéloi-
» gnéé de l’une & de l’autre à peu-près de la même
>> quantité.
» Le poids moteur étant remonté , il s’en faut
» de beaucoup qu’il ait par lui-même là force dé
» mettre le pendule en mouvement. Pour l’y met-
» tre, il faut l’élever & le lâcher enfuite ; tombant
» alors par fa propre pefanteur, & accéléré dans fa
» chute par la dent H qui par fuppofition le pouffe
» jufqu’en A , il remonte de l’autre côté. Pour lors
» la dent AT rencontrant l’ancre en F , elle eft con-
» trainte de reculer un peu par le mouvement acquis
» du pèndule; cêlui-ci retombant de nouveau par
» l’effort dé la pefanteur, eft encore accéléré dans
» fa chuté par la dçnt qui avoit reculé, &t remonte
E C H b ainfi du côte d’où il étoit premièrement defeendu."
» Alors la nouvelle dent qu’il y rencontre ,. après
» avoir reculé, comme l’autre, le pourfuit & le hâte
» dans fa chûte, comme ci-devant.
- » Le pendule fe mouvant dans le Vuide, oh fait
» que dans ce cas, faifant abftraâion des frottemens,
» il remonteroit toûjours à la même hauteur 3 met-
» tant encore à part l’aélion des deux dents bppo-
» fées ÿ il eft clair que fes vibrations demeureroient
» conftamment les mêmes & ne fimroient point.
» Ajoûtons préfentement à la force de la pefanteur
»celle des deux dents oppofées du rochet; cette
» derniere force agiflant également de part & d’au-
» tre fur le pendule, & fe détruifant de même, les
» vibrations demeureront encore les mêmes, fans
» jamais diminuer ni ceffer, rien n’empêchant le pen-
» dule dans notre fuppofition de remonter toûjours
» à la hauteur d’où il eft defeendu. Mais il eft évi-
» dent que dans le plein il en doit être empêché par
» la réfiftance de l’air ; les vibrations iront donc en
» diminuant, & cefferont enfin.
» Quelle eft donc la caufe des vibrations conftan-
» tes dans nos horloges ? elle fe rencontre précifé-
» ment dans la conftruélion de Y échappement , qui eft
» telle que le pendule étant en repos , une partie
» A B de l’une des faces eft engagée dans la dent H
» qui la touche, non au point A , mais au point B ;
» & une partie égale A B de l’autre courbe s’avan-
» ce? entre les deux dents N Q dans un éloignement
» regie de maniéré, que le pendule étant en mouve-
» ment, lorfque la dent H échappe au point A , la
» dent N rencontre la face oppofée au point F, qui
» donne B F é gale B A ; & de même, lorfque la dent
» N vient à échapper, la dent H rencontre l’autre
» face en un fêmblable point F ; c’eft-à-dire que la
» diftance A F eft égale dans les deux faces, & dou-
» ble de A B dans l’une & dans l’autre.
» Ce qu’il faut bien remarquer, c’eft que la dent
» H étant au point F f le poids du pendule eft en L
» à gauche ; & la dent A"étant au point femblable F
» de l’autre côté , le poids du pendule eft en A à
» droite : de forte que l’une & l’autre dent agiflant
» fucceflivement d’f en B , accélèrent le pendule
» dans fa chûte d’A en D , & que continuant d’agir
» fur la face de B en A > elles l’accélerent encore
» dans tout l’arc qu’il parcourt en montant de D en
» A ; ainfi la force de la dent tranfmife au pendule,
» ne l’abandonne pas à lui-même au point D , elle
» continue d’exercer fon effort fur lui jufqu’au point
» A , & c’eft précifément ce furcroît d’effort de A> en
» A en montant, qui eft la caufe de la durée & de la
» confiante égalité des vibrations : ce qu’il eft aifé
» de voir.
» Car fuppofons que l’arc S D S eft celui que le
» pendule parcourt dans fes vibrations confiantes,
» en tombant de S en D ; s’il n’y avoit ni réfiftance
» d’air, ni frottement, l’accélération de fon mouve-
» ment, caufée par la pefanteur & par l’aélion de la
» dent qui le fuit dans fa chûte, lui dônneroit bien
» une vîtefle fuffifante pour le faire monter de l’au-
» tre côté à la hauteur S , contre l’effort de la dent
» oppbfée qu’il ne rencontre qu’en A : mais il eft évi-
» dent que les frottemens Sc la réfiftance de l’air
» ayant diminué cette vîteffe dans toute la defeen-
» te , & la diminuant encore quand le pendule mon-
» te , il ne fauroit arriver au point S fans un nou-
» veau fecours : fi donc il y parvient, c ’eft que ce
» fecours lui eft donné par l’aélion de la dent, con-
» tinuée fur.lui depuis D jufqu’en A. Le point S
» eft tel que l’effort ajoûté de D en A , égale préci-
» femerit la perte caufée par les frottemens & la ré-
» fiftance de l’air dans tout l’arc parcouru S D S .
» Si pour mettre le pendule en mouvement on
» l’avoit élevé à quelque point I plus haut que S ,
Ton» K P *
E C H 23s
» feffort de D én A de la dent ne fe trouvant pas
» affez grand pour réparer la perte, le pendule ne
» monteroit de l’autre côté qu’au-deffous de A, 8c
» les vibrations continueroient à diminuer jufqu’à
>> ce qu’il eût attrapé le point d1, où l’effort ajoûte
» eft égal à la perte.
» Il en feroit de même fi on l ’avoit élevé moins
» haut que S ; l’effort ajoûté étant alors plus grand
» que la perte , le pendule monteroit plus haut que le
» point d’où il feroit defeendu, & les vibrations ne
» cefleroient d’augmenter jufqu’à ce qu’elles euflenÉ
» atteint le point S ».
Ce que M. Saurin vient de dire touchant le péri-'
dule & Y échappement à ancre , doit s’entendre des au«
très régulateurs , & de toutes fortes d’échappemens »
dans tous il y a toûjours une partie des palettes ou
des courbes , telle que A B , qui engrene dans la
roue de rencontre : & c’eft cette partie qui eft def-
tinée à reftituer le mouvement, que le régulateur,
perd par la réfiftance de l’air & des frottemens. Cela
me paroît affez éclairci par ce qui précédé : c’eft
pourquoi je ne m’arrêterai pas à faire remarquer la
même chofe dans les deferiptions qui vont fuivre.
Je reviens à l’ancre. Elle eft accompagnée de plii-
fieurs belles propriétés ; fes courbes, comme mon
pere l’a découvert, &; comme M. Saurin l’a démon«
tré, doivent être à très-peu près des développantes
de cercle, au moyen dequoi elles compenfent parfaitement
les inégalités de la force motrice : parce
que dans les plus grandes ofcillations, la roue de
rencontre agit par des leviers plus avantageux. Une
autre propriété de cet échappement, c’eft que les arcs
de vibration du pendule peuvent être fort petits, &:
par conféquent très-ifochrones, & la lentille du pendule
fort pefàntei
Deux inconvéniens confidérables diminuent beau*
coup tous ces avantages : le frottement que les dents
du rochet occafionnent fur les courbes, & la diffi-*
culté de donner à celles-ci l’exaélùude requife. Pouh.
c es deux raifons, on lui préféré ordinairement IV-
chappement à deux verges, qui avec les mêmes avantages
eft beaucoup moins fufceptible de frottements
De l 'échappement à deux verges. Les chofes les plus
ingénieufes & les plus utiles, font fou vent abandon*
nées, ôc tombent après dans un profond oubli. C’eft
ce qui eft arrivé à Y échappement dont nous faifons la
i defeription ; il eft fort ancien : cependant on n’en a
guere fait ufage que lorfque mon pere ayant recon*
! nu toutes fes propriétés, il entreprit de ne pas les
laiffer inutiles.
Cet échappement confiftoit autrefois en deüx portions
de roue (fig. 20.) qui s’engrenoient l’une dans
! l’autre, & dont chacune étoit ajiiftée fur une tige >
où Ton avoit adapté une palétte. L’une de ces tiges
portoit en outre la fourchette ; & lorfque le rochet
formé comme celui de Y échappement à ancre , écar-
toit Tune des palettes, l’autre, au moyen de l’engrenage
qui la faifoit avancer en fens contraire, venoit
fe prélenîer à Taélion du rochet, ainfi de fuite : dans
cet état on l’appelle échappement à patte de taupe.
Mon pere, après avoir fait plufieurs changement
dans la maniéré dont ces deux palettes fe communi-
quoient le mouvement, a réduit ces deux portions
de roue à un cylindre ou rouleau mobile fur ces deux
pivots, & qui a une efpece de fourche dans lequel
s’avance le cylindre ; comme on le voit dans la fig~
2 C. A près plufieurs te n ta tiv e s & ex p é rie n c e s, il p a rv
in t aufli à lui p ro c u re r u n e com penfation exa& e d e s
inégalités du m o te u r. T â c h o n s d e d éco u v rir com m
en t s’op ère c e t e ffe t, q u i eft p eu t-être aufli furpre-*
n a n t, qu’il eft difficile à développer.
T o u t pendule lib re (voye^ l'article P e n d u l e ) d écrit
les grands arcs en plus de tem s q u e les p lu s p etits
$ ainfi puifque dans le pendule appliqué à l’h o r-
S g >i