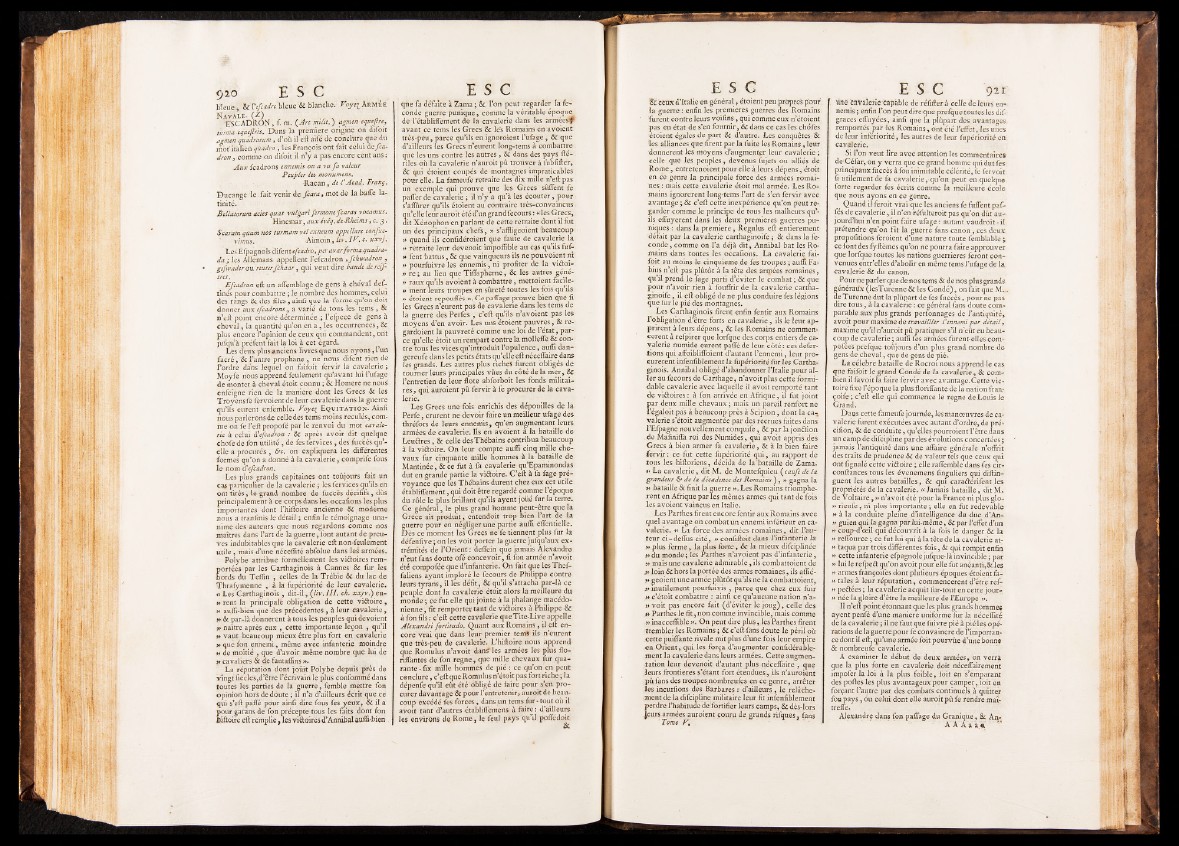
Heue-j & Ÿcfiadn~b\me & blanche. Voye{ ArMÎe
H Sm r a (Z ) . ' | „
'ESCADRON, f. m. .('Art mite.) agrnen- equeßre,
ïuriM tqucftris. Dans la première origiriejon äifoit
agmen quaimmm , d’öh il eft aile de conclure (jue du
mot' italien qiiadro , ‘lés François ont fait celuide/ce-
dron, comme on difoit il n’y i j a s èhcore cent ans:
^«xfcadrons ennemis on a.vufn valeur
Peupler les monumens.
Racan, de VAcad. Franç.
Ducange le, fait venir de feara, mot de la baffe latinité.
Bellatorum actes quas vulgari fermontfearas vocamus.
Hincmar, aux évêq. de Rheims ,c . j .
Scaratn qaam nos turmam vel cuneum appellare confue-
ybniis. ' Aimoin., ihr. IV,'C. x x v f
le s Efpagnols àiletitefcadro , per av arforma.q uadra-
da j le s Allemans appellent Fefcadroii, fehwadron
gefwader ou reuterfehaar, qui veut dire bande de reif
Efcadron eft un affemblage de gens à cheval def-
tinés pour combattre ; le nombre des hommes, celui
des rangs &c des files ., ainfi que la forme qu’on doit
donner aux efiadrons,, a varié de tous les tems , &
n’eft point encore dé te rminée l’efpece de gens à
cheval, la quantité qu’on en a , les occurrences, &
plus encore l’opinion de ceux qui commandent, ont
jufqu’à préfent fait la loi à cet égard.
Les deux plus Anciens livres que nous ayons, l’un
facré, & l ’autre prophane , ne nous difent rien de
Tordre dans lequel on faifoit fervir la cavalerie ;
Moyfe nous apprend feulement qu’avant lui l’ufage
de monter à cheval étoit connu ; & Homere ne nous1
enfeigne rien de la maniéré dont les Grecs & les
Troyensfe fervoientde leur cavalerie dans la guerre
qu’ils eurent enfemble. Voye^ E q u i t a t i o n . Ainfi
nous parlerons de celle des tems moins reculés, comme
on fe l’eft propofé par le renvoi du mot cavalerie
à celui efcadron : & après avoir dit quelque
chofe de fon utilité , de les fervices, des fuccès qu’elle
a procurés , &c. on expliquera les différentes
formes qu’on a donné à la cavalerie, comprife fous
le nom a efcadron.
Les plus grands capitaines ont toujours fait un
ca£ particulier de la cavalerie ; les fervices qu’ils en
ont tirés, le grand nombre de fuccès décififs , dûs
principalement à ce corps dans les occafions les.,plus
importantes dont Thiftoire ancienne & moderne
nous a tranfmis le détail ; enfin le témoignage unanime
des auteurs que nous regardons comme nos
maîtres dans l’art de la guerre, font autant de preuves
indubitables que la cavalerie eft non-feulement
utile , mais d’une nécefïité abfolue dans les armées.
Polybe attribue formellement les vi&oires remportées
par les Carthaginois à Cannes & fur les
bords du Teffin , celles de la Trébie & du lac de
Thrafymenne , à la fupériorité de leur cavalerie.
« Les Carthaginois , dit-il, (AV. III. ch. x x jy l)eu-
» rent la principale obligation de cette vittoire,
» aufli-bien que des précédentes , à leur cavalerie,
» & par-là donnèrent à tous les peuples qui dévoient
» naître après eux , cette importante leçon , qu’il
» vaut beaucoup mieux être plus fort en cavalerie
» que fon ennemi, même avec infanterie moindre
» de moitié , que d’avoir même nombre que lui de
>> cavaliers & de fantaffins ».
La réputation dont jouit Polybe depuis près de
vingt fiecles,d’être l’écrivain le plus eonfommé dans
toutes les parties de la guerre, femble mettre fon
opinion hors de doute ; il n’a d’ailleurs écrit que ce
qui s’eft paffé pour ainfi dire fous fes yeux, & il a
pour garans de fon précepte tous les faits dont fon
biftoire eft remplie, les victoires d’Annibal aiiffi-bien
que fa défaite à Zama ; & Ton peut regarder la féconde
guerre punique, comme la véritable époque
de Tétabliffement de la cavalerie dans les armées^
avant ce tems les Grecs & lès Romains en avoient
très-peu, parce qu’ils en ignoroient l’ufage, & que
d’ailleurs les Grecs n’eurent long-tems à combattre
que les uns contre les autres, & dans des pays fté-
riles oîi la cavalerie n’auroit pu trouver à fubfifter,
& qui étoient coupés de montagnes impraticables
pour elle. La fameufe retraite des dix mille n’eft pas
un exemple qui prouve que les Grecs sûffent fe
paffer de cavalerie ; il n’y a qu’à les écouter, pour
s’affûrer qu’ils étoient au contraire très-convaincus
qu’elle leur auroit été d’un grand fecours : « les Grecs,
dit Xénophon en parlant de cette retraite dont il fut
un des principaux chefs, » s’affligeoient beaucoup
» quand ils confidéroient que faute de cavalerie la
» retraite leur devenoit impoffible au cas qu’ils fuf-
» fent battus, & que vainqueurs ils ne pouvoient ni
» pourfuivre les ennemis, ni profiter de la viéloi-
» re ; au lieu que Tiffapherne, & les autres géné-
» ràux qu’ils avoient à combattre, mettoient facile-
» ment leurs troupes en sûreté toutes les fois qu’ils
» étoient repouffés ». C e paffage prouve bien que li
les Grecs n’eurent pas de cavalerie dans les tems de
la guerre des Perfes , c’eft qu’ils n’avoient pas les
moyens d’en avoir. Les uns étoient pauvres, & re-
gardoient là pauvreté comme une loi de l’état, parce
qu’elle étoit un rempart contre la molleffe & contre
tous les vices qu’introduit l’opulence, auffi dan-
gereufe dans les petits états qu’elle eft néceffaire dans
les grands. Les autres plus riches furent obligés de
tourner leurs principales vues du côté delà mer, &
l’entretien de leur flote abforboit les fonds militaires,
qui auroient pû fervir à fe procurer de la cavalerie.
Les Grecs une fois enrichis des dépouilles de la
Perfe, crurent ne devoir faire un meilleur ufage des
thréfors de leurs ennemis, qu’en augmentant leurs
armées de cavalerie. Ils en avoient à la bataille de
Leuttres, & celle desThébains contribua beaucoup
à la vi&oire. On leur compte auffi cinq mille chevaux
fur cinquante mille hommes à la bataille de
Mantinée, & c e fut à fa cavalerie qu’Epaminondas
dut en grande partie la vi&oire. C ’eft à fa fage prévoyance
que les Thébains durent chez eux cet utile
établiffement, qui doit être regardé comme l’époque
du rôle le plus brillant qu’ils ayent joiié fur la terre.
Ce général, le plus grand homme peut-être que la
Grece ait produit, entendoit trop bien l’art de la
guerre pour en négliger une partie auffi effentielle.
Dès ce moment les Grecs rie fe tiennent plus fur la
défenfive; on les voit porter la guerre jufqu’aux extrémités
de l’Orient : deffein que jamais Alexandre
n’eut fans doute ofé concevoir, fi fon armée n’avoit
été compofée que d’infanterie. Qn fait que les Thef-
faliens ayant imploré le fecours de Philippe contre
leurs tyrans, il les défit, & qu’il s’attacha par-là ce
peuple dont la cavalerie étoit alors la meilleure du
monde ; ce fut elle qui jointe à la phalange macédonienne
, fit remporter tant de vi&oires à Philippe &
à fon fils : c’eft cette cavalerie queTite-Live appelle
Alexandri fortitudo. Quant aux Romains , il eft encore
vrai que dans leur premier temt ils n’eurent
que très-peu de cavalerie. L’hiftoire nous apprend
que Romulus n’avoit danS' les armées les plus flo-
riffantes de fon régné, que mille chevaux fur quarante
fxx mille hommes de pié : ce qu’on en peut
conclure, c’eft que Romulus n’étoit pas fort riche ; la
dépenfe qu’il eût été obligé de faire pour s’en procurer
davantage & pour l’entretenir, auroit de beaucoup
excédé fes forces, dans un tems fur-tout où il
avoit tant d’autres établiffemens à faire : d’ailleurs
les environs de Rome , le fçul pays qu’il poflédoit
cfeüx d’Italie en général, étoient peu prbpre'S pour
la guerre : enfin les premières guerres des Romains
furent contre leurs voifins, qui comme eux n’étoient
:pas en état de s’en fournir, & dans ce cas les chofes
étoient égales de part & d’autre. Les conquêtes &
les alliances que firent par la fuite les Romains, leur
donnèrent les moyens d’augmenter leur cavalerie ;
celle que les peuples, devenus fujets ou alliés de
Rome, entretenoient.pour elle à leurs dépens , étoit
en ce genre la principale force des armées romai*-
’nes : mais cette cavalerie étoit mal armée. Les Ro-,
mains ignorèrent long-tems l’art de s’en fervir avec
avantage ; & c’eft cette inexpérience qu’on peut regarder
comme le principe de tous les malheurs qu’ils
effuyerent dans les deux premières guerres puniques:
dans la première, Regulus eft entièrement
défait par la cavalerie carthagin'oife ; & dans la fécondé
, comme on Ta déjà dit, Annibal bat les Romains
dans toutes les occafions. La cavalerie faifoit
au moins le cinquième de fes troupes ; auffi Fabius
n’eft pas plûtôt à la tête des aripées romaines,
qu’il prend le fage parti d’éviter le combat; & que
pour n’avoir rien à fouffrir de la cavalerie cartha-
ginoife, il eft obligé de ne plus conduire fés légions
que fur le pié des montagnes.
Les Cafthaginois firent enfin fentir aux Romains
l ’obligation d’être forts en cavalerie, ils le leur apprirent
à leurs dépens, & les Romains ne commencèrent
à refpirer que lorfque des corps entiers de cavalerie
numide eurent paffé de leur côté : ces déferlions
qui affoibliffoient d’autant l’ennemi, leur procurèrent
infenfiblement la fupériorité fur les Carthaginois.
Annibal obligé d’abandonner l’Italie pour aller
au fecours de Carthage, n’avoit plus cette formidable
cavalerie avec laquélle il avoit remporté tant
de vittoires : à fon arrivée en Afrique, il fut joint
par deux mille chevaux ; mais un pareil renfort ne
ï ’égaloit pas à beaucoup près à Scipion, dont la ca^
valerie s’étoit augmentée par des recrues faites dans
l ’Efpagne nouvellement conquife, & par la jonâion
. de Mafiniffa roi des Numides, qui avoit appris des
Grecs à bien armer fa cavalerie, & à la bien faire
fervir: ce fut cette fupériorité qui, au rapport de
tous les hiftoriens, décida de la bataille de Zama;
a< La cavalerie, dit M. de Montefquieu ( caufe de la
grandeur & de la décadence des Romains ) , » gagna la
» bataille & finit la guerre ». Les Romains triomphèrent
en Afrique par les mêmes armes qui tant de fois
les avoient vaincus en Italie.
Les Parthes firent encore fentir aux Romains avec
quel avantage on combat un ennemi inférieur en cavalerie.
« La force des armées romaines, dit l’auteur
ci-deffus cité, » confiftoit dans l’infanterie la
» plus ferme, la plus forte, & la mieux difeiplinée
» du monde ; les Parthes n’avoient pas d’infanterie,
» mais une cavalerie admirable, ils combattoient de
y> loin & hors la portée des armes romaines, ils affié-
» geoient une armée plûtôt qu’ils ne la combattoient,
» inutilement pourfuivis , parce que chez eux fuir
» c’étoit cpmbattre : ainfi ce qu’aucune nation n’a-
» voit pas encore fait (d’éviter le joug), celle des
» Parthes le fit, non comme invincible, mais comme
» inacceffible ». On peut dire plus, les Parthes firent
trembler les Romains ; & e’eft fans doute le péril où
cette puiffante rivale mit plus d’une fois leur empire
.en Orient, qui les força d’augmenter confidérable-
ment la cavalerie dans leurs armées. Cette augmentation
leur devenoit d’autant plus -néceffaire , que
leurs frontières s’étant fort étendues, ils n’auroient
pu fans des troupes nombreufes en ce genre, arrêter
les incurfions des Barbares : d’ailleurs , le relâchement
de la difeipline militaire leur fit infenfiblement
perdre l’habitude delfortifier leurs camps, & dès-lors j
leurs armées auroient couru de grands rifques, fans
Tome V%
ûnè Cavalerie capable de réfifter à celle de leurs ennemis
; enfin Ton peut dire que prefque toutes les dif-
graces effuyées, ainfi què la plupart des avantages,
remportes pair les Romains, ont été l’effet, les unes
de leur infériorité, les autres de leur fiipériorité en
cavalerie.
Si Ton veut lire avec attention les commentaires
de'Céfar, on y verra que ce grand homme qui dut fes
principaux fuccès à fon inimitable célérité, fe fervoit
fi utilement de fa cavalerie,-qu’on peut en quelque
forte regarder fes écrits comme la meilleure école
que nous ayons en ce genre.
/ Quand il feroit virai que les anciens fe fuffent paf-
fés de cavalerie, il n’en réfulteroit pas qu’on dût aujourd’hui
n’en point faire ufage : autant vaudroit - il
prétendre qu’on fît la guerre fans canon ,_ces deux
propofitions feroient d’une nature toute femblable ;
ce font des fyftèmes qu’on ne pourra faire approuver
que lorfque toutes les nations guerrières feront convenues
entr’elles d’abolir en même tems l’ufage de la
cavalerie & du canon-.
Pour ne parler que de nos tems & de nos plus grands
généraux (lesTurênne & les Condé), on fait que Mw.
de Turehnê dut la plûpàrt de fes fuccès, pour ne pas
dire tous, à la cavalerie : ce général fans doute comparable
aux plus grands perfonnages de l’antiquité,
avoit pour maxime de travailller l ’ennemi par détail y
maxime qu’il n’auroit pû pratiquer s’il n’eût eu beaucoup
de cavalerie ; auffi fes ahnées furent-elles com-
pôfées prefque toûjoürs d’un plus grand nombre de
gens de cheval, que de gens de pié-.
La célébré bataille de Roeroi nous apprend le cas
que faifoit le grand Condé de la cavalerie, & combien
il favoit la faire fervir avec avantage.Cette victoire
fixe l’époque la plus floriffante de la nation fran-
çoife ; c’eft elle qui commence le régné de Louis le
Grand.
Dans cette fameüfe journée, les manoeuvres de cavalerie
furent exécutées avec autant d’ordre, de pré-
eifion, & de conduite, qu’elles pourroient l’être dans
un camp de difeipline par des évolutions concertées ;
jamais l’antiquité dans une affaire générale n’offrit
des traits de prudence & de valeur tels que ceux qui
ont fignalé cette viâoire ; elle raffemble dans fes cir-
conftances tous les évenemens finguliers qui diftin-
guent les autres batailles, & qui cara&érifent les
propriétés de la cavalerie. « Jamais bataille, ditNL
de Voltaire, » n’avoit été pour la France ni plus glo-
» rieufe , ni plus importante ; elle en fut redevable
» à la conduite pleine d’intelligence du duc d’An-
» guien qui la gagna par lui-même, & par l’effet d’un
» coup-d’oeil qui découvrit à la fois le danger & la
» reffource ; ce fut lui qui à la tête de la cayalerie at-
» ïaqua par trois différentes fois, & qui rompit enfin
» cette infanterie efpagnole jufque-là invincible ; par
» lui le refpeél qu’on avoit pour elle fut anéanti,& les
» armes françoifes dont plufieurs époques étoient fa-
» taies à leur réputation, commencèrent d’être ref-
» peftées ; la cavalerie acquit fur-tout en cette jour-
» née la gloire d’être la meilleure de l’Europe ».
Il n’eft point étonnant que les plus grands hommes
ayent penfé d’une maniéré uniforme fur la néceffité
de la ca valerie ; il ne faut que fui vre pié à pié les opérations
de la guerre pour fe convaincre de l’importance
dont il eft, qu’une armée foit pourvûe d’une bonne
& nombreufe cavalerie.
A examiner le début de deux armées,; on verra
que la plus forte en cavalerie doit néceffairement
impofer la loi à la plus foible, foit en s’emparant
des poftes les plus avantageux pour camper, l’oit en
forçant l’autre par des combats continuels à quitter
fon pays, ou celui dont elle auroit pû fe rendre maî-
trefle.
Alexandre dans fon paffage du Graniqüe, & An-
À A A a a.-ft