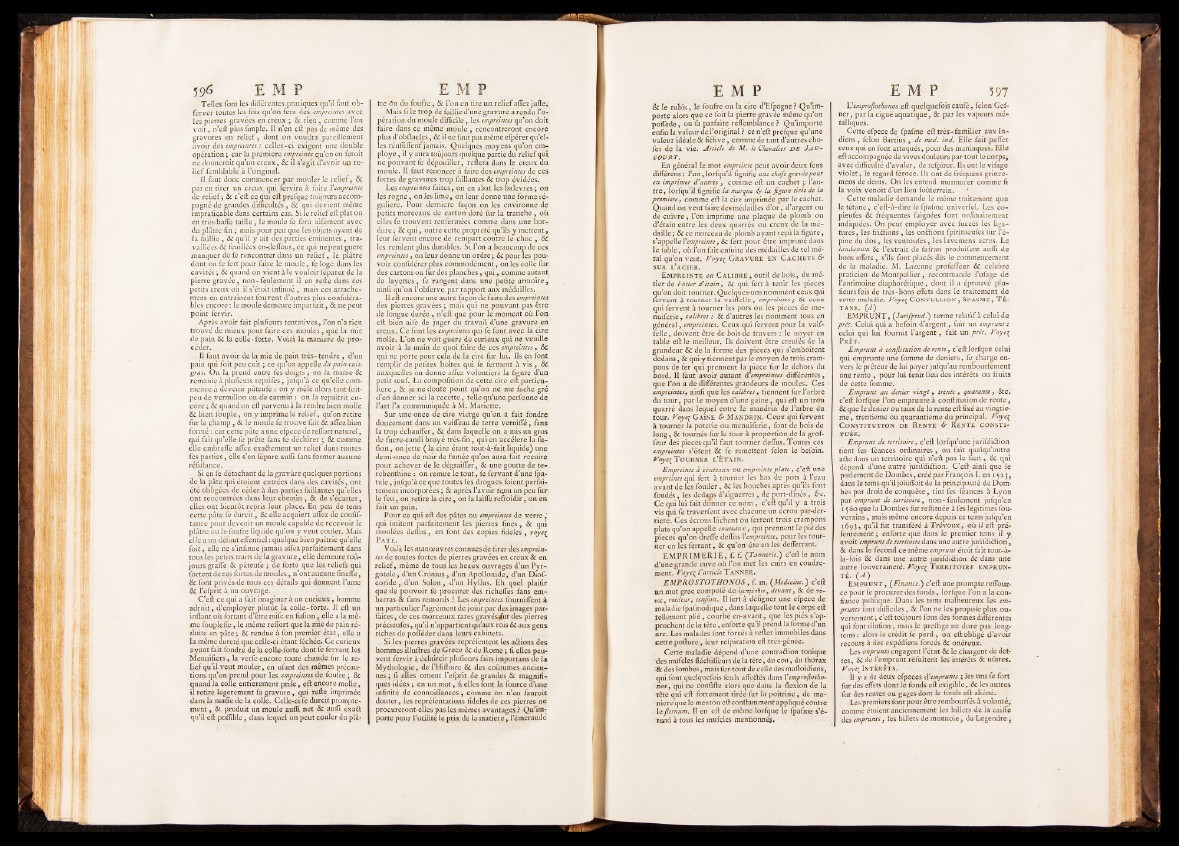
Telles font les différentes pratiques qu’il faut ob-
ferver toutes les fois qu’on fera des empreintes avec
les pierres gravées en creux ; & rien, comme l’on
voit, n’eft plus fimple. Il n’en eft pas de même des
gravures en relief, dont on voudra pareillement
avoir des empruntes : celles - ci exigent une double
opération ; car la première empreinte qu’on en feroit
ne donneroit qu’un creux, 8c il s’agit d’avoir up relief
femblable à l’original.
Il faut donc commencer par mouler le relief, 8c
par en tirer un creux qui fervira à faire l’empreinte
de relief ; & c’eft ce qui eft prefque toujours accompagné
de grandes difficultés, Sc qui devient même
impraticable dans certains cas. Si le relief eft plat ou
en très-baffe taille, le moule fe fera aifément avec
du plâtre fin ; mais pour peu que les objets ayent de
la faillie , Sc qu’il y ait des parties éminentes, travaillées
8c feuillées en-deffous, ce qui ne peut guere
manquer de fe rencontrer dans un relief, le plâtre
dont on fe fert pour faire le moule, fe loge dans les
cavités ; 8c quand on vient à le vouloir féparer de la
pierre gravée, non - feulement il en refte dans ces
petits creux où il s’étoit infinué , mais ces arrache-
mens en entraînent fouvent d’autres plus confidéra-
bles encore : le moule demeure imparfait, & ne peut
point fervir.
Après avoir fait plufieurs tentatives , l’on n’a rien
trouvé de mieux pour faire ces moules, que la mie
de pain 8c la colle-forte. Voici la maniéré de procéder.
Il faut avoir de la mie de pain très-tendre , d’un
pain qui foit peu cuit ; ce qu’on appelle du pain cuit-
gras. On la prend entre fes doigts ; on la manie 8c
remanie à plufieurs reprifes, jufqu’à ce qu’elle commence
à devenir pâteufe : on y mêle alors tant-foit-
peu de vermillon ou de carmin : on la repaîtrit encore
; 8c quand on eft parvenu à la rendre bien molle
8c bien fouple, on y imprime le relief, qu’on retire
fur le champ, & le moule fe trouve fait 8c affez bien
forrùé : car cette pâte a une efpece de reffort naturel,
qui fait qu’elle fe prête fans fe déchirer ; & comme
elle embraffe affez exaftement un relief dans toutes
fes parties, elle s’en fépare auffi fans former aucune
réfiftance.
Si en fe détachant de la gravure quelques portions
de la pâte qui étoient entrées dans des cavités, ont
qté obligées de céder à des parties faillantes qu’elles
ont rencontrées dans leur chemin , & de s’écarter,
elles ont bientôt repris leur place. En peu de tems
cette pâte fe durcit, 8c elle acquiert affez de confif-
tance pour devenir un moule capable de recevoir le
plâtre ou le foufre liquide qu’on y veut couler. Mais
elle a un. défaut effentiel : quelque bien paîtrie qu’elle
foit, elle ne s’infinue jamais affez parfaitement dans
tous les petits traits de la gravure, elle demeure toujours
graffe & pâteufe ; de forte que les reliefs qui
fortent de ces fortes de moules, n’ont aucune fineffe,
8c font privés de tous ces détails qui donnent l’ame
8c l’efprit à un ouvrage.
C ’eft ce qui a fait imaginer à un curieux, homme
adroit, d’employer plûtot la colle-forte. Il eft un
inftant où for tant d’être mife en fufion, elle a la même
foupleffe, le même reffort que la mie de pain réduite
en pâte ; 8c rendue à fon premier état, elle a
la même dureté que celle-ci étant féchée. Ce curieux
ayant fait fondre de la colle-forte dontfe fervent les
Menuifiers, la verfe encore toute chaude fur le relief
qu’il veut mouler, en ufant des mêmes précautions
qu’on prend pour les empreintes de foufre ; 8c
quand la colle entièrement prife, eft encore molle,
il retire legerement fa gravure, qui refte imprimée
dans la maffe de la colle. Celle-ci fe durcit promptement
, & produit un moule auffi net 8c auffi exaél
qu’il eft poffible, dans lequel on peut çouler du plâtre
ôu du foufre, & l’on en tire un relief affez jufte.’
Mais fi le trop de faillie d’une gravure a rendu l’opération
du moule difficile, les empreintes qu’on doit
faire dans ce même moule , rencontreront èncore
plus d’obftacles, 8c il ne faut pas même efpérer qu’elles
réuffiffent jamais. Quelques moyens qu’on employé
, il y aura toujours quelque partie du relief qui
ne pouvant fe dépouiller, reliera dans le creux du
moule. Il faut renoncer à faire des empreintes de ces
fortes de gravures trop faillantes 8c trop évidées.
Les empreintes faites, on en abat les balevres ; on
les rogne, on les lime, on leur donne une forme régulière.
Pour derniere façon on les environne de
petits morceaux de carton doré fur la tranche, où
elles fe trouvent renfermées comme dans une bordure
; 8c qui, outre cette propreté qu’ils y mettent,
leur fervent encore de rempart contre le choc , 8c
les rendent plus durables. Si l’on a beaucoup de ces
empreintes, on leur donne un ordre ; 8c pour les pouvoir
confidérer plus commodément, on les colle fur
des cartons ou fur des planches, qui, comme autant
de layettes, fe rangent dans une petite armoire,'
ainfi qu’on l’obferve par rapport aux médailles.
Il eft encore une autre façon de faire des empreintes
des pierres gravées ; mais qui ne pouvant pas être
de longue durée , n’eft que pour le moment où l’on
eft bien aife de juger du travail d’une gravure en
creux. Ce font les empreintes qui fe font avec la cire
molle. L’on ne voit guere de curieux qui ne veuille
avoir à la main de quoi faire de ces empreintes, 8c
qui ne porte pour cela de la cire fur lui. Ils en font
remplir de petites boîtes qui fe ferment à vis , 8c
auxquelles on donne affez volontiers la figure d’un
petit oeuf. La compofition de cette cire eft particulière
, 8c je ne doute point qu’on ne me fâche gré
d’en donner ici la recette, telle qu’une perfonne d e,
l’art l’a communiquée à M. Mariette.
Sur une once de cire vierge qu’on a fait fondre
doucement dans un vaiffeau de terre verniffé, fans,
la trop échauffer, 8c dans laquelle on a mis un gros
de fucre-candi broyé très-fin, qui en accéléré la fufion,
on jette ( la cire étant tout-à-fait liquide) une
demi-once de noir de fumée qu’on aura fait recuire
pour achever de le dégraiffer, 8c une goutte de te-
rebenthine : on remue le tout, fe fervant d’une fpa-
tule, jufqu’à ce que toutes les drogues foient parfaitement
incorporées ; 8c après l’avoir tenu un peu fur
le feu, on retire la cire, on la laiffe refroidir, on en
fait un pain.
Pour ce qui eft des pâtes ou empreintes de verre,'
qui imitent parfaitement les pierres fines, 8c qui
moulées deffus, en font des copies fideles , voyez Pâte.
Voilà les manoeuvres connues de tirer des empreintes
de toutes fortes de pierres gravées en creux 8c en
relief, même de tous les beaux ouvrages d’un Pyr-
gotele, d’un Cronius, d’un Apollonide, d’un Diof-
coride, d’un Solon, d’un Hyllus. Eh quel plaifir
que de pouvoir fe procurer des richeffes fans embarras
8c fans remords ! Les empreintes fourniffent à
un particulier l’agrément de jouir par des images parfaites
, de ces morceaux rares gravés^ùr des pierres
précieufes, qu’il n’appartient qu’aux rois 8c aux gens
riches de pofféder dans leurs cabinets.
Si les pierres gravées repréfentent les allions des
hommes illuftres de Grece Sc de Rome ; fi elles peuvent
fervir à éclaircir plufieurs faits importans de la
Mythologie, de l’Hiftoire 8c des cpùtumes anciennes
; fi elles ornent l’efprit de grandes 8c magnifia
ques idées ; en un mot, fi elles font la fource d’une
infinité de connoiffances, comme on n’en fauroit
douter, les repréfentations fideles de ces pierres ne
procureront-elles pas les mêmes avantages ? Qu’importe
pour l’utilité le prix de la matière, l’émeraude'
& le rubis, le foufre ou la cire d’Efpagne ? Qu’importe
alors que ce foit la pierre gravée même qu’on
poffede, ou fa parfaite reffemblance ? Qu’importe
enfin la valeur de l’original ? ce n’eft prefque qu’une
valeur idéale 8c fiftive, comme de tant d’autres cho-
fes de la vie. Article de M. le Chevalier d e Ja u -
COURT.
En général le mot empreinte peut avoir deux fens
différens : l’un, lorfqu’il fignifie une chofe gravée pour
en imprimer d'autres , comme eft un cachet ; l’autre
, lorfqu’il fignifie la marque & la figure tirée de la
première, comme eft la cire imprimée par le cachet.
Quand on veut faire desmiédailles d’o r, d’argent ou
de cuivre, l’on imprime une plaque de plomb ou
d’étain entre les deux quarrés ou creux de la médaille
; 8c ce morceau de plomb ayant reçu la figure,
s’appelle Vempreinte, 8c fert pour être imprimé dans
le fable, où l’on fait enfuite des médailles de tel métal
qu’on veut. Voyeç Gravure en Cachets &
suEr l’acier. mpreinte ou Calibre, outil de bois, du métier
de Potier £ étain, 8c qui fert à tenir les pièces
qu’on doit tourner. Quelques-uns nomment ceux qui
fervent à tourner la vaiffelle, empreintes ; 8c ceux
qui fervent à tourner les pots ou les pièces de me-
nuiferie, calibres : 8c d’autres les nomment tous en
général, empreintes. Ceux qui fervent pour la vaiffelle
, doivent être de bois de travers : le noyer en
table eft le meilleur. Ils doivent être creufés de la
grandeur 8c de la forme des pièces qui s’emboîtent
dedans, 8c qui y tiennent p.ar le moyen de trois crampons
de fer qui prennent la piece fur le dehors du
bord. Il faut avoir autant d'empreintes différentes,
que l’on a de différentes grandeurs de moules. Ces
empreintes, ainfi que les calibres, tiennent fur l’arbre
du tour, par le moyen d’une gaine, qui eft un trou
quarré dans lequel entre le mandrin de l’arbre du
tour. Voye^ Gaine 6* Mandrin. Ceux qui fervent
à tourner la poterie ou menuiferie, font de bois de
long, 8c tournés fur le tour à proportion de la grof-
feur des pièces qu’il faut tourner deffus. Toutes ces
empreintes s’ôtent 8c fe remettent félon le befoin.
Voye{ Tourner l’Étain.
Empreinte à couteaux ou empreinte plate , c’eft une
empreinte qui fert à tourner les bas de pots à l’eau
avant de les fouder, 8c les bouches après qu’ils font
foudés, les dedéuis d’aiguerres , de port-dînés , &c.
Ce qui lui fait donner ce nom , c’eft qu’il y a trois
vis qui fe traverfent avec chacune un ecrou par-der-
riere. Ces écrous lâchent ou ferrent trois crampons
plats qu’on appelle couteaux, qui prennent le pié des
pièces qu’on dreffe deffus Vempreinte, pour les tourner
en les ferrant, 8c qu’on ôte en les defferrant.
EM P R IM E R IE , f. f. (Tannerie.) c’eû le nom
d’une grande cuve où l’on met les cuirs en coudre-
ment. Voye^ T article Tanner.
EMPROSTOTHONOS, f. m. (Médecine. ) e’eft
un mot grec compofé de Ipmfôabiv, devant, 8c de to-
Voç, roideuri ttnfion. Il fert à défigner une efpece de
maladie fpafmodique, dans laquelle tout le corps eft
.tellement plié, courbé en-avant, que les piés s’approchent
de la tête, enforte qu’il prend la forme d’un
arc. Les malades font forcés à refter immobiles dans
cette pofture, leur refpiration eft très-gênée.
Cette maladie dépend d’une contraction tonique
des mufelés fléchiffeurs de la tête, du cou, du thorax
des l’ombes, mais fur-tout de celle des maftoïdiens,
qui font quelquefois feuls affeétés dans Y emprofiotho-
nos, qui ne confifte alors que dans la flexion de la
têté qui eft fortement tirée fur la poitrine , de maniéré
que le menton eftconftamment appliqué contre
le flernum. Il en eft de même lorfque le fpafme s’étend
à tous les mufcles mentionnés.
Vemprofiothonos eft quelquefois caufé, félon Gef-
ner, par la ciguë aquatique, 8c par les vapeurs métalliques.
Cette efpece de fpafme eft très-familier aux Indiens
, félon Bartius , de med. ind. Elle fait paffer
ceux qui en font attaqués, pour-des maniaques. Elle
eft accompagnée de vives douleurs par tout le corps,
avec difficulté d’avaler, de refpirer. Ils ont le vifage
violet, le regard féroce. Ils ont de fréquens grince-
mens de dents. On les entend murmurer comme fi
la voix venoit d’un lieu foûterrein. #
Cette maladie demande le même traitement que
le tétane, c’eft-à-dire le fpafme univerfel. Les co-
pieufes 8c fréquentes faignées font ordinairement
indiquées. On peut employer avec fuccès les ligatures,
les friftions , les on&ions fpiritueufes fur l’épine
du dos, les ventoufes, les lavemens acres. Le
laudanum 8c l’extrait de fafran produifent auffi de
bons effets , s’ils font placés dès le commencement
de la maladie. M. Lazenne profeffeur 8c célébré
praticien de Montpellier, recommande l’ufage de
l’antimoine diaphorétique, dont il a éprouvé plufieurs
fois de très-bons effets dans le traitement de
cette maladie. Voyei C o nvulsion, Spasme, T é-
tan è. (d)
EMPRUNT, (Jurifprud.') terme relatif à celui de
prêt. Celui qui a befoin d’argent, fait un emprunt :
celui qui lui fournit l’argent, fait un prêt. Voyeç Prêt.
Emprunt à confiitution de rente, c’eft lorfque celui
qui emprunte une fomme de deniers, fe charge envers
le prêteur de lui payer jufqu’au rembourfement
une rente , pour lui tenir lieu des intérêts ou fruits
de cette fomme.
Emprunt au denier vingt , trente , quarante, &c.'
c’eft lorfque l ’on emprunte à conftitution de rente ,
8c que le denier ou taux de la rente eft fixé au vingtième
, trentième ou quarantième du principal. Voyeç Constitution de Rente & Rente constituée.
Emprunt dt territoire, c’eft lorfqu’une jurifdi&ion
tient fes féances ordinaires, ou fait quelqu’autre
a&e dans un territoire qui n’eft pas le fien , 8c qui
dépend d’une autre jurifdi&ion. C ’eft ainfi que le
parlement de Dombes, créé par François I. en 1 523,
dans le tems qu’il joüiffoit de la principauté de Dombes
par droit de conquête, tint fes féances à Lyon
par emprunt de territoire , non - feulement jufqu’en
1560 que la Dombes fut reftituée à fes légitimes fou-
verains, mais même encore depuis ce tems jufqu’en
1693, qu’il fut transféré à T révoux, où il eft pré-
fentement ; enforte que dans le premier tems il y
a voit emprunt de territoire dans une autre jurifdiâion ,
& dans le fécond ce même emprunt étoit fait tout-à-
la-fois 8c dans une autre jurifdiâion 8c dans une
autre fouveraineté. Voye^ Territoire empruntéE.
0 0 mprunt, (Finance.') c’eft une prompte reffour-
ce pour fe procurer des fonds , lorfque l’on a la confiance
publique. Dans les tems malheureux les emprunts
font difficiles, & l’on ne les propofe plus ouvertement
; c’eft toûjours fous des formes différentes
qui font illufion, mais le preftige ne dure pas long-
tems : alors le crédit fe perd , on eft obligé d’avoir
recours à des expédiens forcés 8c onéreux.
Les emprunts engagent l’état 8c le chargent de dettes,
8c dé l’emprunt réfultent les intérêts 8c ufures.
Voyei Intérêts.
Il y a1 de deux efpeces d’emprunts ; les uns fe fort
fur des effets dont le fonds eft exigible, 8c les autres
fur des rentes ou gages dont le fonds eft aliéné.
Lespremrersïbnt pour être rembourfés à volonté,-
comme étoient anciennement les billets de la caiffe
des emprunts, lès billets de monnoie, de Legendre ,