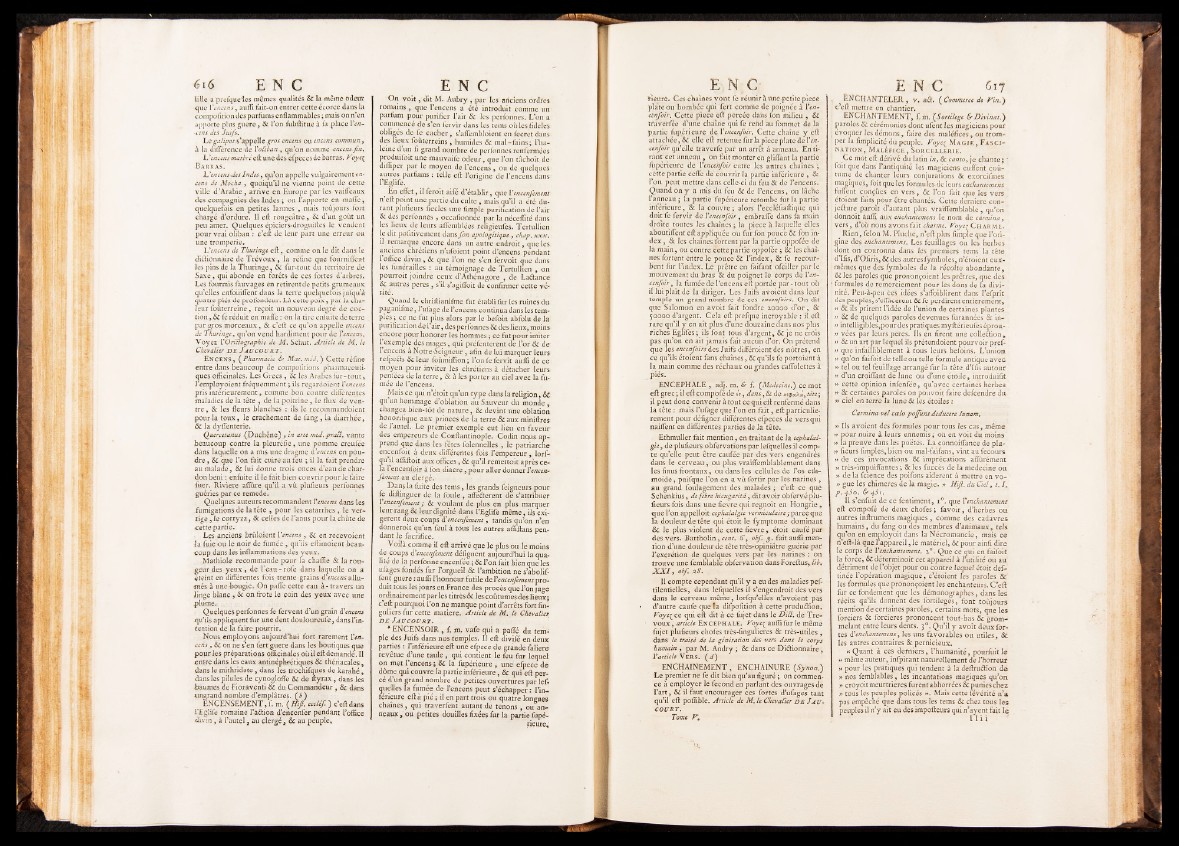
Elle a'prefqueies mêmes qualités & la même odeur
que l'encens, auffi fait-on entrer cette écorce dans la
compofition des parfums enflammables ; mais on n?en
apporte plus guere, & l’on fubftitue à la place Vencens
des Juifs.
Le gvz/zpor-s’appelle gros encens ou encens commun,
. | .. à la différence de Yoliban, qu’on nomme encens fin,
h-encens marbré eft une des efpeces de barras. Vyye_i Barras.
L ’encens-des Indes, qu’on appelle vulgairement encens
de Mocha , quoiqu’il ne vienne point de cette
ville d’Arabie, arrive en Europe par les vaiffeaux
des compagnies des Indes ; on l ’apporte en maffe,
quelquefois en petites larmes , mais toujours fort
chargé d’ordure. Il eft rougeâtre, & d’un goût un
peu amer. Quelques épiciers-droguiftes le vendent
pour vrai oliban : c’en de leur part une erreur ou
une tromperie.
L’encens de Thuringe eft, comme on le dit dans le
di&ionnaire de Trévoux, la réline que fourniffent
les pins de la Thuringe, &c fur-tout du territoire de
Saxe, qui abonde en forêts de ces fortes d’arbres.
Les fourmis fauvages en retirent de petits grumeaux
qu’elles enfoiiifTent dans la terre quelquefois juiqu’à
quatre piés de profondeur. Là cette poix, par la chaleur
foûterreine, reçoit un nouveau degré de coc-
tion, & fè réduit en maffe : on la tire entuite de terre
par gros morceaux, & c’eft ce qu’on appelle encens
de Thuringe y qu’on vend hardiment pour de Vencens.
Voyez l’ O ricio graphie de M. Schut, Article de M. le
Chevalier DE J a u c o u r t . Encens, ( Pharmacie & Mat. med.) Cette réfine
entre dans beaucoup de composions pharmaceutiques
officinales. Les Grecs , & les Arabes fur-tout,
l’employoient fréquemment ; ils regardoient Vencens
pris intérieurement, comme bon contre différentes
maladies de la tête , de la poitrine , le flux de ventre
, & les fleurs blanches :• ils le recommandoient
pour la toux, le crachement de fang , la diarrhée,
& la dyffenterie.
Quercetanus (Duchêne), in arte med. praçt. vante
beaucoup contre la pleuréfie, une pomme creufée
dans laquelle on a mis une dragme à.'encens en poudre
, & que l’on fait cuire au feu ; il la fait prendre
au malade, & lui donne trois onces d’eau de chardon
béni : enfuite il le fait bien couvrir pour le faire
fuer. Riviere affûre qu’il a vu plufieurs perfonnes
guéries par ce remede.
Quelques auteurs recommandent l'encens dans les
.fumigations de la tête , pour les catarrhes , le ver-
tige, le corryza, & celles de l ’anus pour la chute de
■ cette partie.
Les anciens bruloient Y encens , & en reçevoient
la fuie ou le noir de fumée , qu’ils eftimoient beaucoup
dans les inflammations des yeux.
Mathiole recommande pour la chaffie & la rougeur
des y e u x , de l ’eau-rofe dans laquelle on a
éteint en différentes fois, trente grains d'encens allumés
à une bougie. On paffe cette eau à-travers un
linge blanc, & on frote le çoin des yeux avec une
plume.
Quelques perfonnes fe fervent d’un grain d'encens
qu’ils appliquent fur une dent douloureufe, dans l’intention
de la faire pourrir.
Nous employons aujourd’hui fort rarement Yen-
cens , & on ne s’en fert.guere dans les boutiques que
pour les préparations officinales où il eft demande. Il
entre dans les eaux antinéphrétiques & thériacales,
dans le mithridate, dans les trochifques de karahé,
dans les pilules de cynogloffe & de ftyrax, dans les
baumes de Fioraventi & du Commandeur, & dans
ungrand nombre d’emplâtres. (£)
ENCENSEMENT, f. m. {Hifi. eccUf. ) c’eft dans
l’Eglife romaine l’attion d’encenfer pendant l’office
divin , à l’autel, au clergé , & au peuple.
On v o it , dit M. Aubry , par les anciens ordfes
romains, que l’encens a été introduit comme un
parfum .pour purifier l’air & les perfonnes. L’on a
commencé de s’en fervir dans les teins où les fideles
obliges de fe cacher, s’alfembloient enfecretdans
des lieux foûterreins , humides & mal-fains; l’ha-
leine d un li grand nombre de perfonnes renfermées
procküfoit une mauvaife odeur, que l’on tâchoit.de
diffiper par le moyen de l’encens , ou de quelques
autres parfums : telle eft l’origine de l’encens dans
lEglife. 5
% Ën effet, ilferoit aifé d’établir, que Yencenfement
n’eft point une partie du culte , mais qu’il a été durant
plufieurs fiecles une limple purification de l’air
& des perfonnes , occafionnée par la néceffité dans
les lieux de leurs affemblées religieufes. Tertullien
le dit politivement dans fon apologétique , chap. xxx.
il remarque encore dans un autre endroit, que les
anciens chrétiens n’ufoient point d’encens pendant
l’office divin, & que l’on ne s’en fervoit que dans
les funérailles : au témoignage de Tertullien , on
pourroit joindre ceux d’Athénagore , de Laétance
&c autres peres, s’il s’agiffoit de confirmer cette vérité.
Quand le chriftianifme fut établi fur les ruines du
paganifme, l’ufage de l’encens continua dans les temples
; ce ne fut plus alors par le befoin abfolu de la
purification de l’air, des perfonnes & des lieux, moins
encore pour honorer les hommes ; ce fut pour imiter
1 exemple des mages, qui préfenterent de l’or & de 1 encens à Notre-Seigneur, afin de lui marquer leurs
refpe&s leur foûmiffion ; l’on fe fer vit auffi de ce
moyen pour inviter les chrétiens à détacher leurs
penfees de la terre, & à les porter au ciel avec la fumée
de l’encens.
Mais ce qui n’étoit qu’un type dans la religion, &
qu un hommage d’oblation au Sauveur du monde ,
changea bien-tôt de nature, & devint une oblation
honorifique aux princes de la terre & aux miniftres
de l’autel. Le premier exemple eut lieu en faveur
des empereurs de Conftantinople. Codin nous apprend
que dans les fêtes folennelles , le patriarche
encenfoit à deux différentes fois l’empereur , lorf-
qu’il affiftoit aux offices, & qu’il remettoit après cela
l’encenfoir à fon diacre, pour aller donner Yencenfement
au clergé.
Dans la fuite des tems, les grands feigneurs pour
fe diftinguer de la foule , affe&erent de s’attribuer
Yencenfement ; & voulant de plus en plus marquer
leur rang & leur dignité dans l’Eglife même, ils exigèrent
deux coups Yencenfement, tandis qu’on n’en
donneroit. qu’un féul à tous lés autres afliftans pen*
dant le facrifice.
Voilà comme il eft arrivé que le plus ou le moins
de coups Yencenfement défignent aujourd’hui la qualité
de la perfonne encenfée ; & l’on fait bien que les
ufages fondés fur l’orgueil & l’ambition ne s’abolif-
fen t guere : auffi l’honneur futile de Yencenfement produit
tous les jours en France des procès que l’on juge
ordinairement parles titras & les coutumes des lieux;
c’eft pourquoi l’on ne manque point d’arrêts fort fin-
guliers fur cette matière. Article de M. le Chevalier
d e J a u c o u r t .
* ENCENSOIR, f, m. vafe qui a paffé du temple
des Juifs dans nos tempjes. Il eft divifé en deux
parties : l’inférieure eft une efpece de grande faliere
revêtue d’une taule, qui contient le feu fur lequel
on met l’encens; & la fupérieure , une efpece de
dôme qui couvre la.partie inférieure, & qui eft percé
d’un grand nombre de petites ouvertures par lef-
quélles la fumée de l’encens peut s’échapper : l’inferieure
eft à pié ; il en part trois ou quatre longues
chaînes, qui traverfent autant de tenons , ou anneaux
, ou petites douilles fixées fur la partie fupé-
rieure,'
H P
itîeure. Ces chaînes vont fe réunir à Une petite pièce
plate Ou bombée qui fert comme de poignée à Yen-
cinfoir..Cette piece eft percée dans Ion milieu , &
tfaVerfée d’une chaîne qui fe rend au fommet de la
partie fupérieure de Yencenfoir. Cette chaîne y èft
attachée, & elle eft retenue fur la piece plate de Yén-
cenfoir qu’elle traverfe pat un arrêt à anneau. En tirant
cet anneau, bn fait monter en gliffant la partie
ftipërieufe de Yencenfoir entre les antres chaînes ;
cette partie cèffe de couvrir la partie inférieure , &
l’on peut mettre dans celle-ei du feu & de l’encens.
Quand on y a mis du feu & de l’encens, on lâche
l’anneau ; la partie fupérieure retombe fur la partie
inférieure, & la couvre ; alors l’eccléfiaftiqüe qui
doit fe fervir de Yencenfoir, embraffe dans la main
droite toutes les chaînes ; la piece à laquelle elles
aboutiffent eft appliquée ou fur fon pOuce fk fon index
, & les chaînes fortent par la partie oppofée de
la main, ou contre cette partie oppofée ; & les chaînes
fortent entre le pouce & l’index, & fe recourbent
fur l’index. Le prêtre en faifant ofciller par le
mouvement du bras & du poignet le Corps de Yencenfoir
y la fumée de l ’encens eft portée par - tout où
il lui plaît de la diriger. Les Juifs avoient dans leur
temple un grand nombre de ces encenfoirS. On dit
que Salomon en avoit fait fondre 20000 d’o r , &
50000 d’argent. Cela eft prefque incroyable : il eft,
rare qu’il y en ait plus d’une douzaine dans nos plus
riches Eglifes; ils font tous d’argent, & je ne crois
pas qu’on en ait jamais fait aucun d’or. On prétend
que les encenfoirsdes Juifs différoientdes nôtres, en
ce qu’ils étoient fans chaînes, & qu’ils fe portoiént à
la main comme des réchaux ou grandes caffolettes à
p ie s.
ENCEPHALE , adj. m. & f. (’Medecine.) ce mot
eft grec ; il eft compofé de *y, dans, & de xêpaA», tête ;
il peut clone convenir à tout ce qui eft renfermé dans
la tête : mais I’ufage que l’on en fait, eft particulièrement
pour défigner différentes efpeces de vers qui
naiffent en différentes parties de la tête.
Ethmuller fait mention, en traitant de la céphalalgie
y de plufieurs obfervations par lefquelles il compte
qu’elle peut être caufée par des vers engendrés
dans le cerveau, ou plus vraiffemblablement dans
les finus frontaux, ou dans les cellules de I’q s eth-
moïde, puifque l’on en a vu fortir par les narines ,
au grand foulagement des malades; c’eft ce que
Schenkius, de febre hieugaritâ, dit avoir obfervé plufieurs
fois dans une fievre qui regnoit en Hongrie ,
que l’on appelloit céphalalgie vermiculaire ; parce que
la douleur de tête qui étoit le fymptome dominant
& le plus violent de cette fievre, étoit caufépar
des vers. Bartholin, cent. 6 , obf. j . fait auffi mention
d’une douleur de tête très-opiniâtre guérie par
l’excrétion de quelques vers par les narines : on
trouve une femblable obfervation dansForeftus, lib,
X X I y obf. 0.8.
Il compte cependant qu’il y a eu des maladies pef-
tilentielles, dans lefquelles il s’engendroit des vers
dans le cerveau même, lorfqu’elles n’avoient pas
d’autre caufe que fa difpofitioh à cette produ&ion.
Voyeç ce qui eft dit à ce fujet dans le DiB. de Trévoux
, article Encéphale. Foye^ auffi fur le même
fujet plufieurs chofes très-fingulieres & très-utiles ,
dans le traité de la génération des vers dans le corps
humain , par M. Andry ; & dans ce Di&ionnaire,
l ’article Vers, (d')
ENCHAINEMENT, ENCHAINURE (Synon.)
Le premier ne fe dit bien qu’au figuré ; on commence
à employer le fécond en parlant des ouvrages dé
l’art, & il faut encourager ces fortes d’ufages tant
qu’il eft poffible. Article de M . le Chevalier D K J A U -
COURT .
Tome F,
^ ËNCHÀNTÉLER, v. ait. [Comment de Vin.')
•c’eft mettre en chantier.
ENCHANTEMENT, f.m. {Sortilège &Divinat.)
paroles ôt cérémonies dont ufent les magiciens pour
évoquer les démons, faire des maléfices, ou tromper
fa fimplicité du peuple. Voyeç Ma g ie , F a s c i n
a t i o n , M a l é f i c e , S o r c e l l e r i e .
Ce môt eft dérivé du latin in, & canto, je chante ; '
foit que dans l’antiquité les magiciens euffent coû-
tilme de chanter leurs conjurations & exorcifmes
magiques, foit que les formules de leurs enchantemens
fuffent conçues en vers, & l’on fait que les vers
étoient faits pour être chantés. Cette derniere conjecture
pafoît d’autant plus vraiffemblable, qu’on
dônnoit âuffi aux enchantemens le nom de càrmina,
vers, d’où nous avons fait charme. Voyer C harme.
Riert, félon M. Pluché, n’eft plus fimpîe que l’ori-
gihe des enchantemens. Les feuillages ou les herbes
dont on couronna dans lés premiers tems la tête
d’Ifis, d’Ofiris, & des autres fymboles, n’étoient eux-
mêmes que des fymboles de la récolte abondante,
& les paroles qüe pronortçoient les prêtres, que des
formules de remerciement pour les dons de la divinité.
Peü-à-peu ces idées s’affoiblirent dans l’efprit
des peuples, s’effacèrent St fe perdirent entièrement,
« & ils prirent l’idée de l’union de certaines plantes
» & de quelques paroles devenues furannées & in-
» intelligibles,pour des pratiques myftérieufes éprou-
» vées par leurs peres. Ils en firent une colleftion ,
» & un art par lequel ils prétendoient pourvoir pref-
» que infailliblement à tous leurs befoins. L’union
» qu’on faifoit de telle ou telle formule antique avec
» tel ou tel feuillage arrangé fur la tête d’Ifis autour
» d’un croiflant de lune ou d’une étoile, introduifit
» cette opinion infenfée, qu’avec certaines herbes
» & certaines paroles on pouvoit faire defeendre du
» ciel en terré la lune & les étoiles :
Carmina vel ccelo poffunt deducere lunam.
» Ils avoient dés formules pour tous lés cas, même
» pour nuire à leurs ennemis ; oh en voit du moins
» la preuve dans les poètes. La connoiflance de plu-
» fleurs fimples, bien ou mal-faifans, vint au fecours
» de ces invocations St imprécations affûrément
» très-impüiffantes ; & les fuccès de la medecine ou
» de la feience des poifons aidèrent à mettre en vo-
» gue les chimefes de la magie. » Hijl. du Ciel, t. ƒ„ p. 4S0.
Il s’enfuit de cé fentiment, i ô. que Y enchantement
eft compofé de deux chofes; favoir, d’herbes ou
autres inftrumens magiques , comme des cadavres
humains, du fang ou des membres d’animaux, tels
qu’on en ertiployoit dans la Nécromancie, mais ce
n’eft-là que l’appareil, le matériel, & pour ainfi dire
le corps de Y enchantement. x°. Que ce qui en faifoit
la force, & déterminoit cet appareil à l’utilité ou au
détriment de l’objet pour ou contre lequel étoit def-
tinée l’opération magique, c’étoient les paroles &
les formules que prononçoiént les enchanteurs. C ’eft
fur ce fondement que les démonogràphès, dans les
récits qu’ils donnent des fortileges, font toujours
mention de certaines paroles, certains mots, que les
forciers & forcieres prononcent tout-bas & grommelant
entre leurs dents. 30. Qu’il y avoit deux fortes
Y enchantemens, les uns favorables ou utiles, &
les autres contraires & pernicieux.
« Quant à ces derniers, l’humanité, pourfuit le
» même auteur, infpirant naturellement de l’horreur
» pour les pratiques qui tendent à la deftru&ion de
» nos femblables, les incantations magiques qu’on
>> crOyoit meurtrières furent abhorrées & punies chez
» tous les peuples policés ». Mais Cetté févérité n’a
pas empêché que dans tous les tems & chez tous les
peuples il n’y ait eu des impofteurs qui n’ayent fait le
1 1 i i
r S I