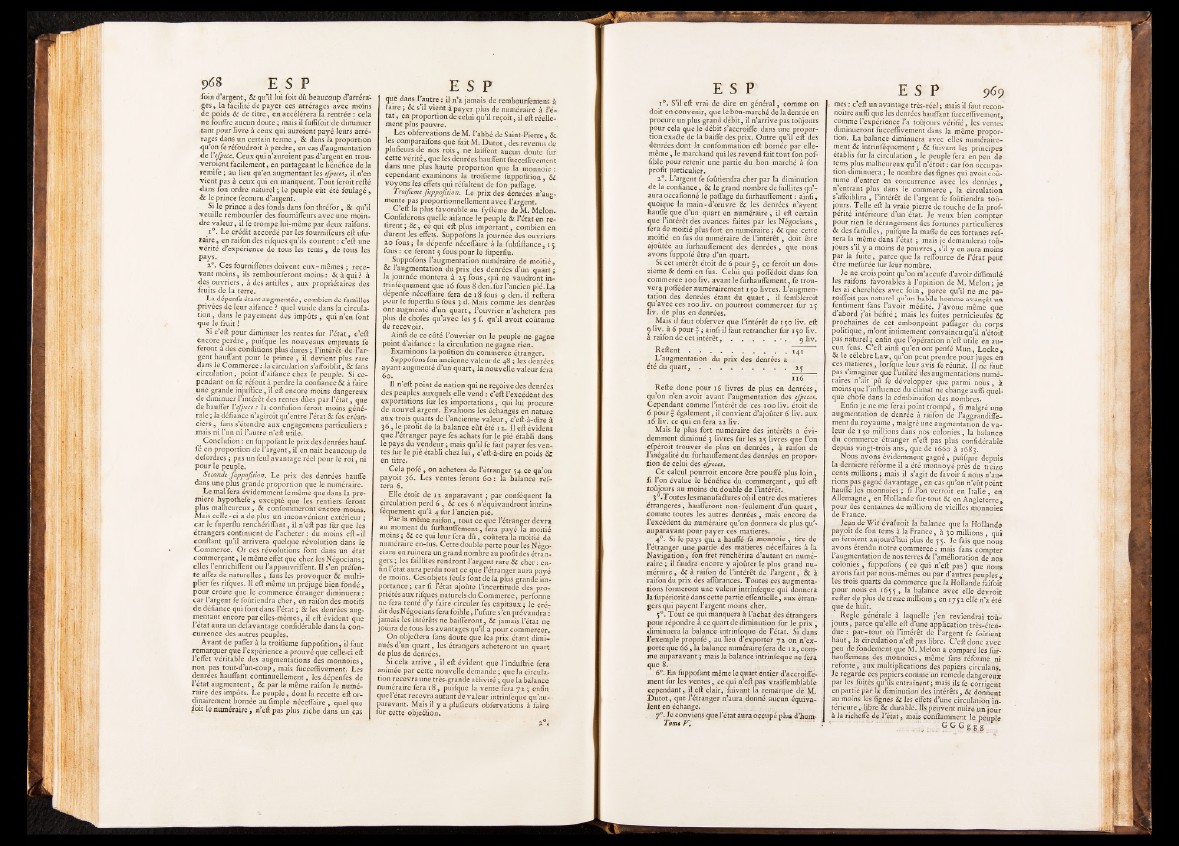
9 6 8 E S P
foin d’argent, & qu’il lui foit dû beaucoup d’arrérages
, la facilité de payer ces arrérages avec moins
de poids 8c de titre, en accélérera la rentrée : cela
ne fouffre aucun doute ; mais il fuflifoit de diminuer
tant pour livre à ceux qui auroient payé leurs arrérages
dans un certain terme , & dans la proportion
qu’on feréfoudroit à perdre, en cas d’augmentation
ce Yefpece. Ceux qui n’auroient pas d’argent en trouveraient
facilement, en partageant le bénéfice de la
remife ; au lieu qu’en augmentant les efpeces, il n’en
vient pas à ceux qui en manquent. Tout feroit relié
dans fon ordre naturel ; le peuple eût été foulagé,
& le prince fecouru d’argent.
Si le prince a des fonds dans fon thréfor, & qu’il
veuille rembourser des fourniffeurs avec une moindre
valeur, il fe trompe lui-même par deux raifons.
i° . Le crédit accordé par les fourniffeurs ell ufu-
raire , en raifondes rifques qu’ils courent : c’elt une
vérité d’expérience de tous les tems, de tous les
pays. /
2,°. Ces fournifleurs doivent eux-mêmes ; recevant
moins, ils rembourferont moins : & à qui ? à
des ouvriers, à des artilles, aux propriétaires des
fruits de la terre.
La dépenfe étant augmentée, combien de familles
.privées de leur aifance ? quel vuide dans la circulation
, dans le payement des impôts , qui n’en font
que le fruit !
Si c’ell pour diminuer les rentes fur l’état, c’efl
encore perdre, puifque les nouveaux emprunts fe
feront à des conditions plus dures ; l’intérêt de l’argent
hauffant pour le prince , il devient plus rare
dans lé Commerce : la circulation s’affoiblit, & fans
circulation, point d’aifance chez le peuple. Si cependant
on fe réfout à perdre la confiance & à faire
une grande injuflice, il ell encore moins dangereux
de diminuer l’intérêt des rentes dues par l’éjat, que
de hauffer Ytfptce : la confulion feroit moins générale
; la défiance n’agiroit qu’entre l’état & fes créanciers
, fans s’étendre aux engagemens particuliers :
mais ni l’un ni l’autre n’ell utile.
. ^ Conclulion : en fuppofant le prix des denrées hauf-
fé en proportion de l’argent, il en naît beaucoup de
defordres ; pas un feul avantage réel pour le ro i, ni
pour le peuple.
Seconde fuppofition. Le prix des denrées hauffe
dans une plus grande proportion que le numéraire.
^Le mal fera évidemment le même que dans la première
hypothefe, excepté que les rentiers feront
plus malheureux, & confommeront encore moins.
Mais celle-ci a déplus un inconvénient extérieur ;
car le fuperflu renchériffant, il n’efl pas fûr que les
étrangers continuent de l’acheter : du moins efl- il
confiant qu’il arrivera quelque révolution dans le
Commerce. Or ces révolutions font dans un état
commerçant, le même effet que chez les Négocians ;
elles l’enrichiffent ou l’appauvrifTent. Il s’en préfente
affez de naturelles , fans les provoquer & multiplier
fes rifques. Il efl même un préjugé bien fondé,
pour croire que le commerce étranger diminuera :
car l’argent fe foûtiendra cher, en raifon des motifs
de défiance qui font dans l’état ; & les denrées augmentant
encore par elles-mêmes, il efl évident que
l’etat aura un defavantage confidérable dans la concurrence
des autres peuples.
Avant de paffer à la troifieme fuppofition, il faut
remarquer que l’expérience a prouvé que celle-ci efl
1 effet véritable des augmentations des monnoies,
non pas tout-d’un-coup, mais fuccefîîvement. Les
denrées hauffant continuellement, les dépenfes de
I état augmentent, &c par la même raifon le numéraire
des impôts. Le peuple, dont la recette efl ordinairement
bornée au fimple néceffaire , quel que
M le numéraire, n’eft pas plus riçhe dans un .cas
E S P
que dans loutre : il n’a jamais de rembourfeirtenâ à
faire ; & s’il vient à payer plus de numéraire à l’état
, en proportion de celui qü’il reçoit, il efl réellement
plus pauvre.
Les obfervations deM. l’abbé de Saint-Pierre, &.
les comparaifons que fait M. Dutot, des revenus de
plufieurs de nos rois, ne biffent aucun doute fur
cette vérité, que les denrées hauffent fucceflivement
dans une plus haute proportion que la monnoie :
cependant examinons la troifieme fuppofition 8c
voyons les effets qui réfultent de fon paffage.
Troifieme füppojition. Le prix des denrées n’augmente
pas proportionnellement avec l’argent.
C ’efl la plus favorable au fyflème de M. Melon.
Confidérons quelle aifance le peuple & l’état en retirent
; & , ce qui efl plus important, combien en
durent les effets. Siippofons la journée des ouvriers
20 fous ; la dépenfe néceffaire à la fubfiflance, 15
fous : ce feront 5 fous pour le fuperflu.
Suppofons l’augmentation numéraire de moitié,
& l’augmentation du prix des denrées d’un quart ;
la journée montera à 25 fous, qui ne vaudront in-
trinféquement que 16 fous 8 den. fur l’ancien pié.La
dépenfe nécèffaire fera de 18 fous 9 den. il refiera
pour le fuperflu 6 fous 3 d. Mais comme les denrées
ont augmenté d’un quart, l’ouvrier n’achetera pas
plus de chofes qu’avec les 5 f. qu’il avoit coutume
de recevoir.
Ainfi de ce côté l’ouvrier ou le peuple ne gagne
point d’aifance : la circulation ne gagne rien.
Examinons la pofition du commerce étranger.
Suppofons fon ancienne valeur de 48 ; les denrées,
ayant augmenté d’un quart, la nouvelle valeur fera
60.
Il n’efl point de nation-qui ne reçoive des denrées
des peuples auxquels elle vend : c’efl l’excédent des.
exportations fur les importations, qui lui procure
de nouvel argent. Évaluons les échanges en nature
aùx trpis quarts de l’ancienne valeur, c’efl-à-dire à
36, le profit de la balance eût été 12. Il efl évident
que l’étranger paye fes achats fur le pié établi dans
le pays du vendeur ; mais qu’il fe fait payer fes ventes
fur le pié établi chez lui, c’efl-à-dire en poids &
en titre.
Cela pofé, on achètera de l’étranger 54 ce qu’on
payoit 36. Les ventes feront 69 : la balance restera
6.
Elle étoit de 12 auparavant ; par conféquent la
circulation perd 6 , &c ces 6 n’équivaudront intrin-
féquement qu’à 4 fur l ’ancien pié.
Par la même raifon, tout ce que l’étranger devra
au moment du furhauffement, fera payé la moitié
moins ; & ce qui leur fera dû, coûtera la moitié de
numéraire en-fus. Cette double perte pour les Négocians
en ruinera un grand nombre au profit des étran-.
gers ; les faillites rendront l’argent rare & cher : enfin
l’etat aura perdu tout ce que l’étranger aura payé
de moins. Ces objets feuls font de la plus grande imT
portance ; car fi l’état ajoûte l’incertitude des pror
priétés aux rifques naturels du Commerce, perfonne
ne fera tenté d’y faire circuler fes capitaux ; le cré^
dit des Négocians fera foible, l’ufure s’en prévaudra :
jamais les intérêts ne bailleront, & jamais l’état ne
jouira de tous les avantages qu’il a pour commercer,
On objectera fans doute que les prix étant diminués
d’un quart, les étrangers achèteront un quart
de plus de denrées.
Si cela arrive , il efl évident que I’induflrie fera
animée par cette nouvelle demande ; que la circular
tion recevra une très-grande aélivité ; que la balance
numéraire fera 18, puifque la vente fera 72 ; enfin,
que l’etat recevra autant de valeur intrinfeque qu’au-
paravant. Mais il y a plufieurs obfervations à faire
fur cette objection.
M
E S P
î °. S’il efl vrai de dire en général, comme on
doit en convenir, que le bon-marché de la denrée en
procure un plus grand débit, il n’arrive pas toûjours
pour cela que le débit s’accroiffe dans une proportion
exaéte de la baiffe des prix. Outre qu’il efl dès
denrées dont la confommation efl bornée par elle-
même , le marchand qui les revend fait tout fon pof-
fible pour retenir une partie du.bon marché à fon
profit particulier.
20. L’argent fe foûtiendra cher par la diminution
de la confiance, & le grand nombre de faillites qu’aura
occafionné le paffage du furhauffement : ainfi,
quoique la main-d’oeuvre & les denrées n’ayent
hauffé que d’un quart en numéraire, il efl certain
que l’intérêt des avances faites par les Négocians ,
fera de moitié plus fort en numéraire ; & que cette
moitié en fus du numéraire de l’intérêt, doit être
ajoûtée au furhauffement des denrées, que nous
avons fuppofé être d’un quart.
Si cet intérêt étoit de 6 pour £ , ce feroit un douzième
& demi en fus. Celui qui poffédoit dans fon
commerce 100 liv. avant le furhauffement, fe trouvera
pofféder numérairement 150 livres. L’augmentation
des denrées étant du quart, il fembleroit
qu’avec ces 100liv. on pourrait commercer,fur 25
liv. de plus en denrées.
Mais il faut obferver que l’intérêt de 1 ço liv. efl
9 liv. à 6 pour £ ; ainfi il faut retrancher fur 150 liv.
à raifon de cet intérêt, . . . . . - . o fiv.
R e f i e n t .................................................... 141
L’augmentation du prix des denrées a
été du quart, . . . . . . . . . 2y
ï 16 '
Refie donc pour 16 livres de plus en denrées,
qu’on n’en avoit avant l’augmentation des efpeces.
Cependant comme l’intérêt de ces 100 liv. étoit de
6 pour £ également, il convient d’ajoûter 6 liv. aux
16 liv. ce qui en fera 22 liv.
Mais le plus fort numéraire des intérêts a évidemment
diminué 3 livres^ furies 25 livres que l’on
efpéroit trouver de plus en denrées, à raifon de
l ’inégalité du furhauffement des denrées en proportion
de celui des efpeces.
Ce calcul pourroit encore être pouffé plus loin,
fi l’on évalue le bénéfice du commerçant, qui efl
toûjours au moins du double de l’intérêt.
3 °. Toutes les manufactures où il entre des matières
étrangères, haufferont non-feulement d’un quart,
comme toutes lés; autres denrées, mais encore de
l ’excédent du numéraire qu’on donnera de plus qu’au
para vant pour payer ces matières,
40. Si Iè pays qui a hauffé fa monnoie , tire de
l ’étranger une partie des matières néceffaires à la
.Navigation , fon fret renchérira d’autant en numéraire
; il faudra encore y ajoûter le plus grand numéraire
, & à raifon de l’intérêt de l’argent, & à
raifon du prix des affûrances. Toutes ces augmentations
formeront une valeur intrinfeque qui donnera
2a fupériorité dans cette partie effentielle, aux étrangers
qui payent l’argent moins cher.
50. Tout ce qui manquera à l’achat des étrangers
pour répondre à ce quart de diminution fur le prix,
diminuera la balance intrinfeque de l’état. Si dans
l ’exemple propofé, au lieu d’exporter 72 on n’exporte
que 66, la balance numéraire fera de 12,.côiri-
me auparavant ; mais la balance intrinfeque ne fera
que 8.
6°. En fuppofant même le quart ëntîer d’accroiffe-
ment fur les ventes, ce qui n’eft pas* vraisemblable
cependant, il efl clair, fuivapt la .remarque dé M.
D u to t, que l’étranger n’aura donné aucun équivalent
en échange.
70. Je conviens que l’état aura occupé plus d’fipm-
Totnt K,
ES P 9 6 9
mes : .c’efl un avantage très-réel ; mais il faut recon-
noître auflî que les denrées hauffant fucceflivement,
comme l’experience l’a toûjours vérifié, les ventes
diminueront fucceflivement dans la même proportion.
La balance diminuera avec elles numérairement
& intrinsèquement ; & fuivant les principes
établis fur la circulation, le peuple fera en peu de
tems plus malheureux qu’il n’étoit : car fon occupation
diminuera ; le nombre des lignes qui avoit,coû-
tume d’entrer en concurrence avec les denrées ,
n entrant plus^ dans le commerce , la circulation
s affoiblira , l’intérêt de l’argent fe foûtiendra toû-
jours; Telle 1& vraie pierre de touche de la prof-
perite inferieure d’un état. Je veux bien compter
pour rien le dérangement des fortunes particulières
& des familles, puifque la maffe de ces fortunes ref*.
tera la meme dans l’etat ; mais je demanderai toûjours
s’il y a moins de pauvres, s’il y en aura moins
par la fuite, parce que la reffource de l’état peut
être mefurée fur leur nombre.
Je ne crois point qu’on m’accufe d’avoir difîimulé
les raifons favorables à l’opinion de M. Melon; je.
les ai cherchées avec foin, parce qu’il ne me pa-'
roiffoit pas naturel qu’un habile homme avançât un
fentiment fans 1 avoir médité. J’avoue même que
d’abord j’ai héfité ; mais les fuites pernicieufes &
prochaines de cet embonpoint paffager du corps
politique, m’ont intimement convaincu qu’il n’étoit
pas naturel ; enfin que l’opération n’efl utile en aucun
fens. C’efl ainfi qu’en ont penfé Mun, Locke >
& le célébré Law, qu’on peut prendre pour juges en
ces matières, lorfque leur avis fe réunit. Il ne faut
pas s’imaginer que l’utilité 'des augmentations numéraires
n’ait pû fe développer que parmi nous, à
moins que l’influence du climat ne change aufîi quel-
qu’e chofe dans la cdmbinaifon des nombres.
Enfin je ne me ferai point trompé, fi malgré une
augmentation de denrée à raifon de l’aggrandiffe-
ment du royaume, malgré une augmentation de valeur
de ï 50 millions dans nos- colonies, la balance
du commerce étranger n’efl pas plus confidérable
depuis vingt-trois ans, que de 1660 à 1683.
. Nous avons-évidemment gagné, puifque depuis
la derniere réforme il a été monnoyé près de treize
cents millions ; mais il s’agit de favoir fi nous n’aurions
pas gagné davantage , en ças qu’on n’eût point
hauffé les monnoies ; fi l’on verroit en Italie , en.
Allemagne , en HollandeTur-tout & en Angleterre ,
pour des centaines de millions de vieilles monnoies
de Françe.
Jean de V î t évalüoit la balance que la Hollande
payoit de fon tems à la France, à 30 millions , qui
en feraient aujourd’hui plus de 5 5. Je fais que nous
avons étendu notre commerce : mais fans compter
l’augmentation de nos terres & l’amélioration de nos
colonies , fuppofons (ce qui n’efl pas) que nous
avons fait par nous-mêmes ou par d’autres peuples ’
les trois quarts du commerce que la Hollande faifoit
pour nous en 16 çç , la balance avec elle devroit
refier d.e plus de treize millions ; en 1752 elle n’a été
que de huit.,
V Réglé générale à laquelle j’en reviendrai toûjours
, parce qu’elle efl d’une application très-étendue
: par-tout où l’intérêt de l’argent fe foutiënt
haut, là circulation n’efl paslibre. C’efl donc aÿeb
jpeu de fondement que M. Melon a comparé lei fur-
hauffemens des monnoies, même fans réformé ni
refonte, aux multiplications des papiers circulons.
Je regarde ces papiers comme un remede dangereux
par les fuitês.qû’ijs entraînent^ mais ils fe corrigent
en partié par la' diminution des intérêts, & donnent
au moins'les'fignes & les effets d’une circulation intérieure,:
libre ôç durable. Ils,peuvent nuire un jour
à la richeffé de l ’état, mais cônflamment lé peuple
. G G G g g ,g ;
I
I
€