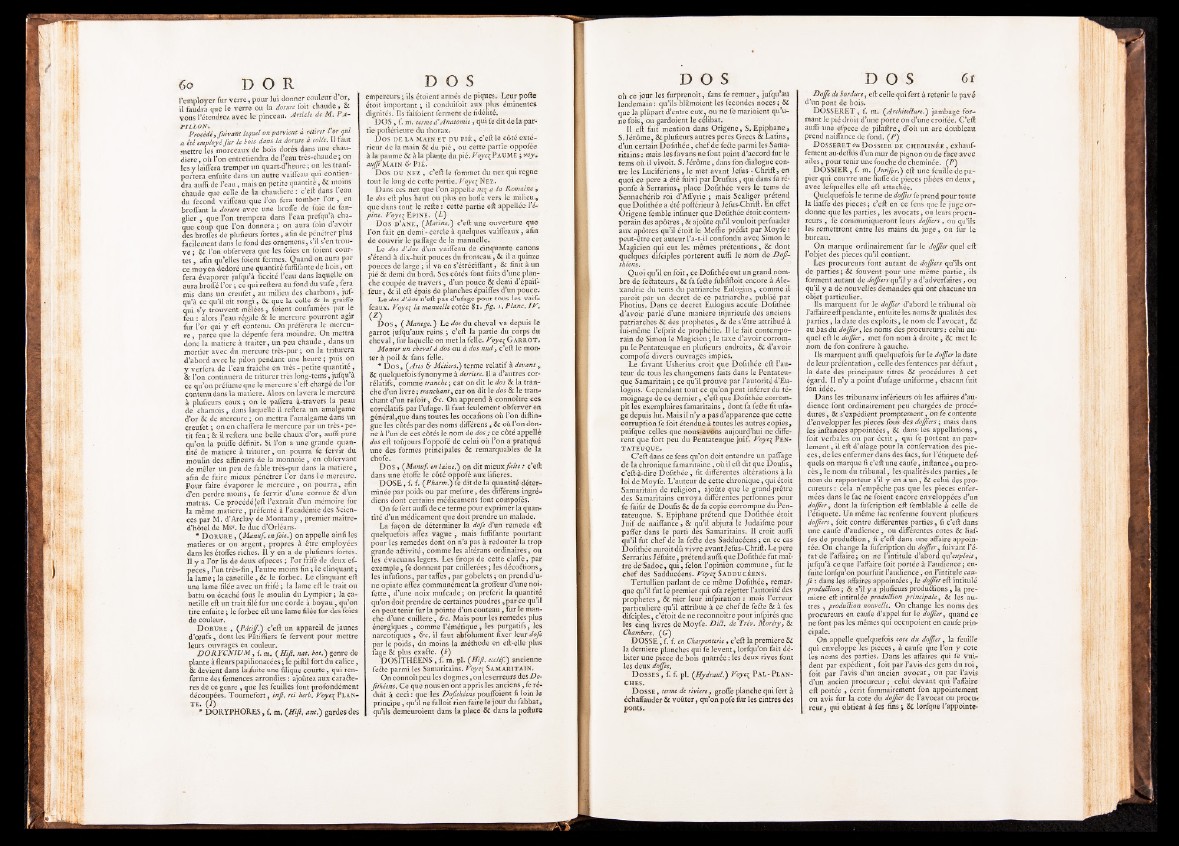
l’employer fur verre, pour lui donner couleur d’or,
il faudra que le verre ou la dorure foit chaude, &
VOUS l’étendrez avec le pinceau. Article de M. P a -
P IL L O i f% , . „
Procédé ifiiv a n t lequel on parvient a retirer l or qui
a été employé fur le bois dans la dorure à colle. Il faut
mettre les morceaux de bois dores dans une chaudière
, oti l’on entretiendra de l’eau très-chaude ; on
les y laiffera tremper un quart-d’heure ; on les tranf-
portera enfuite dans un autre vaiffeau qui contiendra
aufli de l’eau, mais en petite quantité, & moins
chaude que celle de la chaudière : c’eft dans l’eau
du fécond vaiffeau que l’on fera tomber lo f , en
broffant la dorure avec une broffe dê foie de fan-
glier , que l’on trempera dans l’eau prefqu’à chaque
coup que l’on donnera ; on aura foin d avoir
des broffes de plufieurs fortes, afin de pénétrer plus
facilement dans le fond des ornemens, s’il s’en trouve
; & l’on obfervera que les foies en fôiènt courtes
, afin qu’elles foient fermes. Quand on aura par
ce moyen dédoré une quantité fufiifante de bois, ort
fera évaporer jufqu’à liccité l’eau dans laquelle On
aura broffé l’or ; ce qui reliera au fond du v a fë , fera
mis dans un creufet, au milieu des charbons, jufqu’à
ce qu’il ait rougi, & que la colle & la grâiffe
qui s’y trouvent mêlées, foient confumees par le
feu : alors l’eau régale & le mercure pourront agir
fur l’or qui y eft contenu. On préférera le mercure
, parce que la dépenfe fera moindre. On mettra
donc la matière à traiter, un peu chaude, dans un
mortier avec du mercure très-pur ; on la triturera
d’abord avec le pilon pendant une heure ; puis on
y verfera de l’eau fraîche en très - petite quantité,
& l’on continuera de triturer très long-tems, jufqu’à
ce qu’on préfume que le mercure s’eft chargé de l’or
contenu dans la matière. Alors on lavera le mercure
à plufieurs eaux ; on lé paffera à-travers la peau
de chamois, dans laquelle il reliera un amalgame
d’or & de mercure ; on mettra l’amalgame dans un
creufet ; on en chaffera le mercure par un très - petit
feu ; & il reliera une belle chaux d’or, aufli pure
qu’on la puiffe définir. Si l’on a une grande quantité
de matière à triturer, on pourra fe fervir du
moulin des aflineurs de la monnoie , en obfervant
de mêler un peu de fable très-pur dans la matière,
afin de faire mieux pénétrer l’or dans le mercure.
Pour faire évaporer le mercure, on pourra, afin
d’en perdre moins, fe fervir d’une cornue & d’un
matras. Ce procédé {eft l’extrait d’un mémoire fur
la même matière, préfenté à l’académie dès Sciences
par M. d’Arclay de Montamy, premier maître-
d’hôtel de Msr. le duc d’Orléans.
* D orure , (Manuf. enfoie.') on appelle ainfi les
matières or ou argent, propres à être employées
dans les étoffes riches. Il y en a de plufieurs fortes.
Il y a l’or lis de deux efpeces ; l’or frifé de deux ef-
peces, l’un très-fin, l’autre moins fin ; le clinquant ;
la lame ; la canetille, 8c le forbec. Le clinquant eft
une lame filée avec un frifé ; la lame eft le trait ou
battu ou écaché fous le moulin du Lympier ; la canetille
eft un trait filé fur une corde à boyau, qu’on
tire enfuite j le forbec eft une lame filée fur des foies
de couleur.
D orure , (Pâtiff,.) c’eft un appareil de jaunes
d’oeufs, dont les Pâtifliers fe fervent pour mettre
leurs ouvrages en couleur.
DORYCNIUM, f. m. (HUI. nat. bot.) genre de
plante à fleurs papilionacées ; le piftil fort du calice,
& devient dans la/uite une filique courte, qui renferme
des femences arrondies : ajoûtez aux cara&e-
res de ce genre , que les feuilles font profondément
découpées. Tournefort, inû. rei herb. Voye^ Plan-
TE. (ƒ)
* DORYPHORES, (. m. {Hiß, anc.) gardes des
empereurs ; ils étoient armés de piques. Leur pofte
étoit important ; il conduifoit aux plus éminentes
dignités. Ils faifoient ferment de fidélité.
DOS , f. m. terme d'Anatomie, qui fe dit de la partie
poftérieure du thorax.
D o s de la main et du pie , c’eft le côté extérieur
de ia main 8c du pié, ou cette partie oppofée
à la paume & à la plante du pié. Voye^Paume ; voy.
aufji Main & Pîé .
Dos du nez , c’eft le fommet du nez qui régné
tout le long de cette partie. Voye{ Nez.
Dans ces nez que l’on appelle ne{ à la Romaine ,
le dos eft plus haut ou plus en boffe vers le milieu,
que dans tout le refte : cette partie eft appellée i’é-
pine. Voyeç EPINË. (L)
Dos d ’a n e , (Marine.) c’eft une ouverture que
l’on fait en demi - cercle à quelques vaiffeaux, afin
de couvrir le paffage de la manuelle.
Le dos d’âne d’un vaiffeau de cinquante canons
s’étend à dix-huit pouces du fronteau , & il a quinze
pouces de large ; il va en s’étréciffant > 8c finit à un
pié & demi du bord. Ses côtés font faits d’une planche
coupée de travers, d’un pouce 8c demi d’épaif-
feur, & il eft épais de planches épaiffes d’un pouce*
Le dos d'âne n’eft pas d’ufage pour tous les vaiffeaux.
Voye^ la manuelle cotée 81. fig. <. Plane. IY*
(Z ) . ,
D o s , ( Manege. ) Le dos du cheval va depuis le
garrot jufqu’aux reins ; c’eft la partie du corps du
cheval, fur laquelle on met la felle. Voye^ Gar ro t .
Monter un cheval à dos ou à dos nud, c’eft le monter
à poil & fans felle*
* D o s , (Arts & Métiers.) terme relatif à devant y
8c quelquefois fynonyme à derrière. Il a d’autres corrélatifs
, comme tranche ; car on dit le dos & la tranche
d’un livre ; tranchant, car on dit le dos & le tranchant
d’un rafoir, &c. On apprend à connoître ces
corrélatifs par l’ufage. Il faut feulement obferver en
général,que dans toutes les occafions oh l’on diftin-
gue les côtés par des noms différens, & oii l’on donne
à l’un de ces côtés le nom de dos ; ce côté appelle
dos eft toûjours l’oppofé de celui où l’on a pratiqué
une des formes principales 8c remarquables de la
chofe.
D o s , (Manuf. en laine.) on dit mieux faîte : c’eft
dans une étoffe le côté oppofé aux lifieres.
D O SE , f. f. ( Pharm.) fe dit de la quantité déterminée
par poids ou par mefure, des différens ingré-
diens dont certains médicamens font compofés.
On fe fert aufli de ce terme pour exprimer la quantité
d’un médicament que doit prendre un malade.
La façon de déterminer la dofe d’un remede eft
quelquefois affez vague , mais fuffifante pourtant
pour les remedes dont on n’a pas à redouter la trop
grande a â iv itê, comme les altérans ordinaires, ou
les évacuans légers. Les firops de cette claffe, par
exemple, fe donnent par cuillerées ; les décodions,
les infufions, par taffes, par gobelets ; on prend d’une
opiate affez communément la groffeur d’une noi-
fette, d’une noix mufeade ; on preferit la quantité
qu’on doit prendre de certaines poudres, par ce qu’il
en peut tenir fur la pointe d’un couteau, fur le manche
d’une cuillère, &c. Mais pour les remedes plus
énergiques , comme l’émétique, les purgatifs, les
narcotiques , &c. il faut aWolument fixer leur dofe
par le poids, du moins la méthode en eft-elle plus
fage & plus exa&e. (b)
DOSITHÉENS, f. m. pl. (Hift. eccléf.) ancienne
feûe parmi les Samaritains. Yoye[ Sama rita in.
On connoît peu les dogmes, ou les erreurs des Do-
jithèens. Ce que nous en ont appris les anciens, fe réduit
à ceci : que les Dofithéens pouffoient fi loin le
principe, qu’il ne falloit rien faire le jour du fabbat,
qu’ils demeuroient dans la place 8c dans la pofture
oh ce jour les furprenoit, fans fe remuer, jufqü’au
lendemain : qu’ils blâmoient les fécondés noces ; 8c
que la plûpart d’entre eux, ou ne fe marioient qu’une
fois* ou gardoient le célibat.
Il eft fait mention dans Origene, S. Epipbane a
S. Jérôme, & plufieurs autres peres Grecs & Latins,
d’un certain Dofithée, chef de feéle parmi les Samaritains
: mais les favans ne font point d’accord fur le
tems oh il vivoit. S. Jérôme, dans fon dialogue contre
les Lucifériens, le met avant Jefus - Chrift, en
quoi ce pere a été fuivi par Drufius, qui dans fa re-
ponfe à Serrarius, place Dofithée vers le tems de
Sennachérib roi d’Affyrie ; mais Scaliger prétend
que Dofithée a été poftérieur à Jefus-Chrift. En effet
Origene femble infinuer que Dofithée étoit contemporain
des apôtres, & ajoute qu’il vouloit perfuader
aux apôtres qu’il étoit le Meflie prédit par Moyfe :
peut-être cet auteur l’a-t-il confondu avec Simon le
Magicien qui eut les mêmes prétentions, 8c dont
quelques difciples portèrent aufli le nom de Dofithéens.
Quoi qu’il en foit, ce Dofithée eut un grand nombre
de feélateurs, 8c fa feéle fubfiftoit encore à Alexandrie
du tems du patriarche Euiogius, comme il
paroît par un decret de ce patriarche, publié par
Photius. Dans ce decret Euiogius accufe Dofithée
d ’avoir parlé d’une maniéré injurieufe des anciens
patriarches & des prophètes, & de s’être attribué à
lui-même l’efprit de prophétie. Il le fait contemporain
de Simon le Magicien ; le taxe d’avoir corrompu
le Pentateuque en plufieurs endroits, 8c d’avoir
compofé divers ouvrages impies.
Le favant Usherius croit que Dofithée eft l’auteur
de tous les changemens faits dans le Pentateuque
Samaritain ; ce qu’il prouve par l’autorité d’Eu-
logius.' Cependant tout ce qu’on peut inférer du témoignage
de ce dernier, c’èft que Dofithée corrompit
les exemplaires famaritains, dont fa feéle fit ufa-
ge depuis lui. Mais il n’y a pas d’apparence que cette
corruption fe foit étendue à toutes les autres copies,
puifque celles que nousÿavôns aujourd’hui ne different
que fort peu du Pentateuque juif. Voye^ Penta
t euq ue.
C ’eft dans ce fens qu’on doit entendre un paffage
de la chronique famaritaine, oh il eft dit que Doufis,
c ’eft-à-dire Dofithée, fit différentes altérations à la
loi de Moyfe. L ’auteur de cette chronique, qui étoit
Samaritain de religion, ajoûte que le grand-prêtre
des Samaritains envoya différentes perfonnes pour
fe faifir de Doufis 8c de fa copie corrompue du Pentateuque.
S. Epiphane prétend que Dofithée étoit
Juif de naiffance, & qu’il abjura le Judaïfme pour
paffer dans le parti des Samaritains. Il croit aufli
qu’il fut chef de la feéle des Sadducéens; en ce cas
Dofithée auroitdû vivre avant Jefus-Chrift. Le pere
Serrarius Jéfuite, prétend aufli que Dofithée fut maître
de'Sadoc, qui, félon l’opinion commune, fut le
chef des Sadducéens. Yoye^ Sadducéens.
Tertullien parlant de ce même Dofithée, remarque
qu’il fut le premier qui ofa rejetter l’autorité des
prophètes, 8c nier leur infpiration : mais l’erreur
particulière qu’il attribue à ce chef de fefte & à fes
difciples, c’étoit de ne reconnoître pour infpirés que
les cinq livres de Moyfe. Dict. de Trév. Moréry, &
Ckambers. (G)
DOSSE, f. f. en Charpenterie, c’eft la première &
la derniere planches qui fe lèvent, lorfqu’on fait débiter
une piece de bois quarrée : les deux rives font
les deux dojfes.
D osses , f. f. pl. (Hydraul.) Yoyei Pa l -P lanches.
D osse, terme de rivière , groffe planche qui fert à
cchaffauder & voûter, qu’on pofe fur les cintres des
ponts.
Dofe de bordure, eft celle qui fert à retenir le pavé
'd’un pont de bois.
DOSSERET, f. m. (Architecture.) jambage formant
le pié droit d’une porte ou d’une croifée. C ’eft
aufli une efpece de pilaftre, d’oh un arc doubleau
prend naiffance de fond. (P)
DossEREt ou D ossier de cheminée , exhauf-
fement au-deffùs d’un mur de pignon ou de face avec
ailes, pour tenir une fouche de cheminée. (P)
DOSSIER, f. m. (Jurïfpr.) eft une feuille de papier
qui couvre une liaffe de pièces pliées en deux,
avec lefquelles elle eft attachée.
Quelquefois le terme de doffier fe prend pour toute
la liaffe des pièces ; c’eft en ce fens que le juge ordonne
que les parties, les avocats, ou leurs procureurs
, fe communiqueront leurs doffiers , ou qu’ils
les remettront entre les mains du juge, ou fur le
bureau.
On marque ordinairement fur le dofjier quel eft
l’objet des pièces qu’il contient.
Les procureurs font autant de doffiers qu’ils ont
de parties ; 8c fouvent pour une même partie, ils
forment autant de doffiers qu’il y a d’adverfaires, ou
qu’il y a de nouvelles demandes qui ont chacune un
objet particulier.
Ils marquent fur le doffier d’abord le tribunal oh
? l’affaire eft pendante, enfuite les noms & qualités des
parties, la date des exploits, le nom de l’avocat, 8c
au bas du dofjier, les noms des procureurs : celui auquel
eft le doffier, met fon nom à droite, 8c met le
nom de fon confrère à gauche.
Ils marquent aufli quelquefois fur le doffier la date
de leur préfentation, celle des fentences par défaut,
la date des principaux titres & procédures à cet
égard. Il n’y a point d’ufage uniforme, chacun fuit
fon idée.
Dans les tribunaux inférieurs oh les affaires d’audience
font ordinairement peu chargées de procédures
, & s’expédient promptement, on fe contente
d’envelopper les pièces fous des doffiers ; mais dans
les inftances appointées, 8c dans* les appellations ,
foit verbales ou par écrit, qui fe portent au parlement
, il eft d’ufage pour la confervation des pièces
, de les enfermer dans des faes, fur l ’étiquete def-
quels on marque fi c’eft une caufe, inftance, ou procès
, le nom du tribunal, les qualités des parties, le
nom du rapporteur s’il y en a un, 8c celui des procureurs
: cela n’empêche pas que les pièces enfermées
dans le fac ne foient encore enveloppées d’un
doffier, dont la fufeription eft femblable à celle de
l’étiquete. Un même fac renferme fouvent plufieurs
doffiers, foit contre différentes parties, fi c’eft dans
une caufe d’audience, ou différentes cotes 8c liaf-
fes de produélion, fi c’eft dans une affaire appointée.
On change la fufeription du doffier, fuivant l’état
de l’affaire ; on ne l’intitule d’abord qu’exploit,
jufqu’à ce que l’affaire foit portée à l’audience ; en-
fuite lorfqu’on pourfuit l’audience, on l’intitule caufe
: dans les affaires appointées, le doffier eft intitulé
production ; & s’il y a plufieurs produirions, la première
eft intitulée production principale, & les autres
, production nouvelle. On change les noms des
procureurs en caufe d’appel fur lé doffier, quand ce
ne font pas les mêmes qui occupoient en caufe principale.
On appelle quelquefois cote du doffier, la feuille
qui enveloppe les pièces, à caufe que l ’on y cote
les noms des parties. Dans les affaires qui lé vul-
dent par expédient, foit par l’avis des gens du roi,
foit par l’avis d’un ancien avocat, ou par l’avis
d’un ancien procureur ; celui devant qui l’affaire
eft portée , écrit fommairement fon appointement
ou avis fur la cote du doffier de l’avocat ou procu?
I reur, qui obtient à fes fins j 8c lorfque l ’appointe