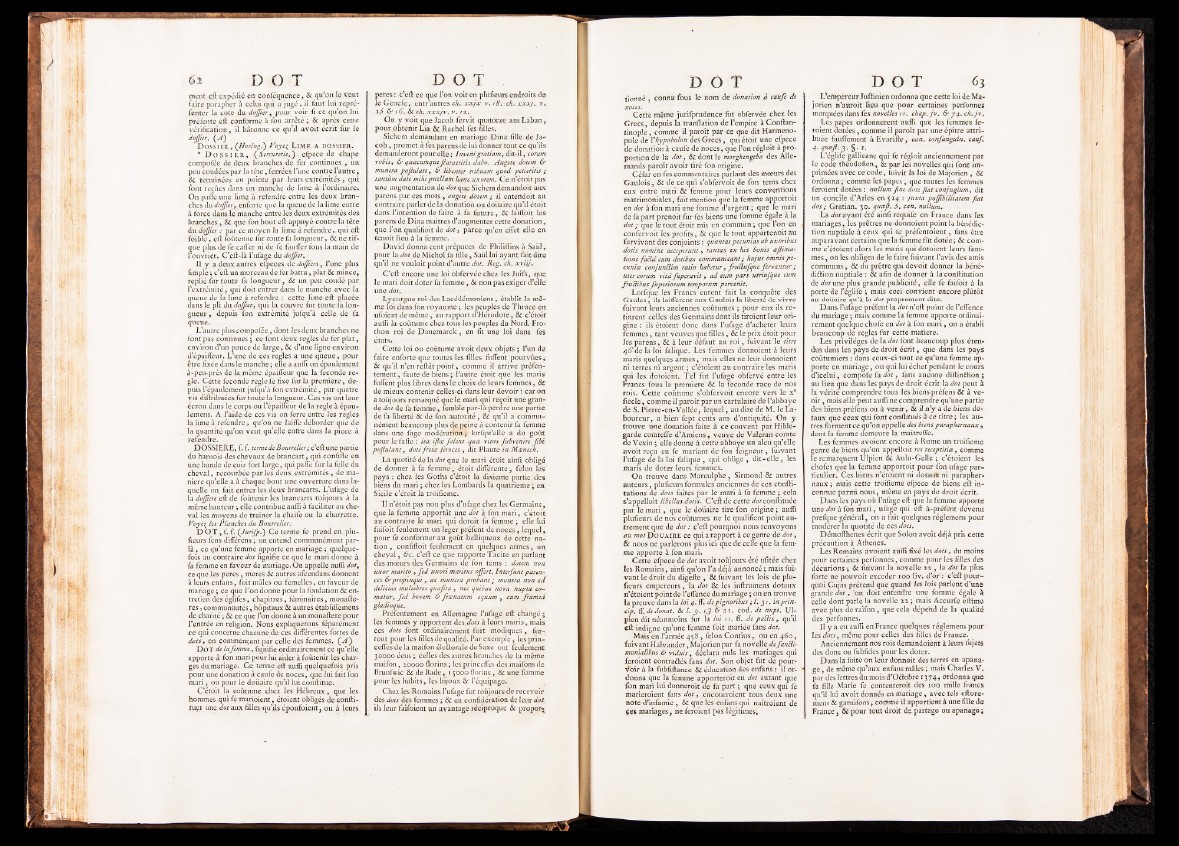
ment eft expédié en conféquehce, & qü’on le Veut
faire parapher à celui qui a jugé, il faut lui repré -
Tenter la cote du doffier, pour voir fi ce qu’on lui
préfente eft conforme à fon arrêté ; & après, cette
vérification, il bâtonne ce qu’il avoit écrit fur le
ZoJJÎer. (A)
D o s s ie r , ( fforlog.) Voye^ L im e a d o s s ie r .
* D o s s i e r , ( Serrurerie. ) efpece de chape
tompofée de deux branches de fer continues , un
peu coudées par la tête, ferrées l’une contre l’autre,
& terminées en pointe par leurs extrémités > qui
font reçues dans un manche de lime à l’ordinaire*,
On paflé une lime à refendre entre les deux branches
du doffier, enforte que la queue de la lime entre
à forcé dans le manche entre les deux extrémités des
branches, & que fon bout eft appuyé contre la tête
du doffier ; par ce moyen la lime à refendre, qui eft
foible, eft loûtenue fur toute fa longueur, & ne rif-
que plus de fe cafter ni de fe fauffer fous la main de
l’ouvrier. C’eft-là l’ufage du dojjier.
Il y a deux autres elpeces dedo/fiers, l’une plus
fimple ; c’eft un morceau de fer battu, plat & mince,
replié fur toute fa longueur, & un peu coudé par
l'extrémité, qui doit entrer dans le manche avec la
queue de la lime à refendre : cette lime eft placée
dans le pli du doffier, qui la couvre fur toute fa longueur
, depuis fon extrémité jufqu’à celle de fa
queue.
L’autre plus compofée, dont les deux branches ne
font pas continues ; ce font deux réglés de fer p lat,
environ d’un pouce de large, & d’une ligne environ,
d’épaiffeur. L’une de ces réglés a une queue, pour
être fixée dans le manche ; elle a aufli un épaulement
à-peu-près de la même épaiffeur que la fécondé réglé.
Cette fécondé réglé fe fixe fur la première, depuis
l’épaulement jufqu’à fon extrémité, par quatre
vis diftribuées fur toute la longueur. Ces vis ont leur
écrou dans le corps ou l’épaiffeur de la réglé à épau-
lemens. A l’aide de ces vis on ferre entre les réglés
la lime à refendre, qu’on ne laiffe déborder que de
la quantité qu’on veut qu’elle entre dans la piece à
refendre.
DOSSIERE, f. f. terme de Bourrelier; c’eft une partie
du harnois des chevaux de brancart, qui confifte en
une bande de cuir fort large, qui paffe fur la Telle du
cheval, recourbée par les deux extrémités, de maniéré
qu’elle a à chaque bout une ouverture dans laquelle
on fait entrer les deux brancarts. L’ufage de
la dojjiere eft de foûtenir les brancarts toujours à la
même hauteur ; elle contribue aufli à faciliter au cheval
les moyens de traîner la chaife ou la charrette.
Voye{ les Planches du Bourrelier.
D O T , f. f. ( Jurifp«) Ce terme fe prend en plu-
fieurs fens différens ; on entend communément par-
là , ce qu’une femme apporte en mariage ; quelquefois
au contraire dot fignifie ce que le mari donne à
la femme en faveur de mariage. On appelle aufli dot,
ce que les peres, meres & autres afcendans donnent
à leurs enfans, foit mâles ou femelles, en faveur de
mariage ; ce que l ’on donne pour la fondation & entretien
des églifes, chapitres, féminaires, monafte-
res, communautés, hôpitaux & autres établiffemens
de charité ; & ce que l’on donne à un monaftere pour
l’entrée en religion. Nous expliquerons féparément
ce qui concerne chacune de ces différentes fortes de
dots, en commençant par celle des femmes. (A )
D o t delàfemme, fignifie ordinairement ce qu’elle
apporte à fon mari pour lui aider à foûtenir les charges
du mariage. Ce terme eft aufli quelquefois pris
pour une donation à caufe de noces, que lui fait fon
mari, ou pour le doiiaire qu’il lui conftitue.
C ’étoit la coûtume chez les Hébreux, que les
hommes qui fe marioient, étoient obligés de confti-
tuer une dot aux filles qu’ils époufoient, ou à leurs
pètes : c’eft ce que l’on voit en plufieurs endroits de
le Genefe, entrautres ch, x x jx v. 18. ch. xxxj. v.
iJ & / 6\.& ch.xxxjv. y. ix.
On y voit que Jacob fervit quatorze ans Laban,
pour pbtenir Lia & Rachel fes filles;
Sichem demandant en mariage Dina fille de Ja*
co b , , promet à fes parens de lui donner tout ce qu’ils
demanderont pour elle : Inveni gratiam, dit-il, coram
vobis, & quacumque fiatueritis dabo. Augete dotent &
munera pojlulate, & libenter tribuam quod petieritis ƒ
tantum date mi/iipuellam hanc uxorem. Ce n’étoit pas
une augmentation de dot que Sichem demandoit aux
parens par ces mots, augete dotem ; il entendoit au
contraire parler de la donation ou doiiaire qii’il étoit
dans l’intention de faire à fa future, & laiflbit le9
parens de Dina maîtres d’augmenter cette donation,
que l’on qualifioit de dot, parce qu’en effet elle en
tenoit lieu à la femme.
David donna cent prépuces de Philiftins à Saiil,
pour la dot de Michol fa fille, Saiil lui ayant fait dire
qu’il ne vouloit point d’autre dot. Reg. ch. xviij.
C ’eft encore une loi obfervée chez les Juifs, que
le mari doit doter fa femme, & non pas exiger d’elle
une doti -
Lycurgue roi des Lacédémoniens, établit la même
loi dans fon royaume ; les peuples de Thrace eri
ufoient de même, au rapport d’Hérodote, & c’étoit
aufli la coûtume chez tous les peuples du Nord. Fro-
thon roi de Danemarck, en fit une loi dans fes
états*
Cette loi ou coûtume aVoit deux objets ; Piin dë
faire enforte que toutes les filles fuffent pourvûes ;
& qu’il n’en reftât point, comme il arrive préfen-
tement, faute de biens ; l’autre étoit que les maris
fuffent plus libres dans le choix de leurs femmes, &
de mieux contenir celles-ci dans leur devoir : car on
a toûjours remarqué que le mari qui reçoit une grande
dot de fa femme, femble par-là perdre une partie
de fa liberté & de fon autorité , & qu’il a communément
beaucoup plus de peine à contenir fa femme
dans une fage modération f Iorfqu’elle a du goût
pour le fafte : ica ifloe folent qucé viros fubvenire Jibi
pojlulant, dote fréta feroces, dit Plaute in Manechi
La quotité de la dot que le mari étoit airtfi obligé
de donner â fa femme, étoit différente, félon les’
pays : chez les Goths c’étoit la dixième partie : des
biens du mari ; chez les Lombards la quatrième ; en
Sicile c’étoit lâ trôifieme.
11 n’étoit pas non plus d’ufage chez les Germains ,
que la femme apportât une dot à fon mari, c’étoit
au contracte le mari qui dotoit fa femme ; elle lui
faifoit feulement un leger préfent de noces , lequel,
pour fe conformer au goût belliqueux dé cette nation
, confiftoit feulement en quelques armes, un
cheval, &c. c’eft ce que rapporte Tacite en parlant
des moeurs des Germains de fon tems : dotem non
ùxor marito , fed uxori mariais offert, Interfunt parentes
& propinqui , ac munera probant ; munera non ad
delicias muliebres quafita , nec quibus nova nupta co-
matur, fed bovem & franatum equum , cum frameâ
gladioque.
Préfentement en Allemagne Pufage eft changé ;
les femmes y apportent des,dots à leurs maris, mais
ces dots font ordinairement fort modiques , fur-,
tout pour les filles de qualité. Par exemple, les prin-
ceffes de la maifon éleftorale de Saxe ont feulement
30000 écus ; celles des autres branches de la même
maifon, zoooo florins ; les princeffes des maifons de
Brunfwic & de Bade, 15000 florins, & une fomme
pour lés habits, les bijoux & l’équipage*
Chez les Romains l’ufage fut toûjours de recevoir
des dots des femmes ; & en confidération de leur dot.
ils leur faifoient un avantage réciproque & proportïonné
, connu fous le nom dé donation â Cdufe de
noces.
Cette même jurifprudence fut obfervée chez les
Grecs, depuis la tranflation de l’empire à Conftan-
tinoplè, comme il paroît par Ce que dit Harmeno-
pttle de Ykypobdlon des Grecs, qui étoit une efpece
de donation à caufe de noces, que l’on régloit a proportion
de la dot, & dont le morghengeba des Allemands
paroît avoir tiré fon origine.
Céfar en fes commentaires parlant des moeurs des
Gaulois, ôc de ce qui s’obfervoit de fon tems chez
eux entre mari & femme pour leurs conventions
matrimoniales, fait mention que la femme apportoit
en dot à fon mari une fomme d’argent ; que le mari
de fa part prenoit fur fes biens une fomme égale à la
dot ; que le tout étoit mis en commun ; que l’on en
confervoit les profits, & que le tout appartenoit au
furvivant des conjoints : quantaspétunias ab uxoribus
dotis nomine acceperunt, tantas ex kis bonis aftima-
tione facta cum dotibus communicant; hujus omnis pétunia
conjunclim ratio habetur, fruciufque fervantur ;
■ uter eorum vitâ fuperavit, ad eum pars utriufque cum
fruclibus fuperiorum temporum pervenit.
Lorfque les Francs eurent fait la conquête des
Gaules, ils laifferent aux Gaulois la liberté de vivre
fuivant leurs anciennes coûtumes ; pour eux ils retinrent
celles des Germains dont ils tiroient leur origine
ils étoient donc dans l’ufage d’acheter leurs
femmes, tant veuves que filles, & le prix étoit pour
les parens, & à leur defaut au ro i, fuivant'le titre
46'de la loi falique. Les femmes donnoient à leurs
maris quelques armes, mais elles ne leur donnoient
ni terres ni argent ; c’étoient au contraire les maris
qui les dotoient. Tel fut l’ufage obfervé entre les
Francs fous la première & la leconde race de nos
rois. Cette coûtume s’obfervoit encore vers le xe
fiecle, comme il paroît par un cartulaire de l’abbaye
de S. Pierre-en-ValIée, lequel, au dire de M. le La*
boureur, a bien fept cents ans d’antiquité. On y
trouve une donation faite à ce couvent par Hilde-
garde cofiateffe d’Amiens, veuve de Valeran comte
de Vexin ; elle donne à cette abbaye un aleu qu’elle
avoit reçu en fe mariant de fon feigneur, fuivant
l’ufage de la loi falique , qui oblige , d it-elle , les
maris de doter leurs femmes.
On trouve dans Marculphe, Sirmond & autres
auteurs, plufieurs formules anciennes de ces cOnfti-
tutions de dots faites par le mari à fa femme ; cela
s’appelloit libellus dotis. C ’eft de cette dot conftituée
par le mari, que le doiiaire tire fon origine ; aufli
plufieurs de nos coûtumes ne le qualifient point autrement
que de dot : c’eft pourquoi nous renvoyons
au mot D o u a ir e ce qui a rapport à ce genre de dot,
& nous ne parlerons plus ici que de celle que la femme
apporte à fon mari.
Cette efpece de dot avoit toûjours été tifitée chez
les Romains, ainfi qu’on l’a déjà annoncé ; mais fuivant
le droit du digeftè , & fuivant les lois de plufieurs
empereurs, la dot & les inftrumens dotaux
n’étoient point de l’effence du mariage ; on en trouve
la preuve dans la loi 4. ff. depignoribus ; l . 31. inprin-
eip. ff. de donat. & /. £. >3 & 22. cod. de nupt. Ulpien
dit néanmoins fur la loi 11. ff. de paUis , qu’il
eft indigne qu’une femme foit mariée fans dot.
Mais en l’année 458, félon Contius, ou en 460,
fuivant Halvander, Majorien par fa novelle de fancti-
monialibus & viduis, déclara nuis les mariages qui
feroient contraûés fans dot. Son objet fut de pourvoir
à la fubfiftance & éducation des enfans : il ordonna
que la femme apporteroit en dot autant que
fon mari lui donneroit de fa part ; que ceux qui fe
marieroient fans dot, encourroient fous deux une
note d’infamie, & que les enfans qui naîtroient de
ces mariages, ne feroient pas légitimes,
L’etnpereur Juftinien ordonna que cette loi de Majorien
n’auroit lieu que pour certaines perfonnes
. marquées dans fes novetles 11. chap.jv. & y 4. ch. jv .
Les papes ordonnèrent aufli que les femmes fe-
rôient dotées, comme il paroît par une épître attribuée
fauffement à Evarifte, can. confanguin, cauf
4. quafi.3.%. 1.
L’églife gallicane qui fe régloit anciennement par
le code théodofien, & par les novelles qui font imprimées
avec ce code, fuivit la loi de Majorien, &
ordonna-? comme les papes, que toutes les femmes
feroient dotées : nullum fine dote fiat cûnjugium, dit
un concile d’Arles en 514 : juxta poffibilitatem fiai
dos ; Gratian. 30. quajt. 5. can. nullum.
La dot ayant été ainfi réquife en France dans les
mariages, les prêtres ne donnoient point la bénédiction
nuptiale à ceux qui le préfentoient, fans être
auparavant certains que la femme fut dotée ; & comme
c’étoient alors les maris qui dotoient leurs femmes
, on les obligea de le faire fuivant l’avis des amis
communs, & du prêtre qui devoit donner la béné-
dittion nuptiale : & afin de donner à la conftitution
de dot une plus grande publicité, elle fe faifoit à la
porte de l’eglife ; mais ceci convient encore plûtôt
au doiiaire qu’à la dot proprement dite.
Dans l’ufage préfent la dot n’eft point de l’effence
du mariage ; mais comme la femme apporte ordinairement
quelque chofe en dot à fon mari, on a établi
beaucoup de réglés fur cette matière.
Les privilèges de la dot font beaucoup plus étendus
dans les pays de droit écrit, que dans les pays
coûtumiers : dans ceux-ci tout ce qu’une femme apporte
en mariage, ou qui lui échet pendant le cours
d’icelui, compofe fa dot, fans aucune diftinéfion ;
au lieu que dans les pays de droit écrit la dot peut à
la vérité comprendre tous les biens préfens & à ve*
n ir, mais elle peut aufli ne comprendre qu’une partie
des biens préfens ou à venir, & il n’y a de biens do*
taux que ceux qui font conftitués à ce titre ; les autres
forment ce qu’on appelle des biens paraphernaux >
dont la femme demeure la maîtreffe.
Les femmes avoient encore à Rome un-trôifieme
genre de biens qu’on appelloit res receptitia , comme
le remarquent Ulpien & Aulu-Gelle ; c’étoient les
chofes que la femme apportoit pour fon ufage particulier.
Ces biens n’étoient ni dotaux ni paraphernaux
; mais cette trôifieme efpece de biens eft inconnue
parmi nous, même en pays de droit écrit.
Dans les pays où l’ufage eft que la femme apporte
une dot à fon mari, ufage qui eft à-préfént devenu
prefque général, on a fait quelques réglemens pour
modérer la quotité de ces dots.
Démofthenes écrit que Solon avoit déjà pris cette
précaution à Athènes.
Les Romains avoient aufli fixé les dots 3 du moins
pour certaines perfonnes, comme pour les filles des
décurions ; & fuivant la novelle 12 , la dot la plus
forte ne pou voit exceder 100 liv. d’or : c’eft pourquoi
Cujas prétend que quand les lois parlent d’une
grande dot, 'on doit entendre une fomme égale à
celle dont parle la novelle 22 ; mais Accurfe eftime
avec plus de raifon, que cela dépend de la qualité
des perfonnes.
Il y a eu aufli en France quelques réglemens pour
les dots, même pour celles des filles de France.
A nciennem ent no s ro is d em an d o ién t à leu rs fujets
des dons o u fubfides p o u r les d o ter.
Dans la fuite on leur donnoit des terres en apanage
, de même qu’aux enfans mâles ; mais Charles V.
par des lettres du mois d’Oétobre 1374, ordonna que
fa fille Marie fe contenteroit des 100 mille francs
qu’il lui avoit donnés en mariage, avec tels eftore-
mens & garnifons, comme il appartient à une fille de
France, &pour tout droit de partage ou apanage?