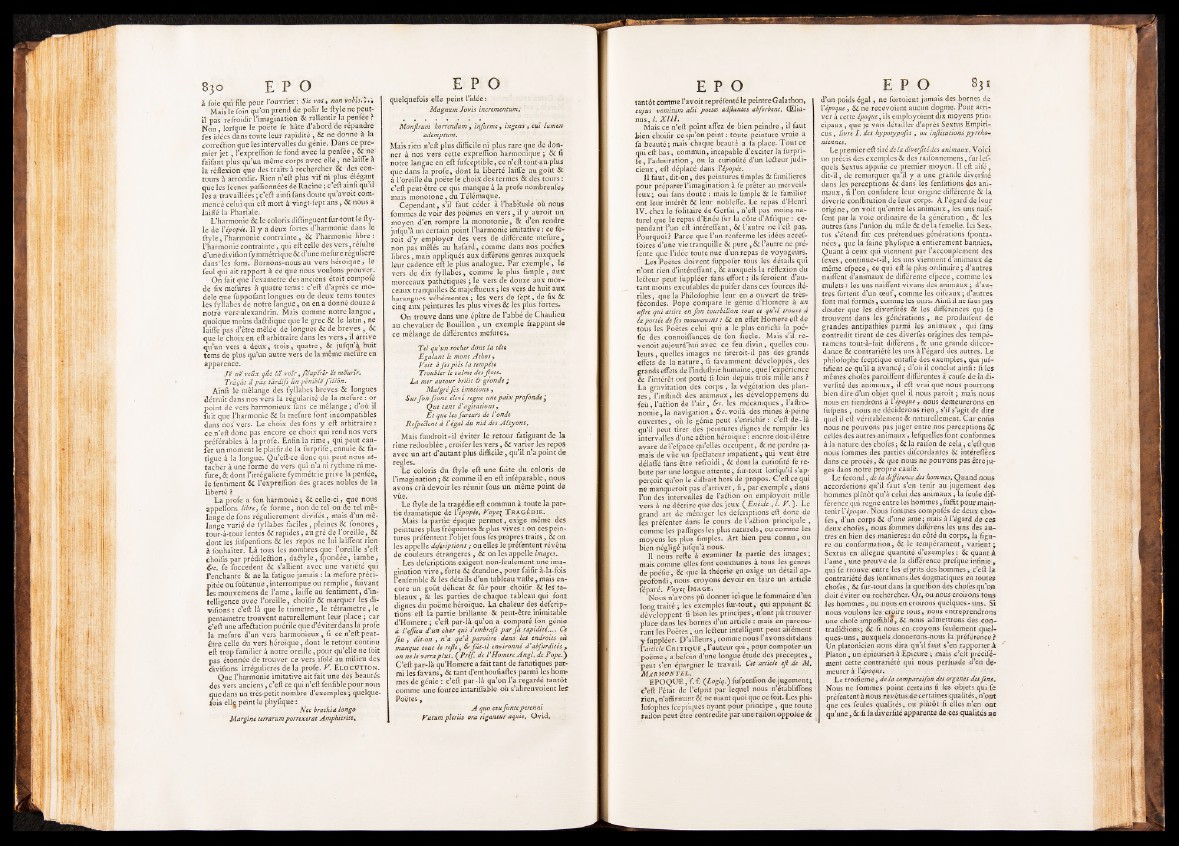
à foie qui file pour l’ouvrier: Sic vos, nonvobis.".^
Mais le foin qu’on prend de polir le ftyle ne peut-
il pas refroidir l’imagination & rallentir la çenfée ?
Non Iorfque le poëte fe hâte d’abord de répandre
fes idées dans toute leur rapidité, & ne donne à la
correftion que les intervalles du génie. Dans ce premier
je t , l’expreflion fe fond avec la perifee , & ne
faifant plus qu’un même Corps avec elle , ne laiffe à
la réflexion que des traits à rechercher &c des contours
à arrondir. Rien n’eft plus v if ni plus élégant
que les {cènes paflionnées de Racine ; c ’eft ainfi qu’il
les a travaillées ; c’eft ainfi fans doute qu’avoit commencé
celui qui eft mort à vingt-fept ans, & nous a
laiffé la Pharfale.
L’harmonie & le coloris diftinguent fur-tout le fty-
le de Y épopée. Il y a deux fortes d’harmonie dans le
ftyle, l’harmonie contrainte, 8c l’harmonie libre :
l’harmonie contrainte, qui eft celle des vers,relulte
d’unedivifion fymmétrique 8c d’une mefure reguliere
dans*les fons. Bornons-nous au vers héroïque, le
feul qui ait rapport à ce que nous voulons prouver.
On fait que l’exametre des anciens étoit compofé
de fix mefures à quatre tems : c’eft d’après ce modèle
que fuppofant longues ou de deux tems toutes
les fyllabes de notre langue, on en a donné douze à
notre vers*alexandrin. Mais comme notre langue,
quoique moins da&ilique que le grec 8c le latin, ne
laiffe pas d’être mêlée de longues & de brèves , &
que le choix en eft arbitraire dans les vers, il arrive
qu’un vers a deux, trois, quatre, & jufqu’à^ huit
tems de plus qu’un autre vers de la même mefure en
apparence.
Je rie veux que la voir, foupirer et mtfurïr.
Traçât a pas tardifs un pénible fillôn.
Ainfi le mélange des fyllabes brèves & longues
détruit dans nos vers la régularité de la mefure : or
point de vers harmonieux fans ce mélange ; d’où il
fuit que l’harmonie 8c la mefure font incompatibles
dans nos' vers. Le choix des fons y eft arbitraire :
ce n’eft donc pas encore ce choix qui rend nos vers
préférables à la profe. Enfin la rime, qui peut cau-
fer un moment le plaifir de la furprife, ennuie 8c fatigue
à la longue. Qu’eft-ce donc qui peut nous attacher
à une forme de vers qui n’a ni rythme ni mefure,
& dont l’irréguliere fymmétrie prive la penfée,
le fentiment 8c l’exprelfion des grâces nobles de la
liberté ?
La profe a fon harmonie ; 8c celle-ci, que nous
appelions libre, fe forme, non de tel ou de tel mélange
de fons régulièrement divifés , mais d’un mélange
varié de fyllabes faciles, pleines 8c fonores,
tour-à-tour lentes 8c rapides, au gré de l’oreille, &
dont les fufpenfions 8c les repos ne lui laiflent rien
à fouhaiter. Là tous les nombres que l’oreille s’eft
choifis par prédilection, da&yle , fpondée, iambe,
&c. fe fuccedent 8c s’allient avec une variété qui
l ’enchante & ne la fatigue jamais : la mefure précipitée
ou foûtenue, interrompue ou remplie, fuivant
fes mouvemens de Taine, laiffe au fentiment, d’intelligence
avec l’oreille, choifir 8c marquèr les di-
vifions : c’eft là que le trimetre, le tétrametre , le
pentamètre trouvent naturellement leur place ; car
c ’eft une affeftation puérile que d’éviter dans la profe
la mefure d’un vers harmonieux, fi ce n’eft peut-
être celle du vers héroïque, dont le retour continu
eft trop familier à notre oreille, pour qu’elle ne foit
pas étonnée de trouver ce vers ifolé au milieu des
divifions irrégulières de la profe. V. Elocution.
Que l’harmonie imitative ait fait une des beautés
des vers anciens, c’eft ce qui n’eft fenfible pour nous
?ue dans un très-petit nombre d’exemples ; quelque-
ois elle peint le phyfique :
Nec brachia longo
Margine terrarum porrexerat Amphitrite»
quelquefois elle peint l’idée :
Magnum Jovis incrementum; ' ■
Monjirum horrendum, informe, ingehs, cui lumen
ademptum. •
Mais rien n’eft plus difficile ni plus rare que de donner
à nos vers cette expreffion harmonique ; 8c lï
notre langue en eft fufceptible, ce n’eft tout-au-plus
que dans la profe, dont la liberté laiffe au goût &
à l ’oreille du poëte le choix des termes & des tours :
c’eft peut-être ce qui manque à la profe rtômbreufe»
mais monotone, du Télémaque.
Cependant, s’il faut céder à Thabitudé où nous
fommes de voir des poëmes en v e r s , il y aïiroit un
moyen d’en rompre la monotonie, & d’en rendre
jufqu’à un certain point l’harmonie imitative : ce fe-
roit d’y employer des vers de différente mefure,
non pas mêlés au hafard, comme dans nos poéfies
libres, mais appliqués aux différëns genres auxquels
leur cadence eft le plus analogue. Par exemple, le
vers de dix fyllabes, comme le plus fimple, aux
morceaux pathétiques ; le vers de douze aux morceaux
tranquilles & majeftueux ; les vers de huit aux
harangues véhémentes ; les vers de fept, de fix &
cinq aux peintures les plus vives 8c les plus fortes.
On trouve dans une épître de l’abbé de Chaulieu
au chevalier de Bouillon , un exemple frappant de
ce mélange de différentes mefures.
Tel qu'un rocher dont la tête
Egalant le mont Athos ,
Voit à fes pies la tempête
Troubler le calme des flots.
La mer autour bruit & gronde ;
Malgré fes émotions ,
Sur fon front élevé régné une paix profondej|
Que tant dagitations,
Et que les fureurs de l'onde
Refpcclent à l'égal du nid des Alcyons.
Mais faudroit-il éviter le retour fatiguant de la
rime redoublée, croifer les vers, 8c varier les repos
avec un art d’autant plus difficile, qu’il n’a point de
réglés. / . # •
Le coloris du ftyle eft une fuite du coloris de
l’imagination ; & comme il en eft inféparable, nous
avons crû devoir les réunir fous un même point de
vûe.
Le ftyle de la tragédie eft commun à toute la partie
dramatique de l'épopée, Voye^ Tragédie.
Mais la partie épique permet, exige même des
peintures plus fréquentes & plus vives : ou ces peintures
préfentent l’objet fous fes propres traits, & on
les appelle defiriptions ; ou elles le préfentent révêtu
de couleurs étrangères , 8c on les appelle images.
Les deferiptions exigent non-feulement une imagination
v iv e , forte 8c étendue, pour faifir à-la-fois
l’enfemble & les détails d’un tableau vafte, mais encore
un goût délicat 8c fûr pour choifir 8c leS tableaux
, & les parties de chaque tableau qui font
dignes du poëme héroïque. La chaleur des defcripT
tions eft la partie brillante & peut-être inimitable
d’Homere ; c’eft par-là qu’on a comparé fon génie
à l'tjjieu d'un char qui s'embrafe par fa rapidité.... Ce
feu , dit-on , n'a qu'à paroître dans les endroits ou
manque tout le rejle, & fut-il environné d'abfurdités ,
on ne le verra plus. ( Préf de l'Homere Angl. de Pope.)
C ’eft par-là qu’Homere a fait tant de fanatiques parmi
les favans, 8c tant d’enthoufiaftes parmi les honv
! mes de génie : c’eft par-là qu’on Ta regardé tantôt
comme une fource intariffable où s’abreuvoient les
Poëtes,
A quo ceu fonte perenni
Vatum pieriis ora rigantur aquis, Oyid,
tantôt comme l’avoit repréfenté le peintre Galathon,
cujus vomitum alii poetee adfiantes abforbent. ÛEfia-
nu s , l .X H l .
Mais ce n’eft point affez de bien peindre, il faut
bien choifir ce qu’on peint : toute peinture vraie a
fa beauté; mais chaque beauté a fa place. Tout ce
qui eft bas, commun, incapable d’exciter la furpri-
l è , l’admiration , ou la curiofité d’un leéteur judicieux
, eft déplacé dans Y épopée.
Il faut, dit-on, des peintures Amples & familières
pour préparer l’imagination à fe prêter au merveilleux
; oui fans doute : mais le fimple & le familier
ont leur intérêt 8c leur noblçffe. Le repas d’Henri
IV. chez le folitaire de Gerfai, n’eft pas moins naturel
que le repas d’Enée fur la c^te d’Afrique : cependant
l’un eft intéreffant, & l ’autre ne l’eft pas.
Pourquoi ? Parce que l’un renferme les idées accef-
foires d’une vie tranquille 8c pure, 8c l’autre ne préfente
que l’idée toute nue d’un repas de voyageurs.
Les Poëtes doivent fuppofer tous les détails qui
n’ont rien d’intéreffant, 8c auxquels la réflexion du
lefteur peut fuppléer fans effort : ils feroient d’autant
moins excufables de puifer dans ces fources fté-
riles, que la Philofophie leur en a ouvert de très-
fécondes. Pope compare le génie d’Homere à un
afire qui attire en fon tourbillon tout ce qu'il trouve à
la portée de fes mouvemens : 8c en effet Homere eft de
tous les Poëtes celui qui a le plus enrichi la poe-
fie des connoiffances de fon fiecle. Mais s’il re-
.vénoit aujourd’hui avec ce feu divin, quelles couleurs
, quelles images ne tireroit-il pas des grands
effets de la nature, fi favamment développés, des
grands effets de l’induftrie humaine, que l’expérience
& l’intérêt ont porté fi loin depuis trois mille ans ?
La gravitation des corps , la végétation des plantes,
Tinftinfr des animaux, les développemens du
fe ü , l’a&ion de l’air, &c. les mécaniques , l’aftror
nomie,la navigation, &c. voilà des mines à-peine
ouvertes, où le génie peut s’enrichir : c’eft de - là
qu’il peut tirer des peintures dignes de remplir a s
intervalles d’une adion héroïque : encore doit-il être
avare deTefpace qu’elles occupent, & ne perdre jamais
de vûe un fpedateur impatient, qui veut être
délaffé fans être refroidi, 8c dont la curiofité fe rebute
par une longue attente, fur-tout lorfqu’il s’ap-
perçoit qu’on le diftrait hors de propos. C ’eft ce qui
ne manqueroit pas d’arriver, f i , par exemple , dans
l ’un des intervalles de l’adion on empioyoit mille
vers à ne décrire que des jeux ( Enéide ,1. V. ) . Le
grand art de ménager les deferiptions eft donc de
les préfenter dans le cours de l’adion principale ,
comme les paffages les plus naturels, ou comme les
moyens les plus Amples. Art bien peu connu, ou
bien négligé jufq-u’à nous.* / . '
Il nous refte à examiner la partie des images ;
mais comme elles font communes à tous les genres
de poéfie, & que-la théorie en exige un détail approfondi,
nous croyons devoir en faire un article
féparé. Voye[ Image. ^1 ■ | ^
■ Nous n’avons pu donner ici que 1e fommaire ëtyl
long traité ; les exemples fur-tout, qui .appuient &
développent fi bien les principes:,-n’ont pû trouver
place dans les bornes d’un article : .mais .en parcourant
les Poëtes , un le&eur intelligent peut.ailement
y fuppléer. D ’ailleurs, comme nous l ’avons .ditdans
l’article C r i t iq u e , l’auteur qui, -pour, compolër .un
poëme ,■ a befûin d’une ’longue etude des préceptes ,
peut s’en épargner le travail. Cet article ejl de M.
M a r m o i t t e l .
EPOQUE, f.f . (Xog-iÿ.) fufpenfion de jugement ;
c’eft l’état de l’ëfprit par lequel nous n’établiffons
rien, n’affirmant ne niant quoi que oe foit. ’Les phi-
lofophes feeptiques ayant -pour principe , que toute
raifon peut-être contredite par une railôn oppoiée &
d’un poids ég a l, ne fortoient jamais des bornes de
Y époque, & ne recevoient auçnn dogme. Pour arriver
à cette époque, ils employoient dix moyens prin?
cipaux, que je vais détailler d’après Sextws Etnpirt-
cus, livre I. des hypotypofes , ou infiitutions pyrrho•
niennes.
Le premier eft tiré de la diverfité des animaux. Voici
un précis des exemples & des raifonnemens, fur lesquels
Sextus appuie ce premier moyen. 11 çft aifé,
dit-il, de remarquer qu’il y a une grande diverfité
dans les perceptions & dans les fenfatipns 4es animaux
, fi l’on confidere leur origine différente & la
diverfe conftitution de leur corps. A l’égard de leur
origine ,,on voit qu’entre les animaux, les uns najf-?
fent par la voie ordinaire de la génération , & les
autres fans l’union du mâle & de la femelle. Ici Sextus
s’étend fur ces prétendues générations fponta-*
nées, que la faine phyfique a entièrement bannies.
Quant à ceux qui viennent par l’acçouplement des
fexes, çontinuç-t-il, les uns viennent d’animaux de
même efpece, ce qui eft le plus ordinaire ; d’autres
naiffent d’animaux de différente efpece, comme les
mulets : les uns naiffçnt vivans des anim^tot ; d’autres
fortent d’un oeuf, comme les oifeaux; d’autres
font mal formés, comme les oiirs. Ainfi il ne faut pas
douter que les diverfités & les différences qui fe
trouvent dans les générations, ne prqduifent de
grandes antipathies parmi les animaux , qui fans
contredit tirent de ces diverfes origines des tempe-
ramens tout-à-fait différëns, & une grande efifeor-
dance & contrariété les un? à l’égard des autres. Le
philofophe feeptique entaffç des exemples, qui juf-
tifîent ce qu’il a avancé ; d’où ü çpnçlut ainfi : fi les
mêmes chofes paroiffent différentes à caufe de la dir
verfité des animaux, il eft vrai que nous pourrons
bien dire d’un objet quel il nous paroît ; mais nous
nous en tiendrons à Y époque f nous demeurerons en
fufpens , nous ne déciderons rien, s’il s’agit de dire
quel il eft véritablement & naturellement. Car enfin
nous ne pouvons pas juger entre nos perceptions ôf
celles des autres animaux, lefqueftes font conformes
à la nature des chofes ; & la raifon de cela ? c’eft que
nous fommes des parties difeordantes & intéreffées
dans ce procès, & que nous pe pouvons pas être juges
dans notre propre caufe.
Le fécond, de la différence 4?s hommes, Quand nous
accorderions qu’il faut s’ep tenir au jugement des
hommes plutôt qu’à celui des animaux, la feule différence
.qui régné entre les hommes, fuffit pour maintenir
Y époque. Nous fommes composés de deux çho-
fes, d’un corps & d’une ame; njfis à l'égard de ces
.deux chofes , nous fopimpf différent les uns des autres
en bien des manières : du côté du corps, U figure
ou conformation, & .le tempérament, varient^
Sextus en allégué quantité d’exemples : quant à
.Tame, une preuve de la différence prefque infinie,
.qui fe trouve entre les efpjits des hommes -, c’eft la
contrariété des lentimens des dogmatiques en toutes
chofes, & fur-tont dans la qpeftion des chofes qu’op
doit éviter ou rechercher. Qr, ou .nous croirops tops
les hommes, ou .nous en croirons quelques-uns. Si
nous voulons les croire tous » .nous entreprendrons
une chofe impoftihîe, 8c paus admettrons des con-
tradifrionsj 8c tfi nous ,en, croyons feulement quelques
uns , auxquels donnerons-nous la préférence ?
j Un platonicien nous dira qu’ilfaut s ’en rapporter>à /
Platon, un .épicurien à Epicure ; mais .c’eft précifé-
ment cette contrariété qui nous pe.rfu3.de .d’en demeurer
à YJp.oqu.e. .
Le troifieme, de la çojitparaifon desorganes des fins.
Nous ne fommes point certains fi les objets qui fe
préfentent à nous re vêtuside certaines qualités, .n’opt
que ces feuLés ;qualicés,,pu plfitôt -.fi elles n’en ont
qu’une, Sc,fr la diverfité appareate.de ,ces qualités ne