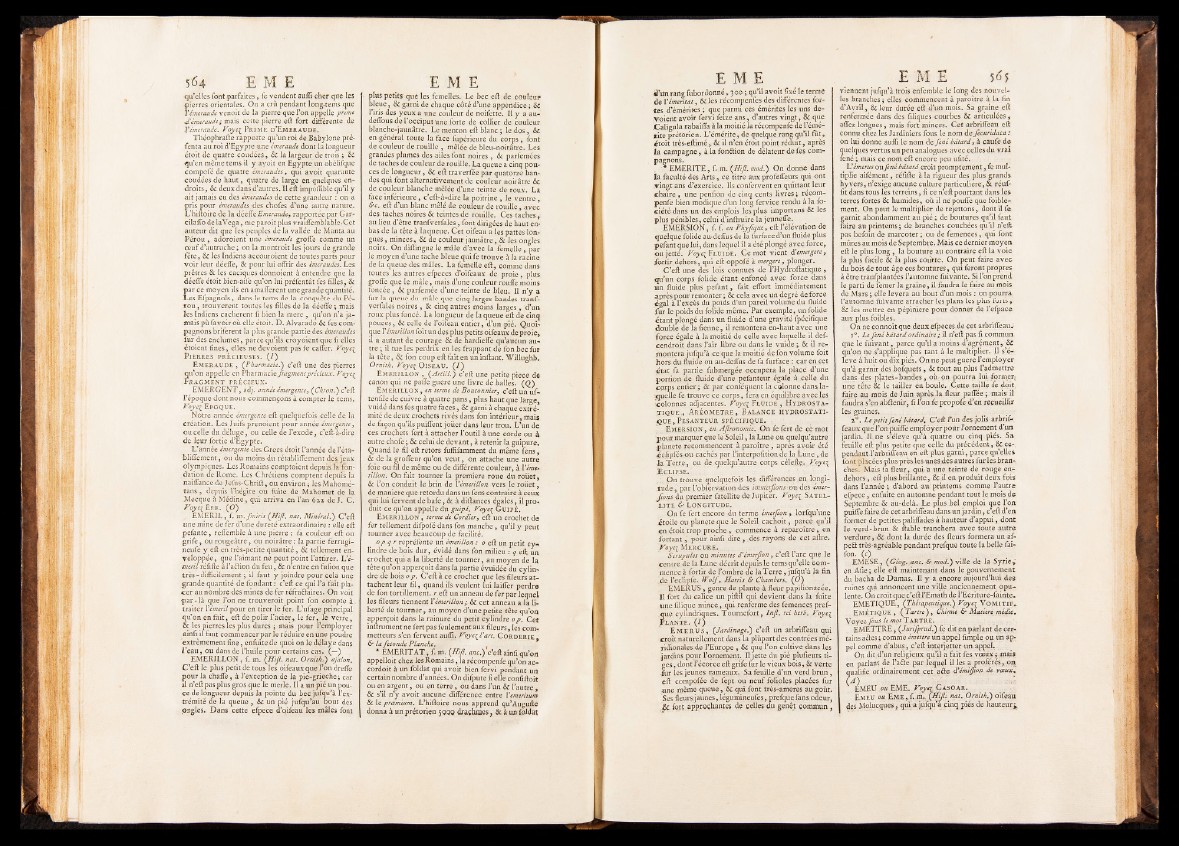
qu’elles font parfaites, fe vendent auffi cher que les
•pierres orientales. On a crû pendant long-tems que
Y émeraude venoit de la pierre que l’on appelle prime
d'émeraude; mais cette pierre eft fort différente de
Yémeraude. Foye^ Prime D’Emeraude.
Théophrafte rapporte qu’un roi de Babylone pré-
fenta au roi d’Egypte une émeraude dont la longueur
étoit de quatre coudées, & la largeur de trois ; &
qu’en même tems il y avoir en Egypte un obélifque
compofé de quatre émeraudes, qui avoit quarante
coudées de haut, quatre de large en quelques endroits
, deux dans d’autres. Il eft impoffible qu’il y
ait jamais eu des émeraudes de cette grandeur : on a
pris pour émeraudes des chofes d’une autre nature.
L’hiftoire de la déeffeEmeraude, rapportée par Gar-
cilaffo de laVega, me paroît plus vraiffemblable.Cet
auteur dit que les peuples de la vallée de Manta au
Pérou, adoroient une émeraude groffe comme un
oeuf d’autruche ; on la montroit les jours de grande
fête, & les Indiens accouroient de toutes parts pour
voir leur déeffe, & pour lui offrir des émeraudes. Les
prêtres & les caciques donnoient à entendre que la
déeffe étoit bien-aife qu’on lui préfentât fes filles, &
par ce moyen ils en amafferent une grande quantité.
Les Efpagnols, dans le tems de la conquête du Pérou
, trouvèrent toutes les filles de la déeffe ; mais
les Indiens cachèrent fi bien la mere , qu’on n’a jamais
pu favoir où elle étoit. D. Alvarado & fes compagnons
briferent la plus grande partie des émeraudes
fur des enclumes, parce qu’ils croyoient que fi elles
étoient fines, elles ne dévoient pas fe caffer. Voye^_
Pierres précieuses. ( /)
Emeraude , (Pharmacie.) c’eft une des pierres
qu’on appelle en Pharmacie fragment précieux. Voyeç Fragment précieux.
EMERGENT, adj. année émergente, (Chron.) c’efi
l ’époque dont nous commençons à compter le tems.
Foye{ Epoque.
Notre année émergente eft quelquefois celle de la
création. Les Juifs prenoient pour année émergente,
ou celle du déluge, ou celle de l’exode, c’eft-àrdire
de leur fortie d’Egypte.
L’année émergente des Grecs étoit l’année de l’éta-
hliffement, ou du moins du rétabliffement deS jeux
olympiques. Les Romains comptoient depuis lâ fondation
de Rome. Les Chrétiens comptent depiiîs la
naiffance de Jefus-Chrift, ou environ ; les Mahomé-
tans , depuis l’hégire ou fuite de Mahomet de la
Mecque à Médine, qui arriva en l’an 622. de J. C.
Foye^ Ere. (O)
, EMERÎL, f. m.fmiris (Hifi. nat. Minéral.) C ’eft
une mine de fer d’une dureté extraordinaire : elle eft
pefante, reffemble à une pierre : fa couleur eft ou
grife, ou rougeâtre, ou noirâtre : la partie ferrugi-
neufe y eft en très-petite quantité, & tellement enveloppée
, que l’aimant ne peut point l’attirer. L7-
meril réfifte à l’aétion du feu, & n’entre en fùfion que
très - difficilement ; il faut y joindre pour cela une
grande quantité de fondant : c’eft ce qui l’a fait placer
au nombre des mines de fer réfraétaires. On voit
pa r-là que l’on ne trouveroit point fon compte à.
traiter Yémeril pour en tirer le fer. L’ufage principal
qu’on en fait, eft de polir l’acier, le fer, le verre,
& les pierres les plus dures ; mais pour l’employer
ainfi il faut commencer par le réduire en une poudre
extrêmement fine, enfuite de quoi on le délaye dans
l ’eau, ou dans de l’huile pour certains cas. (—)
EMERILLON, f. m. (Hifi. nat,. Ornith.) afalon.
C ’eft le plus petit de tous les oifeaux que l’on dreffe
pour la chaffe, à l’exception de la pie-grieche ; car
il n’eft pas plus gros que le merle. II a un pié un pouce
de longueur depuis la pointe du bec jufqu’à l’ex-
trémitë de la queue , & un pié jufqu’au bout des
ongles. Dans cette efpece d’qifeau les mâles font
plus petits que les femelles. Le bec eft de couleur
bleue, & garni de chaque côté d’une appendice ; &c
l’iris des yeux a une couleur de noifette. Il y a au-
deffous de l’occiput une forte de collier de couleur
blanche-jaunâtre. Le menton eft blanc ; le dos, &
en général toute la face fupérieure du corps , font
de couleur de rouille , mêlée de bleu-noirâtre. Les
grandes plumes des ailes font noires , & parfemées
de taches de couleur de rouille. La queue a cinq pouces
de longueur , & eft traverfée par quatorze bandes
qui font alternativement de couleur noirâtre &
de couleur blanche mêlée d’une teinte de roux. La
face inférieure, c’eft-à-dire la poitrine , le ventre,
&c. eft d’un blanc mêlé de couleur de rouille, avec
des taches noires & teintes de rouille. Ces taches,
au lieu d’être tranfverfales, font dirigées de haut en-
bas de la tête à la queue. Cet oifeau a les pattes longues
, minces, & de couleur jaunâtre, & les ongles
noirs. On diftingue le mâle d’avec la femelle, par
le moyen d’une tache bleue qui fe trouve à la racine
de la queue des mâles. La femelle eft, comme dans
toutes les autres efpeces d’oifeaux de proie, plus
groffe que le mâle, mais d’une couleur rouffe moins
foncée, & parfemée d’une teinte de bleu. II n’y a
fur la queue du mâle que cinq larges bandes tranfverfales
noires , & cinq autres moins larges , d’un
roux plus foncé. La longueur de la queue eft de cinq
pouces, & celle de l’oileau entier, d’un pié. Quoi-«
que Yémerillon foit un des plus petits oifeaux de proie,
il a autant de courage & de hardieffe qu’aucun autre
; il tue les perdrix en les frappant de fon bec fur
la tête, & fon coup eft fait en un inftant. "Willughb.
Ornith. Voye£ OlSEAU. (/ ) Emerillon , (ArtiU.) c’eft une petite piece de
canon qui ne paffe guere une livre de balles. (Q)
Emer illon, en terme de Boutonnier, c’eft un uf-
tenfile de cuivre à quatre pans, plus haut que large,
vuidé dans fes quatre faces, & garni à chaque extrémité
de deux crochets rivés dans fon intérieur, mais
de façon qu’ils puiffent joiier dans leur trou. L’un de
ces crochets fert à attacher l’outil à une corde ou à
autre chofe ; & celui de devant, à retenir la guipure.
Quand lé fil eft retors fuffifamment du même fens,
& de la groffeur qu’on veu t, on attache une autre
foie ou fil de même ou de différente couleur, à Yémc*
rillon. On fait tourner la première roue du roüet,
& l’on conduit le brin de Yémerillon vers le roiiet,
de maniéré que retordu dans un fens contraire à ceux
qui lui fervent de bafe, & à diftances égales, il pro-*
duit ce qu’on appelle du guipé. Voyeç G uipé. Emerillon , terme de Cordier, eft un crochet do
fer tellement difpofé dans fon manche, qu’il y peut
tourner avec beaucoup de facilité.
o p q r repréfente un émerillon : o eft un petit cy-*
lindre de bois dur, évidé dans fon milieu : q eft un
crochet qui a la liberté de tourner, au moyen de la
tête qu’on apperçoit dans la partie évuidée du cylindre
de bois o p. C’eft à ce crochet que les fileurs attachent
leur fil, quand ils veulent lui laiffer perdre
de fon tortillement, r eft un anneau de fer par lequel
les fileurs tiennent Yémerillon; & cet anneau a la liberté
de tourner, au moyen d’une petite tête qu’on
apperçoit dans la rainure du petit cylindre o p. Cet infiniment ne fert pas feulement aux fileurs, les corn-
metteurs s’en fervent auffi. Voye^l'art. Corderie
& la fécondé Planche.
* EMERITAT, f. m. {Hiß. ancY) c’eft ainfi qu’on
appelloit chez les Romains, la récompenfe qu’on ac-
cordoit à un foldat qui avoit bien fervi pendant un
certain nombre d’années. On difpute fi elle confiftoit
ou en argent, ou en terre, ou dans l’un & l’autre,
& s’il n’y avoit aucune différence entre Yemeritum
& le pramium. L’hiftoire nous apprend qu’Augufte
donna à un prétorien 5000 drachmes, & à un foldat
E M E
d’un rang fubordonne, 3 oo-; qu’il avoit nxe le terme
de Yémeritat, & les récompenfes des différentes fortes
d’émérit-es ; que parmi ces émérites les uns de-
yoient avoir fervi feize ans, d’autres vingt, & que
.Caligula rabaiffa à la moitié la récompenfe de l’éme-
rite prétorien. L’émérite, de quelque rang qu’il fut,
étoit très-eftimé, & il n’en étoit point réduit, après
la campagne, à la fonction de délateur de fes compagnons.
* EMERITE, f. m. {Hifi. mod.) On donne dans
la faculté dés Arts, ce titre aux profeffeurs qui ont
vingt ans d’exercice. Ils confervent en quittant leur
chaire , une penfion de cinq cents livres ; récompenfe
bien modique d’un long fervice rendu à la fo-
ciété dans un des emplois les plus importans & les
plus pénibles, celui d’inftruire la jeuneffe.
EMERSION, f. f. en Phyfique, eft l’élévation de
quelque folide au-deffus de la furfaced’un fluide plus
pefant que lui, dans lequel il a été plongé avec force,
ou jette. Voye{ Fluide. Ce mot vient d'emergere,
fortir.dehors, qui eft oppofé à mergere, plonger.
C ’eft une des lois connues de l’Hydroftatique ,
qu’un corps folide étant enfoncé avec force dans
un fluide plus pefant, fait effort immédiatement
après pour remonter ; & cela avec un degré de force
égal à l’excès du poids d’un pareil volume du fluide
fur le poids du folide même. Par exemple, un folide
étant plongé dans un fluide d’une gravité fpécifique
double de lafienne, il remontera en-haut avec une
force égale à la moitié de celle avec laquelle il def-
cendroit dans l’air libre ou dans le vuide ; & il remontera
jufqu’à ce que la moitié de fon volume foit
hors du fluide ou au-deffus de fa furface : car en cet
état fa partie fubmergée occupera la place d’une
portion de fluide d’une pefanteur égale à celle du
corps entier ; & par conséquent la colonne danSr laquelle
fe trouve ce corps, fera en équilibre avec les
«colonnes adjacentes. Voye%_ Fluide , Hydrosta- l
tique,, Aréomètre, Balance hydrostatique,
Pesanteur spécifique. •
' Emersion, en Afironomie. On fefert de cè mot
pour, m.arquer que le Soleil, la Lune ou quelqu’autre
plianete recommencent à paroître , après avoir été
-«écjipfés pu cachés. par l’interpofition de la Lune, de
la Terre , ou de quelqu’autre corps célefte. , Voye\
J^CLipSE.i : _ ' . . . . ’ ’ •• •
., On trouve quelquefois les différences .en, longi-
Tude, par i ’obfervation des immèrfions ou des emer-
Jîons du premier fatellite de Jupiter. Voye^ Satellite
& Longitude.
On fe fert encore du terme émerfion , lor (qu’une
étoile ou planete que le Soleil cachoit, parce qu’il
en étoit trop proche, commence à reparoître, en
fortant,‘ pour ainfi dire, .des rayons de cet aftre.
Foye{ Mercure.
Scrupules ou minutes d'émerfion , c’eft l’arc que le
centre de la Lune décrit depuis le tems qu’elle commence
à fortir de l’ombre de la Terre, jufqu’à la fin
.de l’eclipfe. Wolf| Harris & Çhambers. (O)
EMERUS, genre de plante à fleur papilionaeée.
Il fort du calice un piftil qui devient dans la fuite
line filique mince, qui renferme des femences pref-
que cylindriques. Tournefort, Infi. rei herb. Foye^
JPlante. (J)
È m e r u s ,. {JardinageY) c’eft un arbriffeau qui
croît naturellement dans la plupart des contrées méridionales
de l’Europe , & que Ton cultive dans les
jardins pour l’ornement. Il jette du pié plufieurs tiges
, dont l’écorce eft grife (ur le vieux bois, ,& verte
fur les jeunes rameaux. Sa feuille d’un verd brun,
eft compofée de fept ou neuf folioles placées fur
une même queue, & qui font très-ameres au goût.
Ses fleursq aunes, légumineufes, prefquefans odeur,
f it fort approchantes de celles du genêt commun,
E M Ë 565
viennent jufqu’à trois enfemble le long des nouvelles
branches ; elles commencent à paroître à la fin
d’Av r il, & leur durée eft d’un mois. Sa graine eft
renfermée dans des filiques courbes & articulées,
affez longues, mais fort minces. Cet arbriffeau eft
connu chez les Jardiniers fous le nom de fecuridaca :
on lui donne auffi le nom de fené bâtard, à caufe de
quelques vertus un peu analogues avec celles du vrai
fené ; mais ce nom eft encore peu ufité.
Uémerus ou fené bâtard croît promptement, fe multiplie
aifément, réfifte à la rigueur des plus grands
hy vers, n’exige aucune culture particulière, & réuf-
fit dans tous les terreins, fi ce n’eft pourtant dans les
terres fortes & humides, où il ne' pouffe que foible-
ment. On peut le multiplier dé rejettons, dont il fe
garnit abondamment au pié ; de boutures qu’il faut
faire au printems ; de branches couchées qu’il n’eft
pas. befoin de marcoter ; ou de femences, qui font
mûres au mois de Septembre. Mais ce dernier moyen
eft le plus long, la bouture au contraire eft la voie
la plus facile & la plus courte. On peut faire avec
du bois de tout âge ces boutures, qui feront propres
à être tranfplantées l’automne fuivante. Si l’on prend
le parti de femer la graine, il faudra le faire au mois
de Mars ; elle lèvera au bout d’un mois : on pourra
l’automne fuivante arracher les plans les plus forts ,
& les mettre en pépinière pour donner de l’efpac©
aux plus foibles.
On ne connoît que.deux efpeces de cet arbriffeauÿ
i°. Le fené bâtard ordinaire'; il n’eft pas fi commun
que le fuiyant, parce qu’il a moins d’agrément, &c
qu’on ne-s’applique pas tant à le multiplier. Il s’élève
à huit ou dix piés. On ne peut guere l’employer
qu’à garnir des bofquets, &tout au plus l’admettre
dans des plates-bandes , oùrpn pourra lui former;
une tête & le tailler en boule. C.ette taille fe -doit,
faire an mois de Juin après.la fleur paffée j mais il
faudra s’en abftenir, fi l’on fe propofe d’en recueillir
les-graine^ citâjb-siîi
20. Le petitfené bâtard, C ’eft l’un des jolis arbril-
feaux que l’on puiffe emplôyër pour l’ornement d’un
jardin. II, ne s’élève qu’à quatre ou cinq piés. Sa
feuille eft plus petite que celle du précédent, & ce-,
pendant.l’arbriffeau en eft plus garni, parce qu’elles
font placées plus près les unesjdes autres fur les branches.
Mais fa fleur, qui/a une teinte de rouge en-
dehors , :eft plus brillante, il en produit deux fois
dans Tannée; d’abord au printems comme l’autre
efpece j .enfuite en automne pendant tout le mois de
Septembre & au-delà. Le plus bel emploi que l’on
puiffe faire de cet arbriffeau dans un jardin, c’eft d’en
former de petites paliffades à hauteur d’appui, dont
le verd-brun & fiable tranchera avec toute autre
verdure, &. dpnt la durée des fleurs formera un âf-
peû très-agréable pendant prefque toute la belle fai-
fon. (c) ; -- 1 ^ -
EMESE, {Géog. anc. & modY) ville de la Syrie,'
| en Afie ; elle eft maintenant dans le gouvernement
du bacha de Damas. Il y a encore aujourd’hui des
ruines qui annoncent une ville anciennement opulente.
On croit que c’eft l’Émath de l ’Ecriture-fainte.
EMETIQUE, (ThérapeutiqueY) Foye^ VOMITIF,
E m é t i q u e , ( Tartre) , Chimie & Matière médic.
Voyez fous, le mot T a r t Re .
EMETTRE, (JurifprudY) (e dit en parlant de certains
aûes ; comme émettre un appel fimple ou un ap*
pel comme d’abus, c’eft interjetter un. appel.
On dit d’un religieux qu’il a fait fes voeux ; mais
en parlant de l’afte par lequel il les a proférés, .on
ualifie ordinairement, cet a été dYémijJipn de vaux* WÊÊÊSm EMEU ,0# EME. Foyer. C aso^r .
E m e u 0« E m e , f.,m,. {H if i: nat. Ornith.) oifeau
des Molucques, quiajufqu’à cinq piés de hauteur