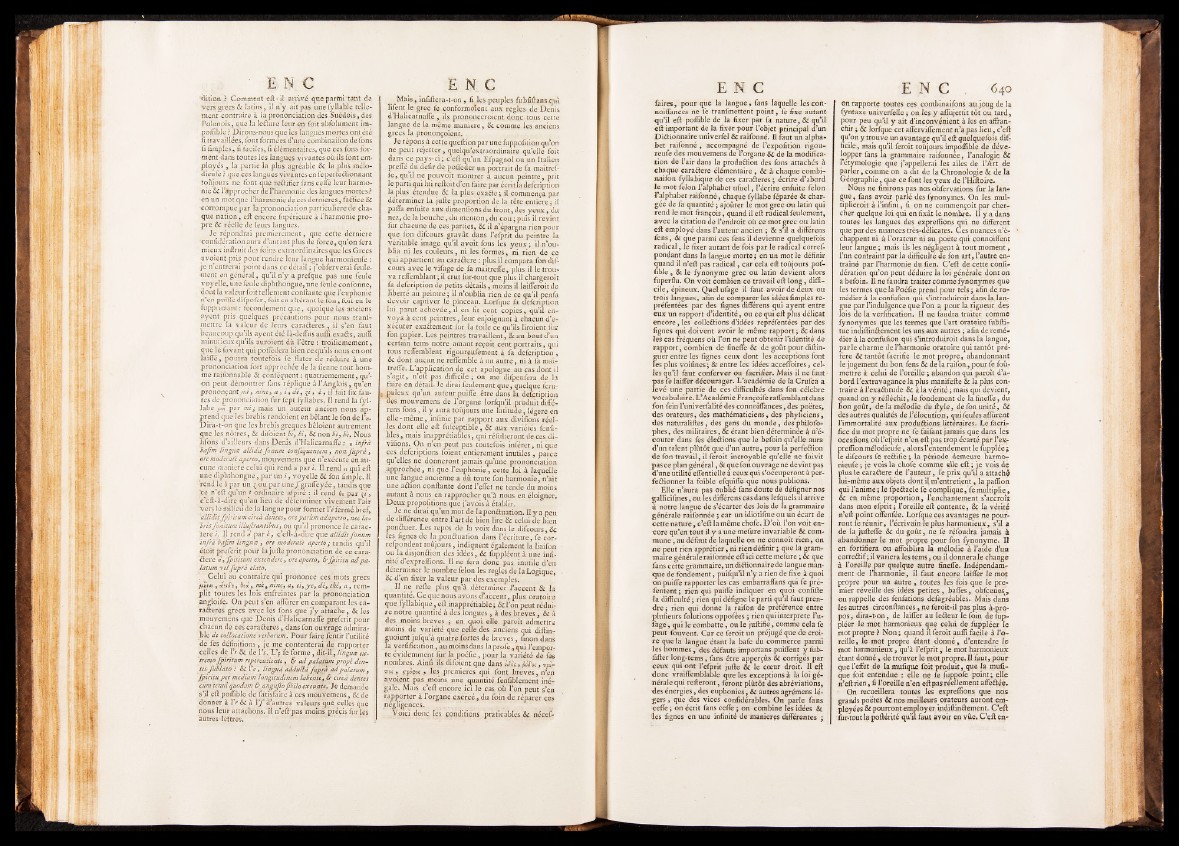
' ENG
riition ) Comment eft - il arrivé que parmi;tant de
‘vers grecs & latins, il n’y ait pas une fyllable tellement
contraire à la prononciation des Suédois, des
Polonpis,, que la leâure leur en foit absolument im-
poffiblc ? Dirons-nous que les langues mortes ont été
Si travaillées, font formées d’une combinaifon de fons
fi Simples, Si faciles, Si élémentaires, que ces fons forment
dans toutes les langues vivantes oit ils font employés
, la partie la plus agréable 6c la .plus mélo-
dieufe ? que ces langues vivantes en fe perfectionnant
toujours ne font que rectifier fans ceSTe leur harmonie
6c l’approcher de l’harmonie des langues mortes?
en un mot.que l’harmonie de ces dernieres, factice &
■ corrompue par la prononciation particulière de chaque
nation, eft encore fupérieure à l’harmonie propre
6c réelle de leurs langues.
Je répondrai premièrement, que cette derniere
considération aura d’autant plus de force, qu’on fera
mieux inftruit des foins extraordinaires que les Grecs
■ avoient pris pour rendre leur langue harmonieufe •:
je n’entrerai point dans ce détail ; j’obferverai feulement
en général, qu’il n’y a prefque pas une feule
voyelle, une feule diphthongue, une feule conforme,
dont la valeur foit tellement confiante que l’euphonie
n’en puiffe difpofer, foit en altérant le l'on, foit en le
Supprimant-: Secondement que, quoique les anciens
ayent pris quelques précautions pour nous transmettre
la valeur de leurs cara&eres , il s’en faut
beaucoup qu’ils ayent été là-defiiis aufti exaûs, a'ulîi
minutieux qu’ils auroient dû l’être : troifiemement,
que le Savant qui poffédera bien ce qu’ils nous en ont
laifle, pourra toutefois fe dater de réduire à une
prononciation fort approchée de la tienne'tout homme
rajfonnable & conféquent : quatrièmement, qu’on
peut démontrer fans réplique à l’Anglois, qu’en
prononçant /ni , nine, a, i , dé, f i , e , il fait fix fautes
de prononciation fur fept fyllabes. Il rend la fyl-
labe //-ï par mi; mais un auteur ancien nous apprend
que les brebis rendoient en bêlant le fon de l’a.
Dira=t-on que lès brebis greques bêloient autrement
que les nôtres, & difoiëntbi, bi, 6c non be, bl. Nous
lifons d’ailleurs dans Denis d’Halicarnaffe : a infra
bajim lingue allidit fonum confequenum , non fuprà,
ore moderatl aptrto, mouvemens que n’exécute en aucune
maniéré celui qui rend a par i. Il rend u qui eft
une diphthongue, par un i , voyelle 6c Son fimple. Il
'rend le ô par un ^ ou par une ƒ graffeyée, tandis que
.ce n’eft qu’un t ordinaire afpiré : il rend ôê par \ i,
c’eft-à-dire qu’au lieu de déterminer vxverhent l’air
vers le milieu de la langue pour former Yéfermé bref,
àllïdit fpiritum circà dentes, orepariimada.pe.no, net la-
bris fonuum illuflrantibus, ou qu’il prononce le caractère
i, Il rend « par è, c’eft-à-dire que allidit fonum
infra bajîriï lingtice , ore moderate aperio; tandis qu’il
étoit preferit pour la jufte prononciation de ce cara-
élerè «, fpiritum exiendere, ore aperto, &fpiritu ad pa-
laium.yelfuprà elato.
\ Celui au contraire qui prononce ces.mots grecs
, Oed, ml, rime, a, ei,ye, dé, thé, a, remplit
toutes les lois enfreintes par la prononciation
angloife. On peut s’en alïïirer en comparant les caractères
grées avec les fons que j’y attache, & les
mouvemens que Denis d’Hàlicarnaffe preferit pour
chacun de ces caraâeres ,.dans fon ouvrage admirable
de collocatione verborum. Pour faire fentir l’utilité
de fes définitions, je me contenterai de rapporter
celles de IV 6c de Vs."Up fé forme, dit-il, linguoe ex-
ire mo fpiritum reperçutiente, & ad palatàm propè dentesfüblato
: Sc IV lingua àdduclâ fuprà ad palatum ,
Jpirituper mediam longitudihem labentët & circà dentes
cüm tenuiquodam&àngiifioJibiloexeunte.lt demande
s’il eft poflible de fàtisfàire à ces mouvemens, & de
donner à IV & à V f d’autres valeurs que celles que
nous leur attachdhs. i l n’eft pas moins précis fur les
autres -lettres.
ENC
Mais, infiftera-t-on, fi les peuples fubfiftans qui
lifent le grec fe conformolent aux réglés de Denis
d’Halicarnaffe , ils prononceroient donc tous cette
langue de la même maniéré, 6c comme les anciens
grecs la prononçoienr.
J e répons à cette queftion par une fuppofition qu’on
ne peut rejetter, quelqu’extraordinaire qu’ejle foit
dans ce pays-ci ; c’eft qu’un Efpagnol ou un Italien
preffé du defir de poffeder un portrait de fa maîtref-
fe, qu’il ne pouvoit montrer à aucun peintre, prit
le parti qui lui reftoit d’en faire par écrit la defeription
la plus étendue 6c la plus exade ; i'I commença par
déterminer la jufte proportion de la tête entière : il
pafla enfuite aux dimenfions du front, des y e u x , du
nez, de la bouche, du menton, du cou ; puis il revint
fur chacune de ces parties, 6c il n’épargna rien pour
que fon difeours gravât dans l’efprit du peintre la
véritable image qu’il avoit fous les yeux; il.n’oublia
ni les couleurs, ni les formes, ni rien de ce
qui appartient au cara&ere : plus il compara fon difeours
avec le vifage de fa maîtreffe, plus il le trouva
reflemblant ; il crut fur-tout que plus il chargeroit
fa defeription de .petits détails, moins il laifferoitde
liberté au peintre; il n’oublia rien de ce qu’il penfa
devoir captiver le pinceau. Lorfque fa defeription
' hti parut achevée, il en fit cent copies, qu’il envoya
à cent peintres, leur enjoignant à chacun d’exécuter
exactement fur la toile ce qu’ils liroient fur
fon papier. Les peintres travaillent, & au bout d’un
certain tems notre amant reçoit cent portraits, qui
tous reffembient rigoureufement à fa defeription ,
& dont aucun ne reffemble à un autre, ni à fa maîtreffe.
L’application de cet apologue au cas dontil
s’agit, n’eft pas difficile; on me difpenfera de la
faire en détail. Je dirai feulement que, quelque feru-
, puleux qu’un auteur puiffe être dans la defeription
des mouvemens de l’organe lorfqu’il prbdtiit diffé-
rens fons, il y aura toujours une latitude, légère en
elle-même, infinie par rapport aux divifions réelles
dont elle eft fufceptible, & aux variétés fenfi-
bles, mais inapprétiables, qui réfulteront de ces. divifions.
On n’en peut pas toutefois inférer, ni que
ces. deferiptions foient entièrement inutiles , .parce
qu’elles ne donneront jamais qu’une prononciation
approchée, ni que l’euphonie, cette loi à laquelle
une langue ancienne a dû toute fon harmonie, n’ait
une a&ion confiante dont l’effet ne tende du moins
autant à nous en rapprocher qu’à nous en éloigner.
Deux propofitions que j’avois à établir.
Je ne dirai qu’un mot de la ponctuation. II y a peu
de différence entre l’art de bien lire & celui de bien
ponCtuer. Les repos de la voix dans le difeours, &
les fignes de la ponctuation dans l’écriture, fe cor-
refpondent toujours, indiquent également la liaifon
ou la disjonction des idées, & fuppléent à une infinité
d’expreftions. Il ne fera donc pas inutile d’en
déterminer le nombre félon les réglés de la Logique;
& d’en fixèr la valeur par des exemples.
Il ne refte plus qu’à déterminer l’accent & la
quantité. Ce que nous avons d’accent, plus oratoire
que fyllabique, eft inapprétiable ; & l’on peut réduire
notre quantité à des longues , à des brèves, & à
des moins brèves,; en quoi elle paroît admettre
moins de variété que celle des anciens qui diftin-
guoient jufqu’à quatre fortes de brèves, finon dans
la verfification, au moins dans la profe., qui l’emporte
évidemment fur la poéfie, pour la variété de fos
nombres. Ainfi ils difoient que dans ôJ'oç, poé'oç , rpà-
"pos, ç-potpoç , les premières qui font brèves, n’en
avoient pas moins une quantité fenfiblement inégale.
Mais c’eft encore ici le cas oii l’on peut s’en
rapporter à l’organe exercé, du foin de réparer ces
négligences.
Voici donc les conditions praticables & nécef-
E N C
feire*, pour que la langue, fans laquelle les con-
noiffances ne fe tranfmettént point, fe fixe autant
qu’il eft poflible de la fixer par fa nature, &C qu’il
eft important de la fixer pour l’objet principal d’un
Dictionnaire univerfel & raifonné. Il faut un alphabet
raifonné , accompagné de l’expofition rigou-
reufe des mouvemens de l’organe & de la modification
de l’air dans la production des Ions attachés à
chaque caraCtere élémentaire , & à chaque combinaifon
fyllabique de ces caraCteres ; écrire d’abord
le mot félon l’alphabet trfuel, l’écrire enfuite félon
l’alphabet raifonné, chaque fyllabe féparée & chargée
de fa quantité ; ajouter le mot grec ou latin qui
rend le mot françois, quand il eft radical feulement,
avec la citation de l’endroit où ce mot grec ou latin
eft employé dans l’auteur ancien ; & s’il a différens
fens, & que parmi ces fens il devienne quelquefois
radical, le fixer autant de fois par le radical corref-
pondant dans la langue morte ; en un mot le définir
quand il n’eft pas radical, car cela eft toûjours pof-
fible, & le fynonyme grec ou latin devient alors
fuperflu. On voit combien ce travail eft long, difficile,
épineux. Quel ufage il faut avoir de deux ou
trois langues, afin de comparer les idées fimples re-
préfentées par des fignes différens qui ayent entre
eux un rapport d’identité, ou ce qui eft plus délicat
encore, les collerions d’idées repréfentées par des
fignes qui doivent avoir le même rapport ; & dans
les cas rréquens oü l’on ne peut obtenir l’identité de
rapport, combien de fineffe & de goût pour diftin-
guer entre les fignes ceux dont les acceptions font
les plus voifines ; & entre les idées ac.cefl'oires, celles
qu’il faut conferver ou facrifier. Mais il ne faut •
pas fe laiffer décourager. L’académie de la Crufca a
levé une partie de ces difficultés dans fon célébré
vocabulaire. L’Académie Françoife raffemblant dans
fon fein l’univerfalité des connoiffances, des poètes,
des orateurs, des mathématiciens, des phyficiens,
des naturalises, des gens du monde, des philofo-
phes, des militaires, & étant bien déterminée à n’écouter
dans fes éleftions que le befoin qu’elle aura
d’un talent plûtôt que d’un autre, pour la perfeftion
de fon travail, il feroit incroyable qu’elle ne fuivît
pas ce plan général, & que fon ouvrage ne devînt pas
d’une utilité effentielle à ceux qui s’occuperont à perfectionner
la foible efquiffe que nous publions.
Elle n’aura pas oublié fans doute de défignernos
gallicifines, ou les différens cas dans lefquels il arrive
à notre langue de s’écarter des lois de la grammaire
générale raifonnée ; car un idiotifme ou un écart de
cette nature, e’eft la même chofe. D ’où l’on voit encore
qu’en tout il y a une mefiire invariable & commune
, au défaut de laquelle pn ne connoît rien, on
ne peut rien apprétier, ni rien définir ; que la grammaire
générale raifonnée eft ici cette mefure ; 6c que
fans cette grammaire, un dictionnaire de langue manque
de fondement, puifqu’il n’y a rien de fixe à quoi
on puifle rapporter les cas embarraffans qui fe pré-
fentent ; rien qui puifle indiquer en quoi confifte
la difficulté ; rien qui défigne le parti qu’il faut prendre;
rien qui donne la raifon de préférence entre
plufieurs folutions oppofées ; rien qui interprète l’u-
fage, qui le combatte, ou le juftifie, comme cela fe
peut fouvent. Car ce feroit un préjugé que de croire
que la langue étant la bafe du commerce parmi
les hommes, des défauts importans puiffent y fub-
fifter long-tems, fans être apperçûs & corrigés par
ceux qui ont l’efprit jufte & le coeur droit. Il eft
donc vraiflemblable que les exceptions à la loi générale
qui relieront, feront plûtôt des abréviations,
■ des énergies, des euphonies, & autres agrémens légers,
que des vices confidérables. On parle fans
çeffe ; on écrit fans ceflë ; on combine les idées & 4es fignes en une infinité de manierçs différentes ;
E N C 640
on rapporte toutes ces combinaifons au joug de la
fyntaxe univerfelle ; on les y aflujettit tôt ou tard,
pour peu qu’il, y ait d’inconvénient à les en affranchir
; & lorfque cet afferviflement n’a pas lieu, c’eft
qu’on y trouve un avantage qu’il eft quelquefois difficile,
mais qu’il feroit toûjours impoffihle de développer
fans la grammaire raifonnee, l’analogie èc
l’étymologie que j’appellerai les ailes de l’Art de
parler, comme on a dit de la Chronologie & de la
Géographie , que ce font les yeux de l’Hiftoire.
Nous ne finirons pas nos obfervâtions fur la langue,
fans avoir parlé des fynonymes. On les mul-
tiplieroit à l’infini, fi on ne commençoit par chercher
quelque loi qui en fixât le nombre. Il y a dans
toutes les langues des expreflions qui ne different
que par des nuances très-délicates. Ces nuances n’é^
chappent ni à l’orateur ni au, poète qui connoiffent
leur langue ; mais ils les négligent à tout moment,
l’un contraint par la difficulté de fon art, l’autre entraîné
par l’harmonie du fien. C ’eft de cette confi-
dération qu’on peut déduire la loi générale dont on
a befoin. Il ne faudra traiter comme fynonymes que
les termes que la Poéfie prend pour tels \ afin de remédier
à la confufion qui s’introduiroit dans la, langue
par l’indulgence que l’on a, pour la rigueur des
lois de la verfification. Il ne faudra traiter comme
fynonymes que les termes que l’art oratoire fubfti-
tue indiftin&ement les uns aux autres ; afin de remé-
dier à la confufion qui s’introduiroit dans la langue,
parle charme de l’harmonie oratoire qui tantôt préféré
& tantôt facrifie le mot propre, abandonnant
le jugement du bon fens & de la raifon, pour fe foû-
mettre à celui de l’oreille ; abandon qui paroît d’abord
l ’extravagance la plus manifefte & la plus contraire
à l’exa&itude & à la vérité ; mais qui devient^
quand on y réfléchit> le fondement de la fineffe, du
bon goût, de la mélodie dû ftyle, de fon unité, &
des autres qualités de l’élocution, qui feules affûrent
l’immortalité aux productions littéraires. Le facri-
fice du mot propre ne fe faifant jamais que dans les
occafions. où l’efprit n’en eft pas trop écarté par l’ex-
preflion mélodieufe, alors l’entendement le fuppléè ;
le difeours fe reôifie ; la période demeure harmonieufe
; je vois la chofç comme elle eft ; je vois de
plus le caraCtere de l’auteur, le prix qu’il a attaché
luirmême aux objets dont il m’entretient, la paflion
qui l’anime ; le fpe&acle fe complique, fe multiplie ,
& en même proportion, l’enchantement s’accroît:
dans mon efprit ; l’oreille eft contente, & la vérité
n’eft point offenfée. Lorfque ces avantages ne pourront
fe réunir, l’écrivain le plus harmonieux, s’il 9
de la juftefle 6c du goût, ne fe réfoudra jamais à
abandonner le mot propre pour fon fynonyme. II
en fortifiera ou affoiblira la mélodie à l’aide d’un
corre&if ; il variera les tems, ou il donnera le change
à l’oreille par quelque autre fineffe. Indépendamment
de l’harmonie, il faut encore laiffer le mot
propre pour un autre , toutes les fois que le premier
réveille des idées petites, baffes, obfcenes,
ou rappelle des fenfations defagréables. Mais dans
les autres circonftances, ne feroit-il pas plus à-propos
, dira-t-on, de laiffer au leéteur le foin de lup-
pléer le mot harmonieux que celui de fuppléer le
mot propre } Non ; quand il feroit aufli facile à l’oreille
, le mqt propre étant donné, d’entendre le
mot harmonieux, qu’à l’efprit, le mot fiarpionieux
étant donné, de trouver le mot propre. Il faut, pour
que l’effet de lamufique foit produit, que la mufi-
que foit entendue : elle ne fe fuppofe point; elle
n’eft rien, fi l’oreille n’en eft pas réellement affeélée.
On recueillera toutes les expreflions que nos
grands poètes & nos meilleurs orateurs auront employées
& pourront employer indiftinftement. C’eft
fur-tout la poftérité qu’il faut avoir en vue. C ’eft en