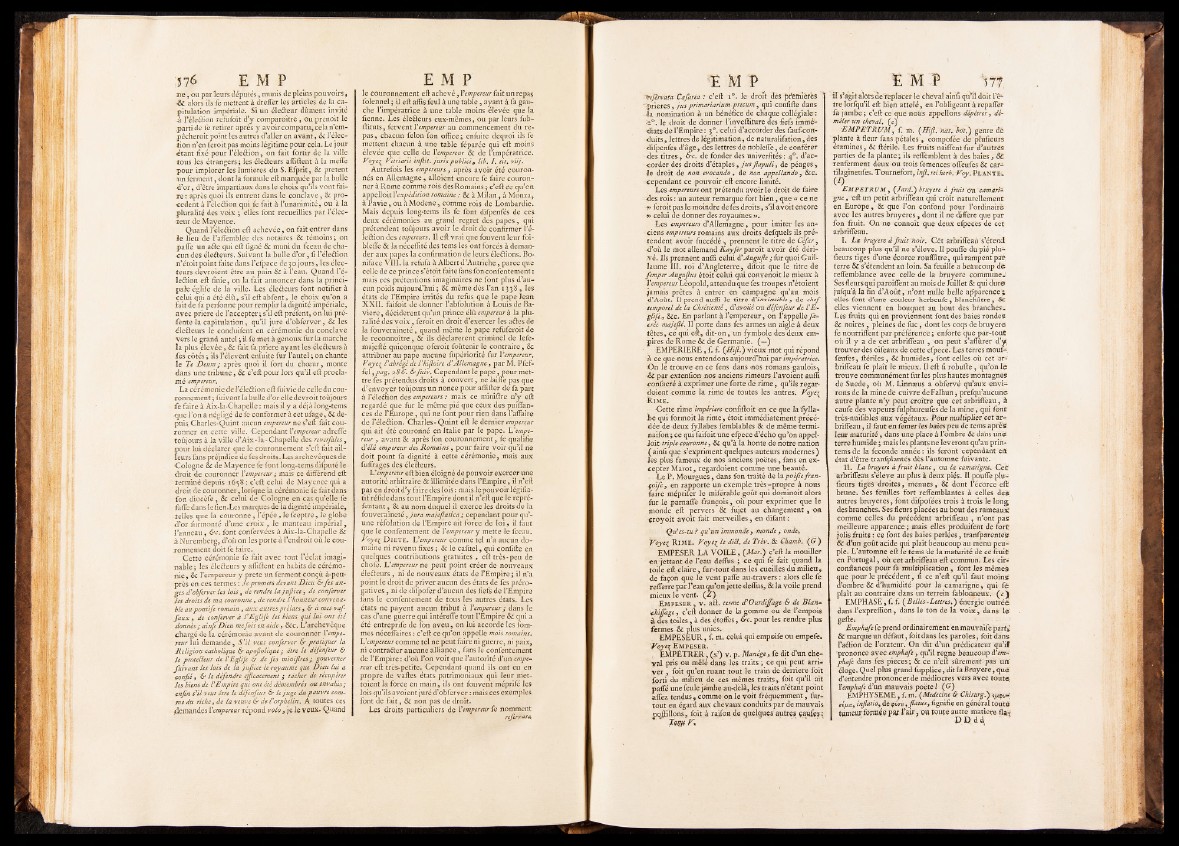
aie, ou parleurs députés, munis de pleins pouvoirs,
& alors ils fe mettent à dreffer les articles de la capitulation
impériale. Si un électeur dûment invité
•à l’éleâion refùfoit d’y comparoître , ou prenoit le
«parti de fe retirer après y avoir comparu, cela n’em-
pêcheroit point les autres d’aller en avant, &c l’élection
n’en feroitpas moins légitime pour cela. Le jour
«tant fixé pour l’éleâion, on fait fortir de la ville
tous les étrangers ; les électeurs afliftent à la meffe
pour implorer les lumières du S. Efprit, & prêtent
•un ferment, dont la formule eft marquée par la bulle
-d’o r, d’être impartiaux dans le choix qu’ils vont faire
: après quoi ils entrent dans le conclave, & procèdent
à l’éleâion qui fe fait à l’unanimité, ou à la
pluralité des voix ; elles font recueillies par l’électeur
de Mayence.
Quand l’éleâion eft achevée, on fait entrer dans
ie lieu de l’affemblée des notaires & témoins; on
paffe un aâe qui eft figné & muni du feeau de chacun
des électeurs. Suivant la bulle d’o r , fi l’éleâion
n’étoit point faite dans l’efpace de 30 jours, les électeurs
devroient être au pain & à l’eau. Quand l’éleâion
eft finie, on la fait annoncer dans la principale
églife de la ville. Les éleâeurs font notifier à
celui qui a été élû, s’il eft abfent, le choix qu’on a
fait de fa perfonne pour remplir la dignité impériale,
avec priere de l’accepter ; s’il eft prélent, on lui préfente
la capitulation, qu’il jure d’obferver, & les
■ éleâeurs le conduifent en cérémonie du conclave
vers le grand autel ; il fe met à genoux fur la marche
la plus élevée, Sc fait fa priere ayant les éleâeurs à
fes côtés ; ils l’éievent enfuite fur l’autel ; on chante
le Te Deum; après quoi il fort du choeur, monte
dans une tribune, & c’eft pour lors qu’il eft proclamé
empereur.
La cérémonie de l’éleâion eft fuivie de celle du couronnement
; fui vant la bulle d’or elle devroit toujours
fe faire à Aix-la-Chapelle : mais il y a déjà long-tems
.que l ’on a négligé de fe conformer à cet ufage, & depuis
Charles-Quint aucun empereur ne s’eft fait couronner
en cette ville. Cependant l’empereur adreffe
ioûjours à la ville d’Aix-la-Chapelle des reverfales,
pour lui déclarer que le couronnement s’eft fait ailleurs
fans préjudice de fes droits. Les archevêques de
Cologne & de Mayence fe font long-tems difputé le
droit de couronner l’empereur ; mais ce différend eft
terminé depuis 1658 : c’eft celui de Mayence qui a
droit de couronner, lorfque la cérémonie fe fait dans
fon diocèfe, & celui de Cologne en cas qu’elle fe
faffe dans lefien.Les marques de la dignité impériale,
telles que la couronne , l’épée, lefceptre , le globe
d’or fiirmonté d’une croix , le manteau impérial,
î ’anneau, &c. font confervées à Aix-la-Chapelle &
à Nuremberg, d’oii on les porte à l’endroit où le couronnement
doit fe faire.
Cette cérémonie fe fait avec tout l’éclat imaginable
; les électeurs y afliftent en habits de cérémonie
, & l’empereur y prete un ferment conçu à-peu-
près en ces termes : Je promets devant Dieu &fes anses
d’obferver les lois, de rendre la jujlice, de conferver
les droits de ma couronne , de rendre .l’honneur convenable
au pontife romain , aux autres prélats , & à mes vaf-
fau x, de conferver à l ’Eglife les biens qui Lui ont été
donnés ; ainfiDieu mefait en aide, & c . L’archevêque
chargé de la cérémonie avant de couronner l’empereur
lui demande, S ’il veut conferver & pratiquer la
Religion catholique & apojlolique ; lire le défenfeur &
le protecteur de VEglife & de fes miniflres ; -gouverner
fuivant les lois de la juftice le royaume que Dieu lui a
■ confié, & le défendre efficacement ,• tâcher de récupérer
les biens de l'Empire qui ont été démembrés ou envahis;
enfin s*il veut être le défenfeur & le juge du pauvre comme
du riche, de la veuve & de l ’orphelin. A toutes ces
demandes Y empereur répond volo 9 je le veux. Quand
le couronnement eft achevé, l’empereur fait un repas
folennel ; il eft aflis feul à une table, ayant à fa gauche
l’impératrice à une table moins élevée que la
fienne. Les électeurs eux-mêmes, ou par leurs fub-
ftituts, fervent Vempereur au commencement du repas
, chacun félon fon office ; enfuite dequoi ils fe
mettent chacun à une table féparée qui eft moins
élevée que celle de l'empereur & de l’impératrice.
Voyeç Vitriarii infiit. juris publia# lib. I. tit. viij. ■
Autrefois les empereurs , après avoir été couronnés
en Allemagne, alloient encore fe faire couronner
à Rome comme rois des Romains ;• c’eft ce qu’on
appelloitl'expédition romaine : & à Milan, à Monza,
à Pavie, ou à Modene, comme rois de Lombardie.
Mais depuis long-tems ils fe font difpenfés de ces
deux cérémonies au grand regret des papes, qui
prétendent toujours avoir le droit de confirmer l’éleâion
des empereurs. Il eft vrai que fouvent leur foi-,
bleffe & la néceflité des tems les ont forcés à demander
aux papes la confirmation de leurs éleâions. Bo-
niface VIII. la refufa à Albert d’Autriche, parce que
celle de ce prince s’étoit faite fans fon confentement :
mais ces prétentions imaginaires ne font plus d’aucun
poids aujourd’hui ; & même dès l’an 1338, les
états de l’Empire irrités du refus que le pape Jean
XXII. faifoit de donner l’abfolution à Louis de Bavière
, décidèrent qu’un prince élû empereur à la pluralité
des v o ix , feroit en droit d’exercer les aâes de
la fouveraineté, quand même le pape refuferoit de
le reconnoître, & ils déclarèrent criminèl de lefe-
majefté quiconque oferoit foûtenir le contraire, &
attribuer au pape aucune fupériorité fur l ’empereur.
Voye£ l'abrégé de l ’hijioire d’Allemagne , par M. Pfef-
fel jpag. 2.86. & fuiv. Cependant le pape, pour mettre
fes prétendus droits à couvert, ne laiffe pas que
d’envoyer toûjours un nonce pour afîifter de fa part
à l’éleâion des empereurs : mais ce miniftre n’y eft
regardé que fur le même pié que ceux des puiffan-
ces de l’Europe, qui ne font pour rien dans l’affaire
de l’éleâion. Charles- Quint eft le dernier empereur
qui ait été couronné en Italie par le pape. U empereur
, avant & après fon couronnement, fe qualifie
A’élu empereur des Romains , pour faire voir qu’il ne
doit point fa dignité à cette cérémonie, mais aux
fuffrages des éleâeurs.
L'empereur eft bien éloigné de pouvoir exercer une
autorité arbitraire & illimitée dans l’Empire, il n’eft
pas en droit d’y faire des lois : mais le pouvoir légifla-
tif réfide dans tout l’Empire dont il n’eft que le repré-
fentant, & au nom duquel il exerce les droits de la
fouveraineté y jura majejlatica; cependant pour qu’une
réfolution de l’Empire ait force de lo i, il faut
que le confentement de l'empereur y mette le feeau.
V jyeç_ D iete. L5empereur comme tel n’a aucün domaine
ni revenu fixes ; & le cafuel, qui confifte en
quelques contributions gratuites , eft très-peu de
chofe. U empereur ne peut point créer de nouveaux
éleâeurs, ni de nouveaux états de l’Empire ; il n’a
point le droit de priver aucun des états de fes prérogatives
, ni de difpofer d’aucun des fiefs de l’Empire
fans le confentement de tous les autres états. Les
états ne payent aucun tribut à Vempereur ; dans le
cas d’une guerre qui intéreffe tout l’Empire & qui a
été entreprife de fon aveu, on lui accorde les lom-
mes néceffaires : c’eft ce qu’on appelle mois romains.
L’empereur comme tel ne peut faire ni guerre, ni paix,
ni contraâer aucune alliance, fans le confentement
de l’Empire : d’où l’on voit que l’autorité d’un empereur
eft très-petite. Cependant quand ils ont eu en
propre de vaftes états patrimoniaux qui leur met-
toient la force en main, ils ont fouvent méprifé les
lois qu’ils a voient juré d’obferver : mais ces exemples
font de fait, & non pas de droit.
Les .droits particuliers de Vempereur fe nomment
rejerrata
^ejérvata Ccefarèa i c’eft l°. le droit dès pfemiërès
'•prières, jus primariarium precum, qui confifte dans
-•la nomination à un bénéfice de chaque collégiale':
:a°. le droit de donner i ’inveftiture des fiefs immédiats
de l’Empiré : 3°. celui d’accorder des fauficort-
duits, lettres de légitimation, de naturalifation, des
■ difpenfes d’âge , des lettres de nobleffe, de conférer
des titres, &c. de fonder des universités•: ^ . d’accorder
des droits d’étaples, ju s ftapuli, de péages,
•le droit de non evocando , de non appellando, &c.
cependant ce pouvoir eft encore limité.
Les empereursont prétendu avoir le droit de faire
des rois : un auteur remarque fort bien, que « ce né
feroitpas le moindre de fes droits; s’il avoit encore
»> celui de donner des royaumes ».
Les empereurs d’Allemagne, pour imiter les anciens
empereurs romains aux droits defquels ils prétendent
avoir fuccédé > prennent le titre de Cefar,
d ’où le mot allemand Ray fer paroît avoir été déri-
.vé. Ils prennent aufli celui d’Augufle ; fur quoi Guillaume
III. roi d’Angleterre, dil’oit que le titre de
femper Auguftus éfoit celui qui convenoit le mieux à
Vempereur Léopold, attendu que fes troupes n’étoient
jamais prêtes à entrer en campagne qu’au mois
d’Août. Il prend aufli le titre d'invincible , de chef
temporel de la Chrétienté , AU avoué ou défenfeur de l'E-
glife., &c. En parlant à l’empereur, on l’appelle fa-
crée majejié. Il porte dans fes armes un aigle à deux
têtes, ce qui eft, dit-on, un fymbole des deux empires
de Rome & de Germanie. (—)
EMPERIERE, f. f. (fitifi.') vieux mot qui répond
A ce que-nous entendons aujourd’hui par impératrice.
On le trouve en ce fens dans nos romans gaulois*,
& par extenfion nos anciens rimeurs l’avoient aufli
confacré à exprimer une forte de rime, qu’ils regar-
doient comme la rime de toutes les autres. Voyez
•Rime. •
Getté rime impériere confiftoit en ce que la ïylla-
Ibe qui formoit la rime, étoit immédiatement précédée
de deux fyllabes femblables & de même termi-
naifon ; ce qui faifoit une elpece d’écho qu’on appel- '
doit-triple-couronne, •& qu’à la honte de notre nation
(ainfi que s’expriment quelques auteurs modernes)
les plus fameux de nos anciens poètes, fans en excepter
Marot, regardoient comme une beauté.
. -Le P. Mourgues, dans fon traité de la poéfiefran-
ç o i f e en rapporte un exemple très-propre à nous
faire méprifer le miférable goût qui dominoit alors
fur le parnaffe françois, où pour exprimer que le
monde eft pervers & fujet au changement , -on
croyoit avoit fait merveilles, en difant ;
Qu’es-tu ? qu’un immonde , inonde, onde.
Ÿoye^ Rime» Voye^ le dut. de Trév. & Chamb. (G )
EMPESER LA VOILE, {Mar.) c’eft la mouiller
en dettant de l’eau deflus ; ce qui fe fait quand la
toile eft claire, fur-tout dans, les cueilles du milieu ,
de façon que le vent paffe au-travers : alors elle fe
refferre par l’eau qu’on jette deffus, & la voile prend
mieux le vent» (Z)- . : u • Empeser , v . aâ . terme (TOurdijfage & de Blan-
chijfage, c’eft donner de la gomme ou de l’empois
A des toiles, à des étoffes, &c. pour les rendre plus
fermes & plus unies» : i; ^ ^
EMPESEUR, f» m. celui qui empeife ou empefe.
[Voyei Empeser. '
, EMPÊTRER, (s’) V. p. Manège , fe dit d’un cheval
pris ou mêlé dans les traits ; ce qui peut arriver
, foit qu’en ruant tout le train de derrière foit
forti du milieu de ces mêmes traits,,, foit qu’il ait
paffé une feule jambe au-dèlà, les traits n’étant point
affez tendus, comme on le voit fréquemment, fur-
tout eu égard aux chevaux conduits par de mauvais
pq$illons, foit à raifon de quelques autres çaufes ;
Tot^e K%
i f s’agit alors deteplacer le che val aïnfi qu’il doit l’êfc
tre lorfqu’il eft bien attelé, en l’obligeant à repaffer
fa jambe ; c’eft ce que noüs appelions dépêtrer, • démêler
un cheval, {e)
EM PETRUM, f. m. (fHift.'nat. bot.) genre dè
plante à fleur fans pétales , compofée de plufieurs
étamines, & ftérile. Les fruits naiffent fur d’autres
parties de la plante ; ils reflemblent à des baies , &
renferment deux ou trois femences offeufes & car-
tilagmeufes. Toumefort, infi, rei herb. Voy. Plante-.
■ ■ ■
E m p e t r u m , {Jard.) bruyere a fruit Ou cdmari*
gne , eft un petit arbriffeau qui croît naturellement
en Europe, & que l’on confond pour l’ordinaire
avec les autres bruyères, dont il ne différé que par
fon fruit. On ne connoît que deux efpeces de cet
arbriffeau.
I. La bruyere à fruit hoir. Cêt ârbriffeâù s’étend
beaucoup plus qu’il ne s’élève. Il poufle du pié plufieurs
tiges d’une écorce rouffâtre, qui rampent paf
terre & s’étendent au loin. Sa feuille a beaucoup de
reffemblance avec celle de la bruyere commune«’
Ses fleurs qui paroiffent au mois de Juillet & qui duré
jufqu’à la fin d’Août, n’ont nulle belle apparence ;
elles font d’une couleur herbeufe, blanchâtre, &
elles viennent en bouquet au bout des branches-«
Les fruits qui en proviennent font des baies rondes
& noires , pleines de fuc, dont les coqs de bruyere:
fe nourriffent par préférence ; enforte que par-tout
où il y a de cet arbriffeau , on peut s’aflurer d’y,
trouver des oifeaux de cette efpece. Les terres mouf-
feufes, ftériles, & humides, font celles où cet arbriffeau
fe plaît le mieux. Il eft fi robufte, qu’on le
trouve communément fiir les plus hautes montagnes
de Suede-, où M. Linnæùs a obfervé qu’aux envi1»
rons de la mine de cuivre de Falhun, prefqu’aucune
autre plante n’y peut croître que cet ârbrifl’eau, à
caufe des vapeurs fulphureufes de la mine, qui font
très-nuifibles aux végétaux. Pour multiplier cet 'arbriffeau
, il faut en f&mer les baies peu de tems après?
leur maturité, dans une place à l’ombre & dà'ns une
terre humide ; mais les plants ne lèveront qu’au prin-
tems de la fécondé année : ils feront cependant eiï
état d’être tranfplantés dès l’automne fuivante.
II. La bruyere à fruit blanc 9 ou la camàrigne. Ce t'
arbriffeau s’élève au plus à deux piés. Il pouffe plufieurs
tigès droites, menues, & dont l’écorce eft
brune. Ses fèùilles fort reffemblantes à celles des;
autres bruyères, font difpofées trois à trois le long
des branches. Ses fleurs placées au bout des rameau^
comme celles du précédent arbriffeau , n’ont pas
meilleure apparence ; mais elles produisent de fort
jolis fruits : ce font des baies perlées, tranfparentes:
& d’un goût acide qui plaît beaucoup au menu peuple.
L’automne eft ie tems de la maturité dé cë fruit
en Portugal, où cet arbriffeau eft commun. Les cir-
conftances pour fa multiplication, font les mêmés
que pour le précédent, fi ce n’eft qu’il faut moins'
d’ombre & d’humrdité pour la camarigne, qui fè
plaît au contraire dans un terrein fablonneux. ( c )
EMPHASE, f. f. ( Belles - Lettres. ) énergie outréë
dans l’expreflion, dans le ton de la v o ix , dans le
gefte»
Emphafe fe prend ordinairement en mauvâife part**
& marque un défaut, foit dans les paroles, foit dans
l’aâion de l’orateur. On dit d’un prédicateur qu’i l
'prononce avec emphafe , qu’il régné beaucoup à’emphafe
dans les pièces ; & ce n’eft sûrement pas uit
éloge. Quel plus grand fupplice, dit la Bruyere, que
d’entendre prononcer de médiocres vers avec toute,
Y emphafe d’un mauvais poète 1 {G)
- EMPHYSEME, f. m. (Médecine & Ckirttrg.) i/xipu**.
fflp.cc> infiatio, de <pé<rn ,flatus> fignifie en général toute
tumeur formée par Pair, ou toute autre matière fUr
PD.dd^