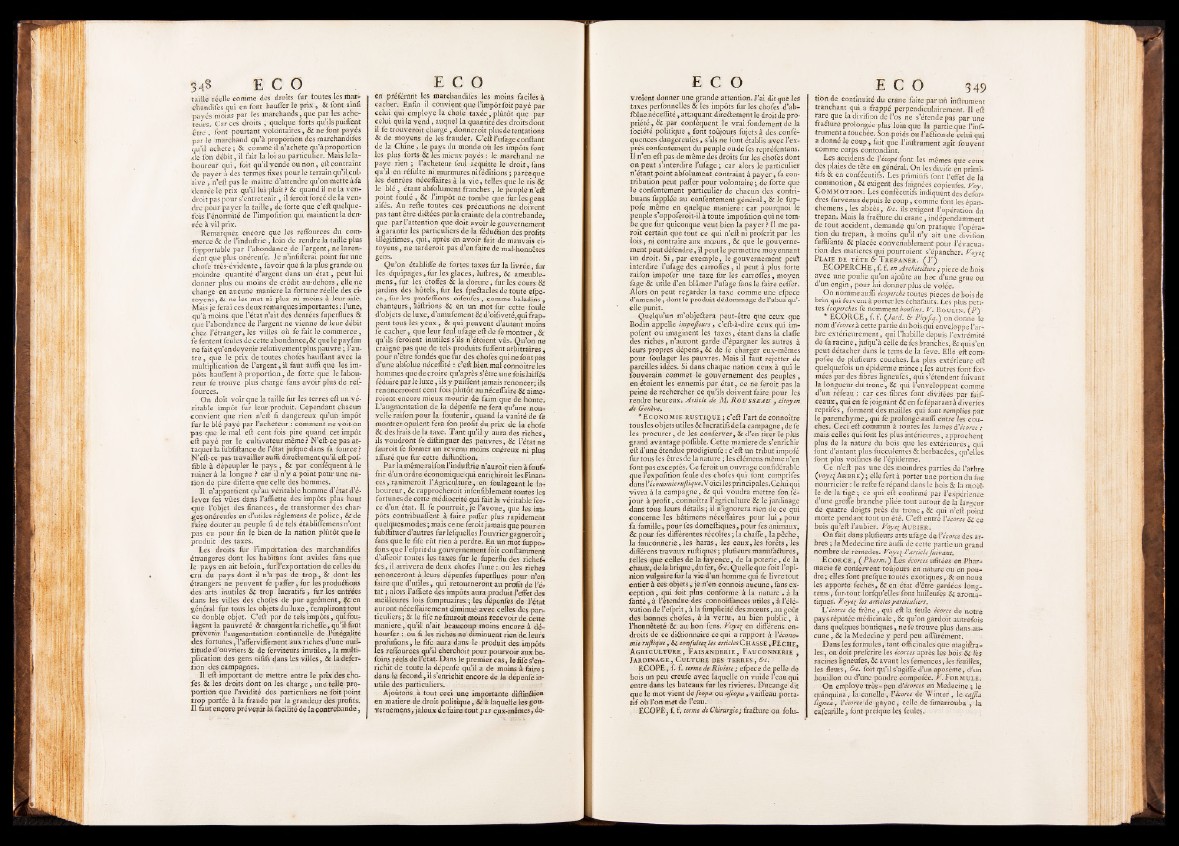
-taille réelle comme des droits fur toutes les fliatv
chandifes qui en font hauffer le prix, & font ainfi
pavés moins par les marchands, que par les acheteu
r , Car ces droits , quelque forts qu’ils puiffent
être , font pourtant volontaires, Sc ne fonr payés
-par le marchand qu’à proportion des marchandifes
qu’il acheté ; & comme il n’aehete qu’à proportion
,de fon débit, il fait la loi au particulier. Mais le laboureur
qui, foit qu’il vende ou non, eft contraint
de payer à des termes fixes pour le terrain qu’il.cultivé
, n’eft pas le maître d’attendre qu’on mette àfa
denrée le prix qu’il lui plaît ? & quand iJ ne la ven-
droit pas pour s’entretenir, il feroit forcé de la vendre
pour payer la taille, de forte que c’eft quelquefois
l’énormité de l’impofition qui maintient la denrée
à vil prix.
Remarquez encore que les reffources du commerce
& de l’ihduftrie , loin de rendre la taille plus
fupportable par l’abondance de l’argent, ne la rendent
que plus onéreufe. Je n’infifterai point fur une
chofe très-évidente, favoir que fi la plus grande ou
moindre quantité d’argent dans un é ta t, peut lui
donner plus ou moins de crédit au-dehors, elle ne
change en aucune maniéré la fortune réelle des citoyens,
& ne les met ni plus ni moins à leur aife.
Mais je ferai ces deux remarques importantes : l’une,
qu’ à moins que l’état n’ait des denrées fuperfliies &
que l’abondance de l’argent ne vienne de leur débit
chez l’étranger, les villes oh fe fait le commerce,
fe fentent feules de cette abondance,& que le payfan
ne fait qu’en devenir relativement plus pauvre ; l’autre
, que le prix de toutes chofes hauffant avec la
multiplication de l’argent, il faut aufli que les impôts
hauffent à proportion, de forte que le laboureur
fe trouve plus chargé fans avoir plus de reffources.
On doit voir que la taille fur les terres eft un véritable
impôt fur leur produit. Cependant chacun
convient que rien n'eft fi dangereux qu’un impôt
fur le blé payé par l’acheteur : comment ne vôit-on
pas que le mal eft cent fois pire quand, cet impôt
eft payé par le cultivateur même ? N’eft-çe pas a ttaquer
la fubfiftance de l’état jufque dans fa fource ?
N’eft-ce pas travailler aufli directement qu’il eft pof-
fible à dépeupler le pa ys, Sc par conféquent à le
ruiner à la longue ? car il n’y a point pour une nation
de pire difètte que celle des hommes.
Il n’appartient qu’au véritable homme d’état d’é-
lever fes vûes dans Faffiette des' impôts plus haut
«ue Fobjet des finances, de transformer des char-
geçonéreufes en d’utiles réglemens de police, & d e
faire douter gu peuple fi dé tels établiffemens n’ont
pas eu pour fin le bien de la nation plutôt que le
produit des taxes.
Les droits fur l’impdrtation des marchandifes
étrangères dont les habita ns font avides fans que
le pays en ait befoin, funPexportation de celles du
cru du pays dont il n'a pas de trop, & dont les
étrangers ne peuvent fé paffer, fur les productions
des arts inutiles & trop lucratifs, fur les entrées
dans les villes des chofes de pur agrément, Sc en
général fur tous-les objets du luxp, rempliront tout
ce double objet. C’eft par de tels impôts, qui fou-
lagent la pauvreté & chargent la richeffe, qu’il faut
.prévenir, l’augmentation-continuelle de-l'inégalité
des fortunes , Fafferviffémentàux riches d’une multitude
d ’ouvriers & de fervrteurs inutiles, la multi-
plication des gens oififs dans les villes, & ladefer-
tion des campagnes.
Il eft important de mettre entre le prix des chofes
& les droits dont on les charge, une telle proportion
que l’avidité des particuliers ne foifc point
trop portée à la fraude par la grandeur des profits:
11 mit encore prévenir la facilité delà contrebande,
en préférant les marchandifes lés moins faciles à
cacher. Enfin il convient que l’impôt foit payé par
celui qui employé la chofe taxée, plûtôt que par
celui qui la vend, auquel la quantité des droits dont
il fe trouveroit charge , .donnerok plus de tentations
& de moyens de les frauder. C ’eft l’ufage confiant
de la Chine, le pays du monde oii les impôts font
les plus forts Sc les mieux payés : le marchand ne
paye rien ; l’acheteur feuî acquitte le droit, fans
qu’il en réfulte ni murmures ni l’éditions ; parce que
les denrées néeeffaires à la v ie , telles que le ris &
le b lé , étant abfolument franches, le peuple n’eft
point foulé , Sc l’impôt ne tombe que fur les gens
aifés. Au refte toutes ces précautions ne doivent
pas tant être di&ées parla crainte de la contrebande,
que par l’attention que doit avoir le gouvernement
à garantir les particuliers de la féduûion des profits
illégitimes, qui, après en avoir fait de mauvais citoyens
, ne tarderoit pas d’en faire de mal-honnêtes
gens..
Qu’on établiffe de fortes taxes fur la livrée, fur
les équipages, fur les glaces, luftres, & ameuble-
mens, fur les étoffes & la dorure, for les cours Si
jardins des hôtels, fur les fp.e&acles de toute efpece
, fur les profeflions oifeufes, comme baladins ,
chanteurs, hiftrions Si en un mot fur cette foule
.d’objets de luxe, d’amufement Sc d’oifiveté,qui frappent
tous les y e u x , & qui peuvent d’autant moins
fe cacher, que leur feul ufage eft de fe montrer, &
qu’ils fèroient inutiles s’ils n’étoient vus. Qu’on ne
craigne pas que de tels produits fuffent arbitraires *
pouf n’être fondés que for des chofes qui ne font pas
d’une abfolue néceflité : c’eft bien mal connoître les
hommes que de croire qu’après s’être une foislaiffés
féduire par le luxe, ils y puiffent jamais renoncer; ils
renoneeroient cent fois plutôt au néceffaire & aime-
roient. encore mieux mourir de faim que de honte.
L’augmentation de, la dépenfe ne fera qu’une non*
yelfe raifon pour la foutenir, quand la vanité de fe
montrer opulent fçra fon. profit du prix de la chofe
& des frais de la taxe. Tant qu’il.y aura des riches *
ils voudront fe diftinguer des pauvres, Sc l’état ne
fauroit fe former un revenu moins onéreux ni plus
affuré que ftir cette diftinétion.
Par la même raifon l’induftrie n’auroit rien à fouf*
frir d’un ordre économique qui enriçhiroit les Finances
, ranimeroit 1’Agriculture, en foulageant le la*
boureur, Sc rapprocheroit infenfiblement toutes leç
fortunés de cette médiocrité qui fait la véritahle force
d'un état. Il fe pourroit, je l’avoue, que les im*
pots contribuaffent à faire paffer plus rapidement
quelquesmod.es ; mais ce ne feroit jamais que pour en
fobftituer d'autres, furlefquelles l’ouvrier gagneroit,
fans que le fifc eût rien à perdre. En un mot foppo*
fons que l’efpritdu gouvernement foit conftamment
d’affeoir toutes les taxes for le fuperflu des richefo
fes.j il arrivera de deux chofes l'une : ou les riches
renonceront à leurs dépenfes foperflues pour n’erç
faire que d'utiles, qui retourneront au profit de Fé*
tat ; alors, l’affiete des impôts aura produit l’effet des
meilleures lois fomptuaires ; les dépenfes de l’état
auront nécefîairement diminué, avec celles des par-
ticuliers ; & le fifc ne fauroit moins recevoir de cette
maniéré, qu’il n’ait beaucoup.1 moins encore à dé-
bourfer : ou fi les riches ne diminuent rien de leurs
protfufions, le. fifc aura dans le produit des.impôts
les reffources qu'il cherchoit pour pourvoir aux ber
foiqs réels de l’etat. Dans le premier cas, le fifc s’enrichit
de toute la dépenfe qu’il a de moins à faire;
dans le fécond, il s’enrichit encore de la dépenfe inutile
des particuliers.
Ajoutons à tout ceci une importante diftinâio»
en matière de droit politique, & à laquelle les gor*
vcrnemens, jaloux défaire tout par eux-mêmes, devroient
donner line grande attention. J’ai dit que les
taxes perfonnelles & les impôts for les chofes d’ab-
fèlue,néceflité, attaquant directement le droitde propriété.,
Sc par conféquent le vrai fondement de la
îociété politique , font toujours fujets à des confé-
quences dangoreufes, s’ils ne font établis avec l’exprès
confentement du peuple oude fes repréfentans»
Il n’en eft pas de-même dès droits fur les chofes dont
on peut s’interdire Fufage ; car alors le particulier
n’étant point abfolument contraint à payer, fa contribution
peut paffer pour volontaire ; de forte que
le confentement particulier de chacun dés eontri-
buans fupplée au confentement général, & le fup-
pofe même en quelque maniéré : car pourquoi lé
peuple s’oppoferoit-il à toute impofition qui ne tombe
que for quiconque veut bien la payer ? Il me pa-
roît certain que tout ce qui n’eft ni profcrit par les
lois, ni contraire aux moeurs, Sc que le gouvernement
peut défendre, il peut le permettre moyennant
tin droit. Si, par exemple, le gouvernement peut
interdire Fufage des earroffes, il peut à plus forte
raifon impofer une taxe fur les earroffes, moyen
fage Sc utile d’en blâmer Fufage fans le faire ceffer.
Alors on peut regarder la taxé comme une efpece
d’amende, dont le produit dédommage de l’abus qu’elle
punit.
Quelqu’un m’obje&era peut-être que cetlx que
Bodin appelle impofieurs , c’eft-à-dire ceux qui im-
pofent ou imaginent les taxes, étant dans la claffe
des riches, n’auront garde d’épargner les autres à
leurs propres dépens, Sc de fe charger eux-mêmes
pour foulager les pauvres. Mais il faut rejetter de
pareilles idées. Si dans chaque nation ceux à qui le
fouverain commet- lie gouvernement des peuples *
en étoient les ennemis par état, ce ne feroit pas la
peine de rechercher ce qu’ils doivent faire pour les
rendre heureux» Article de Mi R o u s s e a u , citoyen
de Genève,
* Economie rustique ; c’eft Fart de eonnoître
tous les objets utiles Sc lucratifs de la campagne, de fe
les procurer, de les conserver, & d’en tirer le plus
grand avantage poflâble. Cette maniéré de s’enrichir
eft d’une étendue prôdigieufe : c’eft Un tribut impofé
fur tous les êtres de la nature ; les élémens même n’en
font pas exceptés. C e feroit un ouvrage confidérable
que l'expofition feule des chofes qui font comprifes
dans F économie mfiiqueN oici les principales.-Gelui qui
vivra à la campagne, Sc qui voudra mettre fon fé-
jour à profit, connoîtra l’ agriculture & le jardinage
dans tous leurs détails ; il n’ignorera rien de ce qiii
concerne les bâtimens néeeffaires pour lui , pour
fa famille, pour fes domeftiques, pour fes animaux,
Sc pour fes différentes récoltes ; la chaffe, la pêche,
la fauconnerie, les haras, les eaux,les forêts, les
différens travaux ruftiques ; plufienrs manufaéhires,
telles que celles de la layence, de la poterie, de la
chauxyde la brique, du fer, &c. Quelle que foit l’opinion
vulgaire fur la vie d’un homme qui fe livre tout
entier à ces objets y je n’en connois aucune, fons exception
, qui foit plus conforme à la nature , à la
fanté, à Fétendne des connoiffances utiles, à l’élévation
de l’efprit, à la firaplicité des moeurs, au goût
des bonnes chofes, à la vertu, au bien public, à
l’honnêteté & au bon feus. Voye^ en différens endroits
de ce di&ionnaire ce qui a rapport à Yécono*
mie ruftique, Sc confultt?^ Les articles^HASSE, PÊCHE,
Agriculture, Faisanderie, Fauconnerie ,
Jardinage, Culture des terres, &c>
ECOPE, f. f. terme de Riviere ; efpece de, pelle de
bois lin peu creufe avec laquelle on vuide l’eau qui
entre dans les bateaux for les rivières. Ducange dit
eue le mot vient de feopa ou afeopa ,>vaiffeau portat
if oïi Fon met de l’eau.'
ECOPÉ, f, f, terme de Chirurgie; fra&ure ou folutiOn
de eoritinuité du crâne faite par un inftmment
tranchant qui a frappé perpendiculairement. Il eft
rare que la divifion de l’os ne s’étende pas par une
fra&ure prolongée plus loin que la partie que l’inf-
trument a touchée. Son poids ou l’aélionde celui qui
a donne le coup, fait que l’inftrument agit fouvent
Comme corps contondant.
bes accidens de 1 écopé font les mêmes que ceux
des plaies de tête en général. On les divife en primitifs
& en confécutifs. Les primitifs font l’effet de la
commotion, & exigent des faignées copieufes. Voy.
C o m m o t io n » Les confécutifs indiquent des defori
dres forvenus depuis le coup, comme font les épan-
çhemens, les abcès, &c. ils exigent l’opération du
trépan. Mais la fraâure du crâne, indépendamment
de tout accident, demande qu’on pratique l’opération
du trépan, à moins qu’il n’y ait une divifion
foffifonte & placée convenablement pour l’évacuation
des matières qui pourroient s’épancher. Voyti
P l a ie d e t ê t e & T r é p a n e r . ( F )
ECOPERCHE, f. f. en Architecture j pièce de bois
avec une poulie qu’on ajoûte au bec d’une a rue ou
d’un engin, pour lui donner plus de volée. °
On nomme aufli écoperche toutes pièces de bois de
brin qui fervent à porter les échafouts. Les pliis petites
écoperches fe nomment boulins. V. Bo u l in . (P)
* ECORCE, f. f; (Jard. & Phyjiq.') on donne le
nom d’écorce à cette partie du bois qui enveloppe l’arbre
extérieurement, qui l’habille depuis l’extrémité
de fa racine, jufqu’à celle de fes branches, Sc qui s’en
peut détacher dans le tems de la feve. Elle eft composée
de plufieurs couches. La plus extérieure eft
quelquefois un épiderme mince ; les autres font formées
par des fibres ligneufes, qui s’étendent fuivant
la longueur du tronc, & qui l’enveloppent comme
d’un réfeau : car ces fibres font divifées par foil-
ceaux, qui en fe joignant & en fe fépàrant à diverfes
reprifes, forment des mailles qui font remplies par
le parenchyme, qui fe prolonge auffi entre lés couches.
Ceci eft commun à toutes les lames d’écorce :
mais celles qui forit les plus intérieures, approchent
plus de la nature du bois que les extérieures, qui
font d’autant plus foceulentes & herbacées, qu’elles
font plus voifines de l’épiderme;
Ce n’eft pas une dés moindres parties de l’arbre
(yoy*i A r b r e ) ; elle fort à porter une portion du lue
nourricier : le refte fe répand dans le bois & la moelle
de la tige ; ce qui eft confirmé par l’expérience
d’une greffe branche pliée tout autour de la largeur
de quatre doigts près du tronc, & qui n’eft point
morte pendant tout un été. C ’eft entre l'écorce Sc ce
bois qu’eft l’aubier. Foye[ A u b ie r .
On foit dans plufieurs arts ufage de Fécorce des arbres
; la Médecine tire aufli de cette partie un grand
nombre de renîedes. Voye^Varticle fuivant.
E c o r c e , ( Pharm.) Les écorces alitées en Pharmacie
fe confervent toûjours en nature ou en poudre;
elles font prefque toutes exotiques, & on nous
les apporte feches, & en état d’être gardées lông-
tems, fur-tout lorfqu’elles font huileufes Sc aromatiques’.
Voyè{ les articles particuliers.
L'écorce de frêne ,• qui eft la feule- écorce de notre
pays réputée médicinale, Sc qu’on gardoit autrefois
dans quelques boutiques, ne fe trouve plus dans aucune
, Sc la Medecine y perd peu affûrément.
D a n s les form u les, ta n t officinales q u e m agistrales
, o n d o it p referire les écorces ap rès le s b o is & lès
racines ligneufes, & a v a n t les fem en ee s, les feuilles,
les fleu rs, &c. foit qu ’il s’agiffe d’u n a p o sèm e , cFun
b o uillon ou d ’une p o u d re com pofée. ^ . F o r m u l e .
On employé très - peu d'écorces en Medecine ; le
quinquina, la canelle , l'écorce de Winter, le cajfîa
ligne a , l'écorce de gayac, celle de fimarrouba , la
cafcajrille, font préfque le? feules.