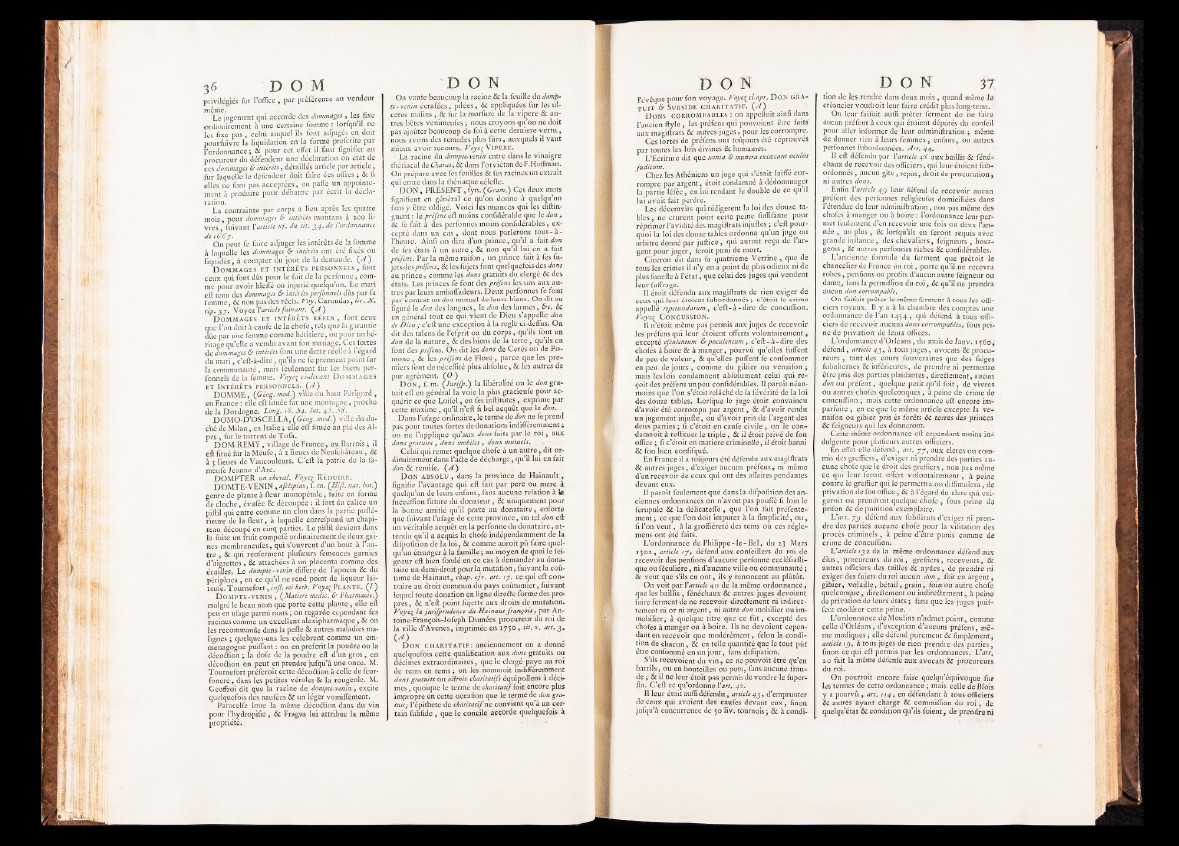
.privilégies fur l’office , par préférence au vendeur •
même. . _
' Le jugement qui accorde des dommages, les nxe
ordinairement à une certaine fomme : lorfqu il ne
les fixe pas 3 celui auquel ils font adjugés en doit
pourfuivre la liquidation en la forme preferite par
l’ordonnance ; & pour cet effet il faut fignifier au
procureur du défendeur une déclaration ou état de
ces dommages & intérêts, détaillés article par article ,
fur laquelle le défendeur doit faire des offres ; & fi
elles ne font pas acceptées, on pafle un appointe-
ment à produire pour débattre par écrit la déclaration.
x
La contrainte par corps a lieu apres les quatre
mois, pour dommages & interets montans à 100 livres
, fuivant l’article x j. du tit. 34. de L ordonnance
de 1667. % •
On peut fe faire adjuger les intérêts de la fomme
à laquelle les dommages & intérêts ont été fixes ou
liquidés, à compter du jour de la demande. {A )
D ommages et intérêts personnels , font
ceux qui font dûs pour le fait de la perfonne, comme
pour avoir bleffe ou injurie quelqu un. Le maii
eft tenu des dommages & intérêts perfonnels dûs par fa
femme, 8c non pas des réels. Voy. Carondas, liv. X .
rép. 37 . Voyez l'articlefuivant. {A )
D ommages et intérêts réels , font ceux
que l’on doit à caufe de la chofe, tels que la garantie
dûe par une femme comme héritière, ou pour un héritage
qu’elle a vendu avant fon mariage. Ces fortes
de dommages & intérêts font une dette reelle à l’égard
du mari, c’eft-à-dire, qu’ils ne fe prennent point fur
la communauté, mais feulement fur les biens perfonnels
de la femme. Vye^ ci-devant D ommages
et Intérêts personnels. {A')
DOMME, ( Géog. mod.') ville du haut Périgord,
en France : elle eft fituée fur une montagne, proche
de la Dordogne. Long. 18. 64. lat. 46. 58.
DOMO-D’OSCELLA, {Géog. mod.) ville du duché
de Milan, en Italie ; elle eft fituée au pié des Alpes
, fur le torrent de Tofa.
DOM-REMY, village de France, au Barrois ; il
eft fitué fur la Meufe, à 2 lieues de Neufchâteau, 8c
à 3 lieues de Vaucouleurs. C ’eft la patrie de la fa-
meufe Jeanne d’Arc.
DOMPTER un cheval. Voye1 RÉDUIRE.
DOMTE-VENIN, afclepias,f. m. {HiJÎ. nat. bot.)
genre de plante à fleur monopétale, faite en forme
de cloche, évafée 8c découpée : il fort du calice un
piftil qui entre comme un clou dans la partie pofté-
rieure de la fleur, à laquelle correfpond un chapiteau
découpé en cinq parties. Le piftil devient dans
la fuite un fruit çompofé ordinairement de deux gaines
membraneufes, qui s’ouvrent d’un bout à l’autre
, 8e qui renferment plufieurs femences garnies
d’aigrettes , 8c attachées à un placenta comme des
écailles. Le dompte-venin différé de l’apocin 8c du
périploca, en ce qu’il ne rend point de liqueur lai-
teufe.Tournefort, injt. rei herb. Voye{ Plante. ( / )
DOMPTE-VENIN, {Matière medic. & Pharmacie.)
malgré le beau nom que porte cette plante, elle eft
peu en ufage parmi nous ; on regarde cependant fes
racines comme un excellent alexipharmaque, 8e on
les recommande dans la pefte 8t autres maladies malignes
; quelques-uns les célèbrent comme un em-
menagogue puiffant : on en preferit la poudre ou la
décottion ; la dofe de la poudre eft d’un gros, en
décoftion on.peut en prendre jufqu’à une once. M.
Tournefort préferoit cette décoftion à celle de feor-
fonere, dans les petites véroles 8e la rougeole. M.
Geoffroi dit que la racine de dompte-venin , excite
quelquefois des naufées 8c un léger vomiffement.
Paracelfe loue la même décoftion dans du vin
pour l’hydropifie, 8c Fragus lui attribue la même
propriété..
On vante beaucoup la racine 8c la feuille du dompte
venin écrafées, pilées, 8c appliquées fur les ulcérés
malins , 8c fur la morfure de la vipere 8c autres
bêtes venimeufes ; nous croyons qu’on ne doit
pas ajoûter beaucoup de foi à cette derniere vertu,
nous avons des remedes plus furs, auxquels il vaut
mieux avoir recours. Voye^ V ipere.
La racine du dompte-venin entre dans le vinaigre
thériacal de Charas, 8c dans l’orviétan de F .Hoffman.
On prépare avec fes feuilles 8c fes racines un extrait
qui entre dans la thériaque célefte.
D O N , PRÉSENT, fyn. {Gram.) Ces deux mots
lignifient en général ce qu’on donne à quelqu’un
fans y être obligé. Voici les nuances qui les diftin-
guent : le préfent eft moins confidérable que le don ,
8c fe fait à des perfonnes moins confidérables, excepté
dans un cas , dont nous parlerons tout - à -
l’heure. Ainfi on dira d’un prince, qu’il a fait don
de fes états à un autre, 8c non qu’il lui en a fait
préfent. Par la même raifon, un prince fait à fes fu-
jets despréfens, & les fujets font quelquefois des dons
au prince, comme les dons gratuits du cierge 8c des
états. Les princes fe font des préfens les uns aux autres
par leurs ambaffadeurs. Deux perfonnes fe font
par contrat un don mutuel de leurs biens. On dit au
figuré le don des langues, le don des larmes, &c. 8c
en général tout ce qui vient de Dieu s’appelle don
de Dieu ; c’eft une exception à la regl’e ci-deffus. On
dit des talens de l’efprit ou du corps, qu’ils font un
don de la nature, 8c des biens de la terre, qu’ils en
font des préfens. On dit les dons de Cerés ou de Po-
mone , 8c les préfens de Flore, parce, que les premiers
font de néceffité plus abfolue, 8c les autres de
pur agrément. (O )
D o n , f. m. {Jurifp.) la libéralité ou le don gratuit
eft en général la voie la plus gracieufe pour acquérir
ce que Loifel, en fes inftitutes, exprime par
cette maxime , qu’il n’eft fi bel acquêt que le don.
Dans l’ufage ordinaire, le terme de don ne fe prend
pas pour toutes fortes de donations indifféremment ;
on ne l’applique qu’aux dons faits par le ro i, aux
dons gratuits , dons mobiles , dons mutuels.
Celui qui remet quelque chofe à un autre, dit ordinairement
dans l’aûe de décharge., qu’il lui en fait
don 8c remife. {A )
D on absolu , dans la province de Hainauk ,
fignifie l’avantage qui eft fait par pere ou mere à
quelqu’un de leurs enfans, fans aucune relation à la
fucceffion future du donateur, 8c uniquement pour
la bonne amitié qu’il porte au donataire, enlorte
que fuivant l’ufage de cette province, un tel don eft
un véritable acquêt en la perfonne du donataire, attendu
qu’il a acquis la chofe indépendamment de la
difpofition de la loi, 8c comme auroit pû faire quelqu’un
étranger à la famille ; au moyen de quoi le fei-
gneur eft bien fondé en ce cas à demander au donataire
un demi-droit pour la mutation, fuivant la coû-
tume de Hainaut, chap. cjv. art. /y. ce qui eft contraire
au droit commun du pays coûtumier, fuivant
lequel toute donation en ligne direfte forme des propres,
8c n’eft point fujette aux droits de mutation.
Voye[ la jurifprudence du Hainaut. françois, par An-
toine-François-Jofeph Dumées procureur, du roi de
la ville d’A ’venes, imprimée en 1750, tit. v. art. 3 .
■
D on c h a r it a t if : anciennement on a donne
quelquefois cette qualification aux dons gratuits ou
décimes extraordinaires, que le clergé paye au roi
de tems en tems ; on les nommoit indifféremment
dons gratuits ou octrois charitatifs équipollens à décimes,
quoique le terme de charitatif foit encore plus
impropre en cette accafion que le terme de don gratuit;
l’épithete de charitatif ne convient qu’à un cer»
tain fubfide, que le concile accorde quelquefois à
i’évêque pour fon voyage. Voye^ ci-apr. DÓN gratu
it & Subside ch a r it a t if . {A )
D ons corrompables : on appelloit ainfi dans
l’ancien fty le , Les préfens qui pouvoient être faits
aux magiftrats 8c autres juges, pour les corrompre.
Ces fortes de préfens ont toûjours été réprouves
par toutes les lois divines 8c humaines.
L’Ecriture dit que xenia & mimera excacant oculos
judicum. _ . , . .a-i
Chez les Athéniens un juge qui s’étoit laine corrompre
par argent, étoît condamné à dédommager
la partie léfée, en lui rendant le double de ce qu il
lui avoit fait perdre.
Les décemvirs qui rédigèrent la loi des douze tables
, ne crurent point cette peine fuffifante pour
réprimer l’avidité des magiftrats injuftes ; c eft pourquoi
la loi des douze tables ordonna qu un juge^ ou
arbitre donné par juftice, qui auroit reçu de 1 argent
pour juger, feroit puni de mort.
Cicéron dit dans fa quatrième Verrine , que de
tous les crimes il n’y en a point de plus odieux ni de
plus funefte à l’état, que celui des juges qui vendent
leur fuffrage.
Il étoit défendu aux magiftrats de rien exiger de
ceux qui leur étoient fubordonnés ; c’étoit le crime
appellé repetundarum, c’eft-à-dire de concuffion.
Voye^ C oncussion.
Il n’étoit même pas permis aux juges de recevoir
les préfens qui leur étoient offerts volontairement,
excepté efculentum &poculentum, c’e ft-à-dire des
chofes à boire 8c à manger, pourvû qu’elles fuffent
de peu de valeur, 8c qu’elles puffent fe confommer
en peu de jours , comme du gibier ou venaifon ;
mais les lois condamnent abfolument celui qui reçoit
des préfens un peu confidérables. Il paroît néanmoins
que l’on s’étoit relâché de la févérité de la loi
des douze tables. Lorfque le juge étoit convaincu
d’avoir été corrompu par argent, 8c d’avoir rendu
un jugement injufte, ou d’avoir pris de l’argent des
deux parties ; fi c’étoit en caufe civile , on le con-
damnoit à reftituer le triple, 8c il étoit privé de fon
office ; fi c’étoit en matière criminelle, il étoit banni
8c fon bien confifqué.
En France il a toûjours été défendu aux magiftrats
8c autres juges, d’exiger aucuns préfens y ni même
d’en recevoir de ceux qui ont des affaires pendantes
devant eux.
Il paroît feulement que dans la difpofition des anciennes
ordonnances on n’avôit pas pouffé fi loin le
fcrupùle 8c la délicateffe , que l’on fait préfente-
ment ; ce que l’on doit imputer à la fimplicité, ou ,
fi l’on veut, à la grofliéreté des tems oii ces réglerions
ont été faits.
L’ordonnance de Philippe - le - Bel, du 23 Mars
1302, article iyy défend aux confeillers du roi de
recevoir des penfions d’aucune perfonne eccléfiafti-
que ou féculiere, ni d’aucune ville ou communauté ;
8c veut que s’ils en ont, ils y renoncent au plutôt.
On voit par l'article 40 de la même ordonnance,
que les baillis , fénéchaux 8c autres juges dévoient
faire ferment de ne recevoir directement ni indirectement
ni or ni argent, ni autre don mobilier ou immobilier,
à quelque titre que ce fû t , excepté des
chofes à manger ou à boire. Ils ne dévoient cependant
en recevoir que modérément, félon la condition
de chacun, 8c en telle quantité que le tout pût
être confommé en un jour, fans diffipation.
S’ils recevoient du v in , ce ne pouvoit être qu’en
barrils, ou en bouteilles ou pots, fans aucune fraude
; 8c il ne leur étoit pas permis de vendre le fuper-
flu. C’eft ce qu’ordonne Vare. 42.
Il leur étoit auflidéfendu, article43, d’emprunter
de ceux qui .avoient des caufes devant eu x, finon
jufqu’à concurrence de 50 liv. tournois; 8c à conditiort
dé les rendre dans deux mois, quand même le
créancier voiidroit leiir faire crédit plus long-tems.
On leur faifoit' aufli prêter ferment de ne faire
aucun préfent à ceux qui étoient députés du confeil
pour aller informer de leur adminiftration ; même
de donner rien à leurs femmes, enfans, ou autres
perfonnes fubordonnées. Art. 44.
Il eft défendu par Varticle 48 aux baillis 8c fénéchaux
de recevoir des officiers, qui leur étoient fub-
ordonnes, aucun gîte, repas, droit de procuration;
ni autres dons.
Enfin Ÿarticle 4g leur défend de recevoir aucun
prefent des perfonnes religieufes domiciliées dans
l’étendue de leur adminiftration, non pas même de9
chofes à manger ou à boire : l’ordonnance leur permet
feulement d’en recevoir une fois ou deux l’année
, au plus , 8c lorfqu’ils en feront requis avec
grande inftance, des chevaliers, feigneurs , bourgeois
, 8c autres perfonnes riches 8c confidérables.
L’ancienne formule du ferment que prêtoit le
chancelier de France au ro i, porte qu’il ne recevra
robes, penfions ou profits d’aucun autre feigneur ou
dame* fans la permiflîon du ro i, 8c qu’il ne prendra
aucun don corrompable.
On faifoit prêter le même ferment à tous les officiers
royaux. IL y a à la chambre des comptes une
ordonnance de l ’an 1454, qui défend à tous officiers
de recevoir aucuns dons corrompables, fous peine
de privation de leurs offices.
L’ordonnance d’Orléans, du mois de Janv. 1560/
défend, article 43, à tous juges, avocats 8c procureurs
, tant des cours fouveraines que des fiéges
fubalternes 8c inférieures, de prendre ni permettre
être pris des parties plaidantes, direftement, aucun
don ou préfent, quelque petit qu’il foit, de vivres
ou autres chofes quelconques, à peine de crime de
concuffion ; mais cette ordonnance eft encore imparfaite
, en ce que le même article excepte la venaifon
ou gibier pris ès forêts 8c terres des princes
8c feigneurs qui les donneront.
Cette même ordonnance eft cependant moins indulgente
pour plufieurs autres officiers.
En effet elle défend , art. 7 7 , aux clercs ou corn*
mis des greffiers, d’exiger ni prendre des parties aucune
chofe que le droit des greffiers, non pas même
ce qui leur feroit offert volontairement, à peine
contre le greffier qui le permettra ou diffimulera, de
privation de fon office , 8c à l’égard du clerc qui exi-
geroit ou prendroit quelque chofe , fous peine do
prifon 8c de punition exemplaire.
L'art. y g défend aux fubftituts d’exiger ni prendre
des parties aucune chofe pour la vifitation des
procès criminels, à peine d’être punis comme de
crime de concuffion.
L'article 132. de la même ordonnance défend aux
élus, procureurs du roi ; greffiers, receveurs, 8t
autres officiers des tailles 8c aydes, de prendre ni
exiger des fnjets du roi aucun don, foit en argent,
gibier, volaille, bétail, grain, foin ou autre chofe
quelconque, direâement ou indireôement, à peine
de privation de leurs états ; fans que les juges puif-
fent modérer cette peine.-
L’ordonnance de Moulins n’admet point, comme
celle d’Orléans, d’exception d’aucuns préfens, même
modiques ; elle défend purement 8c Amplement*
article ig, à tous juges de rien prendre des parties,
finon ce qui eft permis par les ordonnances. Vartt
20 fait la même défenfe aux avocats 8c procureurs
du ro i.1 • -
On pourrait encore faire quelqu’équivoque fur
les termes de cette ordonnancé ; mais celle de Blois
y a pourvû, are. 114, en défendant à tous officiers
8c autres ayant charge 8c commiffion du ro i, de
quelqu’état 8c condition qu’ils foient, de prendre ni