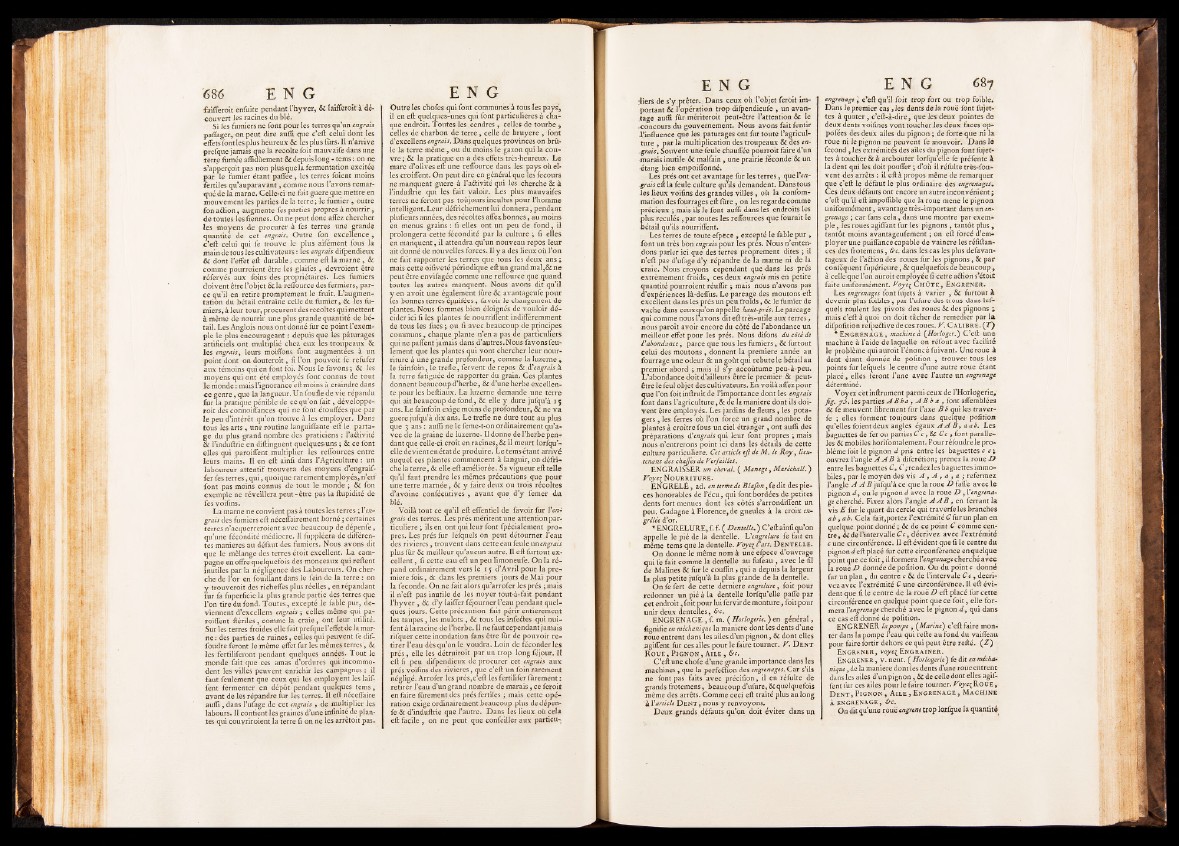
fw
6 8 6 E N G
faifferoit enfuxte pendant l’hyver, & laifferoit à découvert
les racines du blé.
Si les fumiers ne font pour les terres qu’un engrais
paffager, on peut dire aulîi que c’eft celui dont les
•effets fondes plus heureux & les plus fûrs. Il n’arrive
prefque jamais que la récolté foit mauvaife dans une
terre fumée affidûement & depuis long - tems : on ne
s’apperçoit pas non plus que la fermentation excitée
par le fumier étant paffée, les terres foient moins
fertiles qu’auparavant, comme nous l’avons remarqué
de la marne. Celle-ci ne fait guere que mettre en
mouvement les parties de la terre ; le fumier, outre
fon aélion, augmente fes parties propres à nourrir,
de toutes les fiennes. On ne peut donc affez chercher
les moyens de procurer à fes terres une grande
quantité de cet engrais. Outre fon excellence ,
c ’eft celui qui fe trouve le plus aifément fous la
main de tous les cultivateurs : les engrais difpendieux
& dont l’effet eft durable, comme ell la marne , &
comme pourraient être les glaifes , devroient être
réfervés aux foins des propriétaires. Les fumiers
doivent être l’objet & la reffource des fermiers, parce
qu’il en retire promptement le fruit. L’augmentation
du bétail entraîne celle du fumier, & les fumiers,
à leur tour, procurent des récoltés qpi mettent
à même de nourrir une plus grande quantité de bétail.
Les Anglois nous ont donné for ce point l’exemple
le plus encourageant : depuis que les pâturages
artificiels ont multiplié chez eux les troupeaux &
les engraisy leurs moiffons font augmentées à un
point dont on douterait, fi l’on pouvoit fe refufer
aux témoins qui en font foi. Nous le favons ; & les
moyens qui ont été employés font connus de tout
le monde : mais l’ignorance eftmoins à craindre dans
ce genre, que la langueur. Un foufle de vie répandu
fur la pratique pénible de ce qu’on fa it, développerait
des connoiffances qui ne font étouffées que par
le peu d’intérêt qu’on trouve à les employer. Dans
tous les arts, une routine Ianguiffante eft le partage
du plus grand nombre des praticiens : l’aôivité
& l’induftrie en diftinguent quelques-uns ; & ce font
elles qui paroiffent multiplier les reffources entre
leurs mains. Il en eft ainfi dans l’Agriculture : un
laboureur attentif trouvera des moyens d’engraif-
fer fes terres, qui, quoique rarement employés, n’erf
font pas moins connus de tout le monde ; & fon
exemple ne réveillera peut-être pas la ftupidité de
fes voifins.
La marne ne convient pas à toutes les terres ; Vengrais
des fumiers eft néceffairement borné ; certaines
terres n’acquerreroient avec beaucoup de dépenfe,
qu’une fécondité médiocre. Il foppléera de différentes
maniérés au défaut des fumiers. Nous avons dit
que le mélange des terres étoit excellent. La campagne
en offre quelquefois des monceaux qui reftent
inutiles parla négligence des Laboureurs. On cherche
de l’or en fouillant dans le fein de la terre : on
y trouverait des richeffes plus réelles, en répandant
for fa fuperficie la plus grande partie des terres que
l’on tire du fond. Toutes, excepté le fable pur, deviennent
d’excellens engrais ; celles même qui paroiffent
ftériles, comme la craie, ont leur utilité.
Sur les terres froides elle fait prefque l’effet de la marne
: des parties de ruines, celles qui peuvent fe dif-
foudre feront le même effet fur les mêmes terres, &
les fertiliferont pendant quelques années. Tout le
monde fait que ces amas d’ordures qui incommodent
les villes peuvent enrichir les campagnes ; il
faut feulement que ceux qui les employent les laif-
fent fermenter en dépôt pendant quelques tems,
avant de les répandre for les terres. U eft néceffaire
aufli, dans l’ufage de cet engrais , de multiplier les
labours. Il contient les graines d’une infinité de plantes
qui couvriraient la terre fi on ne les arrêtoit pas.
E N G
Outre les chofes qui font communes à toiis lés pays,
il en eft quelques-unes qui font particulières à chaque
endroit. Toutes les .cendres , celles de tourbe ,
celles de charbon de terre, celle de bruyere , font
d’excellens engrais. Dans quelques provinces on brûle
la terre même., ou du moins le gazon qui la couvre;
& la pratique en a des effets très-heureux. Le
marc d’olives eft une reffource dans les pays où elles
croiffent. On peut dire en général que les fecours
ne manquent guere à l’aôivité qui les cherche & à
l’induftrie qui les fait valoir. Les plus mauvaifes
terres ne feront pas toujours incultes pour l’homme
intelligent.Leur défrichement lui donnera, pendant
plufieurs années, des récoltes affez bonnes, au moins
en menus grains : fi elles ont un peu de fond, il
prolongera cette fécondité par la culture ; fi elles
en manquent, il attendra qu’un nouveau repos leur
ait donné de nouvelles forces. Il y a des lieux où l’on
ne fait rapporter les terres que tous les deux ans ;
mais cette ©ifiveté périodique eft un grand mal,& ne
peut être envifagée comme une reffource que quand
toutes les autres manquent. Nous avons dit qu’il
y e n avoit une également fûre & avantageufe pour
les bonnes terres épuifées, favoir le changement de
plantes. Nous fommes bien éloignés de vouloir décider
ici fi les plantes fe nourriffent indifféremment
de tous les focs ; ou fi avec beaucoup de principes
communs, chaque plante n’en a pas de particuliers
qui ne paffent jamais dans d’a*itres.Nous favons feulement
que les plantes qui vont chercher leur nourriture
à une grande profondeur, comme la luzerne ,
le fainfoin, le trefle, fervent de repos & d’'engrais à
la terre fatiguée de rapporter du grain. Ces plantes
donnent beaucoup d’herbe, & d’une herbe excellente
pour les beftiaux. La luzerne demande une terre
qui ait beaucoup de fond, & elle y dure jufqu’à 1 5
ans. Le fainfoin exige moins de profondeur, &c ne v a
guere jufqu’à dix ans. Le trefle ne dure tout au plus
que 3 ans : aufli ne le feme-t-on ordinairement qu’avec
de la graine de luzerne. Il donne de l’herbe pendant
que celle-ci croît en racines, & il meurt lorfqu’-
elle devient en état de produire. Le tems étant arrivé
auquel ces plantes commencent à languir, on défriche
la terre, & elle eft améliorée. Sa vigueur eft telle
qu’il faut prendre les mêmes précautions que pour
une terre marnée, & y faire deux ou trois récoltes
d’avoine confécutives , avant que d y femer du
blé.V
oilà tout ce qu’il eft effentiel de favoir fur Vengrais
des terres. Les prés méritent une attention particulière
; ils en ont qui leur font fpécialement propres.
Les prés for léfquels on peut détourner l’eau
des rivières, trouvent dans cette eau feule un engrais
plus for &c meilleur qu’aucun autre. Il eft furtout excellent
, fi cette eau eft un peu limoneufe. On la répand
ordinairement vers lé 15 d’Avril pour la première
fois, & dans lés premiers jours de Mai pour
la fécondé. On ne fait alors qu’arrofer les prés ;mais
il n’eft pas inutile de les noyer tout-à-fait pendant
l’hy ver , & d’y laiffer féjourner l’eau pendant quelques
jours. Cette précaution fait périr entièrement
les taupes, les mulots , & tous les infeâes qui nui-
fent à la racine de l’herbe. Il ne faut cependant jamais
rifquër cette inondation fans être for de pouvoir retirer
l’eau dès qu’on le voudra. Loin de féconder les
prés , elle les détruirait par un trop long féjour. II
eft fi peu difpendieux de procurer cet engrais aux
prés voifins des rivières, que c’eft un foin rarement
négligé. Arrofer les prés,c’eft les fertilifor forement :
retirer l’eau d’un grand nombre de marais, ce ferait
en faire forement des prés fertiles ; mais cette opération
exige ordinairement beaucoup plus de dépenfe
& d’induftrie que l’autre. Dans les lieux, où cela
eft facile , on ne peut que confeiller aux particu-
E N G
^îers de s’y prêter.. Dans ceux où l’objet ferôit im-
portant & l’opération trop difpendieufe , un avantage
aufli fur mériterait peut-être l’attention & le ,
concours.du gouvernement. Nous avons fait fentir ;
l ’influence que les. pâturages ont fur toute l’agriculture
, par la multiplication des troupeaux & des en-
..grais. Souvent ufie foule chauffée pourrait faire d’un
-marais inutile & malfain, une prairie féconde & un
•étang bien empoiffonné.
Les prés ont cet avantage fur les terrés, tpieVen-
jgrais eft la foule culture qu’ils demandent. Dans tous
les lieux voifins des grandes villes , où la confom-
mation des fourrages eft fore, on les regarde comme
précieux ; mais ils le font aufli dans les endroits les
plus reculés , par toutes les reffources que fournit le
bétail qu’ils nourriffent.
Les terres de toute efpfccc , excepté le fable pur ,
font un très bon engrais pour les près. Nous n’entendons
parler ici que des terres proprement dites ; il
n’eft pas d’ufage d’y répandre de la marne ni de la
craie. Nous croyons cependant que dans les prés
■ extrêmement froids, ces deux engrais mis en petite
quantité pourraient réuflir ; mais nous n’avons pas
d’expériences là-deffus. Le parcage des moutons eft
excellent dans les prés un peu froids, & le fumier de
Vache dans ceux qu’on appelle haut-prés. Le parcage
qui comme nous l’avons dit eft très-utile aux terres,
nous paraît avoir encore du côté de l’abondance un
meilleur effet pour les prés. Nous difons du côté de
Vabondance, parce que tous les fumiers, & furtout
celui des moutons, donnent la première année au
fourrage une odeur & un goût qui rebute le bétail au
premier abord ; mais il s’y accoûtume peu-à-peu.
L ’abondance doit d’ailleurs être le premier & peut-
être le foui objet des cultivateurs. En.voilà affez pour
que l’on foitinftruit de l’importance dont les engrais
font dans l’agriculture, & de la maniéré dont ils doivent
être employés. Les jardins de fleurs, les potagers
, les ferres où l’on force un grand nombre de
plantes à croître fous un ciel étranger , ont aufli des
préparations d'engrais qui leur font propres ; mais
nous n’entrerons point ici dans les détails de cette
culture particulière. Cet article ejl de M. le Roy, lieutenant
des chajfes de Verfailles.
ENGRAISSER un cheval. { Manège, Maréchall.')
Voyeç Nourriture.
ENGRELÉ, ad. en terme de Blafon, fe dit des pièces
honorables de l’écu, qui font bordées de petites
dents fort menues dont les côtés s’arrondiffent un
peu. Gadagne à Florence, de gueules à la croix en-
grêlée d’or.
* ENGRELURE, f. f. ( Dentelle. ) C’eft ainfi qu’on
appelle le pié de la dentelle. ICengrclure fe fait en
même tems que la dentelle. Vye^ l'art. Dentelle.
On donne le même nom à une efpece d’ouvrage
ui fe fait comme la dentelle au fofoau , avec le fil
e Malines & fur le couffin, qui a depuis la largeur
la plus petite jufqu’à la plus grande de la dentelle.
On fe fort de cette derniere engrelure, foit pour
redonner un pié à la dentelle lorfqu’elle paffe par
cet endroit, foit pour lui fervir de monture, foit pour
unir deux dentelles, &c.
ENGRENAGE , f. m. ( Horlogerie. ) en général,
lignifie en méchanique la maniéré dont les dents d’une
roue entrent dans les aîles d’un pignon, & dont elles
agiffent for ces aîles pour le faire tourner. V . Dent-
Roue , Pignon , Aile , &c.
C ’eft une chofe d’une grande importance dans les
machines, que la perfe&ion des engrenages, Car s’ils
ne font pas faits avec précifion, il en réfulte de
grands frotemens, beaucoup d’ufure, & quelquefois
même des arrêts. Comme ceci eft traité plus au long
à l’article D ent, nous y renvoyons.
Deux grands défauts qu’on doit éviter dans un
E N G 687
engrehage \ c’èft qu’il foit trop fort ou trop foible*
Dans le premier cas , les dents de la roue font fojet-
tes à quoter , c’eft-à-dire, que les deux pointes de
deux dents voifines vont toucher les deux faces op*
pofées des deux ailes du pignon ; de forte que ni la
roue ni le pignon ne peuvent fo mouvoir. Dans lé
fécond, les extrémités des aîles du pignon font fojet-
tes à toucher & à arcbôuter lorfqu’elle fo préfonte à
la dent qui les, doit pouffer ; d’où il réfulte très-fou-
vent des arrêts : il eft à propos même de remarquer
que c’eft le défaut le plus ordinaire des engrenages.
Ces deux défauts ont encore un autre inconvénient;
c ’eft qu’il eft impoffible que la roue mene le pignon
uniformément, avantage très-important dahs un engrenage
; car fans cela, dans une montre par exemple
, les roues agiffant for les pignons , tantôt plus ,
tantôt moins avantageufement ; on eft forcé d’employer
une puiffance capable de vaincre les réfiftan-
ces des frotéirtens, &c. dans les cas les plus defavan-
tageux de l’a&ion des roues fur les pignons, & par
conféquent fupérieure, & quelquefois de beaucoup ,
à celle que l’on aurait employée fi cette aftion s’étoic
faite uniformément. Poye^ Chute, Engrener.
Les engrenages font fujéts à varier , & furtout à
devenir plus foibles, par l’ufure des trous dans léfquels
roulent les pivots des roues ôt des pignons ;
mais c’eft à quoi on doit tâcher de remedier par la
difpofition refpe&ivede ces roues. V. Calibre. (T)
* Engrenage, machine à {Horloger.') C’eft une
machine à l’aide de laquelle on réfout avec facilité
le problème qui aurait l’énoncé foivant. Une roue à
dent étant donnée de pofition , trouver tous les
points for lelquels le centre d’une autre roue étant
placé, elles feront l’une avec l’autre un engrenage
déterminé.
Voyez cètinftrument parmi ceux de l’Horlogerie,'
fig. y5, les parties A B b a , A B b a , font affemblées
& fo meuvent librement fur l’axe B b qui les traver-
fo ; elles forment toujours dans quelque pofition
qu’elles foient deux angles égaux A A B , a a b. Les
baguettes de fer ou parties C c , & Gc * font parallèles
& mobiles horifontalement. Pour réfoudre le problème
foit lè pignon d pris entre les baguettes c c ;
ouvrez l’angle A A B k discrétion; prenez la roue D
entre les baguettes C, C; rendez les baguettes immobiles,
parle moyen des vis A , A , a t a ; refermez
l’angle A A B jufqu’à ce que la roue D faffe avec le
pignon dy ou le pignon d avec la roue D , f engrenage
cherché. Fixez alors l’angle A A B , en ferrant la
vis E fur le quart du cercle qui traverfo les branches
a b , a b>, Cela fait,portez l’extrémité G fur un plan en
quelque point donné ; & de ce point C comme centre,
& de l’intervalle Ce , décrivez avec l’extrémité
c une circonférence. Il eft évident que fi le centre du
pignon d eft placé for cette circonférence en quelque
point que ce foit, il formera f engrenage chercné avec
la roué D donnée de pofition. Ou du point c donné
fur un plan , du centre c & de Pintervale C c , décrivez
avec l’extrémité C une circonfére'nce. Il eft évident
que fi le centre de la roue D eft placé fur cette
circonférence en quelque point que ce foit, elle formera
l’engrenage cherché avec, le pignon d y qui dans
ce cas eft donné de pofition.
ENGRENER la pompe , (Marine) c’eft faire monter
dans la pompe l’eau qui refte au fond du vaiffeau
pour faire fortir dehors ce qui peut être refté. (Z ) Engrener, voye^Engrainer.
Engrener, v. neut. {Horlogerie) fo àiit en méchanique
y de la maniéré dont les dents d’une roue entrent
dans les ailes d’un pignon, & de celle dont elles agit-
font fur ces ailes pour le faire tourner. Vyre^Roue,
Dent, Pignon , Ail e , Engrenage, Machine
À engrenage, & c.
On dit qu’une roue engrene trop lorfque la quantité