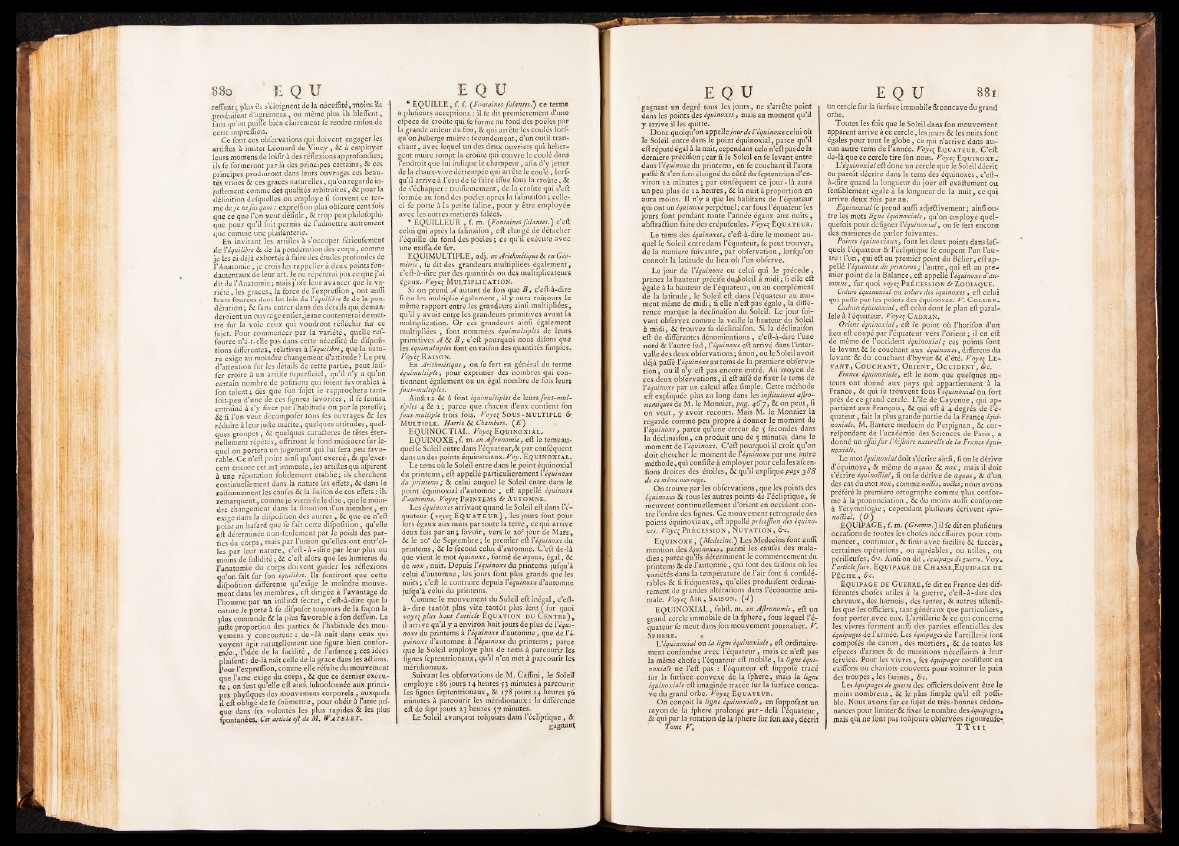
$ s & E Q U
jreffent^ plus-iE ^’éloignent de-la néceffité., -moins ils •
prôduifent d’agrémcns., ou même plus ils bleflênt,
fans qu’on puiüe bien clairement fe rendre-raifon de
cette impreflion. ^
Ce font ces obfervations qui doivent engager les
artiftes à imiter Léonard de Vinqy, & à employer
leurs momens de loifir^à des-réflexions approfondies;
ils fe formeront par-là des .principes certains, & ces
principes produiront dans leurs ouvrages ces beautés
vraies & ces grâces naturelles-, qu’on regarde in-
juftemcnt comme des qualités arbitraires, & pour la
définition defquelles on employé fl fou vent ce terme
de je ne J'ai quoi: expreffion plus obfcure cent fois
que ce que l’on veut définir, ôc trop peu philofophi-
que pour qu’il foit permis de Fad mettre autrement
que comme une plaifanterie.
En invitant les artiftes à s’occuper férieufement
de l'équilibre 8c de la pondération des corps , comme
les-ai déjà exhortés à faire des études profondes de
l’Anatomie , je crois les rappeller à deux points fondamentaux
de leur art. Je ne répéterai pas ce que j’ai
dit de l’Anatomie ; mais j’ofe leur avancer que la va*
riété, les grâces, la force de l’expreflion , ont aufli
leurs fources dans les lois de l'équilibre ôc de la pondération
; ôc fans entrer dans des détails qui deman-
deroient un ouvrage entier,je me contenterai de mettre
fur la voie ceux qui voudront réfléchir fur ce
fnjet. Pour commencer par la variété, quelle ref-
fource n’a-t-elle pas dans cette néceffité de difpofi-
tions différentes, relatives à Véquilibre, que la nature
exige au moindre changement d’attitude ? Le peu
d’attention fur les détails de cette partie, peut laif-
fer croire à un artifte fuperficiel, qu’il n’y a qu’un
certain nombre de pofitions qui foient favorables à
fon talent ; dès que fon fujet le rapprochera tant-
foit-peu d’une de ces figures favorites, il fe fentira
entraîné à s’y fixer par l’habitude ou par la pareffe ;
& fl l’on veut décomvpofer tous fes ouvrages ôc les
réduire à leur jufte mérite, quelques attitudes, quelques
groupes , ôc quelques caraûeres de têtes éternellement
répétés, offriront le fond médiocre fur lequel
on portera un jugement qui lui fera peu favorable.
Ce n’eft point ainfi qu’ont exercé, & qu’exercent
encore cet art immenl’e,, les artiftes qui afpirent
à une réputation folidement établie; ils cherchent
continuellement dans la nature les effets, ôc dans le
raifonnement les caufes Ôc la liaifon de ces effets : ils
remarquent, comme je viens de le dir-e, que le moindre
changement dans la fituation d’un membre, en
exige dans la difpofition des autres , & que ce n’eft
point au ha fard que fe fait cette difpofition, qu’elle
eft déterminée non-feulement par le poids des parties
du corps, mais par l’union qu’elles ont entr’el-
les par leur nature, c’eft-à-dire par leur plus ou
moins de folidité ; ôc c’eft alors que les lumières de
l ’anatomie du corps doivent guider les réflexions
qu’on fait fur fon équilibre. Ils fentiront que cette
difpofition différente qu’exige le moindre mouvement
dans les membres, eft dirigée à l’avantage de
Fhomme par un inftinû fecret, c’eft-à-dire que la
nature le porte à fe difpofer toujours de la façon la
plus commode ôc la plus favorable à fon deflein. La
j^ufte proportion des parties ôc l’habitude des mou-
vemens y concourent : de- là naît dans ceux qui
yoyent agir naturellement une figure bien conformée
, l’idée de la facilité , de l’aifancç ; ces idées
plaifent : de-là naît celle de la grâce dans les aâions.
Pour-l’expreflion, comme elle réfulte du mouvement
que Famé exige du corps, & que ce dernier exécute
• on fent qu’elle eft ainfi fubordonnée aux principes*
phyfiques des mouvemens corporels , auxquels
i f eft obligé de fe foûmettre, pour obéir à Famé juf-
que’ dans fes volontés les plus rapides & les plus
fpontanées. Cet article ejlde M. Wâtelet.
E Q U
* EQUILLE, f. f. (Fontaines Jalon tes.") ce ferma
a plufieurs acceptions : il fe dit premièrement d’une
efpece de croûte qui fe forme au fond des poêles par
la.grande ardeur du feu, 8c qui arrête les coulés lorfi
.qu’on heberge muire : fecondement, d’un outil tranchant
, avec lequel un des deux ouvriers qui hébergent
muire rompt la croûte qui couvre le coulé dans
Fendroit que lui indique le champeur, afin d’y jetter
de la chaux-vive détrempée qui arrête le coulé, lorfi-
qu’il arrive à l’eau de fe faire iffiie fous la croûte, &
de s’échapper : troifiemement, de la croûte qui sfeft
formée au fond des poêles après la falinaifon ; celle-
ci fe porte à 4a petite faline, pour y être employée
avec les autres matières falées.
* EQUILLEUR , f. m. (Fontaines filantes, j c’eft
celui qui après la falinaifon, eft chargé de détacher
l’équille du fond des poêles ; ce qu’il exécute avec
une mafïede fer.
EQÜIMULTIPLE , adj. en Arithmétique 8c en Géométrie
y fe dit des grandeurs multipliées également,
c’eft-à-dire par des quantités ou des multiplicateurs
égaux. Voye\ Mu lt ip l ic a t io n .
Si on prend A autant de fois que B , c’eft-à-dire
fi on les multiplie également, il y aura toûjours le
même rapport entre les grandeurs ainfi multipliées ,
qu’il y avoit entjre les grandeurs primitives avant la
multiplication. Or ces grandeurs ainfi également
multipliées , font nommées équimultiples de leurs
primitives A 8c B ; c’eft pourquoi nous difons que
les équimultiples font en raifon des quantités Amples.,
Voye^ Raison.
En Arithmétique , on fe fert en général du terme
iquimultiple, pour exprimer des nombres qui contiennent
également ou un égal nombre de fois leurs
fous-multiples.
Ainfi i z & 6 font équimultiples de leurs fous-multiples
4 & i ; parce que chacun d’eux contient fon
fous-multiple trois fois. Voye^ Sous-MULTIPLE &.
Multiple. Harris 8c Chambers. (E~)
EQUINOCT1AL. Voye[ Eq uin oxial.
EQUINOXE, f. m. en AJlronomie, eft le tems auquel
le Soleil entre dans l’équateur,& par conféquent
dans un des points équinoxiaux. Voy. Equin oxial.
Le tems où le Soleil entre dans le point équinoxial
du printems, eft appellé particulièrement Y équinoxe
du printems ; 8c celui auquel le Soleil entre dans le
point équinoxial d’automne , eft appellé équinoxe
£ automne. Voye{ PRINTEMS & AUTOMNE.
Les équinoxes arrivant quand le Soleil eft dans I’c-
quateur (voye^ É q u a t e u r ) , les jours font pour
lors égaux aux nuits par toute la terre, ce qui arrive
deux fois par an; favoir, vers le 20e jour de Mars,
ôc le 20e de Septembre ; le premier eft Yéquinoxe du
printems, ôc le fécond celui d’automne. C ’eft de-là
que vient le mot équinoxe, formé de oequus, égal, 6c
de nox, nuit. Depuis Yéquinoxe du printems jufqu’à
celui d’automne, les jours font plus grands que les
nuits ; c’eft le contraire depuis Y équinoxe d’automne
jufqu’à celui du printems.
Comme le mouvement du Soleil eft inégal, c’eft-
à-dire tantôt plus vîte tantôt plus lent ( fur quoi
voye^plus haut Varticle ÉQUATION DU C entre) ,
il arrive qu’il y a environ huit jours de plus de Y équinoxe
du printems à Yéquinoxe d’automne, que de Yi-
quinoxe d’automne à Yéquinoxe du printems ; parce
que le Soleil employé plus de tems à parcourir les
lignes feptentrionaux, qu’il n’en met à parcourir les
{ méridionaux.
Suivant les obfervations de’M. Caflini, le Soleil
employé 186 jours 14 heures 53 minutes à parcourir
les lignes feptentrionaux, & 178 jours 14 heures
minutes à parcourir les méridionaux : la différence
eft de fept jours 23 heures 57 minutes.
Le Soleil avançant toujQurs dans l’écliptique, 8c
gagnant
E Q U
gagnant un degré tous les jours, ne s’arrête point
dans les points des équinoxes , mais au moment qu’il
y arrive il les quitte.
Donc quoiqu’on appelle jour de l'équinoxe celui où
le Soleil entre dans le point équinoxial, parce qu’il
eft réputé égal à la nuit, cependant cela n’eft; pas de la
derniere précifion ; car fi le Soleil en fe levant entre
dans Yéquinoxe du printems, en fe couchant il l’aura
paffé & s’en fera éloigné du côté du feptentrion d’environ
12 minutes ; par conféquent ce jour-là aura
un peu plus de 12 heures, Ôc la nuit à proportion en
aura moins. Il n’y a que les habitans de l’équateur
qui ont un équinoxe perpétuel; car fous l’équateur les
jours font pendant toute l’année égaux aux nuits,
abftraâion faite des crépufcules. Voye^ Équateur.
Le tems des équinoxes, c’eft-à-dire le moment auquel
le Soleil entre dans l’équateur, fe peut trouver,
de la maniéré fuivante, par obfervation, lorfqu’on
connoît la latitude du lieu où l’on obferve.
Le jour de Yéquinoxe ou celui qui le précédé,
prenez la hauteur précife duj^oleil à midi ; fi elle eft
égale à la hauteur de l’équateur, ou au complément
de la latitude, le Soleil eft dans l’équateur au moment
même de midi ; fi elle n’eft pas égale, la différence
marque la déclinaifon du Soleil. Le jour fui-
vant obferyez comme la veille la hauteur du Soleil
à midi, ôc trouvez fa déclinaifon. Si la déclinaifon
eft de différentes dénominations , c’eft-à-dire l’une
nord 6t l’autre fud, Yéquinoxe eft arrivé dans l’intervalle
des deux obfervations ; linon, ou le Soleil avoit
déjà paffé Yéquinoxe ait tems de la première obfervation
, ou il n’y eft pas encore entré. Au moyen de
ces deux obfervations, il eft aifé de fixer le tems de
Yéquinoxe par un calcul allez limple. Cette méthode
eft expliquée plus au long dans les injlitutions agronomiques
de M. le Monnier, pag. 4S7 , ôc on peut, fi
on v eu t , y avoir recours. Mais M. le Monnier la
regarde comme peu propre à donner le moment de
Yéquinoxe , parce qu’une erreur de 5 fécondés dans
la déclinaifon, en produit une de 5 minutes dans le
moment de Yéquinoxe. C ’eft pourquoi il croit qu’on
doit chercher le moment de Yéquinoxe par une autre
méthode, qui confifte à employer pour cela les afeen-
fions droites des étoiles, ôc qu’il explique page 3 88
de ce même ouvrage.
On trouve par les obfervations, que les points des
équinoxes 8c tous les autres points de l’écliptique, fe
meuvent continuellement d’orient en occident contre
l’ordre des lignes. Ce mouvement rétrogradé des
points équinoxiaux, eft appellé précejjion des équinoxes.
Voye^Précession, Nutation, & c.
Equinoxe, (Médecine.) Les Médecins font auflî
mention des équinoxes, parmi les caufes des maladies
; parce qu’ils déterminent le commencement du
printems & de l’automne, qui font des faifons où les
variétés -dans la température de l’air font fi confidé-
rables ôc fi fréquentes, qu’elles prôduifent ordinairement
de grandes altérations dans l’économie animale.
Voye^ Air , Saison. (d)
EQUINOXIAL, fubft. m. en AJlronomie, eft un
grand cercle immobile de la fphere, fous lequel l’équateur
fe meut dans.fon mouvement journalier. V. Sphere. *
L’équinoxial ou la ligne équinoxiale , eft ordinairement
confondue avec l’équateur, mais ce n’eft pas
la même chofe ; l’équateur eft mobile, la ligne équinoxiale
ne l’eft pas : l’équateur eft fuppofé tracé
fur la furface convexe .de la fphere, mais la ligne
équinoxiale eft imaginée tracée fur la furface concave
du grand orbe. Voyc{ Équateur.
On conçoit la ligne équinoxiale, en fuppofant un
rayon de la fphere prolongé par - delà l’équateur,
& qui par la rotation de la fphere fur fon axe, décrit
Tome V,
E Q U 881;
un cercle fur la furface immobile & concave du grand
orbe.
Toutes les fois que le Soleil dans fon mouvement
apparent arrive à ce cercle, les jours & les nuits font
égales pour tout le globe, ce qui n’arrive dans aucun
autre tems de l’année. Voye^ Équateur. C ’efi
de-là que ce cercle tire fon nom. Voye{ Équinoxe-'
Uéquinoxial eft donc un cercle que le Soleil décrit
ou paroît décrire dans le tems dés équinoxes, c’eft-
à-dire quand la longueur du jour eft exattement ou
fenfiblement égale à la longueur de la nuit, ce qui
arrive deux fois par an.
Equinoxial fe prend aufli adjé&i ventent ; ainfi ou*
tre les mots ligne équinoxiale, qu’oii employé quelquefois
pour défigner Y équinoxial, on fe fert encore
des maniérés de parler fuivantes.
Points équinoxiaux, font les deux points dans lesquels
l’équateur 8c l’écliptique fe coupent l’un l’autre
: l’un, qui eft au premier point du Bélier, eft appellé
Yéquinoxe du printems ; l ’autre, qui eft au premier
point de la Balance, eft appellé Yéquinoxe d'aic-.
tomne, fur quoi voye%_ Pré cession & Zodiaque. .
Colure équinoxial ou colure des équinoxes , eft celui
qui paffé parles points des équinoxes. V. Colure.
Cadran équinoxial, eft celui dont le plan eft parallèle
à l'équateur. Voye^ Cadran.
Orient équinoxial, eft le point où l’horifon d’un
lieu eft coupé par l’équateur vers l’orient ; il en eft
de même de l’occident équinoxial ; ces points font
le levant ôc le couchant aux équinoxes, differens du
levant ôc du couchant d’hyver 6c d’été. Voye{ Levant,
Couchant, Orient, Occident, & c.
France équinoxiale, eft le nom que quelques auteurs
ont donné aux pays qui appartiennent à la
France, 8c qui fe trouvent foiis Y équinoxial ou fort
près de ce grand cercle. L’île de Cayenne, qui appartient
aux François, 6c qui eft à 4 degrés de l’équateur
, fait la plus grande partie de la France équinoxiale.
M. Barrere médecin de Perpignan, 6c cor-
refpondant de l’académie des Sciences de Paris, a
donné un ejfai fur F hifoire naturelle de la France équinoxiale.
Le mot équinoxial doit s’écrire ainfi, fi on le dérive
d’équinoxe, & même de oequus 6c nox; mais il doit
s’écrire équinoclial, fi on le dérive de oequus, 8c d’un
des cas du mot nox, comme noctis, nocles; nous avons
préféré la première ortographe comme plus conforme
à la prononciation , 6c du moins aufli conforme
à l’étymologie ; cependant plufieurs écrivent équinoclial.
(O )
ÉQUIPAGE, f. m. (Gramm.) U fe dit en plufieurs
occafions de toutes les chofes néceflaires pour commencer,
continuer, & finir avec facilité 6c fuccès,
certaines opérations, ou agréables, ou utiles, ou
périlleufes, &c. Ainfi on dit, équipage de guerre. V o y.
l'articlefuiv. E q u i p a g e DE CH ASSE,EQ UIPAGE DE
P Ê CH E , &C.
Équipage de Guerre, fe dit en France des différentes
chofes utiles à la guerre, c’eft-à-dire des
chevaux, des harnois, des tentes, & autres uftenfi-
les que les officiers, tant généraux que particuliers ,
font porter avec eux. L’artillerie 8c ce qui concerne
les vivres forment aufli des parties effentielles des
équipages de l’armée. Les équipages de l’artillerie font
composés du canon, des mortiers, ôc de toutes les
efpeces d’armes & de munitions néceflaires à leur
fervice. Pour les vivres, fes équipages confiftent en
caillons ou chariots couverts pour voiturer le pain
des troupes, les farines , &c.
Les équipages de guerre des officiers doivent être le
moins nombreux, 6c le plus fimple qu’il eft pofli-
ble. Nous avons fur ce fujet de très-bonnes ordonnances
pour limiter 6c fixer le nombre des .équipages,
mais qui ne font pas toûjours obfervées rigoureufer
T T t t t