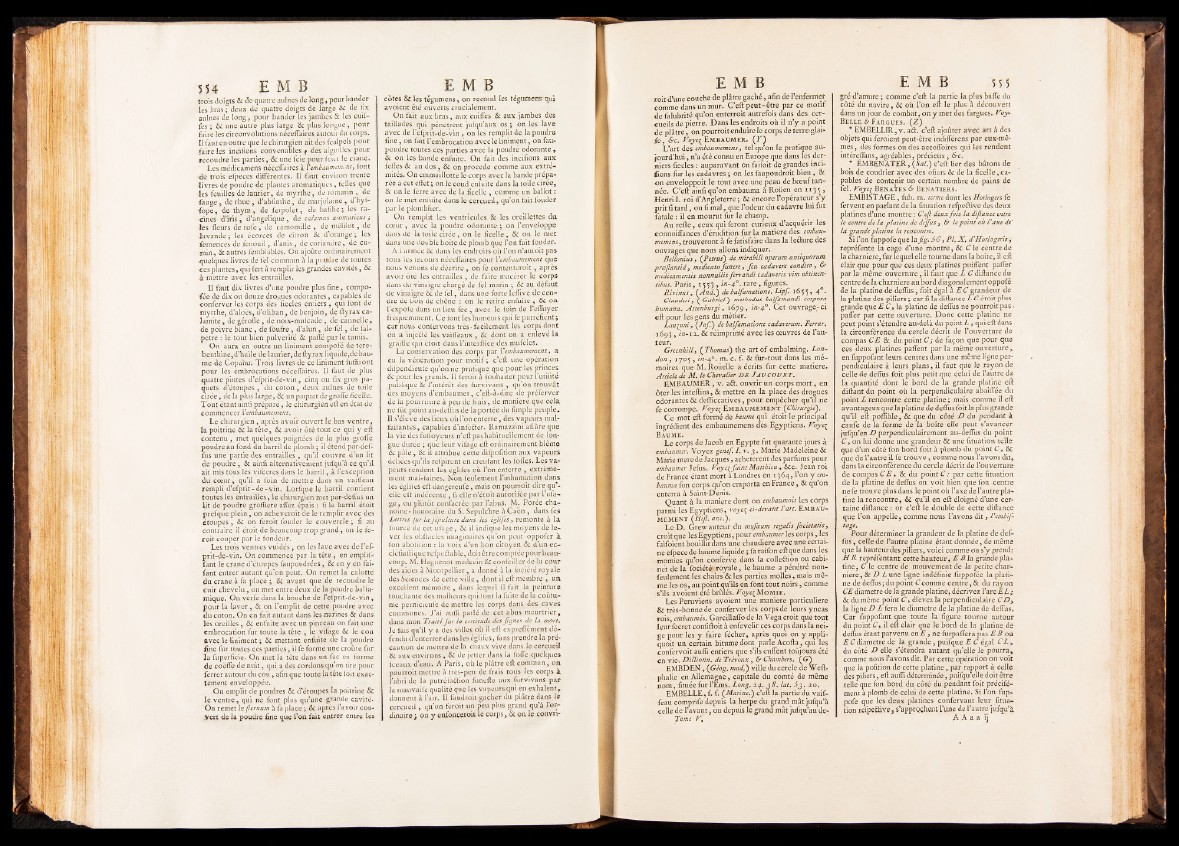
trois doigts & dequatreaulnes de long, pour bander
les bras ; deux de quatre doigts de large 8c de fix
aulnes de long, pour bander les jambes & les c-uil-
fes ; 8c une autre plus large ôc plus longue, pour
faire les circonvolutions néceffaires autour du corps. ,
Il faut en outre que le chirurgien ait des fcalpels pour
faire les incifions convenables y des aiguilles pour
recoudre les parties, 8c une fciepoiîr fcicr le crâne.
Les médicamens néceffaires à Vembaumement, lont
<de trois elpeces différentes. Il faut environ trente
livres de poudre -de plantes aromatiques, telles que
■ les feuilles de laurier, de myrthe, de romarin , de
fauge, de rhue , d’abfinthe , de marjolaine, d’hyl-
fope-, de thym, de ferpolet, de bafilic ; les racines
d’iris , d’angelique , de calamus aromaticus ;
les fleurs de rofe, de camomille , de mélilot, de
lavande ; les écorces de citron 8c d’orange ; les
femences de fenouil, d’anis , de coriandre, de cu-
-min, & autres femblables. On ajoûte ordinairement
■ quelques livres de fel commun à la poudre de toutes
•ces plantes, qui lert à remplir les grandes cavités, 8c
à mettre avec les entrailles.
Il faut dix livres d’une poudre plus fine, composée
de dix ou douze drogues odorantes, capables de
conferver les corps des fiecles entiers, qui font de
myrrhe, d’aloës, d’oliban, de benjoin, de ftyrax calamite
, de gérofle, de noix-mufcade , de cannelle ,
■ de poivre blanc , de foufre, d’alun, de fe l, de fal-
petre : le tout bien pulverifé & paffé par le tamis.
On aura en outre un Uniment compofé de tere-
benthine, d’huile de laurier, de ftyrax liquide,de baume
de Copahu; Trois livres de ce Uniment fufliront
pour les embrocations néceffaires. Il faut de plus
quatre pintes d’efprit-de-vin, cinq ou fix gros paquets
d’étoupes , du coton, deux aulnes de toile
cirée, de la plus large, 8c un paquet de groffe ficelle.
Tout étant ainfi préparé, le chirurgien eft en état de
commencer, Y embaumement.
Le chirurgien, après avoir ouvert le bas-ventre,
la poitrine 8c la tête, 8c avoir ôté tout ce qui y eft
contenu, met quelques poignées de la plus groffe
poudre au fond du barril de plomb ; il étend par-def-
iiis une partie des entrailles , qu’il couvre d’un lit
de poudre , & ainfi alternativement jufqu’à ce qu’il
ait mis tous les, vifceres dans le barril, à l’exception
du coeur, qu’il a foin de mettre dans un vaiffeau
rempli d’efprit-de-vin. Lorfque le barril contient
toutes les èntrailles, le chirurgien met par-deflus un
lit de poudre grofliere affez épais : fi le barril étoit
prefque plein, on acheveroit de le remplir avec des
étoupes, 8c on feroit fouder le couvercle ; fi au
contraire il étoit de beaucoup trop grand, on le feroit
couper par le fondeur.
Les trois ventres vuidés, on les lave avec de I’ef-
prit-de-vin. On commence par la tête, en emplif-
fant le crâne d’étoupes faupoudrées, & en y en fai-
fant entrer autant qu’on peut. On remet la calotte
du crâne à fa place ; ôc avant que de recoudre le
cuir chevelu, on met entre deux de la poudre ball'a-
mique. On verfe dans la bouche de l’elprit-de-vin,
pour la laver, & on l’emplit de cette poudre avec
du coton. On en fait autant dans les narines & dans
les oreilles, 6c enfuite avec un pinceau on fait une
embrocation fur toute la tête , le vifage ôc le cou
avec le Uniment ; ôc mettant enfuite de la poudre
fine fur toutes ces parties, il fe forme une croûte fur
la fuperficie. On met la tête dans un fac en forme
de coëffe de nuit, qui a des cordons qu’on tire pour
ferrer autour du cou, afin que toute la tête l’oit exactement
enveloppée.
On emplit de poudres 8c d’étoupes la poitrine 8c
le ventre, qui ne font plus qu’une grande cavité.
On remet le jlernum à fa place ; 8>C après l’avoir couvert
de la poudre fine que l’on fait entrer entre les
côtes 8c les tégumens, on recoud les tégumens’qui
avoient été ouverts crucialement.
On fait aux bras, aux cuiffes & aux jambes des
taillades qui pénètrent jufqu’aux os ; on les lave
avec de l’elprit-de-vin, on les remplit de la poudre
fine, on fait l’embrocation avec le Uniment, on fau-
poudre toutes ces parties avec la poudré odorante,
& on les bande enfuite. On fait des incifions aux
feffes & au dos, 8c on procédé comme aux extrémités.
On emmaillotte le corps avec la bande préparée
à cet effet ; on le coud enfuite dans la toile cirée,
& on le ferre avec de la ficelle , comme un ballot :
on le met enfuite dans le cercueil, qu’on fait fouder
par le piomblier.
On remplit les ventricules & les oreillettes du
coeur , avec la poudre odorante ; on l’enveloppe
dans de la toile cirée, on le ficelle, 8c on le met
dans une double boîte de plomb que l’on fait fouder.
A l’armée 8c dans les endroits oii l’on n’auroit pas
tous les iecours néceffaires pour l’embaumement que
nous venons de décrire , on fe contenteroit, après
avoir ôté les entrailles , de faire macérer le corps
dans du vinaigre chargé de fel marin ; 8c au défaut
de vinaigre Ôc de fel, dans une forte leflive de cendre
de bois de chêne : on le retire enfuite , ôc on
l’expole dans un lieu lè c , avec le foin de l’effuyer
fréquemment. Ce font les humeurs qui fe putréfient ;
car nous coniervons très - facilement les corps dont
on a injeélé les vaiffeaux, Ôc dont on a enlevé la
graille qui étoit dans l’interftice des mufcles.
La conlervation des corps par l’embaumement, a
eu la vénération pour motif ; c’eft une opération
dilpendieule qu’on ne pratique que pour les princes
ÔC pour les grands. Il feroit à fouhaiter pour futilité
publique & l’intérêt des furvivans , qu’on trouvât
des moyens d’embaumer, c’eft-à-dire de préferver
de la pourriture à peu de frais, de maniéré que cela
ne fût point au-de fins de la portée du fimple peuple*
Il s’élève des lieux où l’on enterre, des vapeurs mal-
failantes, capables d’infe&er. Ramazzini affûre que
la vie des fofloyeurs n’eft pas habituellement de longue
durée ; que leur vilage eft ordinairement blême
Ôc pâle, ôc il attribue cette difpofition aux vapeurs
déliées qu’ils relpirent en creulant les foffes. Les vapeurs
rendent les églifes où l’on enterre , extrêmement
mal-laines. N on feulement l’inhumation dans
les égliles eft dangereufe, mais on pourroit dire qu’elle
eft indécente, fi elle n’étoit autorifée par l’ufa-
g e , ou plùtôt confacrée par l’abus. M. Porée chanoine
honoraire du S. Sepulchre à Caën , dans fes
Lettres fur la jép u ltu re dans les églifes, remonte à la
lource de cet ulâge, ôc il indique les moyens de lever
les obllacles imaginaires qu’on peut oppofer à
ion abolition : la voix d’un bon citoyen. ÔC d’un eç-
cléfiaftique refpeûable, doit être comptée pour beaucoup.
M. Haguenot médecin ôc confeiller de la cour
des aides à Montpellier, a donné à la fociété royale
des Sciences de cette v ille, dont il eft membre , un
excellent mémoire , dans lequel il fait la peinture
touchante des malheurs qui font la fuite de la coûtu-
me pernicieufe de mettre les corps dans des caves
communes. J’ai aufli parlé de cet abus meurtrier,
dans mon Traité Ju r la certitude des fignes de la mort.
Je lais qu’il y a des villes où il eft expreffément défendu
d’enterrer dans les églifes, fans prendre la précaution
de mettre de la chaux vive dans le cercueil
ôc aux environs, ôc de jetter dans la foffe quelques
fceaux d’eau. A Paris, où le plâtre eft commun, on
ppurroit mettre à très-peu de frais tous les corps à
l’abri de la putréfaction funefte aux furvivans pa,r
la mauvaife qualité que les vapeurs qui en exhalent,
donnent à Pair. Il faudroit gâcher du plâtre dans le
cercueil , qu’on feroit un peu plus grand qu’à l’ordinaire
i on y enfoncerait le corps, & on le couvriroit
d’une couche de plâtre gâché, afin de l’enfermer comme dans un mur. C ’eft peut-être par ce motif
de falubrité qu’on enterroit autrefois dans des cercueils
de pierre. Dans les endroits où il n’y a point
de plâtre, on pourroit enduire le corps de terre-glai-
fe , &c. Voye[ Embaumer. (T )
L’art des embaumemens, tel qu’on le pratique aujourd’hui
, n’a été connu en Europe que dans les derniers
fiecles : auparavant on faifoit de grandes inci-
iions fur les cadavres ; on les faupoudroit bien, &
on enveloppoit le tout avec une peau de boeuf tannée.
C ’eft ainfi qu’on embauma à Roiien en 1 1 3 5 »
Henri I. roi d’Angleterre ; ôc encore l’opérateur s’y
prit fi tard, ou fi mal, que l’odeur du cadavre lui fut
fatale : il en mourut fur le champ.
Au refte, ceux qui feront curieux d’acquérir les
connoiffances d’érudition fur la matière des embaumemens
y trouveront à fe fatisfaire dans la leCture des
ouvrages que nous allons indiquer.
Bellonius , (Petrus) de mirabili operum antiquorum
praflantiâ, medicato funere , feu cadavere condito, &
rnedicamentis nonnullis fervandi cadaveris vim obtinen-
tibus. Paris, 1553, in-40. rare, figures.
Rivinus, (And.} de balfamatïone. Lipf. 1655, 4°-
Clauderi, ( Gabriel } methodus balfamandi corpora
humana. Attenburgi y 1679, in-40. Cet ouvrage-ci
eft pour les gens du métier.
Lauzoniy (J<f.} de balfamatïone cadaverum. Ferrar.
1693, in-î x. ôc réimprimé avec les oeuvres de l’auteur.
Greenhill, ( Thomas) the art of embalming. London
y 1705 , in-40. m. c. f. & fur-tout dans les mémoires
que M. Roiielle a écrits fur cette matière.
Article de M. le Chevalier D E J A V C O U R T .
EMBAUMER, v. a£t. ouvrir un corps m ort, en
ôter les inteftins, & mettre en la place des drogues
odorantes ôc defliccatives, pour empêcher qu’il ne
fe corrompe. Hoye^ Embaumement (Chirurgie}.
Ce mot eft formé de baume qui étoit le principal
ingrédient des embaumemens des Egyptiens. V?yeç
Baume.
Le corps de Jacob en Egypte fut quarante jours à
embaumer. Voyez genef. I. v. 3 . Marie Madeleine &
Marie mere de Jacques, achetèrent des parfums pour
embaumer Jefus. Hoye^faint Matthieu, 8cc. Jean roi
de France étant mort à Londres en 1364» l’on y eJn~
bauma fon corps qu’on emporta en France, & qu’on
enterra à Saint-Denis.
Quant à la maniéré dont on embaumoit les corps
parmi les Egyptiens, voye^ ci-devant l'art. Embaumement
(Hijl. anc.}.
Le D. Grew auteur du mufoeum regalis focietatis,
croit que les Egyptiens, pour embaumer les corps, les
faifoient bouillir dans une chaudière avec une certaine
efpece de baume liquide ; fa raifon eft que dans les
momies qu’on conferve dans la collection ou cabinet
de la fociétéproyale, le baume a pénétré non-
feulement les chairs ôc les parties molles, mais mê-
. me les o s, au point qu’ils en font tout noirs, comme
s’ils avoient été brûlés. Voye^ Momie.
Les Péruviens avoient une maniéré particulière
& très-bonne de conferver les corps de leurs yncas
rois, embaumés. Garcillaffo de la Vega croit que tout
leur fecret confiftoit à enfevelir ces corps dans la neige
pour les y faire fécher, après quoi on y appli-
quoit un certain bitume dont parle Acofta , qui les
confervoit aufli entiers que s’ils euffent toûjours été
en vie. Diclionn. de Trévoux, & Chambers. (G)
EMBDEN, (Gèog. mod.) ville du cercle de SVeft-
phalie en Allemagne, capitale du comté de même
nom, fituée fur l’Ems. Long. 24. 38. lat. 53 . 20.
EMBELLE, f. f. (Marine.} c’eft la partie du vaiffeau
comprife depuis la herpe du grand mât jufqu’à
celle de l’avant, ou depuis le grand mât jufqu’au de-
Tome K%
gré d’amure ; comme c’eft la partie la plus baffe du
côté du navire, ôc où l’on eft le plus à découvert
dans un jour de combat, on y met des fargues. Voy*- Belle & Fargues. (Z)
* EMBELLIR, y. aft. c^eft ajoûter avec art à des
objets qui feroient peut-être indifférens par eux-mêmes
, des formes ou des acceffoires qui les rendent
intéreffans, agréables, précieux * &c.
* ÉMBENATER, (Sal.} c’eft lier des bâtons de
bois de coudrier avec des ofiers ôc de la ficelle, capables
de contenir un certain nombre de pains de
fel. Pôyq; Benates 6-Benatiers;
EMBISTAGE, fub. m. terme dont les Horlogers fe
fervent en parlant de la fituation refpeftive des deux
platines d’une montre : C'eft deux fois la dijlance entre
le centre de la platine de dejfus , & Le point où. l'axe de‘
la grande platine la rencontre.
Si l’on fuppofe que la fig. 6 6 y Pl. X . d'Horlogeriei
repréfente la cage d’une montre, ôc C le centre de
la charnière, fur lequel elle tourne dans la boîte, il eft
clair que pour que ces deux platines puiffent paflei:
par la même ouverture, il faut que L C diftance du
centre de la charnière au bord diagonalement oppofé
de la platine de deffus, foit égal à E C grandeur de
la platine des piliers ; car fi la diftance L C étoit plus
grande que E C, la platine de deffus ne pourroit pas •
paffer par cette ouverture. Donc cette platine ne
peut point s’étendre au-delà du point L , qui eft dans
la circonférence du cercle décrit de l’ouverture de
compas C E 8c du point C ; de façon que pour que
ces deux platines paffent par la même ouverture,
en fuppofant leitrs centres dans une même ligne perpendiculaire
à leurs plans, il faut que le rayon de
celle de deffus foit plus petit que celui de l’autre da
la quantité dont le bord de la grande platine éft
diftant du point où la perpendiculaire abaiffée du
point L rencontre cette platine ; mais comme il eft
avantageux que la platine de deffus foit la plus grande
qu’il eft poflîble, 8c que du, côté D du pendant à
caufe de la forme de la boîte elle peut s’avancer
jufqu’en D perpendiculairement au-deffus du point
C y on lui donne une grandeur 8c une fituation telle
que d’un côté fon bord foit à plomb du point C , 8c
que de l’autre il fe trouve, comme nous l’avons dit,
dans la circonférence du cercle décrit de l’ouverture
de compas C E , & du point C : par cette fituation
de la platine de deffus on voit bien que fon centre
ne fe trouve plus dans le point où l’axe de l’autre platine
la rencontre, 8c qu’il en eft éloigné d’une Certaine
diftance : or c’eft le double de cette diftance
que l’on appelle, comme nous l’avons dit, l'embif-
tage.
Pour déterminer la grandeur de la platine de deffus
, celle de l’autre platine étant donnée, de mêmé
que la hauteur des piliers, voici comme on s’y prend:
H R repréfentant cette hauteur, E B lu grande platine
, C le centre de mouvement de la petite charnière,
& D L une ligne indéfinie fuppoîee la platine
de deffus ; du point C comme centre, & du rayon
CE diamètre delà grande platine, décrivez l’arc E L ;
& du même point C , élevez la perpendiculaire CDy
la ligne D L fera le diamètre de la platine de deffuSi,
Car fuppofant que toute la figure tourne autout
du point C» il eft clair que le bord dé la platine dé
deffus étant parvenu en Æ, ne furpaffera pas E B ou
E C diamètre de la grande, puifque E C égal CL >
du côté D elle s’étendra autant qu’elle le pourra,
comme nous l’avons dit. Par cette opération on voit
que la pofition de cette platine, par rapport à celle
des piliers, eft aufti déterminée, puifqu’elle doit être
telle que fon bord du côté du pendant foit précifé-
ment à plomb de celui de cette platine. Si l’on fup-
pofe que les deux platines confervant leur fituation
refpe&ive, s’approchent l’une de l’autre jufqu’à